 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
Le Docteur Duhamel disséqua l’âme du poilu ! Dédié à Abel Djezar, infirmier et ancien para-commando, en souvenir d'une collaboration fructueuse ! Introduction En Belgique, le Dr Duwez, alias « Max Dauville », fut le médecin qui décrivit le mieux les souffrances du soldat au front. En France, ce fut sans aucun doute le Dr Georges Duhamel qui montra le plus de talent à décrire le martyrs des soldats. Il fut un véritable anatomiste de l’âme du poilu et cet article se veut un hommage à l’immense tendresse d’un médecin pour ses patients ! Il se compose de deux parties, une biographie mêlée de réflexions et un condensé de son ouvrage « Civilisation » qui, je l’espère, permettra au lecteur pressé, de découvrir le genre de témoignages que nous laissa ce grand humaniste. I) L’histoire du Dr
Duhamel Le docteur Duhamel est né à Paris le 30 juin 1884, septième de huit enfants. Pour la petite histoire, son père entreprit des études de médecine tardives et devint médecin à l’âge de 51 ans, soit deux ans avant que son fils ne rentrât en faculté. Très tôt Georges Duhamel montra une disposition passionnée pour la littérature. En 1908, il termine ses études de médecine et est engagé dans un laboratoire scientifique. Il partage dés lors son temps entre ses éprouvettes et ses œuvres littéraires (il est notamment chroniqueur au « Mercure de France » et rédigera avant la guerre, quatre volumes de critique, quatre recueils de vers, trois pièces de théâtre). Lors de la mobilisation il demande son incorporation et est nommé médecin aide-major de deuxième classe. Il exercera comme chirurgien dans une auto-chir (voir mon article sur le Dr Marcille, inventeur des auto-chir) et opérera 2.300 soldats. En contact journalier avec les blessés et doué d’une grande sensibilité, Georges Duhamel pénètre au fond des âmes des poilus pour en révéler l’immense richesse. En lisant sa littérature de guerre, le lecteur se retrouve immergé dans la mentalité du blessé de 14-18. On y découvre non pas le soldat mythique, image du héros devant l’ennemi, mais l’image beaucoup plus réaliste du soldat devant la souffrance d’un corps déformé par la guerre. Ses descriptions sont poignantes de sincérité et de vérité. On y découvre le plus souvent un soldat qui doit mener une lutte, non plus contre l’ennemi extérieur, mais contre le désespoir, la dépression, la douleur. Les issues à cette lutte sont diverses mais toujours le poilu finit par accepter son sort pour l’amour de son pays. Leur sacrifice nous émeut. Un sacrifice qui, remarquons le, fut librement consenti malgré les multiples contraintes imposées par la société en guerre. Les preuves en sont : les multiples témoignages recueillis par Georges Duhamel au pied des lits des ses opérés et rassemblés dans deux livres « Vies de martyrs » et « Civilisations ». Ces deux livres, n’ayons pas peur des mots, sont de véritables chefs d’œuvre qui traverseront les siècles. Ils permettent de partager intimement la vie des poilus rendue merveilleusement par les textes de Duhamel, des textes durs ou tendres, bourrés de sarcasmes ou d’ironie mais toujours gonflés d’une affectueuse pitié et d’une secrète admiration. Certains reprochèrent au Dr Duhamel d’être trop sensible mais Duhamel met en garde contre l’endurcissement du cœur par l’habitude. « Pour que cette guerre finisse un jour et finisse le moins mal
possible, il faut souffrir jusqu’à la fin ; il faut refuser de nous
laisser endurcir, de devenir indifférents, aveugles, sourds, il faut refuser de ne plus juger, de n’être pas des
témoins ». La douleur déchire les âmes des soldats blessés et permet d’apercevoir leurs contenus. C’est le grand mérite de Duhamel de s’être penchées sur elles et de les analyser longuement avec « son microscope », un regard lumineux de pitié et d’amour fraternel ! Après la guerre, Georges Duhamel se réjouira de la politique de Wilson voulant instaurer un nouvel ordre mondial. Il croit à l’avènement d’une nouvelle civilisation, la vraie, celle qui se trouve dans le cœur de l’homme et non dans les progrès techniques, « toute cette pacotille terrible ». Il renoncera totalement à ses occupations médicales et se consacrera entièrement à la littérature. La guerre l’avait convaincu qu’il n’y avait pour l’homme qu’une seule issue : la recherche du bonheur et que celui-ci ne pouvait provenir que de la « possession », non pas la possession de biens matériels, mais la possession de la connaissance des hommes, de la nature, des arts. Duhamel explique longuement sa conviction dans un ouvrage paru en 1919 et intitulé « La Possession du monde ». Ce livre de réflexions est certainement encore d’actualité en 2013 où l’on enseigne de plus en plus à « vivre l’instant présent » et à entrer dans une ère de « décroissance » au profil d’une nouvelle civilisation plus centrée sur la véritable vocation de l’homme, celle d’être heureux et de rendre les autres heureux tout en respectant notre environnement. En 1928, Duhamel fit un voyage en URSS et il en rapporta un livre d’impressions qui provoqua un remous d’opinions. Duhamel voyait les erreurs du régime communiste tout en gardant une certaine confiance en cette tentative de l’homme pour se libérer du machinisme. A l’automne 28, il se rendra pour une grande tournée aux Etats-Unis. Il en retirera des impressions très négatives et pessimistes sur une civilisation basée sur la technicité, le rendement et la compétition à outrance. Son livre « Scènes de la vie future » obtiendra un prix de l’Académie française. La vie est chose divine qui nous est donnée qu’une seule fois. Duhamel a exalté cette vie terrestre en s’attachant à la figure humaine, l’objet le plus précieux, le plus mystérieux qui soit ici-bas. Tout ton savoir de pauvre homme Tous ces petits bruits, tous ces
menus mots Qui sont toute ta personne, Tout cela, vraiment, n’est-il
rien du tout ? Toutes ces douleurs misérables, Toutes ces joies faites de peu, Tous ces longs moments qui sont
la vie même, Tout cela peut-il m’être indifférent ? Georges Duhamel fut élu à l’académie française en 1935. Il décéda le 13 avril 1966. Ce grand écrivain, qui disséqua si bien l’âme humaine était un humaniste pessimiste qui voyait dans la course à la possession matérielle que ce soit au niveau individuel ou collectif la source de tous les maux de l’humanité. Le diagnostic du Dr Duhamel porté sur notre monde me laisse songeur. Peut-être est-il encore temps, cent ans plus tard, d’en tenir compte davantage … Et pour vous donner un avant-goût à la lecture de George Duhamel mais aussi pour rendre hommage aux poilus cités par l’écrivain, j’ai résumé pour vous son livre « Civilisations ». Suivons le docteur Duhamel dans son tour de salle. Les phrases retranscrites telles quelles du livre de George Duhamel sont mises en italique. Dr Loodts P. 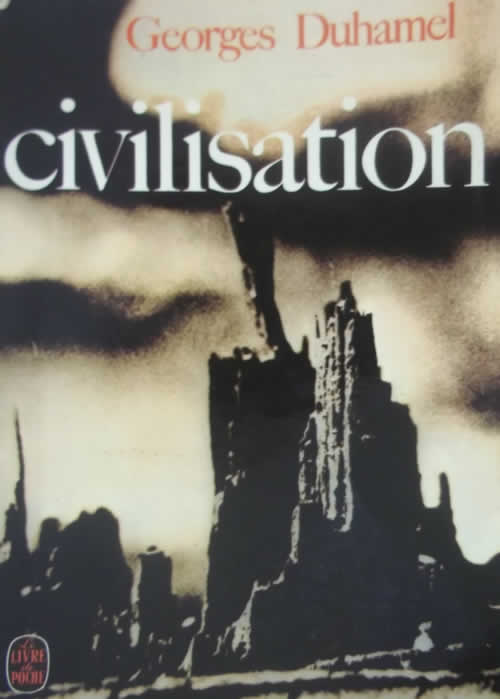
Couverture de livre du Dr Georges Duhamel 2) Condensé du livre du
Dr Duhamel « Civilisations » La chambre de Revaud Dans la chambre de Revaud tout d’abord ? Une chambre bien vivante où l’on ne s’ennuie pas ! Une pièce étroite de quatre lits. Il y avait Sandrap qui « faisait ses besoins par un trou sur le côté », il y a avait Remusot qui portait une grande plaie à la poitrine par où s’échappait bruit et air ; il y avait Mery paraplégique et enfin Revaud qui ne récupérait pas de son opération au genou et qui avait des problèmes urinaires. Les quatre blessés graves étaient gâtés par l’infirmière, madame Baugan, femme admirable de gentillesse et il régnait dans la chambre une ambiance bon enfant qui faisait l’admiration de tout l’hôpital. Un jour cependant on vint chercher Revaud dont la jambe ne guérissait pas. On lui coupa donc la jambe et il revint dans chambre amputé. Il se réveilla comme un enfant et dit : Vrai ! Ils m’ont fait
ramasser chaud avec c’te jambe. Revaud passa une nuit
suffisamment bonne et quand le lendemain, Madame Baugan
pénétra dans la chambre, il lui dit comme à l’ordinaire : Ben, madame Baugan !
J’ai assez bien dormi ! Il dit cela, puis il pencha la tête sur le côté, il ouvrit la bouche
peu à peu, et il mourut – sans faire
d’histoires. Madame Baugan s’écria : Mais il est mort… Elle l’embrassa sur le front et, tout de suite, elle
commença la toilette funèbre… Les agonisants de l’hôpital de
la cote 80 (Somme) Les agonisants de la cote 80. On avait disposé de tentes réservées pour les agonisants. Il y avait le lieutenant Gambier, homme simple et un peu frustre, qui par son mérite avait acquis ses galons d’officier. Le souffle de sa vie mit deux
jours à quitter ses membres glacés. Il me regardait avec des yeux
agrandis, pleins de souvenir et de tristesse et disait : Je ne veux rien ; mais j’ai
le cafard ! Oh ! J’ai le cafard ! Je fus presque content de le voir mourir ; son interminable agonie
était trop lucide. Il y avait le jeune Lalau blessé à la
moelle épinière et qui délirait à cause d’une réaction méningée. Ce soldat
avait un long éclat d’acier fiché dans son poignet droit. On tenta de le
retirer. Le blessé se plaignit seulement de soif. Et je compris comment l’excès même des douleurs procure parfois aux
victimes une trêve qui est en quelque sorte un avant-goût de l’anéantissement,
le prélude des délices de la mort. Il y avait Louba, dont le visage avait été rendu informe par un éclat d’obus. De celui-ci il ne restait qu’une immense plaie. Un jour pourtant Louba voulut nous témoigner
son contentement et il nous fit un sourire. Ils s’en souviendront, ceux qui ont
vu l’âme de Louba sourire sans visage. Freyssinet enfant de vingt ans connut un drôle d’hommage posthume.
Un personnage chamarré et important venu saluer les blessés graves lui adressa
un long discours à la gloire du héros alors même qu’il venait de rendre son dernier
souffle ! L’orateur ne s’aperçut
pas qu’il parlait çà un cadavre. Mais Freyssinet
était si modeste que son attitude de cadavre trahissait le respect et la
confusion ! Et puis comment ne pas se souvenir de l’aveugle Touche qui tenait à se débrouiller toujours tout seul sans se plaindre et qui disait au docteur qui le regardait manger : - Je fais mon possible, voyez-vous : je fouille dans l’assiette
jusqu’à ce que je ne sente plus rien. Et Camel si merveilleux de courage et de résignation qui apostrophait ses camarades blessés qui soudainement étaient pris de panique par le bruit d’un proche bombardement : - Allons, Allons, nous sommes tous des hommes n’est-ce pas ? Dans un hôpital de l’arrière : un intermède à une souffrance
indicible Loin du front, à l’arrière dans une chambrée de grands blessés, Réchoussat se réjouissait de la venue du cortège de Noël emmenant les Rois Mages et leurs cadeaux. Toute la journée il se demanda avec anxiété si on n’oubliera pas sa chambre. Vint enfin le grand moment. Les Rois Mages pénétrèrent dans sa chambre dans un tintamarre de clochettes et avec un vrai sapin de forêt balancé dans une caisse verte. Quelle joie pour le grand mutilé de boire en si belle compagnie un vrai pinard… Mais hélas, il fallût que le cortège s’ébranla à nouveau pour continuer sa tournée. Alors… Doucement, l’ombre rentra dans sa chambre et s’installa partout, comme
un animal familier dérangé dan ses habitudes. Avec elle une triste chose se
glissa partout, qui était l’odeur de la maladie de Réchoussat.
Un silence bourdonnant se déposa sur tous les objets, comme une poussière. Le
visage du blessé cessa de refléter la splendeur de l’arbre en fête ; il
baissa la tête, regarda le lit, les jambes maigres et ulcérées qui étaient ses
jambes, le vase de verre plein de liquide louche, la sonde, toutes ces choses incompréhensibles,
et il dit en bégayant d’étonnement : - Mais… mais quoi c’est qu’il y
a donc ? Quoi c’est qu’il y a donc ? La mort à retardement d’un
grand ami Dans la vallée de la Vesle, un
château a été transformé en hôpital pour officier. Là se trouve le lieutenant Dauche,
un homme doué d’une grande culture et d’une grande sensibilité, arraché
par la guerre de sa femme, de ses deux enfants et de sa prospère
manufacture ! Un léger pansement ceignait le front de cet homme aux traits
fins et doux. Le lieutenant avait reçut un projectile dans le crâne, on l’avait
opéré mais on n’avait pu extraire le fragment métallique enfoui trop
profondément. Les médecins ne lui avaient pas dit la vérité et le lieutenant
se croyait en voie de guérison alors
qu’il était condamné. Plus les jours passèrent et plus l’amitié entre le
narrateur et le lieutenant devint forte. Mais bientôt l’angoisse de voir
disparaître subitement un être proche
envahit le cœur de celui qui connaissait le terrible secret professionnel : Je dus à la guerre de connaitre une angoisse nouvelle et de vivre à côté
d’une créature dont je savais qu’en dépit de sa force et de sa beauté elle
demeurait sous le coup d’une épée d’une déchéance terrible et n’avait d’avenir
que ce qui en tient dans l’espoir et l’ignorance. Un jour en hiver au cours d’une
promenade que faisait ensemble les deux amis, arriva ce que Duhamel prévoyait,
le lieutenant s’effondra sur le sol, subitement éprouvé par une crise
d’épilepsie qui, après d’effroyables minutes, le plongea dans le coma. Le
lieutenant mourut deux jours après. Il paraît que Dauche fut enterré dans le petit
cimetière enclos de branches de bouleaux et de sapins morts que l’on aperçoit
au village de C… dans un aride champ de sable blanc. Je n’ai pu me résoudre à
l’aller visiter là. J’emportais avec moi une tombe plus profonde et moins
vaine. Je quittai le château de S… vers le milieu de décembre. J’étais affaibli
et diminué, recru de lassitude à l’idée qu’il me fallait poursuivre ma vie à
moi, me débattre encore pour ma vie et ma mort, à moi ! Mort sans avoir fini d’expliquer l’art d’être un antiquaire Cousin était antiquaire et le Dr
Duhamel aimait parler « objets d’art » à son patient amputé. Le moignon hélas ne voulut pas guérir et
commença à saigner. Jour après jour les saignements se renouvelaient et chaque
jour Cousin s’affaiblissait un peu plus. Un jour alors que Duhamel écoutait Cousin
parler, une tache rouge apparut de plus en plus grande sur le drap :
l’hémorragie devenait cataclysmique. On plaça un garrot puis on conduisit
l’amputé en salle d’opération. Avant l’anesthésie, Cousin eut encore le temps
de se confier à Duhamel : - On n’est jamais tranquille ! Ah ! Qu’est-ce que je vous disais
donc ? Oui, je vous parlais des styles. Ma force, voilà, c’est que je connais
les styles : le Louis XIV, l’Empire, le hollandais, le moderne, et puis
tout. Seulement c’est difficile, je vous expliquerai. - Endormez Cousin, dit doucement le
chirurgien. Cousin regarda le masque ainsi qu’une vielle connaissance, et il prit
encore le temps de me dire : - Je vous expliquerai ça quand ces messieurs auront fini avec moi, quand je
serai réveillé. - Puis sagement, il se mit à respirer l’éther. - Il y a maintenant plus d’un an de
cela. Je songe souvent, Cousin, à ces explications que tu ne m’as pas données,
que tu ne me donneras jamais. Seule la « dame en vert » fit rire le blessé Rabot Le soldat Rabot était gravement
blessé mais contrairement à beaucoup de ses camarades, rien ne pouvait lui
arraché un rire, un sourire. Duhamel avait pitié de ce jeune homme, ancien
enfant de l’Assistance publique qui sans doute n’avait jamais trouvé le moindre plaisir dans sa vie. Il ne fumait
pas, ne jouait pas et restait camouflé sous ses draps exactement comme un
cochon d’inde apeuré se cache sous la paille. Un jour une dame patronnesse tout
de vert vêtue vint lui faire un long discours. - Ah ! Rabot, dit la dame en vert, quelle reconnaissance ne vous
devons-nous pas, à vous autres qui gardez intacte notre douce France ?
Mais Rabot, tu connais déjà la plus grande récompense : la gloire !
L’angoisse exquise de bondir en avant, baïonnette luisant au soleil ; la
volupté de plonger un fer vengeur dans le flanc sanglant de l’ennemi, et puis
la souffrance, divine d’être endurée pour tous ; la blessure sainte qui,
du héros fait un Dieu ! Ah les beaux souvenirs, Rabot ! La dame en vert se tut et un silence religieux régna dans la salle. C’est
alors que se produisit un phénomène imprévu : Rabot cessa de ressembler à
lui-même. Tous ses traits se crispèrent, se bouleversèrent d’une façon presque
tragique. Un bruit enroué sortit, par secousses, de sa poitrine squelettique et
tout le monde du reconnaître que Rabot riait. Il rit pendant trois-quarts
d’heure ! Par la suite, il eut quelque chose de changer dans la vie de Rabot. Quand
il était sur le point de pleurer et de souffrir, on pouvait encore le tirer
d’affaire et lui extorquer un petit rire en disant à temps : - Rabot ! On va faire venir la dame en vert ! Ne pas mourir pour consoler sa mère : le courage incroyable d’un
amputé des deux bras C’était pendant l’été 1916 quelque
part sur la Marne près de Chavenay une vieille dame
en train de soigner ses vignes. Duhamel en promenade la rencontre et une
conversation s’engage. Elle a perdu à la guerre deux garçons et le troisième a
été amputé des deux bras. - Il a été blessé comme il y en a pas beaucoup qui sont blessés. Il a perdu
les deux bras et il a dans la cuisse un trou qu’il y rentrerait un bol qui
tient deux sous de lait. Et il a été pendant dix jours comme un homme qui va
mourir. Et je suis été le voir, et je lui disais bien : « Clovis, tu
veux pourtant pas me laisser « seule » ? Car il faut que je vous
dise qu’il y a longtemps qu’ils avaient plus de père. Et il me répondait
toujours : - Ca ira mieux demain ! Car il faut vous dire qu’il n’y a pas plus doux que ce garçon-là » L’examen des recrues : pour le vieux médecin, trop de maladies = pas
de maladies ! - Vous n’avez pas que cela. Vous
toussez ? - oui - Vous avez sans doute des
palpitations ? - Oui beaucoup. Et puis des douleurs
articulaires ? - Oui surtout des douleurs
articulaires. - Vous ne digérez pas bien ? - Non jamais je ne digère bien. L’homme semble tout-à-fait rassuré. Il répond avec une sorte d’enthousiasme
comme quelqu’un qui est enfin compris. Soudain le vieux médecin lève les
épaules et dévoile le piège : - Vous avez tout évidemment. Eh bien vous serez versé dans le service armé. L’homme chancelle légèrement et gémit d’une voix sans timbre : - Vous savez pourtant bien… - Vous avez trop de maladies ; eh bien, vous n’avez rien du tout !
Allez-vous-en ! Service Armé ! L’instinct génésique du soldat Ponceau Il fallait voir à l’hôpital de
Saint-Mandé le soldat Ponceau. Il avait été blessé à Château-Thierry. Un éclat
d’obus lui avait cassé la cuisse et il souffrait beaucoup. Chaque matin on
l’emmenait sur un brancard dans la salle des pansements pour soigner la plaie
profonde et verdâtre avec l’os cassé au fond. Malgré les soins journaliers,
Ponceau maigrissait avec rapidité et des crises de crampes à sa cuisse le
torturaient de plus en plus au point que les médecins décidèrent de le soulager
par des injections de morphine. Ponceau
entre deux crises rêvassaient et parfois on l’entendait murmurer :
« Si seulement elle était ici… » Il faut savoir que Ponceau venait de
se marier quand la guerre se déclara. Il avait laissé sa femme à la Ferté-Milon dans l’Aisne et malgré les multiples lettres
envoyées à de nombreux endroits, il restait sans nouvelles de celle-ci. Heureusement
un miracle vint mettre fin à l’attente de Ponceau. Un beau jour, Madame Ponceau
arriva à l’hôpital. Réfugiée en Bretagne, une lettre de son mari avait pu,
après moult pérégrinations, lui être remise. Les retrouvailles furent
évidemment des plus émouvantes et madame Ponceau fut autorisée à venir rendre
visite chaque jour à son mari vu son état considéré comme très grave par les
médecins. Peu à peu les douleurs devinrent plus tolérables et la suppuration de
la plaie diminua. Le Commandant de l’hôpital décida, vu les améliorations de
l’état de santé de Ponceau, de réduire au nombre de deux les visites de Madame
Ponceau. Cette décision fut jugée si injuste que le chirurgien Coupé, le
médecin de Ponceau, obtint de muter le blessé dans l’hôpital complémentaire n°
35 installé dans un ancien hôtel rue des Petites-Ecuries. Dans cet hôpital qui
vivait des subsides accordés par une foule de dames riches qui y remplissaient
aussi les fonctions d’infirmières, le docteur Coupé y était un véritable roi !
Ponceau put alors à nouveau recevoir chaque jour les visites de sa femme. Il se
décida là à montrer sa vilaine jambe à sa femme qui, contrairement à ses
craintes, n’eut pas de réactions de dégoût. Partout dans l’hôpital on jasait
sur l’avenir ce petit couple. Le jour vint où Ponceau fit ses premiers pas à
l’aide de béquilles dans un couloir. L’évènement fut jugé assez extraordinaire
pour réunir tout le staff infirmier qui s’extasiait devant les efforts de
Ponceau pour traîner sa malheureuse jambe. Quelques jours plus tard, Ponceau
suscita dans le local des infirmières un autre émoi : il avait été demandé
par Ponceau l’autorisation de sortir de l’hôpital pour voir… sa femme en
particulier. Les infirmières commentaient à qui mieux-mieux la faveur
demandée : - Quoi avec sa jambe !
s’exclama doucement madame Seigneuret. - Mon Dieu, oui ! Avec sa
jambe ! Il ne peut pourtant pas la laisser ici sa jambe. » A ce moment, la bonne Mme Prosteanu s’approchait en compagnie d’une forte personne,
encore agréable, qui s’appelait Mme Lestourneau. En deux mots ces dames – furent au courant. - Ce pauvre garçon, ajoutait Mme Potocka, m’a expliqué
que, depuis six mois, enfin vous comprenez… depuis six mois…. - Six mois c’est long, dit
franchement Mme Lestourneau dans un soupir. Madame Prosteanu
semblait rêver ; elle murmura seulement avec un accent roumain : - Six mois ! a son âge !
Et il a tant souffert ! - Oh à coup sûr, il le mérite bien
déclara la directrice. - Mais enfin, avec sa jambe !
Pensez ! Avec sa jambe, s’obstinait Mme Seigneuret.
- Allons, trancha Mme Potocka, ce n’est pas parce
qu’il a la jambe déformée qu’il doit se priver d’embrasser sa femme… En quelques heures « l’affaire
Ponceau » fit le tour de l’établissement et un beau jour madame la
directrice demanda l’avis du bon docteur Coupé. - …il voudrait avoir une permission pour avoir avec sa femme quelques
moments d’intimité. - A la bonne heure chère madame ! Dix fois s’il le veut ! Ces
gaillards là doivent encore quelque chose au pays ! Sacré mâtin ! ils
lui doivent des enfants ! - Des enfants ! Vous croyez quand même qu’avec sa jambe ? - Bah ! chère madame, la jambe n’ y est pour rien, ou pour si peu de
choses… La phrase du bon docteur fit
évidemment fortune au sein de l’hôpital en réglant définitivement
« l’affaire Ponceau ». Le lendemain Ponceau se vit remettre une
grande bouteille d’eau de Cologne et le coiffeur vint pour une coupe spéciale.
Ensuite Ponceau se revêtit d’un magnifique uniforme reconstitué avec des pièces
choisies dans les rayons les plus riches du magasin de l’hôpital. Pendant ce
temps les conversations continuaient bon train dans la salle des pansements où
le docteur Guyard donnait des explications
complémentaires aux infirmières : - L’instinct génésique, mesdames, est le plus souvent assoupi pendant la
période fébrile, car, chez nos blessés, ce n’est point comme chez les
tuberculeux, qui paraissent, jusqu’à la troisième période, dominés par le désir
de reproduction. Dans le cas qui nous occupe, le retour progressif des forces
et de l’appétit, s’accompagne d’une certaine aptitude à procréer… Enfin prêt, Madame Prosteanu lui attacha subrepticement un petit bouquet de
fleurs sur sa capote en disant : - Vous aurez l’air d’un marié Et Ponceau sortit de l’hôpital et
monta dans la voiture où l’attendait sa femme.
Quand il revint au terme de sa permission, les escaliers furent le lieu
d’une légère bousculade. Ponceau apparut, béquillant sans adresse, au milieu
des blouses neigeuses. Il fumait un gros cigare. Il avait le teint avisé par la
fraîcheur du dehors. Ses yeux reflétaient
une grande bonté, un grand bonheur et un perpétuel «étonnement. - Etes-vous content de votre permission, Ponceau demanda discrètement Mme Potocka. - Bien sûr, madame la directrice ! Le cauchemar comptable d’un commandant d’hôpital Après une arrivée de blessés à
l’hôpital, le décompte après les soins devait mentionner sept décès or il s’en trouva un de plus. Un
cadavre à la morgue restait tout-à-fait anonyme et personne ne savait dans
quelle salle il avait décédé. Cela posa un gros problème au commandant de
l’hôpital qui s’adressa de cette façon au brancardier qui en était
responsable : - Sept ! Sept seulement ! Vous ne devez avoir que sept cadavres.
Vous êtes un cochon ! Qui est-ce qui vous l’a donné ce mort là ? Je
n’en veux pas. Il n’est pas sur mon compte. D’où vient-il seulement ce
mort-là ? Avec son brancardier, le docteur
Poisson enquêta de baraque en baraque demandant : - Est-ce que c’est vous qui nous envoyez des morts sans papiers ? Evidemment les paroles du Dr Poisson
prêtaient plutôt à la moquerie. Les subalternes en bien riaient en-dessous
ou bien prenaient peur mais tous répondirent - Un mort sans identité ? Oh ! Monsieur le médecin-chef, ce
n’est pas sûrement de chez nous. Rentrés bredouille dans son bureau, le médecin-chef n’en revenait toujours pas ! - Voilà ! Il en est rentré 1.236. Il en est sorti 561.
Comprenez-vous ? A cette heure, il en reste ici 674. Celui-là qui est en
trop ! Et on ne sait pas ce qu’il est ! Nous sommes frais, nous
sommes frais ! La nuit tombait et le problème n’était toujours pas résolu quand tout-à-coup, le brancardier de la morgue reçut à nouveau la visite du médecin-chef qui semblait calme et avait quelques renvois comme un homme qui venait de bien dîner. -
Vous êtes
un couillon, vous n’avez pas vu que ce corps-là c’est celui du cuirassier Cuvelier (…) -
Bien
sûr ! Il est assez grand pour être cuirassier, Voyez-vous, Perrin, le
cuirassier Cuvelier est entré dans l’ambulance
avant-hier. D’après les registres, il n’est pas sorti. Or il n’est plus en
traitement, donc il est mort et c’est lui qui est là. C’est clair ! (…) -
Vous le
mettrez en bière, et vous collerez sur le couvercle : « Cuvelier Edouard 9ème Cuirassier. Et puis, vous
savez, plus de machines comme ça ! L’histoire ne se termina pas aussi bien pour le médecin-chef qui le lendemain pris de remord s’en alla crier dans les salles : Avez-vous ici le cuirassier Cuvelier ? A la fin de sa tournée, dans le pavillon des « évacuables », en réponse à sa question, un homme sortit de son lit en s’écriant : -
Si ! Cuvelier
présent ! Le docteur Poisson sortit comme un fou et fila à la morgue et se plantant devant la bière eut cette amère remarque : - Si ce n’est pas Cuvelier, tout est à recommencer ! Et durant toutes les heures suivantes il alla se pencher sur la bière pour contempler avec fixité le cadavre inconnu. A près plusieurs visites, vers six heures du soir le Dr Poisson reparut une dernière fois à la morgue mais cette fois complètement déstressé avec la barbe soignée et l’haleine d’un homme qui venait de se rincer le bec au vieux marc. -
Eh bien
quoi ? Vous n’avez-pas encore fait clouer la bière de l’Allemand ?
C’est donc que vous êtes un jean-fesse ? -
Mais
monsieur le médecin-chef… -
Taisez-vous !
Et faites vite une plaque : « sujet allemand. Inconnu. Compris » Quand le médecin-chef enfin content de lui quitta la morgue, il se retourna et conclut : -
Après-tout,
sortez-le donc de la bière ; puisque c’est un Allemand, on l’enterrera
sans cercueil, comme d’habitude L’autoclave monstrueuse de l’auto-chir Le paragraphe qui suit est le dernier du livre «Civilisation », il explique le titre donné à son recueil et fait office de conclusion. La civilisation, la vraie, j’y pense souvent. C’est dans mon esprit,
comme un chœur de voix harmonieuse chantant un hymne, c’est une statue de
marbre sur une colline desséchée, c’est un homme qui dirait :
« Aimez-vous les uns les autres ! » ou : « Rendez le
bien pour le mal ! » Mais il y a près de deux mille ans qu’on ne fait
plus que répéter ces choses-là, et les princes des prêtres ont bien trop
d’intérêts dans le siècle pour concevoir d’autres choses semblables. On se
trompe sur le bonheur et sur le bien. Les âmes les plus généreuses se trompent
aussi, parce que le silence et la solitude leur sont souvent refusés. J’ai bien
regardé l’autoclave monstrueux sur son trône. Je vous le dis, en vérité, la
civilisation n’est pas dans cet objet, pas plus que dans les pinces brillantes
dont se servait le chirurgien. La civilisation n’est pas dans toute cette
pacotille terrible ; et, si elle n’est pas dans le cœur de l’homme, eh
bien, elle n’est nulle part. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©




