 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Le brancardier Jean
Agache[1] Le brancardier en campagne ! Celui-là, toute la Belgique combattante l'a connu et l'a aimé. Quel bienfaiteur, avec son chef le médecin de bataillon, a soulagé plus de souffrances, apaisé plus d'angoisses et sauvé davantage de vies humaines ? Lui-même, plongé au cœur de la tourmente, à peine abrité sous quelques tôles ondulées, sous quelques centimètres de terre, n'était qu'une chair à canon comme la pauvre chair à canon qui convergeait, sanglante et pantelante vers le poste de secours. Ce « non combattant » connaissait toutes les angoisses et tous les dangers du combat, et pourtant la noblesse de son rôle exigeait qu'il s'oubliât lui-même pour rester un praticien impassible, maître de son cerveau, de ses nerfs, de ses mains. Le brancardier Jean Agache de Templeuve fut de ceux-là, du 2 août 1914 aux premiers jours de la victoire décisive de septembre 1918. Il était élève au Grand Séminaire de Tournai, lorsque l'ordre de mobilisation vint licencier professeurs et étudiants. A ce propos Jean Agache écrit dans son carnet de route : « C'est le samedi 1er août que le Grand Séminaire est licencié. A 10 heures 30, on sonne. Qu'ya-t-il ? Tout le monde descend au musée. M. le Président, le Chanoine Stenier, nous annonce que « vu les circonstances difficiles nous sommes renvoyés chez nous ». Aussitôt débandade générale. On s'informe des heures des trains qui restent à la disposition des civils et l'on part après avoir fait rapidement ses malles. Dans les rues l'on ne voit que des chariots remplis de sacs de grain et des autos conduites par des carabiniers. Sur la grand’ place une cinquantaine d'autos réquisitionnées. En train, je voyage avec des fermiers de Templeuve qui sont venus conduire leurs chevaux à Tournai et qui s'en retournent avec la bride et un bon de réquisition. Froyennes... Blandain ... Templeuve ... La Maison !... Personne au grillage. On est surpris de me voir. J'embrasse mère puis Petit. Emilie arrive alors et me conduit à père qui, indisposé, garde la chambre. On cause de la guerre. Chaque fois que l'on sonne je crois que c'est le camarade William Mittschke qui vient m'annoncer que nous devons rejoindre dans les vingt-quatre heures. Je suis rempli d'inquiétude et je fais tout ce que je puis pour rassurer les autres. Ah ! que ces heures d'incertitude m'ont parues longues ! Vers le soir, tante Madeleine et oncle Camille arrivent à pied de Roubaix et parlent des préparatifs qui se font là-bas au delà de la frontière. Je n'y tiens plus alors et je décide de partir au dernier train. Père et mère approuvent ma décision. Quelques instants plus tard, j'apprends que le billet collectif de rappel vient d'arriver. Le dimanche 2 août, en gare de Tournai, embarquement pour Anvers. A 11 heures nous faisions notre entrée à l'hôpital militaire de cette ville. Nous y trouvons Henri et Paul Cambier partis avant nous et qui avaient passé leur temps à s'ennuyer. Il y avait là dans la cour de l'hôpital toute la foule des futurs brancardiers : On y voyait des instituteurs, des frères, des religieux et des séminaristes de tous les diocèses. Il y avait des jeunes gens comme nous et aussi des vieux professeurs de collège et des instituteurs mariés et pères de famille. Nous avions naturellement tous nos habits civils et nous avions si peu pensé à nous équiper pour la guerre que certains prêtres étaient venus en mantelet et certains laïcs en chapeau boule. On passait son temps à se promener et à causer, certains jouaient aux cartes sur l'herbe, la plupart s'ennuyaient terriblement et, tous, nous nous demandions ce qu’on allait faire de nous. 
Les aumôniers belges Enfin petit à petit le triage se fit et, en fin de journée, Agache reçut sa destination. « A 10 h. 30 du soir, écrit-il, nous arrivons en gare de Mons. Notre petite troupe sort de la gare, se met en rangs et se dirige en chantant vers la grand' place. Les montois sont tout ébahis de voir cette bande de curés, de petits frères et des laïcs traverser la grand' place à 1l heures du soir, au pas et en chantant. Après vingt minutes de marche notre élan diminue. Nous traversons de petites rues où les becs de gaz se font rares et puis nous sommes si fatigués. Arrivés à la caserne des chasseurs à cheval nous devons rebrousser chemin : pas de place pour nous. On nous conduit dans un hôpital près de la gare ; pas encore de place. Enfin, après bien des hésitations, on nous permet de tirer notre plan. Le lendemain à 9 h, 30 c'est le départ en train pour Bruxelles et, de là, pour Termonde. Heureusement les Allemands ne nous ont pas arrêtés en route et nous avons pu arriver à Termonde sans encombre. Là, plusieurs stations : une caserne, un collège et enfin Grimbergen point d'attache des ambulanciers de la 5e division. En arrivant sur la place du village nous trouvons nos voitures d'ambulance, nos docteurs et notre chef, le commandant Bastin. Nous apprenons alors que nous formons la 3e Compagnie des transports de la 5e Division. Sans tarder le secrétaire communal distribue les billets de logement et nous allons à six nous installer chez Madame My. II y avait Alphonse Nimal, Henri Lesceux, Winant Daubin, Arille Delangre, William Mitschke et moi. Au premier abord, on nous reçut avec beaucoup de défiance et de froideur. Nous avions tous un grand défaut, celui d'être wallons. Daubin se montra à la hauteur s'étant rappelé qu'avant la guerre il était professeur de flamand. II s'en tira si bien que peu à peu nous avions gagné nos gens. Après une chaude alerte en pleine nuit, on se met en route pour Termonde. Là, au déjeuner, la colonne d'ambulance fait connaissance du « petit gris » et du « plata ». A 8 heures on s'embarque pour Perwez : un coup de sifflet, on part... En route le train dut s'arrêter plusieurs fois pour donner libre cours à l'enthousiasme des civils qui apportaient aux soldats de la bière, du lait, du vin et toutes sortes de bonnes choses. Certains bourgeois poussent même la générosité jusqu'à offrir du champagne. On ne saurait d'écrire l'animation et l'empressement de toute cette foule. Notre trajet de Termonde à Perwez, par Gembloux, ne fut qu'une longue ovation. Notre train était salué par tous : les femmes, les enfants, les travailleurs des champs, tout le monde criait : Vive la Belgique ! Les petits drapeaux belges apparaissaient à toutes les fenêtres. Aux approches des gares, des soldats sonnaient du clairon par les portières et les autres criaient : « Vive la Belgique. » Perwez tout le monde descend ! Notre cantonnement est à Thorembais. Le jeudi 6 août, le commandant Bastin décide d'organiser la colonne d'ambulance. Nous sommes quatre cents. Il ordonne de former des escouades de vingt brancardiers avec un chef chacune. Je suis affecté à la 16e escouade avec Henri Lesceux comme brigadier. En font également partie : Mitschke, W. – Nimal, A. – Daubin, V. – Delangre, A. – Nacquart, L. – Poliane, M. – Vangermé. – Gilman t, I. – Dujacquier P. – Guissard, I. – Schadeck, G. – Verday, H. – Gilson. – Rechy, D. – Albert. – Verfaille. – Van Canneyt. – Van der Noort, tous séminaristes et prêtres sauf les cinq derniers qui sont de futurs missionnaires du Sacré-Cœur. Le même jour vers 7 heures du soir, on quitte Thorembais pour Lathuy en chantant : Nous étions quat’ cents brancardiers Logés à Perwez Le lendemain on nous parqua En vingt petits tas Chaqu' brigade eut son
brigadier Choisi le dernier Et c'est ainsi que prit naissance Zim boum ! Tra, la, la, la Notre colonne d'ambulance. Z'étions à peine
organises Près de Thorembais Quand l'en'mi s'annonce au galop, Quel mêli-mèlo ! Vous auriez Vu tous ces froussards Chercher leur brassard Ce tut ainsi que prit naissance Zim boum ! T ra, la, la,
la. Notre colonne
d'ambulance. Après Lathuy,
Pietrebais et La Bruyère où l'on bivouaque tour à
tour dans la boue des terrains labourés, à l'orée des bois ou au milieu des
prairies. On gagne, le 14 août, Willebringen en fredonnant cet autre couplet : De bon cœur on se passa d'lit Au camp de Lathuy Sur les pavés on roupillait A Piétrebais. On se contenta d'une clairière Près de la Bruyère. On n'a vraiment pas beaucoup d' chance A la colonne
d'Ambulance. A Willebringen,
le docteur Bastin est remplacé par le major Lebrun.
Ordre est donné de numéroter les brancards. Celui de Jean Agache porte le n°
302. Le 15 août, la colonne
d'ambulance est à Tourinnes-la-Grosse où elle passe
une excellente nuit. Le 16, elle loge à Beauchevain «
dans une grange de ferme très sale et habitée par d'innombrables troupeaux de souris
». De là, elle retourne à Tourinnes pour y camper, les
17 et 18, dans une prairie basse et humide au pied de la colline sur laquelle
est bâti le village. Quand, note Jean Agache,
je suis rentré au Camp, de la source où j'étais allé remplir les bouteilles et
les flacons d'eau limpide, on y parlait d'une distribution de gourdes. Nous
nous approchons aussitôt William et moi des voitures et nous parvenons à en
recevoir une. Nous étions tout fiers et, ce jour-là, je gardai ma gourde même
pour jouer aux cartes. Le mardi 18 août commence
la retraite du Brabant. La colonne d'ambulance loge successivement à
Weert-Saint-Georges, Saventhem et Machelen. Partout
l'accueil de la population est des plus chaleureux. On traverse Vilvorde,
longuement ovationné et on passe la nuit à Eppeghem.
A Humbeek, Londerzeel et Ramdonck,
nouvelles générosités des habitants. Aux abords du fort de Puers
on construit fiévreusement des réseaux de fils de fer barbelés. Cela m'étonne
très fort, écrit Jean Agache, de retrouver au xxème
siècle les vieux procédés d'antan. Je me rappelle avoir lu dans « de Bello »
tous les trucs de guerre : tonneaux placés en terre et lignes de petits fossés
cachant des éperons de bois destinés à prévenir les attaques d'infanterie. Je
n'aurais jamais cru que tout cela se reverrait dans une guerre moderne. Puis c'est Bornhem où les brancardiers passent quelques excellentes
journées. « Nous étions là tout une petite bande au « Bierhuis
». Rodolphe Lerrain tenait le piano et il le faisait
très bien. P. Nihoul nous a chanté : « Pendant que
les heureux, les riches et les gueux. » Après La « berceuse aux étoiles », tout
notre répertoire y a passé. Nous avons chanté du Botrel à profusion. Lenain était loin de penser alors que quelques mois plus
tard il serait tué au combat de l'Yser. Il devait partir avec les premiers
brancardiers régimentaires et mourir loin de chez lui. Nous étions alors le 21
août. » Le 25 août, la colonne
d'ambulance quitte Bornhem et, après avoir cantonné à
Thiesselt, elle arrive le lendemain à Eppeghem où a lieu la première distribution de musettes de
pansement. Au loin le canon tonne. Les chasseurs sont aux prises avec l'ennemi.
L'accrochage s'est fait à l'aube d'un clair matin. Les compagnies se sont
détachées de la colonne en formation de combat et elles sont montées à l'assaut
de mitrailleuses invisibles. Voici les premiers blessés couchés dans les champs
de blé, dont les gerbes ont été liées à la dernière moisson pacifique de
juillet. Les médecins de bataillon ont installé leur poste de secours où ils
ont pu, derrière une haie, contre une meule de paille, et ils entrent en action
sur le champ de bataille même. C'est cet instant qui décidera de leur autorité
sur les hommes et de leur confiance en eux. Les brancardiers vont où ils ont vu
des hommes tomber, où des cris les appellent. Les sacs d'infirmiers sont là ; à
terre, ouverts, et ce sont des pansements hâtifs, répétés pendant des heures.
Un poste de recueil des blessés a été installé au couvent des Sœurs à Laer. Les brancardiers Nimal, Mitschke et Agache sont chargés de conduire un groupe de
blessés à la gare de Malines. « La ville, écrit ce dernier, n'est pas aussi
endommagée qu'on nous l'avait dit. La tour de Saint-Rombaut
est presque intacte et les maisons de la grand’ place, à part une ou deux, sont
encore entières. Nous traversons la ville et nous arrivons à la gare d'évacuation.
Il y a là une quantité de charrettes de tous modèles que l'on a réquisitionnées
pour le transport des blessés. Ceux qui se trouvent couchés sur de la paille dans
ces charrettes sont bien plus mal arrangés que les nôtres. On ne sait les transporter
sans avoir soi-même les mains toutes couvertes de sang. Nous aidons au transport
de ces malheureux sur les trains sanitaires. Tout un personnel de brancardiers
et d'infirmiers coopèrent activement à ces évacuations. Nous y rencontrons quelques
connaissances du séminaire : Pollet, Morbeu, Delepine et Leblanc. » Mais pendant ce temps-là
la colonne d'ambulance est partie sans laisser d'adresse et nos vaillants
brancardiers, après avoir dépassé Thiesselt sont
obligés à la nuit tombante de frapper à la porte du presbytère de Willebroeck. « Nous convenons, raconte Agache, d'aller demander
l'hospitalité à Monsieur le Curé qui nous fait le meilleur accueil. On nous
offre à souper... de bons restes. Le Révérend Père Hénusse
venait de quitter la table et M. le Curé avait tenu à bien le recevoir. On causa
de la journée et le Père Henusse remonta un peu notre
moral en nous expliquant la journée d'Eppeghem. Il
nous apprit que l'on n'avait nullement l'intention de reconquérir du pays mais
simplement de faire une sortie de l'enceinte fortifiée d'Anvers afin d'attirer des
troupes ennemies sur notre front et ainsi de coopérer à la réussite de la
bataille de la Marne. » Le samedi 29 août, la
colonne d'ambulance quitte Bornhem. Par Puers, Calfort-Ruysbroeck et
Niel, elle fait route jusqu’à Schelle où les brancardiers logent deux jours sur
d'excellents matelas. La dernière nuit, alerte ! On crie que les Allemands sont
là. La vérité est tout autre. Ce sont des soldats belges qui ont déchargé leurs
fusils sur le Zeppelin qui était allé jeter des bombes sur Anvers. Le 3 septembre arrivent
enfin les premiers vêtements militaires et on troque la soutane ou la jaquette
contre la tenue du troupier. Mais ceux-ci sont tellement disparates et usagés
que les brancardiers décident de se rendre au dépôt de Contich. Mais là il n'y
a que 250 tenues pour 400 brancardiers. Et Agache écrit : « Les gens du dépôt
sont très complaisants. Nous avons échangé nos vieux costumes contre des neufs.
William et moi nous sommes habillés complètement en lignards. Mais comme
notre division comprend deux régiments de chasseurs et un de ligne, il y a à la
colonne d’ambulance deux sections : Une de lignards et une mixte composée de
chasseurs et de lignards. » Et le lendemain, la
chanson de route des brancardiers de la 5e Division comprenait un
couplet de plus : Parlerons-nous de L'équipement De tous ces braves gens; Il s'rait impossible à décrire! Le mieux,· c'est d'en rire ! On s'ra prév'nu une autre fois, Ah ! bien
oui! j'te crois! ! On étale toutes
les élégances Zim boum, tra, la.la, la A la colonne
d'ambulance. La colonne d'ambulance est
toujours à Schelle lorsque le 4 septembre, en pleine nuit, elle reçoit l'ordre
de se porter sur Willebroeck où les brancardiers
passent la nuit couchés sur les pavés de la grand’ place. Le lendemain vers 7
heures du matin, ces derniers sont dirigés vers le fort de Liezele
et la redoute de Letterheyde où de furieuses attaques
allemandes ont été brisées. Le brancardier Agache note
dans son journal de campagne à la date du 5 septembre : « Un sergent qui
commandait la tranchée nous parla de l'attaque et nous raconta comment il avait
arrêté par des feux de salve, une troupe d'Allemands qui s'était avancée
jusqu'aux fils de fer barbelés. Au cours de la visite que nous avons faite,
nous avons vu l'officier qui commandait cette troupe. C'était la première fois
que nous parcourrions un « Champ de bataille ». Nous étions là, émus, près de
l'officier allemand avec la grande envie de prendre un petit souvenir et
n'osant pas le toucher. Nous ressentions pour lui le respect qu'on a,
naturellement des morts. Nous avons commencé par regarder sa médaille. C'était
un lieutenant. Enhardis nous avons pris chacun un bouton et un morceau de drap
de sa veste. Un sergent est alors arrivé et l'a complètement visité. Il lui a
enlevé ses gants et sa chevalière. Pas d'alliance : il n'était donc pas marié.
Nous l'avons regardé une dernière fois, le plaignant quoiqu'il fût notre
ennemi. Mourir si loin de son pays et être là à l'abandon, étendu sur le sol.
Personne pour pleurer sa mort, personne pour prier spécialement pour lui. » Après avoir évacué les
blessés belges et allemands à la gare de Sauvage, nos brancardiers cantonnent à
Niel jusqu'au 10 septembre. Les jours suivants ils sont successivement à Boom, Blaesveld et Sempst où ils croisent
le 3e Chasseurs partant au combat. Après avoir occupé Laere et Scheele, ils retournent à Niel jusqu'au 25
septembre date à laquelle ils logent à Rupelmonde. Le
26, ils sont à Opdorp. Le lendemain, la colonne est
endeuillée par la capture de l'abbé Joseph Gilmant.
Voici comment Agache relate la perte du cher camarade : « C'est le dimanche 27
septembre que fut blessé Joseph Gilmant. Comme je lui
étais attaché par des liens de bonne camaraderie, je me fais un devoir de raconter
cet accident dans tous les détails. Une ambulance s'était détachée de la
colonne pour aller en avant chercher des blessés et, comme il fallait des
brancardiers, le docteur avait pris les deux premiers qui lui étaient tombés
sous la main : C'était Edgard Durieux et notre Joseph. La voiture était partie
sous la conduite du brigadier. Je ne sais pas comment cela s'est fait mais il
n'y avait pas de docteur avec eux. Ils se portèrent en avant et rencontrèrent
le 1er de ligne qui se repliait. Voyant que la situation était
dangereuse, l'ambulance prit le premier chemin qu'elle rencontra sur sa droite
pour revenir ensuite en arrière. Elle roulait ainsi sur la route parallèle aux
deux fronts se croyant parfaitement protégée par ses grandes croix rouges. Mais
voilà que tout à coup à une cinquantaine de mètres sur son flanc gauche
apparaît une troupe allemande. Sans hésiter elle se dirige vers la voiture et
la crible de balles. Edgard Durieux qui se trouvait sur le siège avant n'est
heureusement pas touché. Joseph se trouvait à l'intérieur avec des blessés.
L'ambulance se voyant poursuivie partit au triple galop. Une balle atteignit alors
un des chevaux qui s'abattit forçant ainsi la voiture à s'arrêter. Voyant cela
les conducteurs prirent la fuite, sautant pardessus les fossés et les haies, et
parvinrent à nous rejoindre. Plusieurs blessés nous revinrent aussi et nous
apprîmes que Joseph avait été atteint à la jambe. Ce fut bien longtemps après,
lorsque nous étions à Alveringhem, que M. Maquestiaux de Soignies nous annonça que Joseph Gilmant était mort des suites de sa blessure dans un
hôpital d'Ixelles et que l'on avait célébré ses funérailles dans sa ville
natale. Joseph était mon meilleur camarade de collège. C'était un excellent garçon
qui aurait fait plus tard, sans aucun doute, beaucoup de bien autour de lui.
Dieu l'a rappelé à lui, que Sa Sainte Volonté soit faite. Je me souviens,
lorsque nous étions à Bonne Espérance, et que l'on se préparait à l'examen de
la Croix rouge de ces paroles qu'il me dit en riant : « Ecoutez, Jean Agache,
si un jour nous nous trouvons ensemble sur le champ de bataille, n'est-ce pas
que nous nous soignerons l'un l'autre avant toute chose ? » Puis c'est le siège
d'Anvers, le cortège de tous les cantonnements qu'ont connus tous ceux qui
participèrent à l'agonie de nos forts : Wilryck,
Mortsel, Bouchout, Vieux-Dieu, Contich, Duffel.
Lierre, Emblehem, Broeckhem,
Edeghem, Zwyndrecht. Le 7 octobre la colonne
d'ambulance est à Vracene. La retraite d'Anvers a
commencé. Le 8, elle loge à Wachtebeek, le 9 à Lembeek, le 10 à Saint-André-lez-Bruges, puis à Oudenburg
où l'on annonce la création de brancardiers régimentaires. Agache reste cependant
encore à la colonne d'ambulance. Le 12, à deux heures du matin, il arrive à Alveringhem exténué et il y passe le restant de la nuit. Le
lendemain il est à nouveau question de brancardiers régimentaires : « A Il
heures 30 passèrent les grenadiers, musique en tête. Nous étions justement
réunis sur la grand’ place pour y recevoir des ordres. Il fallait des brancardiers
dans les régiments. Nous nous sommes présentés aussitôt et avons dîné très
rapidement pour arriver les premiers à la ferme où se trouvaient les voitures.
Nous partions remplis d'un beau zèle et pleins d'espoir. Et voilà qu'arrivés
là-bas on nous refusa, Mitschke et moi, parce que
nous étions habillés en lignards et non en chasseurs. Nous sommes restés, sur la
route, fort ennuyés. J'étais très vexé de cette aventure. J'aurais tant voulu
partir. Mais rien à faire il fallut se résigner et
rester à la colonne. Le 13 octobre, on forma de nouvelles escouades et Jean Demarbaix nous entraîna à la huitième où se trouvait Louis
Levallois. » Le lendemain la colonne
d'ambulance part pour Clercken. Le 16 elle se rend à Stavele où elle séjourne jusqu'au 21. Pendant ce temps le 2e chasseurs à pied combat à Noordschoote, Oostkerke et Dixmude tandis que le 3e chasseurs
fait preuve de bravoure successivement à Noordschoote-Dixmude et à Saint-
Jacques-Capelle. Le jeudi 22 octobre alors
que la colonne d'ambulance se trouve à Forthem on
réclame des brancardiers pour Dixmude où se livrent de rudes combats. Agache s'offre
immédiatement avec son ami William. Ils effectuent la route sur le marche-pied d'une auto d'occasion et ils arrivent à la nuit
tombante au poste de secours de Caeskerke. « C'est le
soir du 23 octobre, écrit notre héros, que nous avons eu pour la première fois
une réelle idée de la guerre. Jusqu'alors nous n'avions encore rien vu. Pendant
cette fameuse nuit nous avons fait trois fois la route du poste de secours aux
tranchées. Un brancardier que j'ai su plus tard être Raoul Delmotte était venu
nous chercher au poste de secours. Nous étions ainsi à quatre brancardiers et
avions avec nous le médecin Florent Delor. Nous
partons donc et jusqu'au pont de l'Yser nous sommes à notre aise car il n'y
avait à vrai dire guère de danger jusque-là. Le pont franchi nous nous
engageons dans une drève très large, un espèce de
boulevard découvert sur la droite d'où venaient les balles. Nous commençons à
avoir un peu la frousse et nous marchons à la file indienne. Les balles arrivent
de plus en plus nombreuses et elles claquent contre les murs. Le soir cela fait
une drôle d'impression, d'autant plus que nous ne savons pas au juste si les balles
tombent près ou loin de nous. Quand il existe sur notre chemin des maisons nous
les longeons afin d'être mieux à l'abri et quand nous arrivons à des carrefours
de rues nous courons à toutes jambes pour rejoindre la ligne d'habitations.
Nous passons à côté du moulin de l'hôpital Saint- Jean, de la chapelle des
Pères récollets et nous arrivons ainsi au passage à niveau du chemin de fer
Thourout. La route est presqu'impraticable car elle a été défoncée en maints
endroits par les obus. Un projectile est tombé sur la chapelle des Révérends
Pères dont les débris obstruent la rue. Des maisons brûlent encore et le
crépitement du feu qui consume ce qui reste du bois s'ajoute à celui des
balles. Les vitres de toutes les habitations ont été brisées par le déplacement
d'air provoqué par l'éclatement des obus. A la barrière du chemin de fer nous
nous demandons anxieux si nous sommes encore loin des tranchées. Nous décidons
de poursuivre notre route. La nuit est très noire et les feux de salves
résonnent dans les ténèbres comme une longue traînée de poudre. Les Allemands ne
répondent que faiblement au tir prolongé des nôtres. Nous prenons un chemin, ou
plutôt un fossé, sur notre droite et nous atteignons enfin la grange où
gémissent les nombreux blessés de la journée. Nous en chargeons un sur notre
brancard et avec notre précieux fardeau, nous rentrons par le même chemin au
poste de secours. » Puis, ce fut
l'interminable stabilisation des fronts, cette espèce de consolidation des
foules mobilisées dans la souffrance et le risque quotidiens. Le « brancardier »
prend la physionomie qu'il gardera à jamais dans la galerie des héros. En face de la tranchée
allemande voulue et préparée s'est creusée la tranchée belge improvisée.
D'abord les premières tranchées, simples trous recouverts de paille ou de toile
de tente et, ensuite, les dédales de boyaux, les abris à triple couches de rondins, les cagnas en béton. Toute la Belgique
est là. Les paysans de tous les champs qui gardent au fond de l'âme l'image
nostalgique de tous les villages, la chanson de toutes les provinces, les
hommes de tous les métiers, de toutes les professions, de toutes les croyances,
de toutes les classes. C'est là que le brancardier de régiment va prendre sa
véritable figure. Le voyez-vous dans le labyrinthe des boyaux ? Il a
quitté le poste de secours, la compagnie de soutien et va faire sa tournée en
première ligne. Dans sa musette rebondie, s'entassent des pansements, des
garrots, les dernières lettres de la maison, ses cigarettes, un Rabelais ou un
Montaigne, à moins que ce ne soit un recueil de Verhaeren ou de Fernand Séverin.
Son costume est couleur de boue et se confond avec la terre glaise de la
tranchée. C'est un homme des tranchées comme tous ceux qui l'entourent et n'est-il
pas un vrai combattant à sa manière ? Combattant? il
l'est ! Son ennemi ? C'est la mort qui à chaque minute frappe ceux dont il a la
charge de protéger la vie. Et ce qui fait à la fois sa grandeur et sa misère, c'est
la disproportion terrible entre la force brutale de la mort et les moyens
fragiles dont il dispose contre elle. Il est là, dans le secteur de la
compagnie. Sa cagna, qui est à la fois son abri et sa salle de pansement, est à
côté du P. C. du Commandant. Non loin de lui, son médecin, camarade de son âge,
ou plus jeune, et qui, aux heures les plus tragiques, apporte la note fraîche
écho lointain des salles de garde, la note salutaire pour camoufler l'émotion
qui étreint... Dans mon souvenir, je confonds le médecin, le brancardier et
l'aumônier, ce sont trois âmes qui n'en font qu'une. Le 24 octobre 1914, Jean
Agache est désigné pour le 2e chasseurs à
pied et voici comment il relate cet événement : «Depuis longtemps déjà
nous avions demandé à partir au régiment. A Zwyndrecht
nous étions du nombre des quarante brancardiers qui avaient demandé un rôle un
peu plus actif et plus périlleux. A Alveringhem nous
avions failli partir et c'est notre tenue de lignard qui nous en avait
empêchés. Nous nous étions alors recommandés au docteur Gheis
afin de pouvoir partir à la première occasion. Le soir de notre retour de
Dixmude on nous communiqua que le docteur Gheis nous attendait
à la section d'hospitalisation de Forthem. Nous nous
y rendîmes aussitôt et nous y apprîmes notre désignation pour le 2e chasseurs. Le lendemain 25 octobre, la
colonne d'ambulance devant se rendre à Lampernisse nous
décidâmes de l'accompagner jusque là. Avant notre départ on nous remit une
feuille de route pour la 3e compagnie du IIIe bataillon du 2e chasseurs qui combattait à Dixmude. Le
temps était fort beau et nous avons fait la route à pied derrière les voitures
d'ambulance. La colonne s'étant arrêtée près du moulin de Lampernisse,
sur la route d'Oudecapelle, nous prîmes notre sac et nous
entrâmes dans un café près du moulin. Nous étions bien pauvres alors et pour
dîner nous avons mangé quelques sardines avec des biscuits militaires. Le dîner
terminé nous avons laissé nos sacs dans le café et nous nous sommes dirigés
vers le village de Lampernisse. Là, après bien des
recherches, nous avons enfin trouvé le logement de la musique où nous avons
passé la nuit sur un tas de pommes de terre. Le matin du 26 octobre,
lorsque nous avons enfin trouvé le poste de secours, de furieux combats se
livraient devant Dixmude. Les Allemands avaient passé l'Yser avec des forces
considérables et déjà le 24 octobre le 2e
chasseurs avait dû se porter à l'attaque pour reprendre une tranchée
perdue par les grenadiers. Ce fut très dur et nous y perdîmes beaucoup
d'officiers et de soldats. Au poste de secours nous fûmes bien accueillis par
le docteur Heindrickx et nous partîmes aussitôt.
William, Colson et moi à la recherche de blessés à
travers un terrain labouré par les obus. » Mais ce ne fut que le 2 7
octobre que Agache et son camarade William firent leur entrée à la compagnie : «
Le lendemain matin, écrit-il, quand nous nous sommes levés, le village était
rempli de soldats qui y étaient venus cantonner la veille au soir. Nous nous
sommes informés au sujet de notre bataillon et nous avons appris que sans
tarder il allait se rassembler dans la prairie en face de la grand’ place d'Oostkerke. Nous avons fait nos adieux au docteur Van
Beveren et nous nous sommes promenés dans les environs. Enfin voilà la 3/III. La
compagnie avait formé les faisceaux et son commandant le lieutenant Gallot[2] était
assis au milieu de ses hommes. Nous sommes allés, William et moi, lui présenter
nos feuilles de passage. Après nous avoir demandé quelques nouvelles, il nous a
renvoyé au sergent Vandevoguebroeck. » Du 31 octobre au 6
novembre on est au repos à Saint-Ricquiers et à Hoogstaede. Le 6 c'est le retour à Dixmude qui a été
ravagée par les obus et où les combats reprennent de plus belle. Nombreux sont
les blessés à évacuer et Jean Agache écrit: « A la tombée de la nuit nous
sommes partis avec les autres brancardiers à la recherche des blessés. En
passant près de la Minoterie qui était alors le poste du Major nous y avons
trouvé l'aumônier Beernaert qui s'est chargé de nous conduire jusqu'aux
tranchées de première ligne. Nous avons pris la route qui passe par l'hôpital
Saint-Jean, et après avoir traversé le passage à niveau nous sommes arrivés aux
tranchées de seconde ligne occupées par les Sénégalais. C'étaient des abris
creusés assez profondément dans le sol mais de peu de largeur. Impossible de
s'y coucher, il fallait s'y asseoir. On pouvait cependant y faire de la lumière
et cela nous a paru assez gai. Nous sommes passés derrière les tranchées puis
nous sommes partis en avant à travers un champ de betteraves. Il faisait très
calme, pas un coup de fusil. Arrivé à la haie nous avons trouvé un blessé
couché dans un petit fossé. Il appelait au secours, parait-il, depuis bien
longtemps. Quand nous avons voulu l'enlever il se plaignait tellement que nous
avons bien eu peur. Enfin on parvint à le mettre sur un brancard qui prit aussitôt
le chemin du poste de secours. Il restait encore huit brancardiers et
l'aumônier partis en avant. Au bout de cinq minutes celui-ci nous rejoignit en
disant qu'il n'y avait plus de blessés. Nous avons alors rejoint en grande hâte
le poste de secours, car nous n'étions guère à notre aise. Quand nous sommes
arrivés là le docteur nous a dit d'aller prendre deux blessés sur la route de Beerst. Nous sommes ainsi retournés à Dixmude conduits par Colson. Nous avons parcouru quatre ou cinq rues, tournant
tantôt à droite, tantôt à gauche, au milieu des maisons défoncées. Après avoir
traversé le canal d'Handzaeme, nous avons atteint les
dernières maisons de la ville. C'est là, dans un café, près d'un poste de fusiliers
marins, que nous avons trouvé nos deux blessés. Pour le retour nous avons
emprunté les mêmes rues mais cette fois, un peu plus lentement que pour venir. Que
c'est lourd un blessé ? Nous en avons essayé le transport de toutes les
façons ; à bras à quatre, à deux au moyen de bretelles, à quatre sur les
épaules ... Quand nous sommes arrivés
au poste de secours, nous n'en pouvions plus. Heureusement qu'il ne fallut plus
le quitter cette nuit-là. Le lendemain c'était
dimanche. Le matin nous avons enterré un mort arrivé la veille au poste de
secours. Puis nous nous sommes rendus dans un hangar où un aumônier français
célébrait la messe. On y avait apporté deux tables sur laquelle on avait placé
la nappe d'autel, le crucifix, les deux cierges et le petit missel. Au premier rang
de l'assistance des officiers français et quelques soldats, derrière les
quelques belges qui cantonnaient dans les environs. Je n'oublierai jamais cette
messe tellement elle fut bien dite. La voix du prêtre semblait si paternelle que
je crois que Notre Seigneur ne parlait pas autrement. » Après 2 jours de repos à Alveringhem le 2e chasseurs
réoccupe Oostkerke. Le 11 novembre la colonne d'ambulance
est endeuillée par la perte de l'abbé Charles Mathurin. Le brancardier Agache
écrit ce jour-là : « Le matin le bataillon se rassemble dans une prairie en face
de l'église d'Oostkerke. Nous, nous restons dans le café
où nous avons logé. Nous tuons le temps en jouant aux cartes. A 14 heures
arrivent Fernand Delair et frère Welvaert
brancardiers au 1er de ligne. Ils nous apprennent la mort de Charles
Mathurin survenue vers 10 heures. Il avait reçu un éclat d'obus à la tête, non loin
du hameau d'Oude-Bareel. Le
crâne ouvert, il avait été tué presque sur le coup. Nous avons été fort attristés
par cette pénible nouvelle. La veille déjà à Dixmude, trois brancardiers
avaient été blessés. Cette fois c'était un abbé du diocèse de Tournai du même cours
que nous. Mathurin était un très bon élève et un excellent garçon fort aimé de
ses disciples ; plus tard il aurait fait beaucoup de bien. Mais les desseins de
la Providence sont insondables. Je ne connaissais pas personnellement Charles
bien que je l'eusse vu à Bonne-Espérance. Ayant eu un épanchement de synovie
pendant les vacances, j'avais dû en rentrant au petit séminaire passer une
semaine à l'infirmerie. C'étaient Charles Mathurin et son ami Louis Meeremans qui y étaient alors infirmiers. Le soir le
bataillon alla occuper les tranchées de Stuyvekenskerke
mais comme il n'y avait plus de place au poste de secours de Lettenburg, les docteurs nous autorisèrent à rentrer au
cantonnement d'Oostkerke. Le lendemain matin de très
bonne heure nous allâmes occuper une forge près du poste de secours. Nous y fîmes
chauffer du café et griller quelques tranches de pain. Nous y étions bien
malheureux car nous ne savions où nous caser tant il y faisait sale. De plus
les obus et les shrapnels tombaient tout autour de celle-ci. Dans l'après-midi Welvaert vint nous dire qu'on allait enterrer Charles
Mathurin et à 15 heures, nous étions tous réunis au cimetière d'Oostkerke pour la triste cérémonie. Un aumônier était là en
surplis récitant les prières des morts et nous, les camarades du cher disparu,
nous nous étions groupés autour de lui. Nous étions sept : Léonard Tondreau, Fernand Delaire, Welvaert, Raoul Delmotte, Jean Lecellier,
William Mitschke et rnoi. Tout autour de la tombe se
tenaient des soldats la tête découverte. Charles était habillé en lignard avec une
capote d'artilleur. Nous l'avons enterré ainsi sans rien lui enlever pas même
les deux petits paquets de toile bleue qu'il portait en bandoulière. Après
avoir prié un instant sur sa tombe qu'un soldat refermait avec sa pelle
d'infanterie, nous sommes retournés au café pour lui façonner une petite croix
portant son nom et la date de sa mort. Nous fûmes aux tranchées
jusqu'au 16 novembre, puis au repos à Wulveringhem
date à laquelle nous repartîmes pour Oostkerke. Le 28
nous rentrions pour 4 jours à Alveringhern et, le
mardi 1er décembre, nous étions logés à Wildeman.
Le 2 c'était la Saint-Eloi et l’on a fait pas mal de bruit pendant la nuit.
Vers 2 heures du matin quelqu'un vint frapper à la porte de notre logement
disant qu'il fallait faire place pour des blessés. Nous crûmes que c'était la
continuation de la fête et ce n'est que le matin que nous connûmes la vérité.
Le village de Lampernisse occupé par des soldats français
ayant été bombardé il y avait eu là de nombreux tués et blessés. L'église
elle-même avait été atteinte. Une partie du toit en avait été enlevée et un des
piliers en se renversant avait tué 45 chasseurs alpins. Ce bombardement fit
grand bruit et, à partir de ce jour-là, les troupes ne logèrent plus dans les
églises. » Le jour même le régiment
reprend la garde aux tranchées de Stuyvekenskerke. 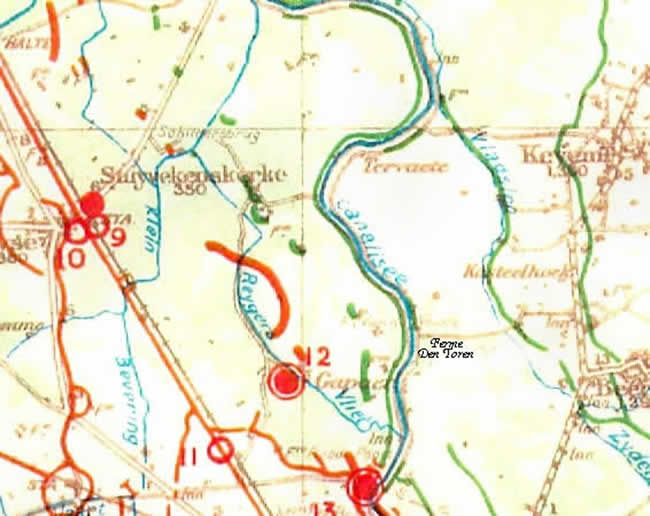
Vue sur la carte, le front allié à Oud-Stuyvekenskerke jusque la ferme « Den Toren », une distance de 850 mètres. Cette fois les
brancardiers doivent y accompagner les compagnies. Voici en quels termes Agache
note ses impressions de tranchée : « Nous entrons dans un boyau et nous
trouvons à l'extrémité de celui-ci un abri tout neuf construit par le génie.
Nous avons été très étonnés de voir que les tranchées étaient en réalité de
petites baraques en planches entourées et recouvertes de terre. Nous avions cru
trouver de longs fossés où l'on pouvait à peine s'asseoir tout comme ceux que
nous avions vus un soir devant Dixmude et qu'occupaient les Sénégalais. Nous fûmes aussi très
étonnés du calme qui y régnait. Nous nous sommes endormis sans tarder et le
lendemain nous étions debout de très bonne heure pour aller chercher les
vivres. Après le déjeuner, nous avons aménagé un peu notre abri. Comme il y
avait des courants d'air nous avons bouché les ouvertures avec de la paille et de
la terre. Il y faisait relativement
clair et l'on pouvait y lire et écrire sans difficulté. Les obus ennemis
passaient très haut au-dessus de nous ; ils étaient dirigés sur nos batteries d'artillerie.
William en a compté quatre-vingt quatre. Le soir le sergent Bovis
et le caporal Gociau sont venus s'installer avec
nous. Le sergent avait une lampe-pigeon : nous avons eu ainsi de la lumière
toute la nuit. La journée du lendemain s'est passée à jouer aux cartes. Quel
type curieux que ce Bovis ; débrouillard et forte
tête, pas élégant pour un sou, sachant cependant raconter pas mal d'histoires
et aimant beaucoup sa maman. » Après huit jours de repos,
le 2e chasseurs occupe du 12 au 14 décembre
les tranchées de Saint-Jacques-Capelle. Agache fait pour la première fois le
coup de feu: « Le 14, après le dîner, nous prenons un bon fusil et nous allons
avec le sergent Bovis dans la tranchée de tir. Nous y
faisons tous les deux, William et moi, le coup de feu. Il y avait à 500 mètres
devant nous des vaches laissées en liberté dans les prairies au delà de l'Yser.
Nous les avons visées mais nous les avons manquées. C'était tout naturel. J'ai
eu le plaisir cependant de constater, par le jet de terre qu'a soulevé la balle
en frappant le sol que je n'avais été qu'à quelques mètres du but. Le soir nous
étions relevés et nous avons emprunté un sentier à travers les prairies. Il
faisait un joli clair de lune. Si ce n'avait été la fatigue je me serais plu à
évoquer les histoires de brigands que j'avais lues étant enfant. Cette longue file
d'hommes le fusil à l'épaule se suivant en silence à la queue leu-leu au milieu
de ces prairies désertes. Ces rares fermes muettes et en ruines que nous
contournons tels des voleurs. Ces meules tronconiques sur lesquelles se
projettent nos silhouettes fantomatiques. Tout cela me faisait songer aux longues
caravanes qui, sous un ciel pareillement étoilé, se sont portées à la conquête
du désert. » Le 16, la ville de Loo où
les chasseurs sont au repos est violemment bombardée. La nuit de Noël se passe aux
tranchées. Après un repos de quelque durée à Ghivelde
et Bray-Dunes on retrouve Agache avec sa compagnie dans les tranchées en face
de Dixmude. A la date du 17 février il note dans son carnet de route : « Il y
avait là un poste de soldats commandé par un caporal blessé que j'ai soigné et
qui m'a paru bien brave. Il s'était amusé à agacer les Allemands avec un pain
coiffé d'un shako et, dans lequel, il avait placé une pipe. Un manche de brosse
retenait le tout en l'air et servait à balancer de droite à gauche, au-dessus
du parapet, cette tête de soldat improvisée. Puis ce fut un petit drapeau belge
que l'on agita au-dessus des tranchées et sur lequel les Allemands tirèrent
avec rage. » Et quelques jours plus
tard notre brave brancardier ajoute : « Le 25 février nous retournons, par un
beau clair de lune, aux tranchées de Dixmude. Nous y occupons cette fois
une cave encore intacte. Le lendemain, vers 10 heures, nous n'étions pas encore
sortis de notre trou et venions de terminer notre déjeuner au cacao lorsqu'un
soldat qui passait devant notre refuge nous dit qu'un brancardier venait d'être
frappé à mort tandis qu'il soignait un blessé. Nous ne voulons pas y croire
quand tout à coup on crie après Georges le porte-sac. Nous sortons aussitôt et
nous apprenons que c'est Raoul Delmotte qui est blessé. Lorsque nous sommes
arrivés il se trouvait dans la cave avec un bandage provisoire autour de la
tête. Nous l'avons remonté à l'extérieur. Le docteur lui a mis une compresse
sèche et une nouvelle bande autour de la tête. Nous l'avons alors transporté
dans l'abri du Commandant de la 2/III. Je suis resté seul pour le surveiller.
Il avait conservé pleine connaissance mais, ne sachant pas desserrer les dents,
il se faisait comprendre par signes. Dans ces gestes c'était toujours le Raoul
d'autrefois. Ainsi quand il avait besoin de quelque chose, il faisait, selon sa
coutume, claquer les doigts. Cette habitude lui était restée du collège. Quand
le docteur est venu le voir il l'a salué de la main, de ce geste un peu
protecteur qui lui était familier. Puis il a éprouvé le besoin de vomir. Il m'a
demandé de le mettre sur son côté gauche. Instinctivement il a tiré de sa poche
une feuille de papier qu'il a placée assez gauchement sur le bras pour ne pas
le salir en vomissant. Je l’ai pris par la main et il a serré fortement la
mienne pour me faire comprendre combien il était content de me savoir près de
lui. Je lui ai dit alors que j'allais bien prier pour lui et il m'a serré la
main plus fort encore. Tous les brancardiers, y
compris ceux du poste de secours d'Oude-Bareel, on veillé tour à tour le cher camarade. Nous avions demandé au
docteur si sa blessure était mortelle et celui-ci nous avait répondu qu'il ne
pouvait encore rien augurer. Il nous avait aussi dit qu'il n'était pas
impossible, dans le cas où il survivrait, qu'il puisse continuer ses études. Le
lendemain de la descente des tranchées nous nous sommes informés de l'état de
Raoul. II avait été transporté à la section d'hospitalisation de Forthem. La balle qui l'avait atteint au front était restée
à l'intérieur du crâne où elle s'était divisée en plusieurs morceaux. Son état
serait à présent désespéré. Les marins sont bien tristes, surtout M. Tilemans, qui, étant de La Louvière, connaissait Raoul d'avant
la guerre. Au point de vue de sa préparation à la mort Raoul est très bien à Forthem avec le Frère Balais et l'aumônier Boffaux. Toutes les heures l'un ou l'autre de nous va près
de lui pour réciter des invocations ou un bout d'office. L'aumônier a dit
plusieurs fois la messe dans la chambre du blessé et l'on nous a dit qu'il avait
même répondu avec les servants de messe. Notre aumônier de bataillon Beernaert
lui a fait visite. Raoul lui a demandé s'il allait mourir. L'aumônier ne lui a répondu
ni oui ni non, d'autant plus qu'il allait un peu mieux ce jour-là. Mais il lui
a dit : « Je suppose que vous êtes prêt et que vous n'avez pas peur de mourir.
» Non je n'ai pas peur, a répondu Raoul, et je suis prêt. Il lui arrivait de
souffrir atrocement de la tête et, dans ces moments, il voulut plus d'une fois
arracher le bandeau de pansage. Le Frère Balais lui rappelait alors que Notre
Seigneur avait été couronné d'épines et à cette pensée Raoul reprenait courage
et se calmait. » Tandis que son meilleur ami
se mourait, Jean Agache apprenait qu'un autre brancardier avec qui il était parti
à la guerre était mort de la fièvre typhoïde à Calais, le 27 février 1915.
C'était l'abbé Joseph Verriest du séminaire de
Tournai. Ce fut un mois plus tard que le IIIe Bataillon du 2e
Chasseurs fut endeuillé par 1a mort du brancardier Raoul Delmotte. Nous en
lisons la relation dans le journal de Jean Agache : « Le 13 mars, Sa Majesté la
Reine Elisabeth vint à Alveringhem visiter les
formations sanitaires. Elle passa à Forthem et entra
à l'hospitalisation. En traversant les salles, elle passa près du lit de Raoul
et s'y arrêta pour le voir et lui dire un mot. Le blessé était couché les yeux tournés
vers le mur. Quand on annonça la Reine, il demanda à la voir. Mais à cause de
sa blessure il ne pouvait bouger la tête et la Reine en se penchant même sur le
lit ne pouvait rencontrer ses yeux. Les brancardiers retirèrent alors le lit du
mur et Raoul vit Sa Majesté. Il avait conservé toute sa lucidité d'esprit et dit
: « Bonjour, Majesté. » Puis : « Quel grand honneur pour un simple brancardier
! » La Reine le félicita et l'encouragea par quelques bonnes paroles. C'est aux
tranchées, le soir même de cette auguste visite, que nous
apprîmes la mort du vaillant camarade. On était le 23 mars 1915. Il était mort
le matin ou plutôt il s'était éteint doucement alors que son état semblait s'améliorer.
L'enterrement eut lieu le lendemain. J'étais aux tranchées et ses autres amis
aussi. William Mitschke et Jean Lecellier
se trouvaient par hasard à Alveringhem. A 8 h. 30
l'abbé Nimal fit la levée du corps à l'hospice. Puis
le cortège se mit en marche. William était en tête portant la Croix. Derrière
suivait le corps porté par 6 brancardiers. Venaient ensuite le Lieutenant-Colonel Godissard
médecin divisionnaire, quelques aumôniers et brancardiers. A l'église la messe
fut célébrée par l'aumônier Boffaux de
l'hospitalisation assisté par Venant Daubin diacre et
Jean Lecellier sous-diacre. Raoul fut enterré par ses
frères d'armes à droite de l'église paroissiale. Quelques jours plus tard nous
plantâmes sur sa tombe une fort jolie croix surmontée de la couronne et des
rayons symboles de la gloire du Ciel. » Le 1er avril
l'aviateur Garros abat un aviatik allemand entre Forthem et Oudecapelle. La fête
de Pâques se passe aux tranchées. Le 23, c'est l'attaque des
Allemands par gaz asphyxiants à Steenstraat. Toute la
5e Division est alertée. Le lendemain le Commandant Seeldrayens est désigné pour commander le 1er
bataillon du 2e chasseurs et est remplacé à
la Compagnie Agache par le Commandant Dupuis. Le 9 mai, le 2e chasseurs qui est aux tranchées depuis plusieurs
jours n'est pas relevé. Il est chargé de construire une tête de pont en face de
Dixmude. Ce travail continue toute la nuit du 9 au 10. Les Allemands ayant remarqué
ces travaux bombardent violemment, cette nuit-là et les jours suivants toutes
les tranchées du secteur. Les pertes du régiment sont très élevées. Quatre officiers
sont tués à quelques jours d'intervalle : le Capitaine A. Van Egroo, le Commandant R. Borlée et
les sous-lieutenants E. Debaisieux et J. Pattheeuws. Un mois plus tard le même
régiment perdait son chef de corps le Lieutenant-Colonel
Rademakers, l'aumônier Charles Lehoucq
et le brancardier Wademant un bon camarade de Jean
Agache. Les deux derniers avaient été tués en se portant au secours de leur
Colonel. Le 2 août le 2e chasseurs était endeuillé à nouveau et Jean
Agache note à cette date : « Le 2 août 191 5, j'étais, en compagnie de Louis Dal,
dans un abri des tranchées de 3e ligne en arrière de Caeskerke lorsque le 1er sergent vint nous dire
de nous rendre aussitôt au poste de commandement du Colonel. Celui-ci vient, paraît-il,
d'être tué par un obus et nous pourrons peut-être y rendre quelque service. Nous quittons notre abri
au plus vite. La nouvelle n'est que trop vraie. Devant l'abri servant de poste
de combat nous y voyons le Colonel étendu ainsi qu'un soldat. Un peu plus loin
se trouve un blessé dont nous pansons les multiples blessures. Cela fait, je
suis revenu près du Colonel qui était affreusement mutilé. J'ai aidé à le
mettre à l'abri, en attendant qu'il fut évacué. C'était le Lieutenant-colonel
Charles Blyckaerts[3] qui était
arrivé chez nous du 6e de ligne il y avait quelques mois. A côté de lui se
trouvait, mort également, un jeune caporal qu'on appelait le petit Bastin et qui était secrétaire. Tous deux avaient une jambe
enlevée. Nous avons retrouvé la jambe du Colonel mais pas celle de Bastin. » Le 1er
septembre le régiment est au repos à La Panne d'où il va travailler
journellement à Nieuport. Le dimanche 5, écrit Agache, à la messe militaire de 11 heures, en la chapelle des
R. Pères Oblats, le R. P. Hénusse clôture la retraite
des brancardiers. Paul Cambier
qui a été ordonné prêtre à Boulogne par Mgr l'évêque d'Arras, dit sa première
messe. Le Roi et la Reine sont là agenouillés parmi les fidèles. Le prédicateur
s'inspirant de la cérémonie parla du prêtre. Pendant le sermon, le Roi se
tourna comme le public du côté de la chaire de vérité et écouta très attentivement
l'éminent Jésuite. II fit même plusieurs fois des .signes d'approbation,
notamment lorsque le Père Hénusse parla de notre
grand cardinal Mercier. Le prédicateur fit aussi l'éloge du Roi et dit que le
peuple belge avait resserré plus que jamais les liens qui l'attachaient à sa
chère Dynastie. 
Son Eminence le cardinal Mercier. Hier nous avons fêté Louis
Dal, mon confrère de la 3/III, qui part, le 8 courant,
pour la Colonie. Celui-ci, qui s'est engagé le 4 août comme volontaire de
guerre aux grenadiers, est un ancien étudiant en philosophie de
Bonne-Espérance. II devait entrer au noviciat des Pères Blancs du Cardinal
Lavigerie lorsque la guerre a éclaté. Il a été remplacé à la compagnie par
Louis Levallois originaire de Binche. A cette petite fête de famille à laquelle
assistait M. le Vicaire Lamy aumônier des brancardiers, Edgard Durieux a rempli
les fonctions d'échanson. Nous nous sommes très bien amusés. » Quelques jours plus tard
Agache avait la joie de rencontrer un officier de son village natal avec
lequel, sans aucun doute, il parla longuement de son cher Templeuve et de sa
famille à laquelle il était si filialement attaché. Voici en quels termes il
note cette rencontre : « Dans une des premières lettres reçues de la maison, Père
m'avait dit que je rencontrerais probablement à l'armée un Templeuvois
officier depuis longtemps, le capitaine Six. J'avais oublié depuis longtemps ce
renseignement lorsqu'un beau jour je rencontrai Marcel Fagot qui logeait sans
que je le susse dans la même villa que moi. Il m'apprit qu'il avait à son
bataillon un commandant de mon village nommé Six. Dès le même jour je me
présentai à son logement mais il était absent. Le lendemain vers dix heures
j'allai au café où il prenait ses repas. En y entrant je croisai deux
officiers. C'est peut-être un des deux, me dis-je. J’entrai et je demandai au
patron si le commandant Six était là. Il sort à l'instant, me répondit-il.
Cette fois il ne m'échappera plus. Je sortis précipitamment et je l'abordai franchement
: « Je vous demande pardon, mon Commandant, mais si j'ose vous accoster ainsi
c'est que je suis comme vous de Templeuve. Je suis Jean Agache. » Il
m'accueillit fort aimablement et me donna rendez-vous pour le lendemain. J'ai
ainsi passé deux après-midi entières avec le commandant Six. Comme le 6e
de ligne devait partir aux tranchées, le commandant Six me fit ses adieux et me
remit sa photographie. Mais avant de nous séparer, il me conduisit au café «
ln de Klok » où je me trouvai attablé avec des majors et des
commandants. Je serai toujours reconnaissant envers le commandant Six de
n'avoir pas rougi de me conduire dans ce milieu d'officiers. Je le remercie
également de m'avoir invité à souper avec lui au mess. Les égards qu'il a eu pour moi, simple jass de seconde classe, m'ont
profondément touché. » 
Papa Merx en présence du général Six Le 25 septembre le 2e
chasseurs donna une soirée à La Panne au profit de la Croix-Rouge. Le 6e
de ligne auquel j'appartenais était également en repos à cette date, je m'en
rappelle parfaitement. Au programme: « Maladie de Cœur », comédie en un acte de
Paul Brohée et « Pan'Repos
», revue en un acte et un prologue du même auteur. Les principaux organisateurs
de cette fête, qui eut un succès sans pareil, furent : P. Brohée
et les Sous-lieutenants Lambert et Jacques y prêtèrent leur concours : Mlle de Clery, le lieutenant Poignard, le sous-lieutenant Lambert,
MM. G. Dupuis de la Gaîté Lyrique de Paris, Em. Hanlet, du Théâtre royal de Liège, Léo Jacques,
compositeur. Gilbert Goorissen des Concerts de Paris.
Albert Demoustier, baryton d'opéra, Louis Boland, chansonnier montois, Victor Thibaut, Briatte, P. Ghobert, Constant Moreau, Geneneffe,
A. Veys, et la musique du régiment sous la direction de
son chef M. Defer. Jean Agache note que cette
représentation très applaudie le divertit fort. Le 19 octobre, la 3/III du 2e chasseurs qui est alors commandée par le
commandant Dupuis et qui compte à son effectif les lieutenants Lambert et Van
der Elst monte pour la première fois aux tranchées du secteur de Ramscapelle. «
Contrairement à l'habitude, écrit Agache, les 3 pelotons de la compagnie sont
séparés et, mieux que cela, les pelotons sont eux-mêmes divisés. Le 1er
peloton est près du poste de secours, à la ferme Wolvernest.
Le 3e peloton est en partie à Rodesterke et
en partie le long du Beverdijk. Le 2e est
en avant sur la droite du 1er peloton. William est avec le 2e
peloton au poste avancé. Quant à moi je suis à Rodesterke
avec Louis Levallois. La ligne de tranchées que nous occupons forme avec la
ferme derrière nous, un point d'appui. De cette grosse ferme dont la cour est
entièrement envahie par les eaux, l'habitation est complètement détruite et des
granges il ne reste que les pignons en ruines. Je me plais assez bien à ce
poste où les abris sont à sec. Le matin avant le lever du brouillard, on peut
même y faire du feu. Le paysage lui-même n'est pas sans intérêt. Nous avons
cherché à identifier les fermes voisines au moyen de la carte au 1/40.000. Mais
nous n'avons pu découvrir la ferme Violette dont on nous a tant parlé. Le soir de la relève, j'étais arrivé un
peu en retard à Rodesterke par suite d'un petit
détour que j'avais fait en suivant le peloton qui se rendait à la tête de pont.
Quand nous arrivâmes à notre tranchée, Louis Levallois et moi, la sentinelle
nous dit qu'on réclamait nos services. L'aumônier venait de partir
précipitamment avec un brancard au poste de secours d'où on réclamait des brancardiers.
Nous nous rendîmes immédiatement au poste de secours où la consternation se lisait
sur tous les visages. La nouvelle qu'on nous communiqua à voix basse était
grave : Le docteur Maurice Tellier[4] avait
reçu une balle dans le foie. On venait de l'évacuer. Notre peine fut grande car
nous l'estimions beaucoup. De retour dans notre abri, notre première besogne
fut de réciter le chapelet pour le cher blessé. Le lendemain, à l'ambulance «
Océan » à La Panne, le jeune praticien rendait chrétiennement son âme à Dieu
après avoir communié avec beaucoup de ferveur. » 
La chapelle de l'ambulance l'Océan La fête de la Toussaint se passa aux
tranchées. « Quelle triste fête, écrit Agache. Nous avons eu une messe basse au
poste de l'Oost-Landen. Il pleuvait, mais nous ne
nous doutions tout de même pas que nous allions passer une nuit aussi pénible.
Nous avions espérer que le vent finirait par s'élever comme cela arrive
fréquemment à la côte et que le pluie cesserait. Les
gouttes d'eau tombent dans l'abri d'abord une à une, puis elles sont si
nombreuses qu'on ne sait plus les compter. Bientôt les couvertures et les
imperméables sont complètement mouillés. Nous avons poussé un soupir de
soulagement lorsque le jour s'est levé. Il pleuvait un peu moins fort et nous
nous sommes blottis transis dans un coin de l'abri. Vers 8 heures nous avons
quitté notre coin pour aller chercher un refuge dans la ferme. William est allé
d'un autre côté. Louis Levallois, le sergent Boris et moi nous avons parcouru
rapidement la ferme. Comme toutes celles des environs « Oost-Landen
» est en ruines et en partie inondée. Nous en avons pris quelques photographies.
» Le 24 novembre, l'état de santé de Jean
Agache est très précaire. Son affaiblissement est tel qu'il ne sait même plus
se tenir debout une demi-heure. Ses camarades Mitschke
et Levallois le conduisent après bien des difficultés, car il ne veut pas se
laisser évacuer, à l'ambulance. Quatre jours plus tard le train sanitaire
l'emportait vers Saint-Brieux où le 1er
décembre, il était hébergé à l'hôpital temporaire n° VII. Le séjour à l'arrière
lui pèse terriblement et il a hâte de rentrer au front. De Saint-Brieuc il
écrit successivement à son ami Mitschke : Le 1er
décembre : « Je suis (à l'hôpital) depuis deux heures et l'impression est
mauvaise. Cela sent le vieux bâtiment, le pensionnat, la caserne, bref nous
sommes dans un lycée transformé en hôpital. » Le 8 décembre: « Je vais lui parler un
peu à l'aumônier belge de l'apostolat à l'hôpital. Il y a tant à faire ici. » Le 10 : « Pas encore de nouvelles et
voilà huit jours que je t'ai écrit. C'est désespérant. Je suis parfois mal disposé,
découragé. Je voudrais me trouver près de mère. » Et enfin le 17 : « Réjouis-toi. Je
partirai demain pour Rennes où je dois repasser une visite. » Le lendemain, Jean Agache était, en
effet, dirigé sur l'hôpital de Rennes où il eut la joie de retrouver un camarade
du séminaire l'abbé Elie Callez. Le 23, il quittait Châteaugiron pour le camp
d'Auvours où il est chaleureusement accueilli par
deux autres camarades d'étude les abbés Raphaël Suya
et René Thirion. Malgré cet accueil c'est le cœur
débordant de joie qu'il annonce le 31 à ses compagnons du front son départ le
soir même pour Fécamps où il doit être rééquipé pour
rejoindre l'Yser. Quelques jours plus tard il arrive enfin à La Panne où les
brancardiers Louis Levallois, Maurice Braquenier,
Alphonse Nimal, Paul Cambier,
William Mitschke et d'autres fêtent son retour. Grâce
à l'amabilité du médecin du régiment il reprend sa place à la 3/III où il avait
été momentanément remplacé par l'abbé Joseph Derasse
de Tournai. Et ce jour-là il écrit dans son journal de campagne : « A mon
retour à la compagnie, j'ai pu y constater les changements que m'avait signalés
dans ses lettres le camarade William. Le commandant Dupuis qui se trouvait à la
tête de la 3/III au moment de mon départ a été évacué pour la deuxième fois. Il
a été remplacé pour le lieutenant Garnir, un vaillant[5] de la
compagnie du commandant Tasnier. Le lieutenant
Lambert a été évacué et le 1er peloton est commandé par le
lieutenant Libert venu du 1er de ligne. A
la tête du 2e peloton se trouve l'adjudant Vouez en remplacement du lieutenant
Van der Elst attaché à l'Etat-Major du régiment en
qualité d'officier grenadier. A la tête du 3e peloton se trouve le
lieutenant Lebeau, d'une grande amabilité. 
Le capitaine Alfred Garnir. Le sergent Meersman
fait partie de ce peloton. C'est un gradé distingué avec qui les brancardiers
entretiennent d'excellents rapports. Le corps médical a, lui aussi, subi un
complet remaniement. Le docteur Delaet a été affecté
à la colonne d'ambulance où il est chef de service. Florent Delore
qui était au front depuis le début a été envoyé à l'arrière pour y prendre la
place d'un médecin qui n'a pas encore vu les tranchées. Sont arrivés d'un
hôpital du midi les docteurs Goossens et Philippart deux
excellents catholiques que notre aumônier, l'abbé Beernaert a été heureux de
retrouver. Louis Levallois a été heureux de passer à ma place aux mitrailleurs.
Dans sa joie il nous a promis un petit régal. Il a, en effet, été faire le tour
de toutes les boutiques et nous a rapporté de quoi préparer un excellent
goûter. J’oublie de dire que nous avons un nouveau lieutenant-colonel, bon
catholique, très ponctuel et très exigeant en service. » Et le lendemain aux tranchées Agache
complète ses impressions : « De retour aux tranchées, disons plutôt aux
avant-postes, je tiens à dire un mot des changements qui s'y sont produits
depuis mon évacuation. La ferme Rodesterke que j'ai
connue assez bien conservée est aujourd'hui entièrement démolie. Un jour que la
compagnie était aux avant-postes les boches y ont déversé 200 obus qui ont mit
la ferme sens dessus-dessous. Aujourd'hui ils ont bombardé les tranchées. Au
poste avancé du Beverdyck un obus de 7,7 c. a
traversé le parapet sans exploser. Dans une autre tranchée un obus a éclaté à
l'entrée d'un abri sans blesser les hommes qui s'y trouvaient. Chez nous un
projectile de 105 est tombé sur le parapet blessant légèrement le soldat Vlieghe que j'ai dû évacuer. On a retrouvé dans un abri
défoncé deux casques littéralement écrasés. Les bords de l'un d'eux qui
s'étaient rejoints serraient comme un étau un demi-pain. Le lieutenant Garnir
est venu aussitôt se rendre compte des dégâts et il est monté sur le parapet
pour examiner le trou d'obus. Il revenait d'avoir été à la chasse en avant des
premières lignes d'où il rapportait, selon son habitude, plusieurs lièvres. Il
est d'une franchise qui devient de l'imprudence. C'est ainsi que lorsqu'on
bombarda Rodesterke il accourut pour photographier
les obus de tout près. Une autre fois profitant du brouillard, qui pouvait se
dissiper à tout instant, il est allé à la chasse en avant de nos postes d'écoute.
Certainement un jour ou l'autre il y restera. Mais c'est quand même plaisir de
le voir revenir du homan' s land le sac au dos et le
fusil de chasse à l'épaule. Il n'est pas fier au moins celui-là. Il est bien de
l'école de Tasnier. » Dans les premier jours de l'année 1916,
le 2e Chasseurs passe du secteur de Dixmude dans celui beaucoup moins
mouvementé, et dès lors moins absorbant, de Ramscapelle. Jean Agache met à
profit cette accalmie dans sa vie de combattant et fonde le journal mensuel « Tout
Templeuve Guerrier ». Le but et l'existence de ce journal du
front nous ne pouvons mieux les définir qu'en publiant l'hommage de reconnaissance
rendu par ce périodique à son fondateur dans les N° 23-24 de novembre et
décembre 1918 : « Ce brave parmi les braves, ce modeste
parmi les modestes, s'était fait notre meilleur ami à tous ; sa disparition
inattendue cause parmi nous un vide que personne ne comblera jamais. Il était
pour ainsi dire au milieu de nous, le symbole, l'âme du petit Pays ! Il
nous avait prodigué tant de témoignages de son dévouement et de son amitié, de
son intelligence et de sa généreuse et inépuisable bonté ; il se dépensait avec
tant de désintéressement pour chacun de nous, pour la vie et le succès de cette
petite feuille aimée compromise si souvent par tant d'imprévus d'ordre
militaire, pécuniaire et autres ; il s'était tant ingénié à la rendre
intéressante, pleine de nouvelles inédites, toute parfumée des parfums du
terroir et de l'esprit de chez nous, que nous nous étions habitués à incarner
en lui l'image de nos familles lointaines, de nos amis restés là-bas, de notre
beau village, enfin !... » La cruelle nouvelle de sa mort nous
jeta dans le désarroi le plus complet ; notre ami Jean – car il ne voulait pas
que nous l'appelions autrement – notre ami Jean disparu, il nous semblait tout
naturel que le petit journal qui lui devait la vie mourût avec lui... Et si
nous nous sommes décidés à le faire revivre, c'est d'abord pour rendre un
hommage public de gratitude et d'affectueux et respectueux souvenir à son à
jamais regretté fondateur, et ensuite pour achever de terminer son œuvre et
continuer en son nom et en suivant le sillon qu'il nous a lui-même si noblement
tracé, à faire de notre feuille mensuelle un trait d'union, un rendez-vous, entre
notre cher village où, malgré notre vif désir nous ne sommes pas encore
revenus, et nous-mêmes les poilus de la grande guerre, que la Patrie retient
encore sous les armes. » Nous publions aujourd'hui le numéro de
novembre dont notre héros modeste avait déjà assuré la publication quelques
jours avant sa glorieuse mort et le numéro de décembre ; nous reproduisons en
entier son bel article, simple et grand comme lui, sur la Toussaint. A la liste
des noms aimés et regrettés dont il nous demande de nous souvenir pieusement et
respectueusement, à l'occasion de la fête des morts, tous, nous aurons à cœur d'ajouter,
en caractères ineffaçables, le sien ». Le 12 mars 1916 était tué à Ramscapelle
M. l'abbé Spiloes, né le 29 mars 1888, à Malines,
aumônier au 3e Régiment de chasseurs à pied. Disons en passant que
ce digne prêtre engagé comme volontaire en 1914 était de ceux dont la bravoure
et l'abnégation furent du pain quotidien. Décorés des Croix de Chevalier des Ordres
de Léopold et de la Couronne, ainsi que de la Croix de guerre, l'aumônier Spiloes était au front depuis septembre 1914. Constamment
sur la brèche, notamment dans le secteur si dangereux de Dixmude, il fut
mortellement blessé dans les tranchées de Ramscapelle par un éclat d'obus qui
lui déchira les entrailles. Jean Agache écrit le jour de ses
funérailles : « La veille de la réunion des brancardiers à Adinkerke pour une récollection
ordonnée par l'aumônier en chef Mgr Marinis, un
aumônier nous avait demandé de bien vouloir servir la messe d'enterrement de
l'aumônier Spiloes du 3e Chasseurs. Le
lendemain, à l'heure prescrite, j'étais à la porte de l'église attendant
l'heure de la cérémonie funèbre. Il n'y avait personne encore dans le temple et
je me demandais, ainsi que mon camarade, où le monde pouvait bien se trouver.
Sur ces entrefaites arriva le Général accompagné du commandant A. E. M. Hans.
Le commandant de la Division me demanda si on allait en premier lieu à l'église
ou au cimetière. Je lui répondis que je ne le savais pas mais que je pouvais
m'en informer. Il n'y avait guère de monde, une partie s'étant rendue à la
morgue. Peu après arriva Mgr Marinis en soutane violette
conduisant le corps à l'église. Il dit lui-même la messe avec une piété qui m'édifia
beaucoup. Comme j'étais acolyte, j'eus l'occasion d'examiner le célébrant à mon
aise. Il doit approcher de la quarantaine. Le Général fut recueilli pendant la
messe, je dirai même qu'il fut pieux. » Quelques jours après ce nouveau deuil
Jean Agache complète son carnet de route par ces lignes : « Un nouveau
Commandant est arrivé à la compagnie. Nous ne savons pas trop qu'en penser. On
en dit beaucoup de bien. C'est le frère du commandant de la 2e
Compagnie. On en parle dans le livre « Sur l'Yser » de Pierre Nothomb. Nous en avons copié ce passage : « Le
premier acte du drame de Dixmude allait finir sur un épisode héroïque. Dans la
nuit du 21 au 22 octobre, à peine minuit sonné, une colonne allemande
surgissait tout à coup de l'ombre se jetant brutalement sur le point faible de la
route de Beerst où le 12e de Ligne a cédé
le 20 octobre. Débordés les fusiliers marins qui l'occupent reculeront
momentanément. A côté d'eux une compagnie du 11, celle du lieutenant Gervais Verhamme, parvenant à s'accrocher à sa ligne, refusera de
lâcher pied. Bien qu'« en l'air » et prise
d'enfilade, elle voudra mourir à son poste. « Je n'ai pas reçu l'ordre de reculer »,
criera le lieutenant Verhamme. Et du premier au
dernier, lui et ses hommes, sont massacrés ou blessés, faits prisonniers avant
qu'un brillant retour offensif des marins n'ait rétabli avec un grand cri de
victoire le front percé. » Lors de la présentation de la compagnie
au Commandant, nous étions absents. Nous avons alors cru convenable de nous
présenter en particulier. La chose nous fut facilitée par le lieutenant Lebeau
qui nous annonça. Le Commandant nous accueillit avec le meilleur sourire mais
pour tout discours il se contenta de nous dire que nous faisions partie de la «
cheville ouvrière de la compagnie ». Le 10 avril 1916, les Allemands
exécutent une attaque sur les tranchées de Rykenhoek en avant de la gare de
Ramscapelle. Notre héros l'a ainsi racontée : « Nous étions au chemin de fer,
entre Pervyse et Ramscapelle, dans notre abri habituel lorsque vers 2 heures du
matin on nous éveilla à grands cris. Ce furent successivement l'adjudant Vouez
un sergent, puis le commandant lui-même qui se présentèrent à la porte de notre
cagna. L'adjudant nous avait dit d'un air grave : « Venez vite, le poste de
Rykenhoek est pris. » Le plus rapidement que nous avions pu, nous avions mis
nos bottines, notre capote et en deux secondes nous étions équipés. On
bombardait très fort dans la direction du poste d'écoute. Nous montâmes sur la
baquette de tir pour mieux voir. Les Allemands répondaient faiblement et il n'y
avait pour ainsi dire que nos batteries qui parlaient. Nous avions plaisir à
regarder les éclatements de nos obus, tandis que les fusées reflétaient leur
lumière vacillante dans les inondations. C'était un vrai feu d'artifice. Aucune
compagnie de renfort n'était arrivée au chemin de fer, ce qui prouvait que la
situation n'était pas fort grave. Tous les hommes étaient sortis de leurs abris
et occupaient les tranchées de tir. Le 1er sergent Bovis était très affairé et à tout moment il se rendait au
P. C. du commandant d'où il sortait avec un tas de nouvelles qu'il nous
distribuait confidentiellement, d'un air mystérieux. Le jour se leva et
l'attaque peu à peu se calma. Le lieutenant Lebeau était au Beverdyck
avec les travailleurs et il lui avait été défendu de le quitter. Vers 5 heures
l'alerte était terminée. Ce n'est qu'alors que nous avons appris que notre
poste d'écoute, momentanément enlevé par l'ennemi, avait été repris par le
lieutenant Poignard aidé du lieutenant Mary et de ses bombardiers. Le sergent
Toussaint, chef de poste, blessé au cours de l'action, avait été fait
prisonnier par les Allemands. » Le 18 mai, le IIIe bataillon organise
une fête intime à Adinkerke. L'aumônier du bataillon, le sous-lieutenant Van
der Elst, officier grenadier, le poète Paul Brohée, le
brancardier Keymelen et le sergent Hanlet en furent les principaux organisateurs. Le 23, le bataillon remonte aux
tranchées de Ramscapelle et en est relevé deux jours après. Et Jean Agache note
: « Au chemin de fer nous avons été remplacés par les brancardiers Léonce Delaunoy et Paul Nackart de Blandain. Après
trois semaines de repos à La Panne et Rousbrugge, le
2e Chasseurs à pied prend, le 15 juin, la garde du secteur de
Boesinghe. Le 7 août, Agache occupe le poste de
secours avancé à gauche de « Het Sas » et il écrit
dans son journal : « D'après les ordres du docteur Dupont un brancardier par
compagnie est détaché près du médecin qui est de service 2 jours aux avancées
et 2 jours en deuxième ligne. Je me suis trouvé à mon tour auprès du docteur Philippart et j'eus ainsi l'avantage de vivre quelques
événements intéressants. C'était le midi du premier jour, je ne sais plus au
juste. Je me trouvais dans l'abri enveloppé dans ma capote. Les bombes commençaient
à pleuvoir mais je n'avais guère l'envie de me lever. Cependant comme presque
tout le monde était dehors je m'étais enfin décidé à sortir avec le caporal brancardier
Oscar Veckens. L'air était rempli de brouillard, les
Allemands étaient extraordinairement calmes et ne lançaient pas une fusée. Les
bombes arrivant moins nombreuses je rentrai avec Oscar dans l'abri. Mais voilà
que Camille Estienne vient nous dire d'en sortir déclarant qu'il n'est pas
prudent de rester à l'intérieur. Nous hésitions, lorsque nous entendîmes crier à
une centaine de mètres de nous et vîmes accourir dans notre direction des
soldats en désordre. Ils criaient : « Les boches sont là ! Ils nous ont capturé
une mitrailleuse. » Les gradés sont alors arrivés et on a pu refouler un peu
les hommes qui appartenaient à la compagnie de réhabilitation de garde dans une
des tranchées des A., c'est-à-dire de la première ligne. Pendant ce temps
Oscar avait pris son fusil et était allé s'installer au parapet. Moi j'étais
resté au poste de secours pour voir ce qui allait se passer. Le docteur était
un peu plus loin. Après un quart d'heure, le calme étant rétabli, je suis parti
avec le brancardier Laers remplaçant notre aumônier
malade pour chercher les tués. Camille Estienne et Aloïs Van Hoof suivaient avec un second brancard. Devant nous,
marchaient deux gradés, baïonnette au canon, pour le cas où il y aurait encore
eu des boches dans les tranchées. Nous nous sommes arrêtés à l'abri du
lieutenant de la compagnie de réhabilitation. Les cadavres étaient tout près de
là. Quand on les a chargés sur le brancard on s'est aperçu, dans la demi-obscurité,
qu'ils avaient plusieurs grenades liées autour du corps. Ce furent les
brancardiers qui les enlevèrent, personne ne voulant y toucher. Nous avons déposé
les corps près de notre abri en attendant les premières lueurs du jour, afin de
pouvoir les débarrasser des objets qu'ils avaient sur eux et en établir
l'inventaire. Au lever du jour, je suis parti avec un des cadavres allemands
aidés par deux soldats atteints de surdité à la suite de l'explosion d'une
bombe. En plus de ces deux morts, les Allemands qui avaient fait irruption dans
nos tranchées ont dû avoir de nombreux blessés qu'ils ont emportés. Le parapet
de la tranchée était encore le lendemain rouge de sang. Dans le courant de la
journée nous avons eu également un fou furieux qu'on a eu toutes les peines du
monde à évacuer. » Le 26 décembre, le 5e
chasseurs à pied est reconstitué sous les ordres du Colonel Tybergin et Agache passe à la 3e compagnie du
nouveau régiment. De février en mai 1917
cette unité défend le secteur de Loo. Puis il passe successivement dans ceux de
Noordschoote, Dixmude, Merckem et Nieuport. Jean Agache continue à accomplir ses
fonctions de brancardier avec un courage, une abnégation et un esprit de
camaraderie qui font honneur à sa nouvelle compagnie. Jamais il n'a été plus
heureux parmi ses soldats. De ces deux années de tranchées il nous a laissé une
collection de lettres qui sont comme le testament authentique dans lequel il
laisse à ses camarades et aux siens les plus belles fleurs de sa pensée et de
ses sentiments. En voici quelques extraits. – Fin
août 1917 : « Je ne vous parle jamais de blessés parce que voilà bien longtemps
que nous sommes en réserve et cela nous ennuie beaucoup ; moi en particulier je
ne vous cache pas que je souhaite l'offensive ardemment... Quant aux histoires de
guerre, elles diffèrent d'un bonhomme à l'autre. Certains ont toujours tout vu,
et d'autres jamais rien. Quant à moi, je ne vous dirai pas grand chose. Je suis
entré dans une compagnie d'infanterie pendant les batailles de l'Yser et jamais
nous n'avons eu l'occasion de faire ce qui s'appelle réellement une offensive. Je
ne connais donc pas la guerre d'offensive, mais simplement celle de défensive.
Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas perdu beaucoup d'hommes ; les statistiques
sont d'ailleurs très éloquentes à ce sujet. Remarquez cependant que le bien que
je puis faire s'exerce plus vis-à-vis des gens bien portants que vis-à-vis des
blessés. Voici quelques histoires : Quand nous étions en tel secteur où les
Alliés ont fait dernièrement une avance de 4 à 6 kilomètres, je ne manquais
jamais de faire la nuit, la visite des sentinelles. Les postes n'étaient pas
reliés entre eux et les sentinelles étaient simples, alors qu'habituellement
elles sont doubles. Certains soldats n'étaient pas généralement très francs,
car l'ennemi était très près. J’allais donc leur rendre visite et je voyais que
c'était pour eux un vrai plaisir de me sentir près d'eux. Ils n'avaient plus peur,
le temps passait plus vite, c'était une distraction ; puis, s'ils étaient
blessés, le brancardier était près d'eux. Une nuit que j'étais fatigué, je
m'étais endormi près d'une sentinelle et je lui avais dit : « Surtout ne me laisse
pas prendre par les boches. » - Non, non, brancardier, vous pouvez dormir. Et
je m'étais si bien endormi, paraît-il, que j'ai ronflé et que la sentinelle a
eu bien peur. Moi, je ne pensais pas au danger et n'en ai pas grand mérite, car
je suis bâti comme cela, et tant que je n'ai pas les obus sur les talons je n'y
pense pas. Je me rappelle qu'un soir, je me
trouvais près d'un certain secteur qui se trouve sur toutes les cartes. Je savais
qu'il y avait un petit poste d'écoute, et voyant un caporal près de là : « C'est
toi qui vas au poste d’écoute ? » - Oui, « Et alors qu'est-ce que tu attends ?
» - J'attends, parce qu'il fait encore trop clair. « Pourtant, lui dis-je, on a
déjà lancé les premières fusées. Viens, je vais aller voir avec toi. » Et je
suis arrivé le premier et je suis retourné tout seul. Mais vous allez penser que je viens me
vanter ... J'en ai déjà trop dit... Voici cependant encore une histoire : Ici
j'en ai encore moins de mérite, je n'ai donc aucun motif de ne pas vous la
raconter : Un jour... on vient me dire qu'il y
avait des blessés à telle place. J'étais justement en route avec trois
camarades brancardiers à la recherche d'un blessé. Nous voyons un mitrailleur
pas trop rassuré. - « C'est toi le blessé ? » - Oui. « Alors attends un
moment, car on vient de nous appeler pour un blessé gravement.» Comme notre
mitrailleur n'avait qu'un petit éclat à la jambe, il nous laisse partir sans
rouspéter. Arrivés à l'endroit, je dis à mes amis : « Attendez avec le
brancard, je vais aller voir où est le blessé. » Comme on disait que c'était un
lance-bombe je suis allé de ce côté à un endroit si bien gardé que je me
rappelais n'y avoir pu passer, même avec le mot d'ordre. Cette fois-ci on
m'accueillait à bras ouverts. Il y avait un tué que nous avons écarté aussitôt
et un blessé vers lequel je me suis précipité. « Eh bien, où est-il blessé ? »
- Il l'était partout... Et le brancardier qui était là ne sachant où donner de
la tête, s'éloigna en voyant mes trois amis avec le brancard. - Pas de temps à
perdre, le mettre aussitôt sur le brancard, un tel et un tel tendant le
brancard (car on ne sait pas le poser à terre il faisait trop étroit), le
troisième prendra le pied et moi le reste. Je dis au blessé : - « Dis, mon
vieux, tu ne saurais pas me prendre par le cou ? » II avait encore un bras
intact et comme je me penchais à terre, m'étant agenouillé près de lui, il me
prit par le cou, et se sentant soulevé de terre, il attira ma figure sur la
sienne et m'embrassa bruyamment en disant : « Ah ! merci,
camarade ! » Ce baiser de soldat m'a ému plus que je
ne le croyais. C'est la seule fois que pareille aventure m'est arrivée et je ne
crois pas qu'elle se soit souvent répétée. Pour nous, c'est plaisir d'être dans un
secteur dangereux. On sent alors les sympathies des hommes se resserrer autour
de nous, on est le bienvenu partout. Que je voudrais revoir ces temps-là !...
» Février 1918
: « Vous me parlez de la guerre qui
pourrait bien un jour finir, et de mère que je reverrai. Tenez, j'ai piqué la
photo de ma famille devant moi sur le mur, et quand je regarde mère, cela me
fait drôle, il y a tant d'affection dans ses yeux, tant d'amour. .. » 7 avril 191
8 : « Je vous écris... parce qu'il fait du
soleil ! Voilà des jours, que nous ne l'avions plus vu. Vous connaissez les
légendaires brouillards de la Tamise ; les nôtres ne sont pas légendaires mais
ils sont aussi fréquents et aussi prolongés. D' ailleurs le pays est identique
à de l'eau et des prairies. Mais je vous parlais... du soleil ! Je
suis en ce moment logé comme un prince, ma maison c’est une petite étable de
chèvres, nous y logeons à deux (oh! il n'y a plus de chèvres depuis longtemps).
Une planche est enlevée à la porte ; c'est notre fenêtre et c'est par là que
nous voyons le soleil. Nous sommes dimanche ; je croyais voir H
..., mais il n'est pas venu. Pour me consoler, je suis allé dîner « en ville »
avec des camarades, puis je suis allé raconter ma petite histoire au bon Dieu à
l'Eglise et je suis rentré, décidé à travailler jusqu'au soir. Ce sera d'autant
plus facile que « les hommes » (c'est l'expression en usage) iront boire leurs
verres, il fera calme comme dans un couvent ou comme quand on est seul au bois.
» 2 juin 1918
: « Je reviens du cimetière où j'ai été prier sur la tombe d'un petit garçon de chez moi. II a été
tué il y a deux mois et je viens seulement de l'apprendre maintenant. Je vais
demander à H ... de me faire une belle croix de bois, quelque chose qui ait du
caractère. D' ailleurs, je n'ai pas à lui demander car je suis sûr que ce sera
simple, artistique et pas banal ; pour moi, je vais me mettre en campagne pour
réunir tous les renseignements que je pourrai sur lui et sur sa mort. Je me
rappelle que ce petit-là venait toujours apporter des œufs à la maison et quand
j'avais six ans, j'étais à l'école près de sa sœur et nous faisions nos
additions ensemble ! Le vieux temps !... » 28 juin 1918. « ... Je viens de lever les yeux, et
c'est tout à fait curieux. Je vous écris à la lumière d'une bougie et mes yeux
y sont faits ; si je regarde subitement par la fenêtre, on dirait un décor. Le
soir tombe tout doucement, c'est le demi-jour, on se demande presque si c'est
le matin ou le soir... mais non, c'est le soir, car il fait si reposant, si calme,
et l'air semble chargé de toutes les pensées d'une journée. Un soldat est assis
sur une motte de terre, il est seul, il lit... et, tout en travers une
passerelle toute blanche qui tranche sur la terre grise... » Enfin voici septembre 1918 ! Sur le
front des Flandres c'est la bataille de la délivrance, celle qui brisera, après
quatre ans d'arrêt sur l'Yser, la barrière bétonnée où les Allemands ont
camouflé à profusion canons, lance-grenades, minnewerfers
et mitrailleuses. Mais tout cela n'arrêtera par l'élan héroïque de nos soldats
décidés. Le 5e Chasseurs est à l'honneur dès le premier jour. Le 5
octobre il est devant Roulers où il livre des combats qui sont, pour ses
compagnies, autant de chevrons de guerre. C'est au cours de cette journée que,
au hameau de Beythem, devait être blessé à mort Jean Agache. Le brancardier Mitschke a relaté comme suit les circonstances dans
lesquelles il perdit son fidèle compagnon d'armes, celui avec qui il avait fait
toute la guerre : « Je fus séparé de Jean, avec qui
j'avais fait toute la guerre, le 29 septembre 1918. Je le revis le 4 octobre devant
Roulers. Il pleuvait, nous étions percés ; il riait encore et ne se plaignait
pas. Il était pourtant fatigué ; sa bonne humeur me réconforta, il était
impossible d'y résister. Ce 4 octobre je causai avec lui sous la pluie, dans un
trou d'obus. Il plaignait ses hommes, de lui pas un mot ; il devait de deuxième
ligne monter en première. Il était plein d'espérance et répétait les idées qui
lui étaient chères : « Nous devons montrer à nos hommes, nous séminaristes, que
nous n'avons pas peur de la mort quand les balles et les obus tombent drus. »
Et il termina en disant : « Pour moi, tu ne dois pas t'inquiéter, je suis prêt.
Dieu le sait bien.» Je lui répondis : « Sois prudent ». « Fiat Dei voluntas », me répondit-il. Les
obus sifflaient. Nous nous séparâmes pour aller chacun de notre côté accomplir
notre mission. Le bombardement dura une heure. On annonça des tués et des blessés
au 1er bataillon, le sien. Puis, tout à coup, un soldat vient me
dire : « Cours vite, Agache est blesse gravement au cou. » Je cours ; il était
porté par deux soldats. Le médecin de bataillon me rassure en disant : « Sois
sans crainte, il guérira. La blessure est grave, mais, à cet endroit, au cou ou
à la figure, elle guérit presque toujours. » L'aumônier me raconte rapidement comment
il fut blessé : « L'heure de l'assaut venait d'être donnée, on s'avance et à
peine avait-on fait quelques mètres qu'une salve d'obus s'abat sur nous, tandis
que les balles sifflent partout. Des hommes, dont le major Ginion
Hector, commandant le bataillon, sont tués. Les soldats, un instant arrêtés
dans leur élan, n'osent plus avancer. Alors comme toujours, Jean veut leur
donner l'exemple. Il entraîne ceux qui sont près de lui en disant : « Allons
les hommes en avant, il ne faut pas avoir peur. » Un de ces soldats tombe
mortellement blessé. Agache se précipite vers lui, une balle le frappe au cou
et il tombe à la renverse. L'aumônier, le médecin, des soldats qui suivaient se
précipitent vers lui. Il les regarde en souriant : « Ce n'est rien, je ne suis
que blessé », leur dit-il. Il veut parler encore, mais la blessure, qui avait
atteint le larynx, étouffe sa voix. Alors, bravement, il trouve encore la
force de se hisser lui-même sur le brancard. L'aumônier lui dit qu'il va
l'administrer. Il fait un signe de tête affirmatif, ferme les yeux et joint les
mains. Les soldats pleuraient et on l'emmène. Pendant son transport, dans un chemin
creux battu par les balles, une d'elles traverse sa capote sans le blesser. Notre régiment fut relevé dans la nuit
du 12 au 13 octobre. C'est en arrivant au cantonnement de repos, le 13, que
j'appris sa mort survenue le 5 à l'hôpital de l'Océan, à Vinckem.
» Le 6 mai 1921 les restes de Jean Agache
quittaient la terre flamande qu'il avait si généreusement arrosée de son sang
pour être ensevelis dans celle de ses pères. A l'entrée du village natal plus
de sept cents personnes formaient la haie et escortèrent la dépouille mortelle
jusqu'à l'église. Après le service religieux elle fut conduite au cimetière par
le Conseil communal, la Fédération nationale des combattants et toute la
population templeuvoise. Là, sur la tombe du glorieux
disparu, M. Victor Derache, président des anciens
combattants prononça un magnifique discours dont nous extrayons ce passage : « Elle fut grande la moisson des templeuvois fauchés pour notre rédemption. Nos morts sont
couchés là-bas dans les plaines des Flandres, ensevelis dans un linceul de
gloire et d'immortalité ; la terre qui a bu leur sang les recouvre. La paix des
champs de repos les environne. Déjà leur mort fut féconde. La Belgique revit
sur leurs cendres, la vie a vaincu la mort, la semence a germé ! Templeuve
pouvait-il être sevré de sa semence ! Ceux de ses enfants qui sont tombés ne
reviendront-ils pas dormir à l'ombre de leur clocher ? N'aurons-nous pas l'âpre
joie de prier quand nous le voudrons sur leurs tombes et d'aller y recueillir
la leçon de vie qu'ils nous laissent ? Nous ne l'avons pas cru, et, un des
nôtres est désormais parmi nous. L'abbé Jean Agache, noble devancier de ses
frères d'armes qui, nous l'espérons, nous seront tous rendus. Une de nos plus
belles figures ouvre la marche, nous n'avons pas de plus beau joyau serti dans
notre couronne. Parmi tant de beauté, la sienne brille d'un éclat plus
attirant. Il résume trop bien l'héroïsme de tous les autres disparus pour qu'en
lui nous ne l'admirions pas tous. A le revoir, toutes les plaies se sont
rouvertes ; à contempler une fois de plus sa vie, toutes les espérances
renaîtront. Quels épis lourds de grains et riches d'espérance que ceux-là !
C'est notre cher Abbé Jean Agache que nous saluons. Les premiers bruits de
guerre, rapides comme une traînée de poudre, le surprirent dans sa paisible
cellule du séminaire de Tournai, où, seul avec Dieu, il trempait son âme
ardente pour les dévouements d'un avenir prochain. La mobilisation l'arracha à
ses rêves. Il fallut tout quitter, il fallut piétiner toutes les affections.
Parents bien aimés, amis, compagnons d'études, études elles-mêmes, tout fut
sacrifié. Il restait Dieu et la Patrie son idéal. Cet idéal n'admettait pas une
seule mesure de l'aimer, c'était de l'aimer sans mesure ; aussi a-t-il prodigué
tout ce qu'il avait de meilleur. Sa vie parmi nous, ses anciens frères d'armes,
est encore présente à toutes les mémoires. Ecclésiastique, l'abbé Jean Agache
fut versé dans l'équipe des brancardiers. Il ne lui convenait pas de faire œuvre
de haine. Il fit œuvre d'amour. Ce n'est pas à nous qu'il faut dire que ce
précieux ami de toutes les batailles, le brancardier, ne connut pas les dangers
communs, qu'il ne vécut pas comme le dernier des jasses
sous la menace des balles traîtresses, des obus meurtriers et des gaz
asphyxiants. On se sentait plus à l'aise quand il était notre bon samaritain
prêt à se pencher sur toutes les blessures, à nous relever, à nous sauver. » Mais le séminariste brancardier voyait
plus qu'un corps en ses compagnons d'héroïsme et de souffrance. Il savait que
pour que le corps tienne bon, il fallait que l'âme fût ardente et le moral
excellent. Il allait aussi aux âmes, à elles surtout, dirons-nous volontiers,
parce qu'il respectait l'ordre des valeurs établi par Dieu. Le moral des
soldats templeuvois, Monsieur l'abbé Agache ne
l'a-t-il pas toujours maintenu et exhaussé au cours de la campagne ? C'est de
lui que vint l'idée de fonder un journal qui serait le trait d'union des
soldats entre eux en même temps qu'il les ferait revivre un peu avec ceux qu'ils
avaient quittés. » J'ai nommé « Le tout Templeuve
guerrier ». Ce titre évoque en toutes les mémoires le souvenir de moments particulièrement
doux, d'heures plus intimes et plus humaines dans le grand bouleversement. Quel
réconfort c'était pour nous, quand nous apercevions ces modestes pages, quand
nous pouvions les lire et les relire sans omettre une ligne, quand nous
livrions à notre essai d'interprétation des nouvelles toujours trop brèves et
trop rares au gré de nos désirs. Avec toutes ces petites communications, Jean
nous envoyait un écho de son âme et la nôtre vibrait à l'unisson de la sienne ;
même absent, il avait le talent de nous retrouver et de panser les blessures de
notre cœur. Ce dévouement, et ce réconfort il nous les a prodigués durant des
mois et des années, les quatre interminables années que dura la guerre. Dieu l'avait
marqué du sceau de ses élus, mais il a voulu nous le conserver jusqu'à la fin
de l'épreuve. Cette lumière a brillé jusqu'au dernier jour, nous ménageant
toujours sa douce et pénétrante chaleur... » A côté de Jean Agache inscrivons ceux
des autres enfants de Templeuve tombés sur les fronts belges et français : Alavoine Joseph, Baudouin André, Blaze Albert, Callens
Arthur, Delmarquette Alexandre, Denis Fernand, Dewattripont Napoléon, Cossens
René, Coube Moïse, Hauwel
Léon, Joveneau Joseph, Liénart Eugène, Pollet
Richard. En 1920 un drapeau a été remis, par la
population de Templeuve, à ses vaillants défenseurs. A cette occasion le
lieutenant Maurice Agache, président d'honneur des anciens combattants,
prononça un vibrant discours dont nous extrayons ces lignes à l'adresse des
héros dont on vient de lire les noms : « Mais hélas ! dans
nos rangs, il est des places vides de ceux qui sont partis. Tous ne sont pas
revenus et vous me reprocheriez, n'est-ce pas, de ne pas évoquer ici leur
souvenir, eux dont le sacrifice total a payé la victoire de la Patrie. Ils sont
morts à la peine ; eux aussi, eux surtout, il faut qu'ils soient à l'honneur.
Ils sont la gloire de notre passé et une grande leçon pour l'avenir. Ils
apprendront aux jeunes générations ce qu'est cette chose sacrée : La Patrie. Nos
chers disparus, leur souvenir plane parmi nous, ils sont présents à cette fête
et je vois palpiter dans les plis de ce drapeau quelque chose de leur âme, un
peu de sang qu'ils ont versé pour lui. » Salut ! Drapeau sacré, immortel
souvenir de cette guerre cruelle mais glorieuse. Quand ces trois couleurs flotteront
par nos rues, au-dessus de nos campagnes, elles chanteront la Grande Victoire.
Qu'elles consolent aussi l'épouse, la mère, l'enfant. Car c'est pour l'Honneur
et le Droit que ceux qu'ils pleurent sont tombés. Que sur ton passage, noble
Drapeau, les têtes se découvrent et s'inclinent à la pensée des héros dont les
noms sont inscrits dans tes plis. » Le 24 octobre 1936 à l'occasion de la
célébration des fastes du Service de Santé il fut décidé, à l'initiative du
lieutenant-colonel médecin De Block qui soigna Agache sur le champ de bataille,
du capitaine Mary son commandant de compagnie lorsqu'il fut blessé et de l'aumônier
militaire Braquenier, que la chapelle de l'hôpital
militaire de la garnison de Mons serait baptisée du nom du brave et regretté
brancardier. Au cours du service funèbre chanté en la dite chapelle, à la
mémoire de tous les héros du Service de Santé, ce fut M. l'abbé Braquenier aumônier militaire principal qui fit le
panégyrique du brancardier Agache. En voici un passage particulièrement
émouvant et significatif : «Doué d'une belle intelligence
spontanément ouverte à toutes les magnifiques réalités de la science et de
l'art, il suivait avec le plus grand succès le périple de ses études, se
préparant ainsi d'être un jour un prêtre savant autant que distingué. Survint
la guerre qui, brusquement, l'amena comme tant d'autres sans aucune préparation
dans les rangs de l'armée. Je renonce à vous décrire l'état de nos âmes dans ce
milieu si différend de celui où jusqu'alors s'était déroulée notre existence.
Nous n'avions pas eu l'occasion, j'allais dire la chance, de faire notre
service militaire, car la loi nous en dispensait en temps de paix. Nous ne
connaissions rien de ces milieux militaires où nous nous trouvions tout
dépaysés et qui ne nous offraient rien de particulièrement attirant. Aussi,
furent nombreux ceux d'entre nous qui éprouvèrent une peine immense à s'y
habituer. Jean Agache dont l'âme jeune vibrait facilement au contact de toute idée
généreuse, sut, d'emblée, se mettre à sa nouvelle vie et y apporter l'exemple
de l'obéissance et de la discipline militaire la plus parfaite. Ce sera, du
reste, une des caractéristiques de son séjour de quatre longues années au
milieu des soldats, vivant avec eux dans le rang, partageant leurs maigres
joies et leurs innombrables misères, il saura rester simplement jusqu'au bout
le soldat modèle que les camarades n'avaient qu'à imiter pour servir
parfaitement. Les chefs sont unanimes à reconnaître et à déclarer qu'il était
un soldat modèle tant par sa vaillance que par son esprit de devoir. Car, il
était vaillant. Il faut, mes chers amis, avoir vécu ces années terribles pour
apprécier à sa juste valeur le rôle du brancardier dans une compagnie
d'infanterie. N'étant pas armé et ne pouvant pas se battre, il doit savoir
toujours être au danger, prêt à courir au secours du camarade qui tombe, pour
le relever, lui donner les premiers soins et l'emporter en lieu sûr. Qui dira
comme il convient le courage et la force morale nécessaire à cet obscur soldat
que n'enfièvre pas l'ardeur de la bataille et qui, cependant, peut, lui aussi,
tomber à chaque instant ? Ce qui était extrêmement pénible pour tant d'autres, semblait
facile à Jean Agache, car il avait une confiance sans limite en sa bonne
fortune et en la divine Providence. Il avait tant de fois connu le danger et
frôlé la mort qu'il se croyait invulnérable. Cela lui donnait un calme et un
courage qui se communiquaient à ses compagnons de lutte et en faisaient des
héros. Ajoutez à cela son esprit de charité et son amour profond pour les
soldats au milieu desquels il vivait. On peut bien le dire sans crainte
d'exagérer, si la qualité principale du soldat combattant est la vaillance, celle
du soldat brancardier est la charité. Plus il aimera ses frères d'armes, plus
il s'oubliera pour eux et se sacrifiera pour leur assurer les soins qu'ils
réclament. » Chers amis, si un jour la défense de
notre chère patrie nous oblige de recommencer la guerre, soyez de ces cœurs généreux
qui savent s'oublier pour ne penser qu'aux autres et, si vous avez besoin d'un
modèle qui puisse concrétiser à vos yeux cette charité fraternelle, pensez à
Jean Agache. » Voyez-le
aux tranchées comme au cantonnement, allant de l'un à l'autre, encourageant les
soldats, leur disant le mot qui touche et qui va droit au cœur, leur prodiguant
sans compter et son temps et sa peine, et ne s'estimant satisfait que lorsqu'il
croyait leur avoir fait du bien. J'en ai connu d'autres dans les infirmeries et
les hôpitaux, dont la besogne n'était jamais terminée parce qu'ils croyaient
n'avoir jamais assez fait pour adoucir le sort de ceux que la balle ou l'obus
avait cloué sur un lit de souffrance. » Ames d'élite, modèles de charité,
combien les soldats vous ont aimés et
qu'elle immense reconnaissance ils vous ont vouée. » Hélas ! si
Jean Agache se croyait immunisé contre le danger, en réalité, il n'en était
rien. Au cours de la grande offensive des Flandres, le 4 octobre 1918, c'est-à-dire
environ un mois avant la fin des hostilités, une balle de mitrailleuse le
blessa mortellement au cou. Il mourut comme il avait vécu, vaillamment,
simplement, saintement. Il avait rêvé d'être un jour un saint prêtre. Il fut un
saint soldat. Le soldat comme le prêtre ne s'appartient plus, il lutte pour une
grande cause et, quand il le faut, il se sacrifie sans hésiter. Tel fut Jean
Agache, clerc tonsuré du diocèse de Tournai, mort au champ d'honneur, pour sa
patrie, pour son Dieu et pour ses soldats. Qu'au ciel, son âme repose en paix !...
» Les pages qui précèdent montrent que
Jean Agache est le véritable symbole de la charité déployée par les 300
brancardiers et les 13 aumôniers militaires tombés au Champ d'honneur de la
grande guerre. C'est de pareils exemples qu'il importe de nourrir la conscience
d'un peuple si l'on veut qu'il soit capable de redressement dans les moments
difficiles. Jean Agache fut, aux tranchées, un des
plus dignes représentants de la spiritualité ; un agent de liaison entre la
terre et le ciel. Si, à la guerre, les uns ont commandé
avec leur cerveau et leur cœur, les autres, ceux que Jean Agache représente
avec tant d'éclat, ont avec leur âme, secouru les blessés, allégé les
souffrances, consolé les agonies et recueilli, pour être transmis, à la mère, à
la femme ou aux enfants les paroles des héroïques mourants. Tel est le sens,
telle est la leçon de cette biographie. Mais elle a encore une autre
signification. Elle atteste que le sacrifice des prêtres et des religieux, dont
les mains sont restées pures de sang humain et le cœur s'est gardé de la haine,
a été consenti pour faire descendre sur la terre, où les luttes entre
concitoyens s'exaspèrent, où les conflits entre peuples menacent de se
rallumer, un souffle purifiant et, par là même, par là surtout, apaisant. Puissent
les jeunesses d'aujourd'hui et de demain comprendre, accueillir et faire leur
cette pensée magnifique. Addendum : Jean
Agache créa « Le Tout
Templeuve guerrier » 
Jean Agache créa donc un journal destiné à donner des nouvelles de son pays de Templeuve à tous les soldats qui en étaient originaires. Il appela son journal « Le Tout Templeuve guerrier » avec comme symbole une épée droite et fière qui transperçaient toutes les lettres de sa ville natale. Un drapeau et un fusil croisés montraient la volonté et le courage des appelés. Le numéro 26 du journal mensuel publié en février 1919 est particulièrement émouvant car il reproduit une partie du discours prononcé lors du service funèbre de l’abbé Agache décédé, lors de l’offensive finale : II avait au milieu des soldats les qualités d'un chef ; une nature
affinée et sensible, un besoin de se donner sans cesse. Le jeune brancardier
comme toujours animait les hommes dans la furieuse ruée à travers les lignes
allemandes que fut la dernière offensive belge, quand une balle de mitrailleuse
le toucha et lui perfora le larynx, devant Beythem, le
4 octobre 1918. Frappé à mort alors qu'il se portait au secours d'un camarade
blessé, il eut le geste et l’inspiration des vrais chefs. « Je ne suis que
blessé », disait-il en souriant ; et sur le brancard qui l'emportait, il se
redressait pour donner confiance. II est mort des suites de sa blessure le 5
octobre 1918 à l'hôpital militaire belge de Vinkem. 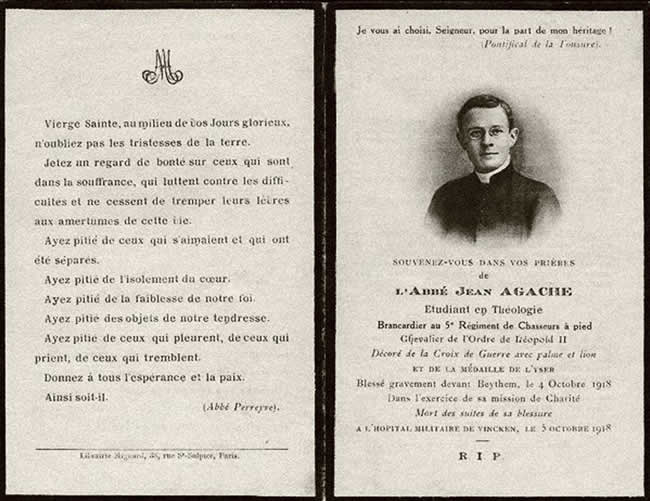
Le 6 mai 1921, sa dépouille mortelle revint à Templeuve. 1.500 habitants formèrent une haie d’honneur sur le trajet du cercueil vers l’église. « Le Tout Templeuve guerrier » parvint à garder tous les Templeuvois unis grâce à Jean Lagache et son équipe réactionnelle tant civile (Madame Durieux) que militaire (M. Mon cousin. M. Wilfart) [1] Tiré du livre : A. Jacoby « Au Drapeau » des Editions Jos. Vermaut. [2] Gallot, François, né à Marchienne-au-Pont le 6 octobre 1878 et tombé au champ d'honneur il Moorslede, le 1er octobre 1918. [3] Né àTirlemont le 13 septembre 1865 [4] Médecin adjoint du 2e Chasseurs à pied, né à Solre-sur-Sambre, le 20 mars 1891. [5] Garnir Alfred, né à Dour, le 15 mai 1887, un vaillant en effet. Capitaine en second. Chevalier des Ordres de Léopold et de la Couronne. Croix de Guerre. Blessé deux fois au cours de la guerre. Décédé le 3 décembre 1917 des suites d'une blessure par fils de fer barbelés qui l'emporta en 48 heures. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©