 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
GLOIRE ET
MISÈRE 1914 – 1918 TEXTE ET DESSINS PAR JAMES THIRIAR BRUXELLES
& PARIS LIBRAIRIE
NATIONALE D'ART ET D'HISTOIRE G. VAN OEST & Cie,
EDITEURS ––– 1920 
« L'armée est une nation dans la nation. » «
Il est convenu que ceux qui meurent sous l'uniforme n'ont ni père, ni mère,
ni femme, ni amie à faire mourir dans les larmes. C'est un sang anonyme. »
« L'armée est aveugle et muette. Elle frappe devant elle du lieu
où on la met. Elle ne veut rien et agit par ressort. C'est une grande chose que
l'on meut et qui tue ; mais c'est aussi une chose qui souffre. »
« L'abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du
martyr. Il faut l'avoir
portée longtemps pour en savoir la grandeur et le poids. » ALFRED DE VIGNY.
(« Servitude et Grandeur militaires. ») Le public me pardonnera de lui donner ce
modeste livre de guerre à l'heure où, pour beaucoup déjà, les canons pris sont
devenus de la vieille ferraille et les récits de campagne de vielles rengaines. Qu'il se rassure. Il ne trouvera ici que
des croquis sans prétention, accompagnés de pages documentaires. Le but ? Essayer de sauver de l'oubli
le petit côté de l'Histoire : essayer de montrer le soldat tel qu'il était. L'excellent historien militaire Winand Aerts, auteur de tant
d'études sur les guerres passées et plus spécialement sur les derniers jours de
l'Empire, a bien voulu m'aider dans ma tâche et entourer mes notes éparses de
son érudition.
JAMES THIRIAR Bruxelles. – Au premier jour de la
Victoire. Préface Il y a, depuis 1914, en Belgique, un créancier et un débiteur. Le débiteur c'est la nation tout entière, le créancier c'est l'armée. Dans cet album, destiné à payer une faible partie de la dette que nous devons à nos soldats, nous n'écrirons point la guerre, le moment n'est pas venu ; nous la décrirons. Nous essaierons – essayer est le mot qu'il faut, car la tâche est ardue autant que passionnante – de montrer ce que furent à la fois l'aspect des jass et celui des champs de bataille où ils versèrent leur sang durant quatre longues années de misère et de gloire. Notre ambition va très loin, sans doute, mais nous souhaiterions qu'on devinât, dans ces croquis faits sur place, dans ces notes prises au jour le jour, l'âme de nos braves et l'épouvante – nous allions dire l'horreur sacrée – des champs de bataille. Que le lecteur veuille bien, en tout cas, se figurer qu'il a devant lui, dans ces pages, l'armée, notre armée, telle qu'elle fut réellement aux champs glorieux de Liège, de Haelen et de Dixmude. Nous allons dérouter beaucoup de gens, bousculer bien des idées reçues, détruire un grand nombre de préjugés, mais, pour qui sait voir au delà d'une vaine apparence, l'armée de la Belgique n'en sortira que plus sympathique. Nos pauvres petits soldats ! Quel est donc ce ministre qui, sur la fin du XVIIIe siècle, conseillait à son souverain de vêtir en bleu le régiment de sa garde, et auquel le monarque, désabusé, répondait avec amertume : « F ... - les en bleu, f... - les en rouge, f...- les en jaune, ils f... tout de même le camp devant l'ennemi ! » Au rebours, on a pu vêtir nos régiments de toutes les manières, on a même pu ne pas les vêtir du tout, ils ont toujours tenu. Mais pour certains auteurs, et non des moindres, voilà un peu ce qu'on pensait en Europe de notre armée avant la bataille de Liège, et nous ne serions pas en peine de citer tel écrivain en renom qui avait pris à cœur de tourner en ridicule, sans grande dépense d'esprit, il faut le dire, les petits Belges. Et c'étaient les fuyards de Waterloo, ou la mascarade de la 628-E-8, l'armée de carton, la troupe grotesque, digne d'une principauté de Gèrolstein, où – suivant une revue anglaise – le corps d'ambulanciers et de musiciens dépassait de beaucoup l'effectif combattant ! Confiante en la foi des traités, engourdie de bien-être et de sophismes, rassurée par sa faiblesse même, la Belgique fut lente à rénover son armée, à la débarrasser d'anachronismes flagrants. Aussi, quand se déchaîna la tourmente, nous ne possédions ni flotte aérienne, ni grosse artillerie, ni recrutement général, ni uniformes de campagne, mais nous avions des dolmans chamarrés, des plumets, une garde civique et des bonnets à poil. 
Patrouille de Lanciers – Août 1914. Comme tous les régiments de Belgique, les Lanciers avaient conservé un uniforme vieux de plus de cinquante ans et ne répondant plus en rien aux nécessité de la guerre moderne Et c'est ce qui donnait prise à l'ironie dont se mêlait le vague mépris de nos voisins, tout aussi fiers par ailleurs de leurs beaux ajustements guerriers, mais ayant sur nous cet immense avantage d'être millions où nous étions milliers et de posséder un en-cas de feldgrau, de kaki et un matériel adéquat aux exigences du siècle. Surpris, nous avons jeté dans la bagarre nos carabiniers en chapeau miroitant, nos lignards en taconnet écrasant les tempes, nos guides en pantalon rouge... et nous avons vu revenir une armée extraordinaire, si extraordinaire que nous ne l'avons pas d'abord reconnue, une armée coiffée de fer, vêtue de brun, avec des canons monstres, peinturlurés, camouflés, des baïonnettes sérieuses, des généraux qu'on ne distingue pas à six pas des sous-lieutenants, semblables eux-mêmes aux simples Jass. Comment s'est opéré ce prodige ? De quelle manière s'est enfin solutionné le problème à l'étude depuis de longues années ? L'histoire officielle dira qu'il a suffi d'un arrêté-loi. Eh bien non ! Ou tout au moins a-t-il fallu, pour en arriver là, des mois de tâtonnement et de misère. Et c'est plutôt d'en bas qu'est venue la transformation. Les pages qui vont suivre le prouvent, et la vérité y trouvera son compte, non seulement pour cette guerre-ci, mais pour toutes. C'est presque un lieu commun de reléguer au rang de la fantaisie les belles toiles qui, dans nos musées d'Europe, avaient la prétention de représenter fidèlement l'épopée guerrière de Louis XIV à Napoléon. C'est trop de dire qu'il n'y a jamais eu de guerre en dentelle, ni de volontaires tels que les décrit Lamartine, ni de batailles de l'Empire en grande tenue de parade. Tout le monde le sait. Et, pourtant, cette concession faite à l'exactitude n'est pas suffisante. A nous donc les croquis faits au front et les récits véridiques et cruels de la vie en campagne. A nous les vîs paltots et les vainqueurs en loques de l'Yser. Ceux-là pourront nous dire pourquoi l'histoire du vrai costume de bataille des siècles passés est encore à venir, pourquoi le pékin ne sait pas, ne peut pas savoir ce que c'est qu'un champ de bataille. Les essais tentés dans ce genre sont, en général, peu connus. Callot et quelques autres, très rares, ont peint le soldat tel qu'il était et soulevé un coin du rideau brillant, tissé d'étincelants mensonges, avec quoi l'on tient les foules en respect et en admiration. Qu'elles sont étranges, angoissantes, ces choses entrevues dans l'œuvre d'un Goya, d'un Faber du Faure, d'un Vereschagin ! Mais, faut-il le dire ? Pas plus qu'une goutte froide jetée dans une cuve d'eau bouillante n'en fait baisser la température, pas plus la révélation des horreurs qui l'accompagnent n'a pu réduire l'attirance de l'homme pour la guerre. Cet hypnotisme du danger, et, tranchons le mot, bien qu'il ait fait sourire quelques sceptiques, cette soif de la gloire, ne sont que trop réels. Disparaîtront-ils quelque jour ? En attendant, il serait puéril et même dangereux d'en nier l'existence. Nous avons parlé des champs de bataille : l'aspect n'en est pas moins déroutant pour les non-initiés que celui d'une armée en campagne, surtout s'il s'agit d'un champ de bataille de cette dernière guerre. 
Ceux du début – Août 1914. Gendarmes, Guides, Carabiniers, Artilleurs et Prêtres-brancardiers au début des hostilités Jadis, le choc qu'on appelle une bataille n'était ni moins terrible, ni moins meurtrier, mais jaillissant en flamme rageuse, il s'éteignait au bout de quelques heures. Jusqu'au milieu du siècle dernier, plus tard encore, les rangs serrés étaient la règle, et il en résultait d'indescriptibles cohues, des confusions sans nom. Quand se produisait une accalmie, que les adversaires regagnaient leurs positions et que les épais nuages blancs de la poudre se dissipaient, le terrain où avait eu lieu la rencontre grouillait de cadavres, de blessés, de chevaux à la débandade, d'armes, d'objets d'équipement et de canons. De nos jours, la lutte s'est éparpillée sous la pluie infernale de projectiles énormes. L'infanterie se terre, la cavalerie n'agit plus en masse, les canons disparaissent sous les camouflages ou dans des fosses. Les boulets du XVIIIe siècle qui s'acharnaient souvent en vain contre les fermes et les villages ont fait place aux obus de rupture, aux torpilles, aux mines devant quoi s'évanouissent au bout de quelques jours, la bataille encore à son début, toutes traces de construction, de plantation. Bois, maisons, villages, collines, tout disparaît dans une sorte de tremblement de terre : ça et là quelques débris fument au milieu d'immenses excavations, comme les fumerolles d'un cratère; le sol raviné, labouré se déforme lentement. Des volcans de terre, des flocons blancs ou noirs ; çà et là quelques infiniment petits bondissant en chaîne lâche, à peine distingués du terrain où ils se plaquent immobiles toutes les dix secondes, et c'est l'assaut parfois décisif. Dans ces conditions, il ne peut être question de représenter un champ de bataille. Il faut bien se rabattre sur le côté épisodique, le détail aperçu, la petite « chose vue ». Un mot pour finir. Cet album n'est pas un musée des horreurs de la guerre. Le hideux cortège qui fait autant que jamais escorte à Bellone n'est point dans notre programme, encore qu'on en puisse entrevoir les ombres et les reflets dans quelques-unes des compositions qui suivent. Mais à cela près, ni le soldat qui a dessiné ici ce qu'il avait eu sous les yeux, ni l'écrivain qui a rassemblé et condensé les notes éparses dans ses carnets de campagne, n'ont voulu théoriser de quelque manière que ce fût. Seulement, il leur était impossible d'embellir, ou pour dire mieux et plus juste, de parer, de camoufler ce que fut cette campagne de quatre ans en Belgique. Ils ont été sincères, rien que sincères et c'est le seul mérite dont ils se réclament auprès du public. 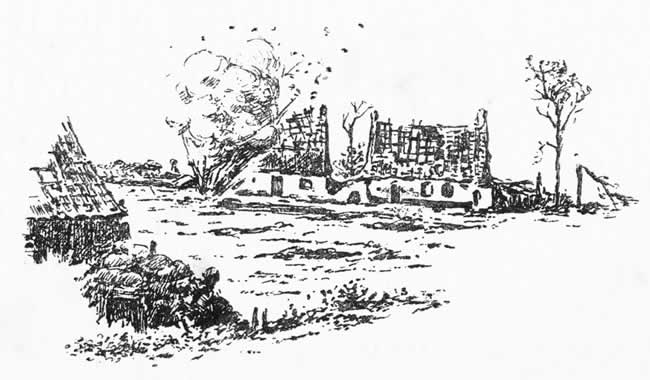
Ce n'est pas que nos troupes n'eussent l'allure qui convient à des gens décidés à entrer sans défaillance dans une grande aventure. Rien de plus martial que ces chasseurs, ces lignards, ces carabiniers, chargés du lourd paquetage de campagne et semant aux quatre coins de l'horizon leurs chants de route ou l'alerte sonnerie de leurs petits clairons. Rien de plus beau que la masse sombre des grenadiers quittant Bruxelles musique en tête au milieu des acclamations. Nulle troupe comparable à cette escorte vraiment royale, à cette gendarmerie à cheval, grave et puissante comme une phalange de la vieille garde. Splendides encore, ces colonnes de l'artillerie manœuvrant sans accroc à la voix calme d'officiers gantés, astiqués, impeccables. Et autant pour tous ! Mais cet appareil guerrier qui était le nôtre en 1914, ces capotes sombres, ces tuniques et ces képis passementés, ces talpaks, ces colbacks, ces oursons tombant aux yeux, ce rutilement de cuivre et d'acier poli, de culottes rouges et de shakos vernis, tous ces équipements, si crânement portés qu'ils fussent, évoquaient un autre âge, une époque déjà lointaine, tout à fait enterrée aujourd'hui. Il ne semblait pas que quarante-quatre ans nous séparassent d'un 1870 toujours présent à nos souvenirs, obsession qui faussait toutes nos conceptions d'une guerre possible, en ce moment certaine. Et la méthode de nos adversaires, sinon leurs costumes, ne fut point d'abord pour ébranler la conviction qu'il en serait toujours ainsi, que rien n'était changé, et que Rezonville – ou Sedan – étaient d'hier. On savait si peu chez nous les noms barbares de Liao- Yang et de Kirk-Kilissé. Voyez plutôt Liège, où l'infanterie ennemie donne l'assaut en masses, et Haelen où sa cavalerie renouvelle les charges d'un Bredow ou d'un Auerswald. Puis, par là-dessus, des dates évocatrices, un grand diable de soleil, du mouvement, des routes poudreuses où s'allongent les colonnes, comme en cette marche fameuse de la 4e brigade le 12 août, des estafettes lancées à fond de train, des vergers où escarmouchent les uhlans et les hussards de la mort, ici une compagnie brandissant fièrement des casques à pointe – les premiers trophées ! – là un drapeau de la ligne fièrement encadré de vieilles moustaches grises; plus loin un général haranguant des bataillons qui défilent, harassés, rendus : « Soldats ! La Belgique a les yeux sur vous ! » Puis, pour que cela n'ait point trop l'air grande manœuvre ou petite guerre, çà et là un groupe saignant et livide de blessés ; dans les prairies, par petits tas, des choses loqueteuses, des haillons sans forme, qui sont des cadavres, et au loin, parmi les arbres ébranchés, décortiqués par les premiers obus, un village qui flambe en crépitant sous un grand panache de fumée rousse. Cela c'est le beau temps où l'illusion
règne maîtresse aussi bien chez l'ennemi que chez nous et dans les camps des
alliés. « Guerre joyeuse et rafraîchissante, clame l'entourage du Kaiser : dans
un mois nous serons à Paris ! –
On va les bouffer, y va pas en rester, ripostent les Français ». Les autos
parquées à l'arrière sous des signes cabalistiques CAMACAMI, etc., hiéroglyphes
devenus depuis une langue courante, les avions timides, pas bien nombreux,
toutes ces innovations : grenades, aéros,
mitrailleuses, dirigeables, canons monstres, ne font partie de l'appareil
guerrier que sous bénéfice d'inventaire. 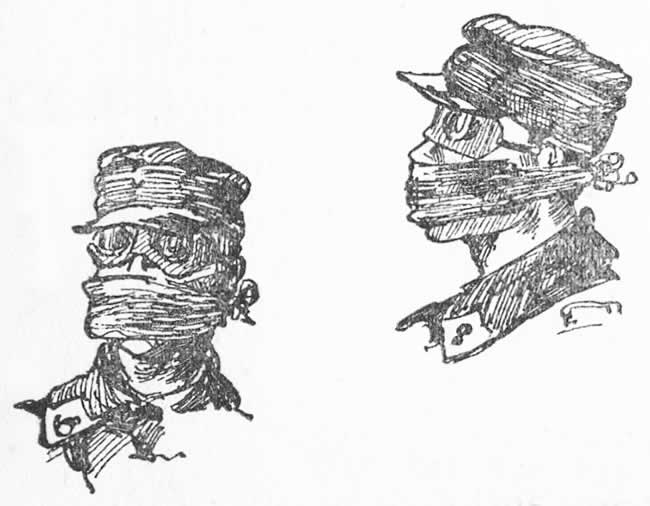
Les tanks et les gaz
asphyxiants, les cuirassés de l'air et les liquides enflammés sont encore dans
les limbes. Nous en sommes toujours à l'imagerie un peu vieillotte ; notre imagination honnête et naïve
néglige Wells et se porte de préférence vers les pantalons rouges et les
casques à crinière, les kilts et les cornemuses des divisions de Joffre et de
French que notre armée sent confusément s'agiter derrière elle dans une mobilisation
pleine de fièvre. Illusion de courte durée.
Nous allons être seuls, longtemps, et l'ennemi jusqu'ici n'a fait que tâtonner,
jouer (jeu dangereux qui lui coûtera cher, soit dit en passant). Il va
démasquer des moyens de guerre devant lesquels s'évanouira très vite le rêve
d'une campagne à la vieille manière – selon nos croyances. A un demi-mois
à peine de la déclaration de guerre, cent détails ont modifié l'aspect de nos
soldats et prouvent l'insuffisance de leurs uniformes de campagne. Sans parler de marches et contre-marches sans nombre qui ont en quelque sorte patiné
les tenues, la sinistre et glorieuse journée du 18 août, qui porte en elle
comme un souffle glacé, dévoile une de nos plus grandes erreurs : pour un seul
régiment, le 22e de ligne, quatorze officiers tués, dont sept chefs
de compagnie, et douze blessés. A ce taux-là, les cadres fondent comme la neige
aux rayons du printemps. Et d'instinct, les
officiers abandonnent leur trop voyants insignes : la housse en toile cirée de
leur shako disparaît, à moins que, ternie, peinte au hasard de l'inspiration,
ou simplement trempée dans la terre humide et la poussière, elle cesse d'être
indiscrète. Les officiers des
grenadiers étaient partis en képi galonné d'or : celui-ci va rejoindre...
les tambours, et pour les remplacer, plusieurs adoptent le petit bonnet rond de
la troupe, cette galette jadis si familière à toutes nos villes de garnison. 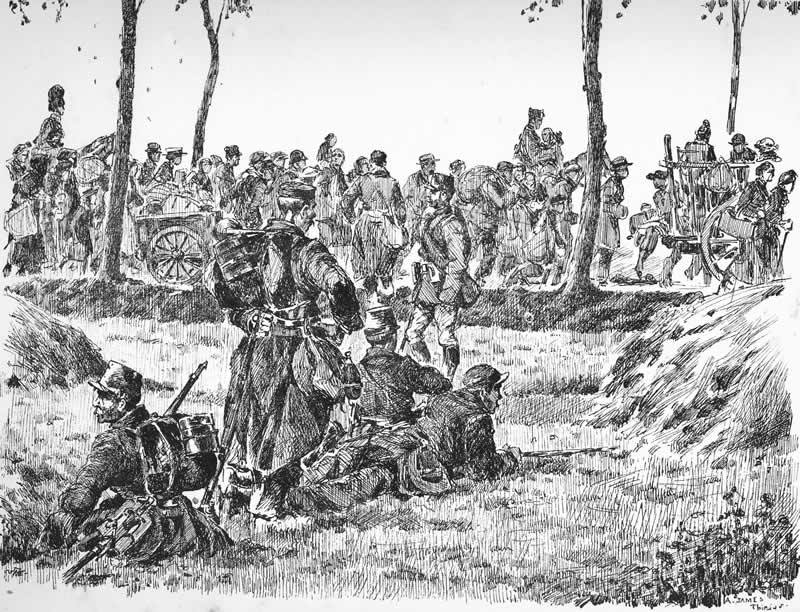
L’exode – Août 1914. Parmi les spectacles de la guerre, la fuite des villages entiers au milieu de la retraite de nos troupes, fut certes le plus lamentable Disparus aussi les pompons
d'or, et ces sabres dont le fourreau d'acier poli décèle de trop loin la
présence des chefs. L'exemple est suivi par la troupe : en peu de jours, tout
ce qui encombrait inutilement les hommes, tout ce qui était susceptible de
trahir, d'allonger la cible vivante, tout ce qui dépassait la silhouette
réduite à sa plus simple expression, est honni, banni, rejeté d'office, sans
souci des règlements ni de l'élégance. Dans ces cas-là c'est
toujours le couvre-chef qui écope : ainsi firent les grenadiers de la Garde à
Essling et les régiments de ligne pendant la campagne de 1859 en Italie. Nos
lanciers s'en prennent à leur shapska, trop semblable
à celui des uhlans et cause de méprises funestes aux heures blêmes de l'aube et
du crépuscule. Les gendarmes ont plus de peine à se séparer de leur ornemental
ourson ; ils le suspendent à l'épaule pour cacher les aiguillettes trop
claires. 
Peu à peu, les shakos font
place aux bonnets de police que l'on retourne pour en faire disparaître le
bandeau rouge, et auxquels on adapte une visière, comme avaient fait déjà les
carabiniers-cyclistes. Des diables, ceux-ci, de véritables démons, bien loin de
se douter pourtant que Berlin les a faits légendaires. Ils sont partout, ils
passent partout, tantôt pédalant à toute allure sur d'impossibles chemins, ou fouillant
les bois et les vallons la machine au dos, le fusil au poing. Appuyés par
quelques randonnées de nos guides, non pas nos beaux guides des jours de revue,
mais de singuliers bonshommes, hirsutes, au teint recuit sous leur colback
ébouriffé, la veste décolorée, la carabine en banderole comme les chasseurs de
l'Empire ; avec quelques pointes hardies de lanciers, de gendarmes et d'auto-mitrailleuses, nos cyclistes désorganisent, décousent,
tailladent l'immense réseau du service de reconnaissance si habilement monté
par l'état-major allemand, désormais hésitant, rageur, persuadé que la ridicule
petite armée du roi Albert masque la concentration d'énormes contingents
français et britanniques ; n'a-t-on point aperçu les pantalons rouges ? Mais si les basanes garance
des guides troublent étrangement le Grosse Generalstab,
il est bien permis aux officiers boches en mission de s'esclaffer à la vue des
blouses bleues, des bonnets 1830, des piques et des carabines Flobert de la garde urbaine, arrière-ban de la garde
civique. Tarasconnade ? Que non pas.
Ignorance tout au plus. Formée en bloc de braves gens, rentiers, commerçants,
pères de famille sans l'ombre d'éducation militaire, notre garde civique ne
pouvait être qu'encombrante. Revenus de leurs illusions, un grand nombre de ces
« soldats du dimanche », débarrassés des zwanzeurs qui avaient eu bien vite «
l'horreur du métier des armes » (le mot est d'un officier des bleus), rentrèrent dans le rang, et
firent modestement et bravement leur devoir. Car si l'institution ne valait
rien, les éléments qui la composaient furent souvent très bons. On en pourrait donner mainte preuve. Même, certains escadrons de
la milice citoyenne furent cités avec éloge, en dépit de leur allure
carnavalesque encore que truculente : rapières monumentales, carabines
hétéroclites, revolvers à faire pâlir les « Bucks »
du Far-West, bonnets roux aussi mal notés que le czapska
des lanciers à cause d'une sinistre ressemblance avec ceux des hussards
ennemis. Allons plus loin. Dans
cette période de la guerre qui s'étend du mois d'août à la fin d'octobre 14,
les volontaires ne valurent pas beaucoup mieux que la garde civique. Certes l'enthousiasme était
émouvant, qui fit s'enrôler par milliers des hommes de tout âge et de toute
condition, mais l'enthousiasme ne fait pas une armée, et si l'infanterie de la
garde civique se distingua surtout par son manque de sang-froid, son
laisser-aller déplorable et sa tenue plus que relâchée, les volontaires belges,
vêtus à la hâte, conservant parfois leurs habits civils, faute de mieux,
équipés de sacs de toile, armés de vieux fusils français, furent plusieurs
semaines à se mettre au pas. Mais quoi ! il fallait tout
improviser, pourvoir à tous les besoins, parer à tant d'éventualités ! L'état
de désorganisation profonde où se débattait la Belgique n'a rien ajouté,
pensons-nous, à la gloire de son agresseur. * * * Avez-vous lu la Guerre
des Mondes ? Il y a là, entre autres, une page étonnante, admirable, où
Wells décrit la fuite de Londres devant le péril martien. C'est à se demander
dans quel cauchemar apocalyptique l'écrivain anglais a puisé les linéaments et
les détails de cette scène : tout un monde en marche, dans une sorte de panique
froide, la cohue, la poussée irrésistible, bestiale, la foule transformée en
torrent où des êtres humains succombent et disparaissent, une rumeur incroyable
faite de cris, d'appels, de jurements, de hurlements, auxquels succèdent par
instant non pas le silence, mais le seul bruit très distinct du piétinement des
chevaux et des hommes, du roulement de tous les véhicules possibles ... Eh
bien, cette vision d'épouvante s'est transportée dans la réalité. Ceux qui ont
vu la fuite d'Anvers devant le péril allemand sont là pour attester que le
romancier n'a rien exagéré. Dans cet exode éperdu de
tout un peuple, que devenait l'armée ? Après d'âpres combats dans la zone qui
s'étend de Boom à Hérenthals, nos régiments décimés
avaient reçu l'ordre de se replier sur la rive gauche de l'Escaut. Cette
retraite a été racontée, et il n'entre pas dans notre cadre de dire ce qu'elle
fut, sinon au point de vue tout spécial qui nous inspire. L'aspect des premiers jours
n'existait plus. La bataille avait passé sur tous ces hommes, et la misère se
montrait sous la forme de vêtements déchirés, de chapeaux de toute sorte «
réquisitionnés », d'espadrilles et de savates quelconques remplaçant les
souliers réglementaires. La division qui avait
combattu à Namur, et dont la retraite s'était prolongée dans tout le nord de la
France jusqu'au delà de Rouen, exhibait des uniformes disparates, des
équipements et des képis français, jusqu'à des chéchias de zouave. L'un de ses
escadrons, remonté en selles, brides, paquetages et lances allemandes évoquait
le souvenir de ces uniformes de prise si fréquemment portés au début du siècle
dernier. 
Les demi-soldats. On en fut encombré au début : gardes-civiques, gardes-urbaines, volontaires, brancardiers, automobilistes et boy-scouts, tous animés des meilleures intentions, mais ne parvenant pas à être « à la page » On innovait le képi à la
serbe. La détresse de nos uniformes minables était rendue plus vive encore par
la présence des troupes anglaises équipées de neuf et d'une propreté, d'une
netteté qui sont l'apanage de cette armée. Les Allemands faisaient des gorges
chaudes de ces bataillons de milice et de yeomanry et annonçaient gravement aux
provinces belges occupées que « l'armée anglaise manquait de vêtements, de
cornemuses et de papier à écrire ». Mais les Tommies
jaillissaient du sol, encourageaient nos jass
par leur sang-froid et leur sens pratique. C'est à Anvers sans doute que naquit
l'idée de s'inspirer des uniformes et du paquetage si bien compris des soldats
britanniques, mais comme d'habitude, le projet fut longtemps à l'état de germe,
et tout se borna pour l'instant à quelques imitations individuelles – le
ceinturon à bretelle des officiers par exemple. Sous la protection des Anglais,
l'armée belge disparut, emportant avec elle ses blessés, son matériel, ses
drapeaux, son Roi. Alors, c'est le calvaire
douloureux, ô très douloureux, qui ne se dénouera que sur l'Yser. C'est que, il faut bien le
dire, notre armée en quittant Anvers avait le moral profondément attaqué. La
misère n'était pas que sur les uniformes. Tous les hommes la portaient au cœur. Jamais peut-être, durant
ces quatre années de guerre, nos troupes n'eurent-elles à subir une crise
semblable. Comment ? on avait laissé
de son sang et de sa chair à Liège, à Louvain, à Namur, à Anvers, on avait
trimé, sué, combattu, crevé de faim, pleuré, on s'était arraché le cœur, et tout cela ne
servait à rien : on abandonnait Liège, et Louvain, et Bruxelles, et Namur, et
Anvers, on parlait d'abandonner Gand et la côte, tout le pays alors ? On
laissait derrière soi les vieux, la femme, les gosses, la maison, les champs, à
la merci de l'ennemi, et de quel ennemi ! Ah ! les phrases toutes
faites sur l'héroïsme ! Oh le bon billet ! Ce jour-là, le jour où
l'armée apprit que la reculade continuait, elle connut le désespoir. La retraite ne fut pas un
mouvement militaire, pas une fuite non plus. Autre chose. Ce fut morne,
machinal. Des régiments réduits à des bataillons, des uniformes devenus
haillons, plus de rangs, plus de grades, plus de musiques. plus de chansons de
route, plus de paroles même ; des êtres hébétés, n'ayant plus que
l'instinct des troupeaux. Alors, l'Yser ? la bataille
de douze jours, sans trêve, sans pain, sans appui, sans artillerie, la
résistance quasi-fabuleuse aux attaques cent fois renouvelées de masses soûlées
d'éther et de discipline, couvertes par une artillerie fantastique ? On peut affirmer
aujourd'hui que ce qui sauva l'armée ce fut la fuite de la population d'Anvers
et des Flandres. Ce spectacle était fait
pour bouleverser jusqu'aux âmes les plus frustes. Au passage de l'Escaut, sur
les ponts de fortune lancés par le génie, le torrent des fuyards fut un instant
arrêté, bloqué par sa densité même. Il y eut là des scènes d'horreur dignes
d'une Katzbach ou d'une Bérézina. La panique gagna la
rive gauche où des villages entiers furent désertés, et le flot de la débâcle
emporta les populations vers la Hollande ou vers la côte. En présence de cette fuite
apeurée, de ce désastre auquel nul d'entre nous, Belges, n'eût jamais osé rêver
sans hausser les épaules, devant l'attitude calme et décidée du Roi au plus
fort du danger, nos soldats se reprirent. Toutes leurs misères disparurent
devant une misère plus grande. Ce fut comme un appel émouvant et désespéré de
la patrie, nul n'y résista, tous consentirent le sacrifice jusqu'au bout. Et voilà pourquoi nos
malheureux soldats ont tenu sur l'Yser. Le jour où vint cette célèbre proclamation
du Roi qui disait la retraite terminée, le soulagement fut inexprimable. La
Belgique inviolée n'était plus qu'un territoire de quelques arpents. Eh bien !
on défendrait ce reste de patrie et l'on se moquerait de toutes les légions du
Kaiser ! * * * Tous les combattants de
l'Yser ont pour parler de la bataille d'octobre 1914, les mêmes expressions,
qui se résument en ce seul mot : l'enfer. Dans cette guerre si longue où
l'horreur devait aller croissant, il y eut mieux pourtant, et Verdun fut
peut-être plus tragique. Mais en octobre 1914, Verdun était loin, et nulle part
on n'était fait dans l'Europe occidentale à de si dramatiques épisodes. 
Toujours encore, les
survivants de Dixmude et de Nieuport gardent de ces douze ou quinze journées de
bataille une impression profonde, mais confuse, et ce n'est étonnant si l'on
songe à la succession vertigineuse des gestes violents, imprévus, au
déchainement combiné de la lutte des éléments, de la tempête d'artillerie, du
prodigieux feu d'artifice des fusées et des incendies, de l'attaque renouvelée
sans répit, non seulement tous les jours, mais toutes les nuits. Dans ce
tremblement de terre, dans ce fracas cyclopéen, dans ces lueurs et ces
écroulements que zèbre sans relâche une pluie diluvienne, nos soldats
apparaissent comme des ombres, et l'on chercherait en vain chez eux une trace
familière d'uniforme ou d'aspect d'avant-guerre. Ils sont en loques, ils sont
méconnaissables. Ils sont d'ailleurs les infiniment petits, ployant sous
l'énorme tourmente, comme des fourmis envahies par l'inondation. Et cependant
ils font tête, ils offrent ce spectacle admirable d'êtres pensants venus à bout
d'immenses forces brutales par le seul miracle de leur volonté. A l'endroit même, et ce parallèle est
émouvant, à l'endroit même où leurs ancêtres avaient lutté contre la force
prodigieuse de l'océan et l'avaient vaincue, ils luttent, eux aussi,
victorieusement contre l'avalanche des légions grises incapables de leur
arracher ce dernier refuge de la Patrie. Et quand s'éteint l'incendie, quand
les gros canons se taisent, essoufflés,
quand la plaine devant eux n'est plus qu'un épouvantable charnier où
l'eau suinte ils demeurent, ils sont là, défigurés, sanglants, noircis,
déchirés, boueux à force de s'être enracinés dans ces quelques arpents de terre
qui représentent désormais toute la Belgique, dans cette glèbe avec laquelle
leur chair se confondit pour résister mieux. 
Eclaireurs anglais dans les dunes – Octobre 1914. Sitôt débarquée, l’étincelante cavalerie anglaise commença son métier de scout dans les dunes Mais qu'ils sont beaux
quand même nos soldats ! Comment s'étonner que la bataille de l'Yser soit
entrée de plain-pied dans la légende et que la physionomie vraie de ses héros
se soit estompée, effacée, pour faire place à une idéalité de gloire et
d'héroïsme ? Oui, la légende s'est d'ores
et déjà emparée de ces grandes figures, de ces actions héroïques, de ces
épisodes mémorables. C'est le 7e de
ligne, dont tous les hommes ont mérité la croix d'honneur attachée par le Roi
au drapeau du régiment. C'est la 28e batterie d'artillerie avec Colson et Cambrelin, la 45e
avec Wéry. C'est Meiser
avec ses piottes, Henri d'Oultremont avec ses
grenadiers. C'est Jacques, frappé sur la grande place en feu de Dixmude, mais
continuant de diriger la défense. Il pourrait dire, celui-là, comme trois siècles
auparavant l'archiduc Albert à la bataille de Nieuport : « je suis esté ung peu blessé... mais ce
n'est chose de moment. » Jacques, vieil Africain, a des mots à lui. A l'ordre
du G. Q. G. « qu'il faut tenir à outrance la tête de pont de Dixmude », il
répond goguenard : « Rien n'est plus exact. » C'est Ronarch
dont la silhouette de rude marin breton est pour toujours liée au souvenir de
cette terrible halte de Caeskerke, d'où il commande
ses demoiselles en pompon rouge, troupe admirable. C'est l'enterrement sous les
obus du brave commandant Pouplier, dans ce petit
cimetière où les obus allemands éventrent les tombes et brisent les croix.
C'est l'assaut mortel de ces six compagnies du 11e de ligne menées par Leestmans, « épisode
inoubliable, tragique et grandiose entre tous », dit l'histoire. C'est enfin le tas sublime
des héros anonymes, plus nombreux que les autres. Or, en ces heures
glorieuses, réduits à se vêtir comme ils pouvaient, privés de loisirs pour
faire le moindre brin de toilette, mal nourris, éreintés, grelottants et
fiévreux, contraints de laisser s'éveiller en eux au souffle de la guerre les
instincts primitifs latents, nos soldats n'étaient pas loin de rappeler
certaines bandes de condottieri fameux dans l'histoire. N'inventaient-ils pas
le mot « dixmuder » pour désigner le fait, en
d'autre temps répréhensible, de s'approprier sans scrupules ce qui leur
semblait bon ? Ceci ne doit effaroucher
personne. Rappelons que cet état violent, tout passager d'ailleurs, était imposé
non seulement par le contact des troupes africaines, mais par la dure loi de la
lutte pour l'existence. La civilisation est un grand mot, mais était-ce avec
des discours sur la morale et des élans de mansuétude que nous pouvions songer
à vaincre les hordes barbares ? Et ne sommes-nous pas bien heureux, au fond,
d'avoir pu opposer une bande de loups à la troupe des chacals ? * * * Rien n'était plus semblable
à nos soldats que ces volontaires en loques, si superbement illustrés par
Raffet : mêmes grands airs farouches, mêmes guenilles héroïques, mêmes sabots. Sortie de la bataille,
l'armée se trouvait dans un dénuement terrible ; pas de magasins à l'arrière,
pas de ravitaillement, pas de dépôts, tout était à faire, à organiser. Les régiments présentaient un chaos
d'uniformes de tous genres : vieux vêtements du début, capotes noires, shakos
défoncés, archaïques bonnets de carabiniers et de grenadiers, képis à oreillères, semblables à des casquettes d'aveugles, et des
vestes, et des tuniques et des pantalons de toutes les toiles et de tous les
draps ; morceaux d'uniformes français : capotes bleues, képis, bonnets de
marin. Et puis la plus outrancière fantaisie qu'il soit possible d'imaginer :
chapeaux mous et melons, casquettes, shandails de
laine, même des golfs de femme. Plus tard, le velours à côtes gris ou brun sera
quasi d'ordonnance, si ordonnance il y a... 
On en fera des culottes
bouffantes portées avec des surculottes de toile, et
de minuscules vestes qui, avec les sabots et les molletières, donneront aux
soldats l'allure de paysans hollandais. Les chaussures ? De vieux
godillots baillant la misère pour les plus fortunés, les autres iront en
galoches de bois, en espadrilles, en sabots, ce qui fera des relèves clapotantes ; d'autres enfin iront pieds nus, voilà tout.
Et l'on songe à la superbe estampe de Raffet, où un représentant aux armées de
la République promet une paire de sabots aux hommes s'étant bien comportés. Pour compenser ces
haillons, réchauffer les membres transis, dans les abris, les granges
écroulées, les églises froides, on s'enroulera dans force couvertures, les plus
bariolées et les plus multicolores. Il y avait de vraies
couvertures, provenant des villas et des hôtels, mais il y avait aussi des
tapis de table, des rideaux à grands ramages dans lesquels on se drapait, ou
que l'on portait troués à la manière de ponchos mexicains ; en route ils
étaient roulés sur le sac, mis en bandoulière ou en ceinture. Le soldat adore, en
principe, tout ce qui, le faisant sortir de l'ordonnance, lui donne une allure
personnelle. Pour ce, cette misère fut l'âge d'or. Que de trouvailles ! Ainsi
l'écharpe dont on s'emmitouflait la tête, quelle source heureuse de
combinaisons ; la variété de formes et de couleurs était infinie, et l'on se
souvient d'un nègre magnifique cravaté d'orange ; fort bien porté également, le
passe-montagne, qui fut à la « mode » dans cette misère. Comme au début de la
campagne, on avait, pour se délasser les jambes, envoyé les guêtres dans tous
les fossés de Brabant et de Flandre, on se trouva en plein hiver, les jambes
dégarnies ; les Français et les Anglais portant la bande molletière, nos hommes
eurent tôt fait de les imiter. Il en vint de partout, même de l'Intendance !
Pour les confectionner on découpait les couvertures des tués, ou bien même, de
vieux rideaux et de vieux sacs. 
Les premiers étrangers en Belgique – Octobre 1914. Ce fut la première partie du formidable défilé de troupes alliées en Flandre : Ecossais, Hindous, Sud-Africains, pour l’Angleterre ; Goumiers, Fusiliers-marins, Pioupious innombrables pour la France 
A l’Yser – Les funérailles, Hiver 1914 - 1915. Nos soldats, lors des grandes journées d’octobre, étonnèrent le monde, mais leurs pertes furent dures ; à peine tombé le martyr était enfoui, roulé dans sa capote ; une hâtive petite croix de bois désignait sa tombe La mode était à la France,
la chose était fatale, puisque nous y vivions en partie ; nos camps s'y
trouvaient, les soldats français étaient mêlés aux nôtres. Malgré sa propre
misère, la France avait su nous aider ; ce qui nous amena les « I9I4 », les
« Elisabeth » – ainsi que jadis, aux derniers jours de l'Empire, on
eut les « Marie-Louise », – en bleu horizon, en bleu de roi, portant
leurs galons aux revers de la capote, à la française, avec des cartouchières
françaises. On eut des sacs français,
si ce n'étaient des sacs à pommes de terre, ou des filets à provisions, ou des
carnassières de chasse, ou des cartables d'écoliers, ou des sacs en tapisserie
; on eut des porte-baïonnettes français, si ce n'étaient de simples cordes à
nœuds, des clairons français, des vestes et des pantalons français. Les
officiers eurent des tuniques coupées à Dunkerque ou Calais, agrémentées des
boutons demi-sphériques français et, afin de compléter la ressemblance, on tailla
en « chasseur-à-pied » les barbes embroussaillant
les figures. Il faut bien se dire une
chose : chacun mettait ce qu'il voulait... ce qu'il avait... Si vous étiez
riche, vous vous payiez un uniforme de cuir (ce qui était fort bien porté dans
l'artillerie). Si vous étiez pauvre ou peu coquet, vous aviez une vieille veste
déchirée du haut en bas, ou tout simplement un jersey, quelquefois rehaussé par
une décoration, vous aviez une culotte faite de vieux uniformes tombant en
lambeaux. On rencontrait fréquemment aussi des équipements de prise :
ceinturons à plaque « Gott mit uns », des gourdes et
des souliers de repos, des haches, des bottes, des sacs, des cartouchières. Avec les éléments de tentes
allemandes, ramassés à Pervyse ou à Ramscapelle, on fit des cannes somptueuses
(car le vrai combattant de l'Yser porte toujours la canne) variant de
l'Alpenstock au gourdin de l'Incroyable. Quelle variété aussi dans
les gourdes ; rares sont celles qui partirent de Bruxelles, il y en a des
françaises et des anglaises, ou bien des bidons de paysans, ou bien encore de
vulgaires bouteilles à bière. Les régiments en marche
sont suivis d'un charroi hétéroclite : charrettes de laitières traînées par des
chiens et surchargées de couvertures, de casseroles, de marmites, de pelles de
terrassiers, – car les pelles portatives ont presque toutes disparu – il y a
des charrettes de paysan - de
déménagement –d'usine portant encore le nom de l'ex-propriétaire, il y a même
un fiacre ! 
Les aumôniers, eux,
n'abandonnent pas leur chapeau à cordon, militarisé par la jugulaire, et leur
croix sur la poitrine, quelques-uns portent des vêtements civils, pèlerine et
redingote ; d'autres sont tout simplement vêtus en soldats, de même que les
ambulanciers : séminaristes et capucins portant bravement la capote d'infanterie et le sac. Aux lanciers, il y eut un
aumônier barbu, tonsuré, coiffé d'une petite casquette de cuir semblable à
celle d'un chef de gare ; aux guides, un autre vêtu d'un uniforme anglais, avec
képi plat, compliqué d'une pelisse. On se rappelle un capucin à cheval, la robe
serrée par un ceinturon de soldat, et un aumônier qui officiait, montrant des
mollets solides, cambrés dans des bas à jour, provenant de Nieuport. Les cavaliers, avec peine,
abandonnèrent leurs uniformes du début ; les guides allèrent aux tranchées en kolbach, en lasalle, en manteau
rotonde, – qui bientôt allait être remplacé par un manteau gris, court, à
ceinture – les pieds chaussés souvent de sabots. On avait doté la cavalerie
d'une carabine ; malheureusement on n'avait point prévu les cartouches ; ce qui
fait que les cavaliers devaient les transporter dans leur poche ou dans un
vieux mouchoir. Qui dit fantassin, dit baïonnette ; les cavaliers démontés
avaient une carabine courte, on leur donna donc une longue baïonnette qui,
accrochée au canon, Dieu sait comme, était d'un rendement ridicule. Pour aller aux tranchées,
les cavaliers faisaient la première étape, montés, enfoncés dans un paquetage
invraisemblable, la canne au porte-sabre. Les chevaux faisaient retour avec les
hommes relevés. De nombreux escadrons étant
sans chevaux, on créa des escadrons cyclistes ; on avait pu apprécier les
services rendus par cette infanterie montée, qui solutionnait le problème que
Napoléon essaya de résoudre, lui, avec ses dragons. Ces escadrons étaient
habillés de toutes les tenues de la cavalerie, et précédés de trompettes dont
les cordons amalgamaient les couleurs de tous les régiments ; les fusils
étaient portés au cadre de la bicyclette, la baïonnette au guidon. Après la dissolution de la
garde-civique à Ostende, beaucoup de gardes passèrent individuellement ou en
groupe à l'armée ; nous ne parlerons pas des autres, ils ont donné la mesure de
leur conscience. Dans la cavalerie, on les
reconnaissait à leur sabre : l'ancienne rapière, qui fit tant sourire ; la
compagnie des cyclistes de Bruxelles qui se comporta bravement et eut son
commandant tué, subsista seule, avec son ancienne tenue, et devint plus tard
compagnie cycliste des lanciers. Seuls, au milieu de ce
pittoresque et glorieux carnaval, quelques officiers habillés à Londres, des aviateurs
avec leurs fourrures, leurs vestes de cuir, leurs vieux uniformes qu'ils
conservèrent longtemps après le kaki, gardaient un peu de correction.
Peu à peu tous les fragments d'anciennes tenues disparurent ; comme un
anachronisme de temps en temps, un kolbach, un talpach réapparaissait. On vit d'étranges petites vestes
grises, brunes, voire même lilas. Ce fut la période où les soldats s'ornèrent
le képi, la poitrine, de médailles et d'insignes de toutes sortes : portrait de
la Reine et du Roi, cocarde, badge de soldats anglais. Telle fut l'armée de
l'hiver. Telle fut l'armée de
Steenstraete, cette sanglante action où les grenadiers tinrent des positions
intenables au prix de pertes effrayantes arrachant un cri d'admiration aux
zouaves, leurs voisins. 
Les Héros en guenilles – Début de l’Yser. Comme les soldats de Raffet, nos « Jass » glorifièrent la misère Une des aventures les plus
curieuses de cette campagne d'hiver, fut celle de cette femme qui avait suivi son
mari, volontaire aux grenadiers; le mari tué, elle continua à suivre la troupe
et faillit se noyer dans l'Yser. Elle était vêtue d'un uniforme : veste-capote,
pantalon, coiffée d'une charlotte noire, et faisait les relèves un panier au
bras. Le mouvement féministe
avant la guerre faisait prévoir que les femmes prendraient une part active à
cette lutte désespérée. Si en Russie on eut des bataillons de femmes, on en
resta en Angleterre, en France, à les charger de services auxiliaires, et plus
spécialement, leur donner le soin des ambulances, ce qu'elles firent à
merveille. Chez nous la Reine donna
l'exemple du dévouement et du courage : et ce n'est pas injustement que la
légende s'est déjà emparée de cette grande figure de Reine, de femme et de
mère. Mais il y eut au front
belge deux héroïnes d'un autre genre : la Joconde, ainsi nommée parce
qu'elle « gardait le sourire » aux minutes les plus graves ; les tranchées
s'appuyaient à sa maison. Elle n'en abandonna les quatre murs criblés, que par
ordre. Il y eut aussi Mme Tack, propriétaire de la
villa Marietta au sud de Dixmude ; comme la Joconde, elle avait
sa maison dans la ligne de feu. Son amusante silhouette était familière aux
soldats, qui la saluaient de grands bonjours. 
Pour les gens importants,
elle avait un livre d'or. Sur ses cheveux gris un chapeau à plumes était perché
; elle était généralement montée sur un petit âne qu'elle guidait avec un
redoutable éperon de cavalier, ce qui n'empêchait pas l'âne de se livrer avec
Mme Tack à des combats homériques. * * * Ce fut la première
apparition des gaz asphyxiants ; pour en empêcher les ravages, les hôpitaux
fournirent aussi vite que possible, des tampons pour la bouche, qui, avec des
lunettes d'automobile, furent le point de départ du masque. * * * Le moral des hommes subit
l'influence du printemps. Ce fut la crise de sentimentalité ; on sortait
de l'horreur de l'hiver, dont on n'aurait jamais cru pouvoir sortir, et les
pâquerettes au revers des routes, les toits rouges qu'un timide rayon de soleil
faisait rutiler, rafraîchissaient les âmes corrodées par toutes les souffrances. Et l'armée chanta. Ce furent Flotte petit drapeau, Tipperary, Le
Dernier Tango, Le Rêve passe, et des berceuses et des
complaintes. Les relèves qui, quelques
semaines plus tôt, ricanaient douloureusement : « Si tu veux ta liberté, écoutaient maintenant avec émotion le chanteur accrédité pleurer les
aventures du Petit employé, ou de Rita la blonde. Des pianos sortirent des
coins, quelquefois « amochés » par la mitraille ; on se les passa de
cantonnement en cantonnement; cela pour les officiers, ou pour messieurs les
autos-mitrailleurs. Mais le piotte, le modeste
piotte, lui, vit avec émotion réapparaitre les accordéons. Oh ! ces accordéons,
aux soufflets peinturlurés, ce qu'ils ont fait rêver, aidé à souffrir en
évoquant le passé. Puis il y eut le chien. Privé de toute famille, de
toute propriété, n'ayant plus pour tout bien que ce qu'il portait sur le dos,
et encore le gouvernement avait des droits sérieux sur ses hardes, le piotte
adopta un chien qui fut sa famille, son ami, sa propriété. Il eut « son » chien, « sa
» pipe !! Il l'unit à sa misère, lui
donna un coin de couverture pour dormir, une part de gamelle pour subsister et
le « zinneke militaire » naquit. Il fut légion, tout ce que
les croisements peuvent donner jappa autour de l'armée. Avec le rang le chien
défile, la cocarde au collier ; les nouveaux nés trouvent un bissac hospitalier
que la mère suit, inquiète, le nez en l'air, les mamelles ballantes. Il y en a sur les caissons,
dans les autos, accrochés aux bicyclettes, aux selles des cavaliers. Pour les
transporter, l'on fit des marches supplémentaires, et des consignes formelles
furent forcées. * * * Notre programme, qui est de
montrer notre armée en campagne, nous porte à parler de certaines troupes
alliées qui furent en quelque sorte mêlées aux nôtres : les Fusiliers marins et
les Goumiers. L'épopée des fusiliers
marins commença à Melle ; leurs rangs étaient composés en partie de Bretons
têtus, petits et râblés. Ils portaient la capote d'infanterie, le bonnet
traditionnel du mathurin ; leur extrême jeunesse les fit appeler par les
Allemands : « Les demoiselles à pompons rouges » ; nous ne dirons pas ici les
fastes de la brigade de l'amiral Ronar' ch. L'historien militaire Le Goffic les a chantées ainsi qu'il convient, mais en donnant
peut-être un peu trop d'importance au rôle joué par cette poignée de braves, à
la bataille de l'Yser. Ils furent sublimes, c'est certain, mais les
soldats de Jacques et de Meiser, Dixmude seulement,
cueillirent tout autant de lauriers que les fusiliers marins. Ils avaient leur allure à
eux, mi-fantassins, mi-marins ; leur cadre sentait la Bretagne, et leurs noms
sonores disaient les origines. Ils avaient comme aumônier l'ancien vicaire de
Reims, qui suivait la colonne en soutane chevronnée et galonnée, le chapelet à
la ceinture, la Croix de guerre et la Légion d'honneur sur la poitrine,
l'aiguillette à l'épaule ; il portait un bonnet de police galonné, et sous la
soutane, apparaissaient des houseaux de cavalier. Ce prêtre-soldat avait
assisté à toute l'agonie de Reims. 
L’inondation devant Pervyse – Hiver 1915-1915. C’est de l’observatoire établi dans la gare de Pervyse que le spectacle de l’inondation était le plus impressionnant Avant la Marne, les
vainqueurs l'avaient pris comme otage, menacé de la fusillade, mais sa finesse et
son sang-froid, sa simple diplomatie d'homme d'église l'avaient sauvé. Puis ce fut la Marne ; la
retraite précipitée des rauques vainqueurs, qui se vengèrent rageusement en
bombardant la ville, et visant tout spécialement la cathédrale, où pourtant
s'entassaient leurs blessés. Le prêtre grimpa aux
plates-formes supérieures, et hissa, avec l'aide de son bedeau, un grand
pavillon aux couleurs de Genève, fabriqué avec des chasubles et des robes
rouges d'enfants de chœur. Les Allemands n'en continuèrent pas moins leur
triste destruction systématique. Alors le prêtre, malgré sa haine de patriote,
sauva les blessés, puis son amour fervent le rejeta au sauvetage des richesses
dont il avait la garde. Sous les obus, les voûtes
se crevaient, la grande rosace couverte d'échafaudages s'empourprait, les
boiseries prenaient feu ; le pauvre prêtre lutta, tant qu'il put – au milieu
des écroulements – avec des seaux d'eau, dont il arrosait les boiseries
fumantes. Effort inutile devant l'étendue du cataclysme. Alors, il sauva le
trésor, bourra des mannes à linge avec les bijoux, les objets précieux des
sacres royaux, s'en emplit les poches, si bien qu'un des jours suivants, en
tirant son mouchoir, il retrouva même une bague royale. Il racontait tout cela,
doucement, les yeux bas, souriant ; puis il redevenait soldat, lâchait des
mots très gros et avouait que, seul, son sacerdoce lui avait fait sauver les
blessés ennemis. Cette troupe de bretons bretonnisants, avec ses officiers aux noms armoricains, son
aumônier, le scapulaire que l'on entrevoyait parfois sur les poitrines velues,
les jurons où Notre Dame d'Auray intervenait fréquemment, donnaient aux «
Demoiselles à pompon rouge », une allure « Vieille France ». Leurs chansons de route
étaient, pour la plupart, des airs vieillots, venus des anciennes provinces
Royales. Sous les drapeaux fleurdelisés, les fantassins en habits blancs,
rouges, aurores ou jonquilles, les avaient chantés, le tricorne sur l'œil : les
gars de Charette et de La Roche-jacquelin en
avaient fait retentir les échos du
Boccage, et les conscrits menés aux rudes combats de l'Epopée avaient scandé
leur pas à travers l'Europe, aux ritournelles de ces chants simples et doux,
tristes et résignés. C'étaient : Les trois princesses, Avec mes sabots,
Dans le jardin de ma blonde. 
Aux combats ils étaient farouches : la défense de Dixmude où, avec nos
soldats en guenilles, ils tinrent contre les assauts éperdus de vagues
allemandes puant l'éther et gueulant le Wacht
am Rhein est certes un
des plus beaux épisodes de la défense de l'Yser. Ils furent sans pitié,
sublimes et atroces, carrant leur obstination de Bretons à côté de l'entêtement
et la ténacité des Flamands et des Wallons ; ils tinrent dans cet enfer, pris
d'une sorte de folie héroïque.
Les fusiliers marins, la bataille de l'Yser finie, tinrent Nieuport, où
ils s'installèrent en soldats débrouillards. Ils y restèrent jusqu'en juin
1917, lorsque les Anglais vinrent s'installer pour mener leur offensive sur
Ostende. Les adieux des marins eurent lieu à La Panne le 18 juin ; ils aimaient
La Panne parce qu'ils y trouvaient un peu de confort, de joie et parce que à
l'Ambulance de l'Océan, il y avait toujours des leurs, que l'on sauvait de la
mort, et La Panne les aimait pour leur allure bon enfant, leur esprit drôle et
leste.
Ces adieux furent poignants ; c'était la fin d'une épopée. Dans un geste
bien français, ils voulurent avant de partir saluer l'hôpital de l'Océan. Ce
fut devant les vastes bâtiments, devant « Depageville
» qu'ils se massèrent avec leurs clairons, avec leurs tambours, leur drapeau.
Dans une alerte sonnerie, « aux champs » ils saluèrent l'hôpital, les fenêtres,
où les nurses vêtues d'azur et de lumière les applaudissaient, ils saluèrent
ceux des leurs qui restaient, et sous les fleurs jaillissant de partout ils
s'en allèrent de leur pas souple, – gars bretons râblés, sanglés, le cou nu,
l'aiguillette battant l'épaule, vers la villa royale, où ils allaient aussi
faire leurs adieux.
Et lorsqu'après le défilé enlevé à la française, le vieux soldat qui les
commandait vint saluer les souverains, et leur faire les adieux de ses hommes,
de grosses larmes coulèrent sur ses joues boucanées.
L'armée française opérant en Belgique avait, parmi les superbes
escadrons de sa cavalerie, des goums marocains et algériens. Lors de la
reculade de l'Yser, on essaya d'employer ces étincelants cavaliers, faits pour
les fantasias au grand soleil, dans cette lutte de boue et de misère. Il y eut
bien, avant que l'armée ne prît sa position définitive de Nieuport à Ypres,
quelques combats à l'ancienne façon, où les dragons aux casques à l'antique et
les goumiers semblant sortir d'un tableau de Clairin,
montrèrent aux bandes d'Outre-Rhin que la tradition des Lasalle, des Montbrun,
des Gallifet n'était pas morte – on se rappelle un
cheik qui, au beau milieu des coups de fusil, alla rechercher un cheval de
prise, et de ces cavaliers aux visages de bronze essuyant les lames rouges de
leur sabre dans la crinière de leurs montures. Mais la grande bataille
s'engageait dans la rafale, dans la boue, les poings crispés sur les fusils
brûlants, les pieds nus dans la fange, et les beaux cavaliers, qui dans leurs
manteaux de pourpre ou d'azur apportaient le chatoiement de l'Orient, avaient
fini leur rôle.
Alors ce fut triste. Dans les dunes désolées – sous le grand ciel aux
nuées en déroute –dans la bise du Nord, ils grelottèrent leur âme.
Il y en avait de jeunes, avec des visages très sombres, une barbe
épaisse, de grands yeux terribles et enfantins, des mains maigres couvertes de
grosses bagues. Un grand rire muet éclairait parfois ces faces noires d'un
étincellement de dents de fauve.
Il y en avait de vieux, la barbe blanche en collier, les sourcils restés
noirs, venus on ne sait d'où et on ne sait pourquoi.
Leur chef était un descendant d'Abd-el-Kader,
un cavalier superbe, dont le cœur était fidèle à l'Arabie libre et qui ne se
pliait que difficilement aux exigences de sa servitude. 
Les Vainqueurs. – Hiver 1914-1918. L’armée sortie de la bataille, était superbe et atroce ; les formidables journées d’octobre, l’hiver implacable avaient donné aux combattants français et belges, une allure définitive. Ils
furent cantonnés dans des fermes perdues dans des océans de boue, dans des
villages adossés aux dunes, et dans l'atmosphère grise de l'hiver ; ce
déballage d'exotisme misérable rappelait les jours mélancoliques de fin d'exposition
; les chevaux étaient maigres, toussaient sous leurs œillères, leurs selles en
cuir rouge terni ; les beaux manteaux étaient tachés de boue et
s'effilochaient. Et eux, les goumiers, chefs riches et puissants qu'attendaient
là-bas du soleil et de la lumière, ils tremblaient le nez enfoui dans une
écharpe de laine, les mains roulées dans leur burnous. Le long de la plage
grise, cette plage de mer du Nord, où le ciel, le sable et les flots lumineux
arrivent à donner une impression complète de tristesse, ces fantômes du pays du
soleil donnaient une note de désespérante fantaisie.
Pour eux, les jours où il fallait aller chercher des prisonniers étaient
jours de joie ; en ouragan on les voyait passer pour chercher leur proie, et
revenir enfin, triomphants, sabre au clair, autour d'une colonne grise et
morne.
Nous vîmes aussi au début de l'Yser – plus tard à Boesinghe, à
Steenstraete – d'autres troupes coloniales : les tirailleurs ; leur aspect
redoutable faisait l'admiration de nos « piottes ». C'est à qui raconterait la
plus terrible « histoire de nègre». Lorsque ces grands diables à cheveux crépus
n'étaient pas au combat – qu'ils menaient avec des bonds de fauves – ce
n'étaient que des enfants craintifs.
Nous connûmes aussi les « pépères » à cheveux blancs et les «
Joyeux », mais cela c'est une autre histoire comme dit Kipling. * * *
Au début de 1915, l'aviation allemande fut exaspérante : ses escadrilles
croisaient en grands vols menaçants ; ses appareils mettaient à observer nos
moindres positions, nos plus modestes fermes, une inlassable indiscrétion, et
comme l'on était revenu des erreurs de jadis, qui faisaient partir en pétarade
– aussi bruyantes que ridicules – les fusils et les pistolets, on devait se
contenter de mettre ses espoirs dans les essais des batteries contre-avions, ce
qui était mince ; aussi lorsque l'on vit, en avril, Garros mettre bas un avion
ennemi, l'enthousiasme fut grand. 
Comme
par tous les jours clairs, ce jour là l'aviation ennemie s'était montrée généreuse
en reconnaissances ; chaque fois les batteries contre-avions s'encoléraient, encerclant les appareils ennemis de
shrapnells qui tantôt craquaient en flocons neigeux, tantôt dessinaient sur le
bleu pâle du ciel des points d'interrogation ou des O semblant jaillir d'une
pipe monstrueuse.
Notre aviation était à ses débuts, les appareils de chasse manquaient et
l'artillerie de défense aérienne elle-même devait exécuter des tours de force
pour ne pas laisser grandir l'audace des appareils à croix noires. On employait
des 75 cabrés sur des socles de bois, sur des plaques tournantes de tramways,
et de rageurs petits canons-revolvers de 3.7 ; des « poum-poum » cédés par les Anglais, qui jadis les employèrent
dans leurs campagnes coloniales, en montagne.
Le camouflage était à sa genèse, les filets de « rafia
» à peine connus ; les pièces se terraient dans des taillis factices, sous des
chaumes des bâtiments écroulés. En action, ces batteries menaient grand tapage
: craquement spasmodique des 75, appuyé du « pam-pam » cadencé des 3.7 ; chacun aussitôt mettait le nez en
l'air, critiquait, applaudissait, se garant tant bien que mal de la pluie
dangereuse d'éclats et de « non éclatés » ; en résumé, ces attaques aériennes
jetaient un peu de fantaisie dans la monotonie des jours.
Il existait encore alors au sud-ouest de Dixmude, un petit village
appelé « Oude-Cappelle »,
Il y avait une église dont le clocher tenait debout, quelques maisons criblées
d'obus, des arbres, un pont, un vaart. De Oude-Cappelle, entre deux rangées
d'arbres tordus par l'éternelle rafale, une route filait droit, rattrapant au
carrefour peu recommandable de Oude-Bareel, la route de Dixmude à Nieuport. 
A la moitié de cette route, il y avait, à côté d'une maison à
demi-scalpée, un poignant cimetière mangé par de la boue purulente ; la hâte de
la bataille y avait enfoui pêle-mêle, sous des croix faites de matériaux de
fortune, des héros de Dixmude : fantassins de Jacques et de Meiser,
« demoiselles à pompon rouge » de Ronar'ch.
Près de cette maison, autour d'une machine agricole qui se rouillait
symboliquement, ce pourrissoir réunissait toutes les misères de ces heures
atroces.
Les noms de ceux qui dormaient là ?
« Un brave », « Un chasseur », « Deux frères » ; là, s'endormaient des
gloires anonymes.
Roulés dans une capote noire de sang, on les avait enfouis, pas trop
profond, pour faire plus vite ; des souliers en lambeaux, des baïonnettes
tordues, une bêche cassée, près d'une fosse toute prête, pleine d'une eau aux
louches reflets vitreux, complétaient le tableau et, sur le mur de la ferme, une main enthousiaste avait
écrit les vers d'Hugo : Ceux
qui pieusement sont morts pour la patrie
Face au cimetière: un poste de secours, d'où économie de transport.
Et la silhouette figée de Dixmude, ses toits aux cent yeux, l'église
dont les obus avaient fait une figure de guillotine, la minoterie mystérieuse,
les crêtes de Clercken avec ses moulins immobiles, se
chargeaient du ravitaillement du poste de secours comme de sa dépendance.
C'est au-dessus de ce coin maudit qu'à la fin du jour Garros remporta un
succès éclatant.
Le combat lui-même. Deux vautours semblables à ceux que l'on voit planer
dans les nues de l'Atlas, une poursuite, des « tac-tac
» rageurs et, soudain, une flamme qui pique vers le sol.
Un cri, un hourra sauvage monta de terre de mille poitrines de soldats
enthousiasmés par le triomphe de la force et de l'adresse, seules lois.
Ce cri sortait de partout : des lignes belges ; car on avait pu voir que
c'était « l'autre » qui avait eu le dessous. Là, près du poste de secours,
l'appareil vint s'écraser en flammes : ce fut une ruée hurlante vers le vaincu.
Il brûlait. Certains amateurs d'horrible virent, paraît-il, une main s'agiter
dans la fumée.
Là-haut le vainqueur tournait en grands cercles, pour disparaître enfin
vers l'Ouest. Lorsque le feu eut achevé de manger tout ce qui lui plaisait, il
resta une carcasse noircie, craquelée, les ossements des ailes où pendaient des
lambeaux de toile, l'armature du lance-bombes, un enchevêtrement de haubans et
deux corps tigrés par le feu.
L'un, face à terre, à demi-vêtu, les muscles des reins écorchés, faisant
tache blanche, les poings serrés ; l'autre couché sur le dos, les jambes
ouvertes ; toute une chair jeune offerte, semblant plus pâle encore aux places
où elle n'était pas mordue.
Les accidents, les catastrophes ont un public spécial que l'espoir d'un
spectacle terrible ou malsain fait sortir de son indifférence et battre des
records de vitesse pour « voir le premier ».
En temps ordinaire, la chose est vraie ; en guerre, aussi bizarre que
cela puisse paraître, c'est plus vrai encore. Ici, le spectacle de deux
aviateurs ennemis écrasés sur le sol eut le pouvoir de faire jaillir de cette
campagne en apparence déserte, du fantastique labyrinthe du front, ses
habitants tapis dans leurs repaires : fantassins des fermes de piquet,
artilleurs des postes d'observation. On fit cercle, des mains palpèrent,
retournèrent, escamotèrent des « souvenirs », des kodaks opérèrent. Les
érudits et les beaux parleurs se mirent à « broebeler
» avec assurance ; parfois, un rire fusait .
... Et ce qui devait arriver, arriva. Dixmude veillait, Dixmude avait
suivi le drame, le cœur rongé de haine. Ce groupe de curieux devait tenter les
canons : miaulements, craquements, des « arrivées » se suivirent.
Selon sa curiosité chacun se gara, les uns sautèrent prudemment dans les
tranchées de repli voisines, les autres se collèrent aux murs proches, les
autres enfin ne bougèrent pas.
Cette dernière ténacité eut sa récompense. A l'abri de Oude-Capelle, une auto s'est arrêtée, un homme vêtu de cuir
en descend, s'informe : il est trapu, sur des épaules carrées se plante une
tête énergique et obstinée, c'est le vainqueur, c'est Garros, qui vient à
grands pas juger de près sa victoire.
Tantôt, ses talons sonnaient sur la route, maintenant ils s'enfoncent
dans la prairie spongieuse.
Minute poignante. Sourcils froncés, il regarde d'un regard lourd
d'émotion ces deux corps torturés, que sa main implacablement fit mourir, là.
La nuit est tombée; une teinte violette ronge le paysage, tantôt d'or et
d'émeraude.
Il ne reste plus qu'un petit groupe de curieux, et, face aux cadavres,
le vainqueur.
Lentement, il fait le tour de l'appareil, demande des trophées, puis à
grands pas, sa silhouette carrée s'enfonce dans la nuit, tête basse, le front
bourdonnant de pensées.
Dans le cimetière d'Oude-Cappelle,
deux croix indiquèrent les tombes des Allemands, jusqu'au jour où
définitivement les obus écrasèrent le village, l'église, le cimetière.
Des morceaux des deux croix on fit à peine un petit fagot.
– Oh ! ces cimetières de soldats, qu'ils étaient grands ! C'était tantôt
un groupe de croix en arrière de la tranchée ; là, en hâte, on enterrait, roulé
dans une couverture, le martyr sitôt tombé. Tantôt, de vastes nécropoles,
s'agrandissant chaque jour de croix nouvelles aux pieds desquelles un képi,
quelques fleurs corrodées par la pluie.
Plus tard, on fournit des cercueils. Sinistre ensevelissement que celui
de ces corps machurés par la mitraille et qui ne
fournissaient pas toujours de quoi remplir la caisse de bois blanc.
– Près d'Oude-Cappelle,
il y avait une ferme, la ferme des obusiers ; avec deux pièces en batterie,
terrés dans les « abris », les hommes y avaient passé l'hiver. Un jour, un obus
tomba en plein dans le dépôt à munitions ; sauf un artilleur qui était allé au
village, personne ne sortit vivant. Les cercueils étaient à leur nouveauté, et
il fut administrativement décidé que chaque homme aurait le sien. Malheureusement,
en voulant y enfouir les corps, on eut devant soi un horrible « puzzle »
de lambeaux déchiquetés et les ensevelisseurs ne purent mieux faire que de
remplir les cercueils de l'équivalent de corps entiers.
Deux boîtes s'en allèrent à peu près vides ; pour ces deux corps-là, une
caisse à biscuits aurait suffi.
Qu'elles étaient émouvantes ces funérailles de soldats ! Dans une
charrette de paysan, une ambulance, le corps est apporté. Un pauvre glas, il
pénètre dans l'église froide, humide, trop neuve. Les vitraux ont des tons sans
richesse, d'une prétention haute en couleur.
Ils sont six, l'arme aux pieds, autour du pauvre catafalque de bois
recouvert d'une chape fatiguée. Ils sont six se reposant d'un pied sur l'autre,
et leurs pieds laissent une trace humide sur le pavement noir.
Ils ont de vieilles capotes, où la boue ne marque plus, élimées,
recousues, misérables et glorieuses. Ils sont six aux yeux sans regard, au
front sans pensée, las, sans âge.
Le camarade qui a fini de souffrir, et qu'ils encadrent de leurs fusils
aux crosses sonores, ils le plaignent de temps en temps, entre deux idées.
L'aumônier qui officie a une figure de soldat et des souliers boueux.
De longues mantes noires semblent dormir sur les chaises ; un ceinturon
craque, une chaise grince, des rires d'enfant viennent du dehors, où il y a du
soleil. * * *
A cette époque la plaine de Flandre, de Nieuport à Ypres, ne présentait
pas encore l'aspect de désolation d'aujourd'hui. Quoique déjà cruellement
blessés, les villages « existaient » ; les tours des églises jalonnaient encore
les grands horizons de leurs massives carrures de pierre. 
Les Goumiers. – Hiver 1914-1915. La campagne de Flandre fut un terrible calvaire pour tous ces cavaliers Marocains et Algériens peu faits à notre climat et à ses intempéries.
Maintenant, les villages, les églises, les arbres même de cette bande de
terre maudite n'existent plus, que dans le souvenir des hommes, qui les virent
s'écrouler sous les obus.
Ainsi disparurent les tours de Nieuport, de Lampernisse,
de Loo, d'Oude-Cappelle.
Voyons ce qu'il était permis de découvrir, de certains observatoires, de
la « Cheminée de Ramscapelle » par exemple.
C'était le plus curieux de tous, installé qu'il était au faîte de la
cheminée de la briqueterie, en arrière du village.
Il y eut d'abord deux cheminées, Nord et Sud, la « cheminée française »
et la « cheminée belge » ; la première fut trouée par un obus, ce qui
força les observateurs français et belges à employer la cheminée restante.
La chute de la cheminée française permit, à un de nos officiers
d'artillerie, d'avoir un mot digne de Fontenoy.
Il se trouvait en observation avec un officier d'une des batteries
françaises, du fameux « bois triangulaire ».
Ainsi qu'ils le faisaient chaque jour, les Allemands tiraient sur la
cheminée, mais cette fois avec une telle précision que les officiers crurent
prudent de « battre en retraite ».
Et, tandis que les arrivées se pressaient, inquiétantes, ébranlant
sinistrement, avec des stridulements rageurs, le tube
de briques, les deux officiers firent assaut de politesse pour la descente : «
Après vous, je vous en prie », et le Belge eut le mot de la fin : « Pardon, je
suis chez moi ! » Ils n'étaient pas à mi-chemin qu'un obus crevait la
cheminée au-dessus de leurs têtes.
L'ascension se faisait intérieurement, à l'aide d'échelons :
quatre-vingt-quatre pour la cheminée Sud. L'obscurité était opaque, se doublant
de suie ; aussi l'arrivée dans la lumière crue de la plate-forme était-elle
d'une opposition extraordinaire. Sous un toit préservant le poste des regards
indiscrets des avions, deux hommes vivaient, accroupis sur des prie-Dieu
provenant de l'église de Ramscapelle; des gourdes, des jumelles, des cartes,
des croquis, des cercles de visée, des provisions encombraient ce nid.
L'observateur français était spécialement curieux, il était, depuis le
début de la bataille de l'Yser, « l'observateur de la cheminée ».
C'est pour cette raison qu'il avait, sur son calot, une petite cheminée
brodée en laine rouge !
Sa sagacité était merveilleuse, il connaissait les plus petits détails
de l'immense paysage qui s'étalait comme un plan en relief.
Nieuport : deux tours trapues dominant des arbres ébranchés, des voûtes
à jour, des toits rouges et gris où s'apercevaient des plaies béantes.
Se profilant sur le ciel : le littoral, ses groupes de villas, d'hôtels
clairs, de dunes d'or : Westende avec son palace,
Middelkerke, Raversyde, Mariakerke,
Ostende enfin, la ville de plaisir aux cent palaces, aux dix clochers. Si le
jour était très clair, au loin entre deux files d'arbres, on pouvait voir les
clochers de Bruges. Ainsi, toute la Flandre déroulait son tapis de riches
prairies, de villages opulents, groupés autour de tours. Leffinghe, Slype, Oudenburg, Ghistelle, Zande, Schoore, Leke, Coukelaere.
Plus près de nous le champ de bataille, avec ses noms déjà légendaires,
de villages, comme Saint-Georges, Mannekensvere, Schoorbakke, de fermes comme Groote-Bamburgh,
où s'immortalisa le 7ème de ligne, Roodepoort, de l' Union, Terstille, Violette, Groote-Hemme
et Kleine-Hemme. En arrière
de ces postes avancés, partant de Nieuport pour aboutir à Dixmude, le chemin de
fer marquait la ligne de résistance belge ; comme à Ramscapelle, comme à
Pervyse, en un effort furieux l'ennemi était parvenu, lors de la bataille d'octobre,
à en chasser nos hommes. Jusque près de la briqueterie il avait mené ses
tirailleurs. Mais nos troupes épuisées, épaulées maintenant par l'effort
français, l'avaient rejeté bien au delà du chemin de fer, qu'il ne devait
jamais plus atteindre. Et puis, l'inondation était venue, l'inondation qui
scintille devant nous. Quelle
antithèse pour un Victor Hugo, cette marche triomphale de légions superbes se
croyant être les élues du destin et un homme, un seul, un éclusier, un inconnu appelant
à la rescousse le plus formidable élément, le guidant et faisant arrêter ainsi
cette marche en avant. On est Empereur, on ne pense pas à un Geraert, éclusier de Nieuport. Tout
proche, nous voyons le village de Ramscapelle ; sa silhouette grise entourée de
trous d'obus ; la bataille qui passa là, désespérée, a laissé des traces effrayantes. Pour
voir l'inondation à son plus complet développement, allons à l'observatoire de
la gare de Pervyse. Nous découvrons là, toute proche, l'énorme étendue d'eau qui
reflète tour à tour les ciels bouleversés des jours de rafale et les aurores
claires et limpides ; de grands vols d'oiseaux aquatiques s'ébattent dans les
roseaux, les haies des prairies émergeant de l'eau.
Devant nous, la route de Pervyse à Spermalie,
piquant droit jusqu'au Schilderbrug ; les arbres en
sont morts, noyés. De chaque côté du pavé qui dépasse le flot, des
amoncellements de briques rappellent l'existence de maisons.
C'est cette route qui, lors de la retraite allemande, était « grise » de
cadavres.
Par-ci, par-là, un rayon de soleil éclaire une ruine blanche, Berkelhof, « la ferme aux cochons », un squelette de
village, Stuyvekenskerke, une masse d'arbres sombres,
le château Vicogne.
Le terrible ouragan de fer qui souffla en Flandre a jeté bas un clocher
contre lequel les plus furieuses tempêtes marines avaient usé leur souffle : Lampernisse. Le groupe de quelques maisons que formait le
village ne répondait pas à l'énorme stature de l'église, campée là, comme un
défi.
C'est dans cette église, prétend-on, que reposait Thomas Zannekin, le célèbre agitateur flamand.
C'est là que la légende voulait voir s'achever l'odyssée d'Uylenspiegel.
Dans l'église, ce qui est certain, quarante-cinq chasseurs français
furent écrasés par le même obus.
Un poste d'observation était installé au-dessus de la chambre des
cloches, les artilleurs français et les Belges voisinaient, entourés de rats,
d'étourneaux criards et de choucas. 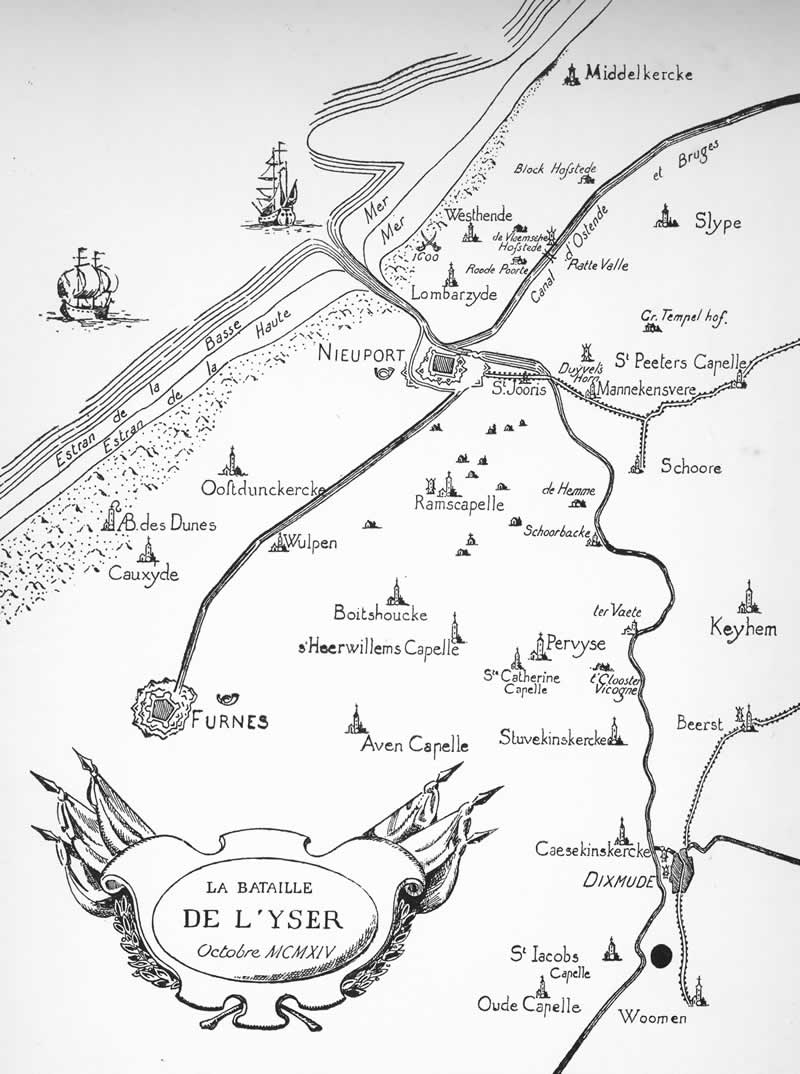
Le champ de bataille de l’Yser. Il nous a paru intéressant de donner, à l’ancienne façon des cartes de Ferraris, le champ de bataille de Nieuport à Dixmude.
C'est là que Jean De Mot avait écrit la phrase finale de l'Uylenspiege1
de De Coster :
Est-ce qu'on enterre Uylenspiegel l'esprit, Nelle, le cœur de la mère Flandre, elle aussi peut dormir,
mais mourir, non.
Plus que n'importe où, de ce vieux clocher l'aspect de la Flandre
meurtrie avait dû émouvoir l'artiste et le patriote ; vers Dixmude, vers la
ville martyre qui subissait son anéantissement, les routes convergeaient, les
fermes se faisaient plus denses, les maisons se groupaient en villages déjà
importants, comme Oostkerke, Beerst,
Vladsloo, Kaeskerke, Essen.
Au Sud de Dixmude débutaient les premières crêtes. Les arbres se faisaient
nombreux, c'étaient Clerckem et ses moulins, Woumen et son château ; à l'horizon enfin, une ombre bleue,
la forêt d'Houthulst. Notre secteur, au Sud, était fort
différent des autres coins du front ; de longues files d'arbres, des saules, de
petits boqueteaux rendaient moins monotone l'aspect de nos lignes avancées. 
Jusqu’aux derniers mois,
l'armée anglaise tint Ypres. Rares étaient les privilégiés qui pouvaient
s'offrir une promenade dans la ville fantôme. Il n'est pas dans notre
programme d'en faire la description ; nous ne parlerons que des superbes
troupes qui vécurent là, plus de trois années. 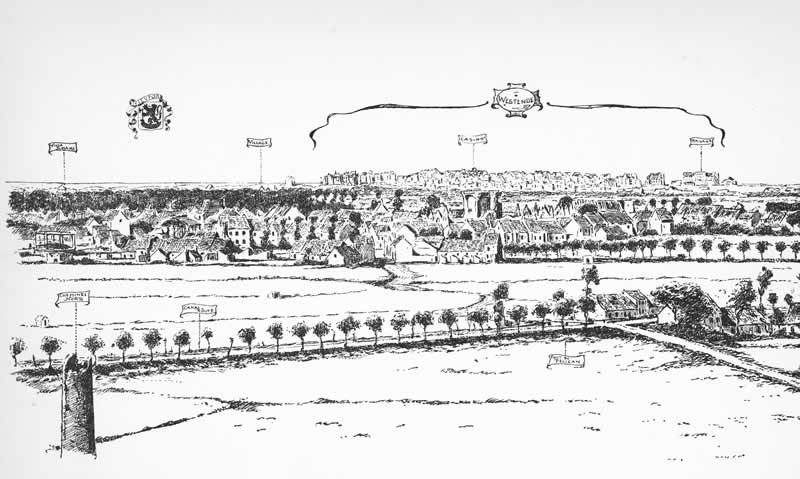
Nieuport et Westende. – Avril 1915. Cette planche, comme les deux suivantes, fait partie d’un croquis panoramique, à destination de l’artillerie belge, exécuté du haut de la cheminée Nord de la briqueterie de Ramscapelle. Ce fut sous Anvers que notre armée prit
contact avec les soldats de Grande-Bretagne : les hommes magnifiques de la
brigade navale amenée à la rescousse par Winston Churchill, puis à Ostende, à
Zeebrugge, sans arrêt les transports déversèrent les hommes, les chevaux, les
canons. Ces soldats, que l'on ne connaissait presque que comme des gens de
parade, allaient montrer que la tradition d'Espagne, de Waterloo et du
Sud-Afrique n'était pas morte. A Mons ils surent se faire hacher sur place, à
l'ancienne manière. Sur les routes de Flandre il en passa encore et encore :
Ecossais aux kilts bariolés, cachés sous des tabliers kakis, fantassins tous
découpés sur le même patron, cavaliers raides en selle, montés sur des chevaux
de robes identiques et qui de suite commencèrent leur métier de scouts, dans
les dunes ; une artillerie étincelante, aux chevaux le front couvert de
chasse-mouches. Soldats faits, encadrés de vieux sergents dont la poitrine
s'ornait de rubans gagnés depuis Kartoum jusqu'à Modder-Rivier, commandés par des officiers de race, ayant
derrière eux l'ombre redoutable du Sirdar, de Kitchener, le chef aux volontés
implacables. L'Allemagne se gaussa
lourdement de cette poignée de mercenaires, de cette méprisable petite armée en
jupon ; mais derrière cette avant-garde de soldats de métier, les seuls qui
existassent encore en Europe, la nation anglaise tout entière, ses colonies –
depuis le Canada jusqu'aux Indes – préparaient le plus formidable des efforts
militaires. C'est cette « autre armée »
que nous allons voir à Ypres – car des régiments du début, il ne reste plus que
de quoi encadrer les recrues – venant d'Angleterre. Les Anglais nous amenèrent
leur flegme, leur sens pratique,... ils amenèrent aussi Tipperary, cet
air que des régiments de tous pays ont chanté, vociféré comme chanson de route,
et chanson de bataille. Ypres vit défiler, si ce
n'est toutes les troupes de l'Empire, du moins des spécimens de toutes ces
troupes. Jamais, sur une aussi petite parcelle de terre, ne défilèrent tant de
gens de guerre de races différentes. Au début de 1915, la ville était encore
habitable : on y voyait des Français, des Anglais, des Belges, la place
s'encombrait d'échoppes de mercantis, où se vendaient mille « souvenirs » de
pacotille. Puis ce fut le cataclysme : l'écrasement de la ville sous les obus,
l'évacuation de la population civile, et seule l'armée anglaise resta à Ypres. 
Pas un artiste n'a mieux rendu l'esprit et l'allure du soldat anglais en
campagne que Bairnfather : ce flegme inébranlable,
cet humour qui est spécial aux Britanniques. Tels, ils étaient à Ypres, vêtus
de fourrures et de vestes de cuir, le passe-montagne en tête – cela pour
l'hiver, – en bras de chemise, en culotte de foot-baller
– cela pour l'été. – Les officiers, eux, restent « sport » genre gravure
Cecil Aldin, et pour se promener dans les ruines, ils portent d'impeccables
culottes claires, les British-warms chamois, des
gants beurre frais ou vert mousse, s'appuient sur des stiks
ou des fouets de chasse. Ils auront leur Spaniel Cooker avec lequel ils chasseront le lièvre dans les
plaines de Poperinghe, et des petits chevaux de polo,
amenés à grands frais d'Angleterre. Nous dirons aussi, pour
compléter la silhouette de l'officier anglais, que s'il aimait d'être
impeccable au front, il voulait en permission se montrer en vrai soldat.
Boueux, le cou entortillé dans une grosse écharpe, un solide gourdin au poing,
tel était le genre « smart » pour arrivée à Charing-Cross. Dans les rues de Poperinghe, rebaptisées pompeusement « Piccadily Circus, Leicester
Square, Oxford street », Tommy retrouvait ses autobus
londoniens pratiquement employés aux relèves, aux transports des
permissionnaires. Chaque bus avait un fer à cheval porte-bonheur. Ypres restera pour les
Anglais une sorte de dépendance de l'Empire : n'ont-ils pas arrosé chacune de
ses pierres de leur sang. Là, sont morts des Canadiens aux épaules larges, les
plus rudes meneurs d'assaut. Là, sont morts les Anzacs
aux faces boucanées de chercheurs d'or. Là, sont morts des Hindous aux yeux de
gazelle. Là, sont morts des Ecossais, des Irlandais, des Anglais de tous les Comtés,
et jamais dans l'esprit des nôtres, ne doit disparaître le souvenir de ces
soldats venus des quatre coins du monde pour garder inviolée la glorieuse cité. 

Middelkerke. – Suite du croquis précédent. A remarquer les ruines de la ferme Groote Bamburgh où s’immortalisa le 7eme de ligne. 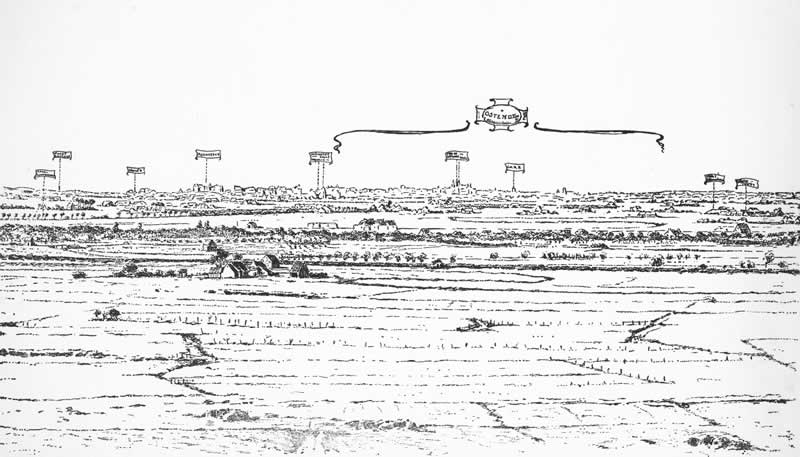
Ostende. Ainsi nos hommes voyaient Ostende, personnifiant en quelques sorte le plaisir, le luxe, le bonheur des jours de paix. Depuis longtemps les « bien
informés », et Dieu sait s'il y a des Belges bien informés, annonçaient le «
kaki », et les soldats, en grands enfants, se réjouissaient à la pensée de se
voir transformés en élégants Tommies. La jeunesse dorée de
l'armée n'y tint plus. Mais comme il était fort difficile de commencer le
changement par la tunique, on débuta par la culotte, ainsi que l'avaient déjà
fait les officiers et beaucoup d'hommes du 7ème d'artillerie attaché
à l'armée anglaise. Quant aux interprètes, depuis longtemps déjà, ils avaient
adopté l'uniforme anglais, le képi excepté. Lorsque les nouveaux
uniformes arrivèrent, la désillusion fut grande ! La ressemblance tant
espérée avec les Tommies n'était que très lointaine. Les vestes étaient en
toile, ce qui n'était pas précisément ce qu'il fallait, pour des gens devant
subir les averses, dormir dans des abris humides, des granges froides, ou
exécuter des travaux faisant ruisseler de sueur. Il y avait quatre naïves
poches à soufflet ; les deux poches de la poitrine, bourrées de bibelots –
mouchoir, pipe, tabac, briquet, etc. – affectèrent, après la première pluie,
des formes de poitrines désabusées. Le « jass » tordit sa
casquette d'affreuse façon, retroussa le bas de son pantalon de toile, se rasa
la moustache, coupa un stick et fut étrangement étonné, après ces efforts, de
n'avoir pas « le genre anglais ». Il est ainsi prouvé qu'il
est toujours dangereux de copier ce qui est fait pour une autre race. Les Belges, qui avaient
grande allure avec leurs vêtements en loque et leur képi de l'hiver (que
certains officiers firent confectionner en kaki, ce qui était parfait), n'en
eurent plus du tout avec leurs nouveaux uniformes ; et puis... donnez la plus
élégante coiffure que vous voudrez à un Belge, étudiant ou soldat, vous verrez
le résultat ! Une partie des officiers,
avec ravissement, se fit habiller à l'anglaise, képi, vareuse, gants, guêtres,
gourde, canne – cela pour les jeunes. Quant aux autres, revenus des vanités
d'ici-bas, ils s'habillèrent en kaki, parce que c'était « prescrit par le
règlement ». Les anciennes tenues
subsistaient pourtant encore ; les pauvres vi-paltots
étaient spécialement chargés de les user, ce qu'ils faisaient avec
indifférence, traînant par les routes un ridicule méli-mélo de vieux uniformes.
Quant aux gendarmes, noirs ils restèrent pour la plus grande joie des piottes,
qui instantanément les surnommèrent « mines flottantes ». En même temps que le
premier kaki, on avait fourni aux troupes des insignes – fusils, lances et
canons croisés – lesquels insignes furent, en un laps de temps
extraordinairement court, transformés en tire-bouchons arrachant les collets,
si ce n'est les figures. Les manches, les képis
s'ornèrent de lettres mystérieuses. Les mitrailleurs furent dotés d'un «
M » les motocyclistes de la même
lettre, mais ailée. « O » sur le képi voulut dire « obusier », et « O »
sur la manche « ordonnance ». L'artillerie à cheval eut sous la cocarde de la
coiffure un « C » qui était équivoque et prêta à maintes plaisanteries d'un
goût douteux. Nous ne continuerons point
l'énumération de ces distinctifs trop nombreux, qui feront plus tard
l'étonnement des uniformologistes. Mais nous ne pouvons
oublier les insignes des automobilistes : une auto, et quelle auto ! Vue
de profil, se répétant au collet, au col de la capote, au képi, chaque homme en
avait cinq ! A nouveau, on se lança dans
la fantaisie ; les guides portèrent d'étranges culottes kaki-rose, les
auto-mitrailleurs les insignes des « Armed-Motor-Car » anglais ; ce fut une véritable floraison
de boutons de cuivre et de corne, de cols et de cravates, de gants à crispins,
de cordons de sifflet, de rosettes d'éperons et de Burbery.
Les hommes se décoraient de badges, et remplaçaient leurs boutons d'uniformes :
« Lion de chez Delhaize » par des boutons anglais. Le sabre fut la partie de
l'armement le plus vite abandonnée par les officiers au début de la campagne.
Nous avons dit plus haut pour quelle raison. Aussi, lorsque l'on réglementa à
nouveau l'ordonnance, il fut fort difficile de se procurer de nouvelles armes.
Il en sortit de partout : sabres français, vieux sabres de cavalerie, sabres à
la Montmorency, sabres anglais portant le G. R. à la coquille, et aussi de ces
redoutables lattes de dragons anglais. On connut même un officier
des carabiniers armé d'un minuscule sabre-briquet, et un officier de cavalerie portant
un sabre de hussard du premier Empire. Enfin arrivèrent les vestes
de drap, les tentes-abris individuelles. Le képi s'orna d'un passepoil
distinctif. Les trompettes, à part
quelques exceptions, eurent des garnitures de laine brune. Les officiers avaient
inauguré, dès l'apparition du kaki, un anachronique bonnet de police,
strictement interdit à la troupe ; la guerre étant très longue, le changement aussi
mauvais soit-il, faisant passer le temps aux administrations, le dit bonnet de
police, auquel on essaya d'adapter un rabat, passa à la troupe. Et le képi
resta définitivement l'apanage des officiers. Cependant, les longs mois
de campagne avaient prouvé que les coiffures sans visière offrent de terribles inconvénients
; mais passons. Une des maximes de l'armée n'était-elle pas : « N'essaie jamais
de comprendre ». 
Le Kaki. – Printemps 1915. Nous donnons ici un ensemble de croquis, de la manière dont fut porté le kaki à son début. Lorsque le casque Adrian
fit son apparition, l'armée entière poussa un cri d'horreur ; il est vrai que
la physionomie du lion placé sous le cimier n'était pas très engageante... Mais
on s'habitua à cette coiffure nouvelle qui, du reste, fit ses preuves. Les jass au premier abord
furent désolés de ne pouvoir donner à leur bourguignotte une allure
personnelle, ainsi qu'ils le firent de leur képi. Mais la ténacité étant une
qualité belge, on vit bientôt des casques aux visières tordues, des lions aux
yeux limés avec soin, ce qui les rendait redoutables, des casques sans cimier.
Le résultat obtenu, on passa à d'autres genres d'exercices. On s'était aperçu que l'étincellement
du casque, malgré la peinture qui le couvrait, rendait précaire l'existence de
celui qui le portait. A l'exemple des Français, nos hommes se firent des
housses en « Vaderland » ; l'Olympe militaire
comprit, et fournit des couvre-casques en toile, lesquels instantanément furent
« enjolivés » d'insignes : grenades, cor de chasse, numéros par devant et par
derrière, le nom du propriétaire ; son numéro matricule, etc., etc. Les gendarmes avaient eu le
casque peint en noir ; leur couvre-casque fut de ton assorti. Dans la cavalerie
apparurent de nouvelles jugulaires tressées, de véritables « jouées » de
cabasset. Ainsi le casque, dont la
légende s'est déjà emparée, débuta-t-il chez nous. A l'instar des Anglais, les
manches commencèrent à s’orner de force insignes : grenades, losanges verts des
signaleurs, jaunes des facteurs, rouges des fusils-mitrailleurs, cor de chasse
pour les trompettes, bombes à ailettes pour l'artillerie de tranchée, et ce ne
fut qu'un début. Les prix de tir reparurent, les officiers d'état-major eurent
un brassard amarante, la police de la route un brassard rouge et blanc, les
commandants de gare, un brassard tricolore. L'aviation porta un « A »
ailé ; les patrouilleurs une étoile et pour compléter la série de l'insigne on
eut les chevrons français, chevrons de front et chevrons de blessure. Quant à l'armement, il
subit de nombreuses modifications. Le génie, en 1916, eut le fusil Lebel, et
les tireurs d'élite un fusil turc dont on avait capturé, dieu sait comment, un
stock venant d'Allemagne. La baïonnette s'allongea, eut une lame noircie ; le
pistolet Colt remplaça le browning devenu introuvable, les lanceurs de grenades
eurent un tabard à poches et les patrouilleurs une dague à rouelles. Au fusil, on adapta une martingale pour le «
lancé » du coup de baïonnette ; la batterie et le bout du canon furent couverts
de toile kaki. La lourde cartouchière portée sur le ventre tendait à
disparaître, remplacée par un ceinturon à poches et à bretelle. En 1918, les cartouchières
de toile firent leur apparition. Le sac de peau de vache,
qui avait peu varié depuis deux siècles, fut, au fur et à mesure des
renouvellements d'équipement, remplacé par un sac de toile fort pratique. On essaya aux tranchées une
sorte de casque et de demi-cuirasse italienne, mais le poids rendait les
amateurs rares. Enfin, en 1918, un nouveau
casque à visière moyenâgeuse allait être donné. Les événements ne
laissèrent pas le temps d'apporter cette nouvelle modification à l'armement. En 1915, les hommes
reçurent la gourde anglaise à cordon bleu ; en 1916, les gourdes de l'ancien
modèle réapparurent, chaque homme en reçut deux. Dans le rang, on rencontrait
fréquemment de grands bidons français, ou des gourdes anglaises en émaillé
bleu. 
Les masques anti-gaz
changèrent de multiples fois, pour aboutir au groin, porté dans une boîte
cylindrique. L'armée eut, en 1917, tout
un jeu de fanions divisionnaires, c'était aux gendarmes d'escorte qu'était
dévolu le rôle de porte-fanion. Tous ceux qui ont passé par
l'armée connaissent les péripéties de la chasse aux bandes molletières; nous
n'insisterons pas. Chacun eut dans ce sens des aventures mémorables. Néanmoins,
il est regrettable que les bandes molletières n'aient pas remplacé les
affreuses petites guêtres « nationales ». Pour se donner une idée
exacte de l'armée en campagne, il faut abandonner toute figure d'uniformité ;
chacun se fait une physionomie à lui, à sa manière de porter les armes. Le contact avec les armées
étrangères amène fatalement des transformations. Au hasard, ce sont des
Belges en culotte bleu horizon, à Merckem en I9I7, en casque français ; ce sont
des soldats venant de la légion étrangère qui portent la fourragère aux
couleurs françaises, ou bien ces soldats des autos-canons, revenant de Russie,
portant la blouse russe. L'hiver, sortiront des
vestes de cuir fauve, provenant des Anglais, des peaux de chèvre des « Pépères »
français et d'étranges gants de tous les tons imaginables. Nos musiques et nos
fanfares réorganisées eurent des instruments provenant des magasins français,
et adoptèrent la formation des « Bands » anglaises. Nous avons parlé tantôt du Burbery ; il fut quasi d'ordonnance, même sous le règne du
plus redoutable des ministres de la guerre. * * * Comme on a pu le voir, ce
n'est pas en une étape que s'est faite la transformation de notre uniforme,
mais par de lents cheminements, par l'expérience souvent douloureuse et
coûteuse !!!... Notre soldat n'en resta pas
moins lui-même avec son allure bon enfant ; et cela nous amène à croire qu'il
fut tel à travers les siècles. 

Les Gourbis. – Eté 1915. Rien n’est plus pittoresque que cette vie sous la tente, qui par les beaux jours d’été avait son charme. La première année de
stagnation à l'Yser avait été passée dans une sorte d'engourdissement ; comme
la lutte ne semblait jamais devoir finir, l'armée, résumant le pays, avec ses
énergies et ses intelligences, réagit, secoua la torpeur et se réveilla. Dans tous les domaines, un
magnifique effort, qui eut d'autant plus de mérites, qu'il fut peu encouragé,
se produisit. Des peintres, parmi
lesquels de beaux artistes comme Wagemans, Bastien, Anspach, Berchmans, Huygens,
Meunier, Houben, organisèrent des expositions qui
remportèrent de gros succès. Tous, ils s'étaient inspirés des spectacles de
désolation parmi lesquels ils vivaient : La Flandre, « leur Flandre » aux
vastes horizons, aux toits chantant dans le soleil, aux canaux endormis entre
les grands arbres, « leur Flandre », éventrée, assassinée. Que sont devenues les
toiles de cette documentation, unique, pour la bataille des Flandres ? Les mauvaises langues
prétendent que l'État les a toutes acquises. Les littérateurs fournirent
une riche floraison, prose, vers, théâtre. C'est au milieu d'eux,
comme un drapeau au centre d'un carré, que vint reposer le corps du grand
Verhaeren ; le soir, lorsque la nuit tombait sur le petit village d'Adinkerke,
ils pouvaient tous aller invoquer l'ombre sublime de leur maître. Un réel mouvement intellectuel se forma avec
Wyseur, Gauchez, de Baugnies, avec Somerhausen et
Frenay-Cid, qui devaient tomber dans l'offensive, comme Boumal. Il y eut des conférences
tumultueuses, des revues, des journaux dont les aventures furent épiques. Le « Claque-à-fond », dont
l'âme était le bon dessinateur Massonet ; plus tard,
« l'Yser », né de la collaboration du sympathique et vaillant Nic-Bar
(Nicolas Barthélemy, de l'ancienne Indépendance,
citations, Ordre de Léopold, croix de guerre, une balle dans la poitrine)
et ... de votre serviteur. Le « Bulletin des gens de lettres et artistes belges
» (excusez du peu !...) et d'autres, d'autres encore, rédigés dans des
cantonnements maussades et imprimés à la « pâte ». En France, depuis longtemps
déjà, paraissaient force journaux de tranchées: « L'Écho des Guitounes »,
« Le Diable-au-Cor », « La Grenade », « Le Plus-que- Torial », etc. L'effort musical était mené
par Corneil de Thoran, dont
nous parlerons plus loin. Ce que donnait son admirable orchestre ? Du Lekeu, du
Duparc, du Haydn, du Moussorgsky, du Grétry ... Pour changer de genre,
l'amusant Genval, le chansonnier des Jass, chantait : Les Vi'paltots, Les Jass, Le Train de Permissionnaires, Et les soldats, les simples
ouvriers et paysans qui suivaient avec une merveilleuse émotion les « Grands
concerts », défilaient aux expositions, perfectionnaient eux aussi leurs petits
talents : peintres aux naïfs essais, écrivains à l'orthographe hésitante,
musiciens vibrants à l'audition de chefs-d’œuvre, et surtout, artisans,
ciseleurs et graveurs, s'appliquaient à voir, à comprendre, à travailler. Qui n'a vu de ces obus
ciselés, de ces bois ouvragés, et surtout de ces bagues, oh, ces
bagues !... Laissons-en parler le charmant conteur qu'est le commandant
Paul André. LES BAGUES (Fragment).
C'est plus que de l'ingéniosité que le soldat mettait à ciseler le
cuivre, à aplatir, effiler, tourner, incruster les bois et les métaux
transformés par ses doigts habiles, et avec les outils les plus rudimentaires,
en cent objets d'une naïve ou amusante fantaisie.
Mais c'est la bague qui connut toujours le maximum de succès. En combien
de milliers d'anneaux gris se sont mués les kilogrammes d'aluminium fondus dans
des creusets de fortune, sur de petits feux de tranchées ou sur de gros poêles
rougeoyants des baraquements ! 
Au début, la bague d'aluminium provenait des débris de fusées
allemandes, ramassées dans les trous d'obus. Mais la matière première ainsi
fournie ne suffit bientôt plus à alimenter l'activité de tous les poilus qui
s'étaient découvert une vocation de joailliers. Et ma foi, – on peut bien
l'avouer aujourd'hui, – les poilus ont triché... Ils ont roulé le client ; ils
ont révélé des âmes roublardes de trafiquants. Et ils ont cherché de
l'aluminium partout où ils pouvaient en trouver : le nombre de marmites, de
gobelets et de gourdes de l'équipement qui disparurent à certain moment fut
tel, que l'autorité supérieure dut s'en émouvoir et édicta des peines
sévères...
Je ne sais si les ustensiles en aluminium furent dès lors épargnés, mais
ce que je sais bien, c'est que le nombre de bagues – toutes faites avec du
métal venu des Boches, était-il, bien entendu, affirmé – alla toujours en croissant.
C'est un peu comme le bronze de certaine cloche fameuse de Reninghe... Qui de nous n'a pas eu, pendant la guerre, sa
bague au chaton formé d'un éclat miroitant de cette Cloche-Gigogne ? Il est
effarant de songer à la dimension qu'elle devait avoir, pour s'être morcelée en
autant de milliers et de milliers de fragments ! 
Ce qu’un fantassin voyait de sa tranchée. De la boue, des entonnoirs d’obus, des marécages : le « no man ‘s land » ; une ligne plus claire de sacs trouées d’embrasures : la tranchée ennemie. En haut de la planche : la redoute de Kloosterhoek.
Pourtant il ne faut pas sourire. Il faut négliger de voir ces puériles
supercheries et ne considérer, au delà de l'innocent mensonge, que l'intention
et l'émotion de celui qui ouvra les menus bijoux de pacotille, qui, en
rêvassant, dans sa solitude, les façonna de ses raides doigts patients devenus
très habiles... Bague
d'aluminium, bague grossière, bague fruste, bague naïve, petite bague du
soldat, la matière dont tu as été faite n'a pas de poids, n'a pas de reflet, de
clarté, n'a pas de valeur, et pourtant, petite bague de guerre, tu es sans
prix. Aux
gros doigts rouges des paysannes, aux fins doigts blancs des jeunes femmes de
la ville, aux gourds doigts ridés des vieilles mamans, tu as eu bien souvent
plus de beauté qu'un riche Joyau. Il
en est, de ces bagues grises, qui ont été gardées, accrochées à une chaînette,
cachées jalousement, chèrement, sur des poitrines de vierges, avec la même ferveur
que s'y tiennent les médaillons enfermant des cheveux ou l'image d'un être
aimé. Ces bagues, – ces bagues venues d'un mort souvent, – ont eu le pieux
prestige des scapulaires sur la gorge des dévotes... Petite bague aux formes simples, au chaton
puérilement enluminé ou enfantinement ouvragé, tu ne
vaux pas dix sous, et pourtant tu n'as pas de prix... Les
larmes que souvent on a versées sur toi sont autrement précieuses que la perle
du plus riche Orient, que le diamant de la plus belle eau. Chère petite bague grise du soldat... Paul
André.
Les « bagues » nous amènent à parler des « Marraines » et les marraines
des permissions.
Oh ! les Marraines... non, ne souriez pas. Grâce à elles aussi « on
a tenu ».
Vous, vieilles mamans à cheveux blancs, ficelant pieusement un petit
paquet qui ira « là-bas » apporter au redoutable filleul, au pauvre cœur
douloureux, un peu de réconfort et l'idée « qu'on pense à lui ». Vous,
coquettes aux longues lettres frivoles et sentant bon, au portrait souriant, et
vous aussi, marraines de la « Vie parisienne » qu'Hérouard,
Préjelean et Léonnec
déshabillaient galamment et coiffaient de casques de fer en place de béguins,
vous toutes, vous aidâtes à souffrir, à tuer l'ennui fait de brume et de canon sourd, à tuer le « cafard
» aux pinces exacerbantes. 
C'était sur le cœur que vos
lettres, vos portraits avaient leur place ; ainsi, ceux qui tombaient ne
crevaient pas en chien perdu. Les permissions avaient
cela de semblable au supplice du pal, qu'elles commençaient bien et finissaient
mal. Lorsqu'il n'arrivait pas
quelque cataclysme militaire, elles s'accordaient tous les quatre mois, que
l'on vivait à décompter les jours, d'abord avec dégoût, puis avec fébrilité. Les préparatifs étaient
importants : il fallait emprunter la tunique de l'un, le bonnet de police de
l'autre, le manteau d'un troisième ; les vêtements hors d'ordonnance sortaient
des coins, ce qui était fort dangereux, certains messieurs importants estimant
que le bougre, qui a traîné sa misère pendant quatre mois, n'a pas le droit d'essayer
d'être coquet. Au fur et à mesure que le
moment du départ approchait, le permissionnaire devenait le plus insupportable des
êtres. Equipé de pied en cap, la
musette bourrée de provisions, de menus cadeaux très pesants, il avait la joie
arrogante. Lorsqu'après de multiples formalités, il avait obtenu son titre de
permission, qui au retour serait couvert de cachets, le Jass disparaissait dans
la campagne. 
Il fut un temps heureux où
l'on « avait avantage » à gagner Dunkerque, sans passer par la gare
d'Adinkerke. C'était alors, sur les routes, l'accrochage des autos ; l'abordage
de galions par les pirates, la surprise de diligences du Wild West par des
Pawnies, n’avaient rien d’aussi féroce que ces prises de possession. On y déployait des
ressources insoupçonnées d'énergie et de persuasion. Mais il fallait tôt ou tard
aboutir au train de permissionnaires, et c'était un pénible aboutissement. Le train, au début, semblait animé des
meilleures intentions, mais bien vite, il fallait abandonner ses illusions et
remettre aux mains du destin, le choix de la date de l'arrivée. Un de ces trains fut même,
un beau soir, attaqué par des avions ennemis ; coût : cinquante tués et
blessés. Dès son installation en
wagon, le soldat se mettait à l'aise ; et Dieu sait ce que c'est qu'un Belge
qui se met à l'aise, surtout lorsqu'il est soldat. A Calais, le troupeau de
permissionnaires se scindait, une partie continuait son lent cheminement vers
Paris ou ailleurs, l'autre se hâtait vers un bateau d'humeur aussi capricieuse
que le train. Les hommes étaient parqués dans l'entre-pont
et sur le pont d'un de ces bateaux, ayant, disent les bien « tuyautés », servi
à la traite des nègres ! La traversée à bord de ce
sabot était une chose autrement redoutable que le plus rageur des tirs de
barrage, aux dires des gens compétents ; et plus d'un soldat qui aurait rêvé
devenir un Jellicoe ou un Beatty, bénissait le sort qui l'avait fait vulgaire «
piotte ». Au bout d'une heure, le
plus flambard des trompettes de cavalerie, qui sont, comme chacun le sait, les
« faquins » les mieux astiqués, ne ressemblait plus qu'à un échappé
de Cayenne. On arrivait finalement, après de multiples
états de consternation, d'indifférence et d'inconscience, à Folkestone, dont le
nom émerveillait les hommes, qui, pour s'en rappeler la prononciation
britannique pensaient primo à leur chien : Fox, secundo, au montreur bien connu
de « Pouchinelles » ; quelques heures
plus tard, dans l'immense vaisseau de Victoria, le flot de Belges aux
capotes ouvertes, aux airs ahuris, se mêlait au flot de Tommies arrivant, armés
de pied en cap, d'Ypres (prononcez Weipers) ou d'ailleurs. Pour raconter les
péripéties des piottes en permission, li faudrait un livre entier, et certains
chapitres ne seraient pas à l'usage des jeunes filles ! Qu'elle était cocasse
l'allure de notre troupier déambulant dans la Rue de la Paix ou dans Oxford
Street ; son bonnet de police archaïque, son laisser-aller en faisaient une
silhouette des plus réjouissante, qui ne choquait que certains grincheux,
auxquels un fusil et un sac auraient rudement bien été. Ah ! certes non – avouons-le
– l'accueil, fait par les Belges en exil à leurs soldats, n'était
pas toujours ce qu'il aurait dû être. On avait pour eux des mots
désarçonnant : « Alors toujours en congé, mon ami?!!... Croyez-moi, vous êtes
mieux dans vos tranchées qu'ici !... Moi, j'ai vu l'attaque de la Somme au
cinéma, ce n'est pas si terrible... » Et lui, le trop humble
martyr, se faisait petit, s'excusant presque d'être malheureux, d'avoir un
uniforme où la boue laissait des taches ineffaçables, n'ayant l'esprit ni assez
prompt, ni assez rosse ! Et involontairement, on
invoquait cet admirable dessin d'Iribe, où souriante,
une jolie femme interroge un officier hâve, mutilé, décoré : « Et alors, et cette petite
gueguerre, mon ami ? » Mais les jours s'enfuyaient
avec une terrifiante rapidité. C'était le retour. Il n'y avait rien de plus
horrible et de plus nauséabond que ces retours. Les hommes étalaient un
moral atroce, étaient vannés, désabusés, avaient le cœur broyé. Et si, au débarquement à
Adinkerke, il tombait une de ces bienheureuses pluies belges, la misère était
complète. On retrouvait la boue, le gourbi, les camarades, indifférents et
goguenards. Pendant l'absence, il s'était passé des tas d'événements, on était
à la veille d'une relève, et les corvées pleuvaient. Au reste, au bout de
quelques mornes jours, l'expermissionnaire racontait
de folles aventures, des bonnes fortunes déconcertantes, et puis.... décomptait
les jours pour la « prochaine ». 
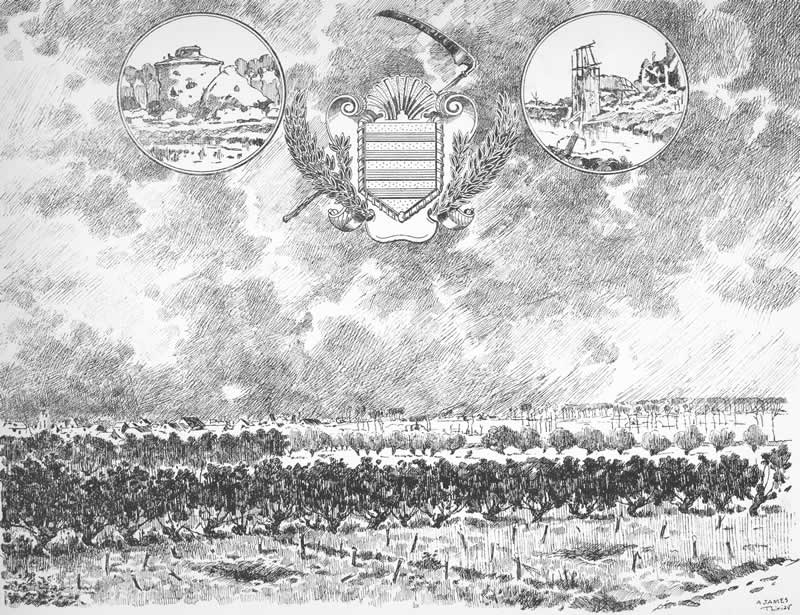
Dixmude. – Août 1915. Ce que, de l’observatoire de Saint-Jacques-Capelle, un artilleur votait de Dixmude, du cimetière, et de la crête Woumen. La capitale du front belge,
de ce coin de patrie que l'on pouvait, du haut d'un clocher, embrasser d'un
seul coup d'œil, était La Panne. Aux premiers jours de
l'Yser, Furnes avait eu d'abord cet honneur redoutable ; mais, pour éviter à
l'adorable petite ville le sort de Nieuport et d'Ypres, qu'elle subit pourtant
en partie, on l'évacua et ce fut La Panne qui devint capitale du royaume. Elle était résidence royale
: « Résidence Royale », les beaux mots pompeux ! N'évoquaient-ils pas les
fastes d'une cour : un palais, des gardes aux portes, des officiers affairés,
tout un monde de laquais galonnés, des piaffements, des trompettes sonnantes et
des drapeaux claquant au vent. Ici, quelques villas
mangées par le sable, près des « barbelés », un vague gendarme de faction,
c'est tout. Y avait-il, pour les deux
grandes figures royales, un cadre plus beau que ce dernier lambeau de pays gardé
au prix de durs et sanglants sacrifices, et n'est-ce pas pour cela que jamais
les souverains ne voulurent s'en exiler ? Leur vie était simple; qui
l'a mieux esquissée que notre grand poète Verhaeren : Parfois, En robe toute droite, ou de
toile ou de laine, Tandis que lui, le Roi, l'homme
qui fut Saint Georges, Pour le « Jass », La Panne
avait des charmes nombreux. Il y avait une plage où
l'on pouvait se livrer à d'innombrables parties de football, la mer pour se
baigner, le sable pour « flemmer ». Il y avait un tramway, des
cinémas, des magasins où l'on vendait « de tout » : de la musique, de la bière presque
bonne, des hôtels, parmi lesquels l'hôtel Terlinck,
la potinière du front. 
Il y avait l'Ambulance de
l'Océan, emplie de nurses qui n'en étaient pas moins de jolies filles,
agréables à regarder, et jetaient dans la monotonie du kaki sale, la note
claire de leur robe, que le vent, fort indiscrètement, collait à des corps
frais et jeunes ; les jours d'été, elles prenaient leur bain…, oh événement !
Et nous nous rappelons de certaine baignade prise par discrétion, à la nuit et
tombante, troublée par la patrouille de garde : « Pas se baigner après le
coucher du soleil, Misske. » (Pour le soldat, toutes
les nurses étaient des Misskes). Mais pour se rendre dans
cet oasis, il fallait passer de redoutables postes de gendarmes (P. P.),
montrer force papiers, ce qui n'empêchait personne d'y aller en fraude, le
plaisir s'en trouvait doublé. L'Ambulance de l'Océan « Depageville », les postes chirurgicaux avancés des
docteurs Neuman et Delporte – plus tard l'hôpital de Vinckem
– avaient au front une réputation réconfortante pour ceux qui, chaque jour, s'exposaient
à être « salement amochés ». C'était devant La Panne que
les monitors anglais venaient se placer, lorsqu'ils avaient un compte à régler avec
les batteries de côtes allemandes, et la petite ville avait la primeur des
raids d'avions ; bien souvent la casse fut sérieuse. 
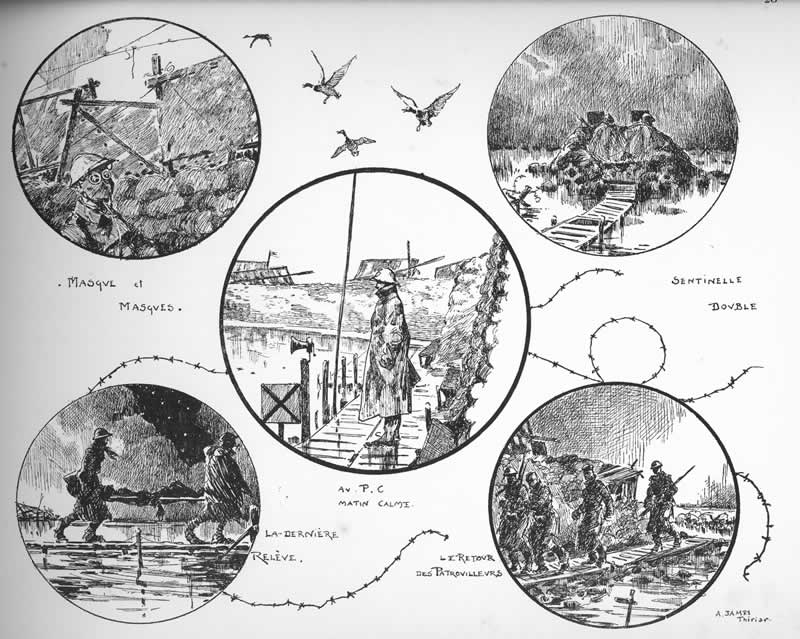
Aux Avant-postes. Dans la partie inondée du front, les avant-postes étaient installés sur de minces bandes de terre immergeantes ou dans des ruines de fermes ; la relève s’y faisait nuitamment. Les Avant-postes étaient protégés eux-mêmes par un réseau de petits postes. On avait pu, dès les
premiers jours de campagne, constater qu'il était absolument nécessaire de masquer
les batteries d'artillerie ; non seulement pour les observateurs terrestres,
mais aussi pour les observateurs en avion. On s'était contenté alors de
modestes branchages, qui défilaient les pièces tant bien que mal. A l'Yser, comme sur tout le
restant du front immobilisé, la situation des adversaires face à face, essayant
de paralyser leurs artilleries, fit chercher tous les moyens de cacher les
canons des vues de l'ennemi. Lorsque les batteries se trouvaient dans des
villages en ruines, à proximité de fermes, la chose était aisée : des faux
toits, des granges écroulées, abritaient les gueules d'acier. Mais, cacher en plein champ
des pièces avec tout leur monde de servants et d'observateurs, était moins
aisé. C'est alors, que naquit en
France et en Angleterre ce véritable art, qui s'appelle « le camouflage ». Ce
ne furent d'abord que de timides essais, des tâtonnements qui firent non
seulement sourire les soldats, mais aussi tous ceux qui voyaient la guerre
présente à travers la tradition. Puis, peu à peu, on se fit à cette idée et
l'on put apprécier les services rendus par cette nouvelle méthode. Bientôt, sur
tout le front, le camouflage déploya ses mille ruses d'escamoteur : arbres
truqués pour les observateurs, faux sacs pour les guetteurs, filets de rafia s'étendant au-dessus des batteries entières, masques
pour cacher le mouvement des routes, etc., etc. 
L'énorme champ de bataille
avait ainsi pris un aspect déroutant, pour quiconque eût voulu retrouver, là,
les traces des anciennes méthodes et traditions guerrières. Le soldat était
devenu, en quelque sorte, un rude travailleur attelé à un labeur semblant sans
fin. Le courage même était changé ; ce n'était plus la flamme ardente d'un combat
au grand soleil, un cliquetis d'acier, un déploiement d'étendards, des
sonneries de trompettes ; vêtu d'un costume couleur de terre, coiffé d'un
casque de mineur, le soldat devait à toutes les minutes songer à mourir. Au front,
aux tranchées, en patrouille, soit, c'est l'action ; mais aussi, la nuit, au
cantonnement de repos, alors qu'éloigné de la réelle zone de mort il croit
pouvoir reposer son corps et son âme. Dès que la nuit se fait noire, jaillit
soudain le long pinceau lumineux des projecteurs, et bientôt le ronflement des
moteurs annonce les avions ennemis. Notre excellent poète
Marcel Wyseur, qui fut avec nos troupes là-bas, a
bien voulu nous donner une intéressante impression de « raid ». Celle qui vient ... Raid d'avions. Quels hommes sont marqués ce
soir du signe rouge, Entendez-vous venir la Mort avec
sa faux, A l'ombre Elle a quitté «
l'autre » pays de Flandre, Ceux qui veillaient de nuit aux
créneaux de combat Quels hommes sont ce soir
marqués du signe rouge, Marcel Wyseur. La brièveté de cet album ne
nous permettant pas de longues descriptions de la vie du front, nous donnerons ici
quelques simples croquis : I. – L'Observateur. Il est le roi des ruines,
roi d'une grange éboulée, de trois pans de mur, d'un grenier-observatoire, d'un
abri. La végétation multiple
l'entoure : graminées, oseilles. sauvages, pirêtres,
liserons, buissons d'aubépines. C'est son parc, plein de
senteurs âcres et sauvages, de bourdonnements et de cricris. Son parc a aussi,
entre les iris jaunes et les roseaux dodelinant, un étang de moire : c'est une
eau morte, oubliée ; elle est noire et azur. Un couple de canards y niche ;
souvent le roi les affûte avec une carabine de guerre et jusqu'à présent les
rata ; c'est paraît-il « la faute à la carabine ». Eux plongent sans bruit,
disparaissent dans les roseaux ; au soir ils barbotent en « points et barres ». Comme mortes, les
grenouilles flottent, leurs yeux d'or en périscope. Le soir, le petit morceau
d'eau fait estampe japonaise. 
La Relève à Drie-Graghten. – Hiver 1917-1918. Drie-Graghten se trouvait dans le secteur reconquis par l’offensive de 1917. La route de Noordschote à Drie-Graghten, par laquelle nos troupes allaient aux avancées, n’était plus qu’une suite d’entonnoirs et de terres éboulées. Dans le grenier, il y a des
étourneaux qui mènent grand bruit de sifflements, volent avec fracas et font tomber
des brindilles de paille sur la tête du roi. Le roi est vêtu d'un
jersey, d'une culotte étrangement déchirée, de grosses chaussettes et de
sabots, ses mains sont singulièrement sales, il a la barbe en brosse-à-dents et
un bout de pipe au bec. Toutes les batteries allemandes,
il les connaît par leur nom, leur prénom, leur numéro ; ce savoir en fait un
personnage. Il a deux sujets : un téléphoniste qui, lorsqu'il n'est pas « en
révision », siffle spécialement la Valse brune ou Madelon, lime
des bagues et bâille, en émettant diverses sentences philosophiques sur les
marraines et autres sujets plus oiseux ; un chien, qui résume de nombreuses
races et a de multiples ennemis, parmi lesquels les puces et les rats : les
ennemis du roi. Il n'a pas son pareil pour déchiqueter une vieille chaussette
et paraitre occupé tout le jour ; comme le roi lui a confié de nombreux
secrets, il prend des airs importants. 
Le roi a d'autres ennemis
plus redoutables que les puces et les rats ; d'abord le téléphone, implacable curieux,
et aussi de sinistres oiseaux qui souvent, par rudes vols stridents, viennent
s'abattre sur son parc, son château, l'entourent de bruit, de fumée et d'éclats
mauvais. Qui sera vainqueur de lui
ou de ces ennemis-là ? II. –
L’Accordéon. Août, midi. Le ciel immuablement bleu
pèse sur les tranchées blanches, ensanglantées de coquelicots. De la plaine inculte
monte, dans un flottement de vapeurs, la chanson de l'été, faite de cricris et
de sifflements. Comme engourdi de paresse, le canon de temps à autre sourdement
secoue l'atmosphère surchauffée. L'homme a pris son accordéon et, autour de
lui, le cercle s'est fait. Ses doigts errent, cherchent et soudain la chanson
s'envole, sautillante et vieillotte. Sous l'avance des casques,
les regards fuient, loin, loin ; les fronts se courbent. Et lui, grave et
impassible, marquant la cadence, fait pleurer le soufflet aux couleurs criardes. ... C'est la kermesse aux
carrousels bruyants, la salle de danse enfumée, l'air que l'on détaille la
bouche en cœur, pour la krotje. ... C'est le chant de la
vieille rue joyeuse et sonore, c'est le cabaret aux fraîches effluves de bière,
des beaux dimanches de paix. ... C'est le refrain devenu guerrier,
chanté la bouche sèche sur les routes poudreuses du Brabant ; c'est le chant
des relèves boueuses. … Et les fronts se courbent
lourds de mélancolie et de haine... III. – Le
Laboureur. Là-bas, entre les arbres
s'étageant sur la côte, un point noir va, vient lentement. Il y a un cheval,
une charrue, un homme. Entre lui et nous, il ya
deux lignes blanches immobiles figées dans leur haine, les deux tranchées face
à face ; il ya la mort. Et les yeux étrangement
attirés suivent le laboureur, qui retourne la terre belge entre les batteries
allemandes, muettes ou hurlantes. Et la grande rêverie
engourdissant monte au cœur : on laboure en terre Flandre. IV. – Le
Guetteur. Cela barde partout, sans
arrêt, de toutes parts. Rapides, brèves, des lueurs éclairent le ciel. Sans
arrêt les obus craquent dans le noir, devant, derrière, fouillant le sol,
rasant les passerelles ; par moment le ciel semble être devenu une voûte sonore
où vrombissent, râlent des oiseaux de fer. Sans arrêt les fusées montent,
lentes, vacillantes, éclairant le paysage de cauchemar de lueurs blafardes. Là,
dans les sacs, en dehors de l'abri, du passage couvert, il y avait donc un
homme ? Un casque brille et, sous
sa visière, un masque impassible regarde l'horizon... C'est le guetteur. Tantôt un obus tombera tout
proche, secouant le sol, lançant vers le ciel, des choses inconnues qui
retombent avec un bruit mat. Est-il toujours là ? Oui. V. – Les
Gestes éternels. De son pas lent, mesuré, le
semeur va et, d'un geste large, il fait pleuvoir, dans les sillons, une pluie
d'or. De son pas lent, mesuré, il
va, entre deux haies de piquets, où s'accrochent des ronces de fer. A l'horizon il y a son
village en ruines, derrière lequel gronde la lutte. Mais il ne regarde pas le
village, il n'écoute point la rumeur de mort. Il ne quitte pas des yeux le
sillon gras : sa terre. Pourquoi pas ? Est-ce parce
qu'il a sur la tête un casque de fer qu'il doit oublier et le printemps et
l'amour que le vent tiède apporte des prairies en fleurs ? Demain, peut-être,
on dira : « Pauvre diable. Bah ! chacun son tour, c'était un brave
garçon. » Demain, peut-être, il ne sera plus dans un lit d'hôpital, qu'une
guenille lamentable, hideuse et sans espoir. Alors ! feriez-vous autrement ? VI. –
Maximes. Avant d'obéir à un ordre,
attends le contre-ordre. Si on avait eu des chevrons
pour blessure d'amour propre, il n'aurait pas suffi des deux manches. Il faut toujours remettre
au lendemain, ce que l'on peut faire le jour même... La croix de guerre ? Nous
l'avons tous portée pendant quatre ans. On a toujours un plus
embusqué que soi. Avant d'exécuter un ordre,
cherche une victime d'un grade inférieur, mais suffisant. 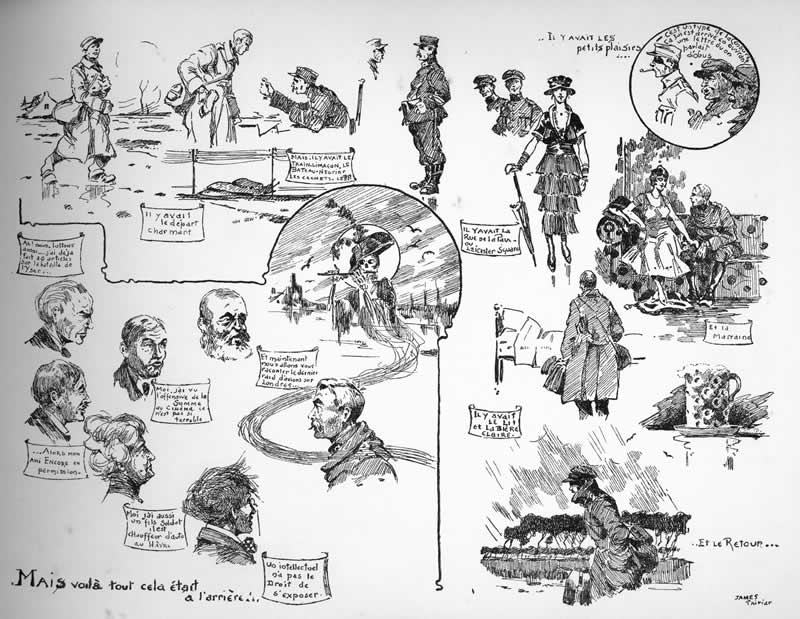
En Permission. … On vivait en pensant à la dernière, et en espérant la prochaine. 
Pièce de 75 sous son camouflage. – Chemins des Rondins, Merckem, Hiver 1917-1918. Après de timides essais, le camouflage était arrivé à masquer sur le champ de bataille tout ce qui était d’utilité militaire. Pour alimenter l'arrière et
le monde entier de nouvelles journalières du front, il y avait le communiqué «
officiel ». Soit dit en passant, notre communiqué belge n'était pas fait pour faire
valoir les efforts de notre armée. Modestie ou indifférence ? On y parlait vaguement «
d'habituels combats à coups de bombes à Steenstraete », de « batteries prises à
partie ». Certain communiqué même, « nous avons dispersé un groupe de travailleurs
», eut son heure de célébrité. De là naquit cette déplorable légende, qu'au
front belge, il ne se passait rien ; il s'y passait tout autant que sur le
restant du front, seulement il n'y avait personne pour le dire. Un autre communiqué
existait : le communiqué « Piotte » : celui-là fait d'informations, dont il
était assez difficile de vérifier les sources, mais qui, très souvent, étaient
d'une étrange exactitude. Le communiqué « Piotte
» savait tout : les relèves, les reprises de secteur, les revers subis sur un
front lointain, les remaniements ministériels, le nom de ceux qui arrivaient au
pouvoir, comme de ceux qui étaient « enduits » ! Aussi, lorsque le dit
communiqué annonça, en 1917, qu'il allait y avoir sur notre front une offensive
« castar », personne n'en douta. On releva les troupes
françaises tenant le secteur de Nieuport : les « pépères », par des « mangeurs
de feu », venus de tous les coins où cela bardait ; nos troupes virent s'intercaler
dans leurs lignes, de ces redoutables régiments français et anglais, tenus en
réserve pour les coups de chien ; il y eut une suite de mouvements que les gens
bien informés prétendirent comprendre, et que personne ne comprit. Il passa de tout : des « Anzacs » aux grands feutres de chercheurs d'aventures, bras
nus ; des Écossais aux glenngaries romantiques,
suivant des cornemuses plaintives et des tambours battus avec des gestes
d'acrobates ; des Maoris, faces de singes, chignons huileux, et puis des Français
: des « diables bleus », le béret sur l'oreille, le mollet musclé ; des
tirailleurs, dont la peau variait du jaune au noir, le coupe-coupe battant la
cuisse ; des nègres ruisselant de sueur, disant d'un air sentencieux : « y
a là chaud » ; il passa de toutes les races du monde, sous les yeux
étonnés et amusés des « Jass ». Les routes tremblèrent sous les roues de
canons géants, traînés par des tracteurs tumultueux. Comme aux grands jours,
réapparut la cavalerie : chasseurs d'Afrique aux petits chevaux dansants,
dragons majestueux. On travailla, on remua de la terre, « on y crut ». Les canons s'amoncelèrent.
Dans les cabarets, on se saoula fraternellement avec une bière aigre. A la Panne, les troupes
anglaises firent la parade aux sons des grands tambours armoriés et des fifres
aigus ; les Australiens prirent des bains sensationnels : hommes nus, chevaux à
poils ; puis, il plut... il plut pendant des jours et des jours et, malgré les
rafales, embuant tout, poissant les capotes, malgré la boue, mangeant hommes,
chevaux, canons, même les âmes, l'offensive se déclencha sous un ouragan de
mitraille. Nos piottes eurent peu à
faire dans cette bagarre ; mais ce qu'ils firent, ils le firent bien. Les carabiniers de Baltia montrèrent que, toujours, le même esprit superbe les
animait. Et puis... et puis... on en
resta où l'on était précédemment. On eut Papegoede et
Languewade, et Champbeaupert,
et Montmirail, et des ruines, et de la boue, et des arbres hachés, et des
entonnoirs d'obus pleins d'une eau infâme, où les charognes montraient des
morceaux de chairs verdâtres. Mais on avait mordu au
morceau, ils avaient reculé. 

Les Gestes éternels. Ni la guerre, ni la mort n’arrêtèrent ces deux grands gestes de vie.
L’année 1918, qui devait se terminer dans la gloire, commença dans la misère.
L'hiver, très dur, avait déprimé le moral de nos soldats, mais le froid n'était
rien. L'armée et la nation allemandes souffrant du mal qui allait amener leur perte,
mettaient tout en œuvre pour communiquer à l'armée et à la nation belges les
mêmes germes de décomposition. Jamais le fiel ne fut répandu avec plus de
maîtrise : les journaux et les proclamations d'alors en font foi, et l'on peut affirmer
que jamais non plus nos troupes n'eurent à subir plus rude assaut. On sait avec
quel succès elles résistèrent à cette forme nouvelle d'empoisonnement.
Mais la campagne elle-même s'était faite plus âpre. Au début de l'hiver,
les Français avaient remis à notre armée le terrain conquis par eux, l'été
précédent, aux lisières d' Houthulst : une bande de territoire ulcérée d'entonnoirs
visqueux, semée d'abris allemands à demi éboulés et de moignons d'arbres
noircis aux racines perdues, mortes dans l'infâme pourriture du charnier. Les
relèves y étaient atroces. Les hommes devaient se lier les uns aux autres pour
ne pas s'enliser dans le sol en décomposition. Gare à qui lâchait les guides. 
L'organisation des lignes avancées se faisait
au petit jour, aussi bien chez l'ennemi que chez nous, et les souffrances
étaient si grandes, la misère si profonde, que le plus souvent fusils et
mitrailleuses demeuraient silencieux. Ces instants d'abandon, d'apathie, alternaient
avec des montées rageuses de haine, et de combats de nuit au coutelas et à la
grenade eurent pour théâtre ce hideux cloaque dont les hommes sortaient
imprégnés d'une boue gluante. – Ciel gris et bas, neige ou pluie, vent aigre ou
bise glaciale. – Pour distraire les hommes, on les mit à la recherche du
matériel abandonné par les Allemands. La moindre fouille mettait au jour des cadavres
à demi enfouis et, pareils aux ermites des thébaïdes antiques, nos jass purent
faire là, d'amples provisions de philosophie. Il est vrai que quarante mois de
guerre leur avaient suffisamment démontré la fragilité de l'existence
humaine ! Les
premiers rayons du printemps firent monter chez les nôtres une sève
bienfaisante de colère, et chez tous les belligérants l'opinion s'ancra qu'il
fallait en finir une bonne fois, coûte que coûte. Jusque
là, la longue guerre de tranchée avait contraint notre cavalerie à l'inaction.
Finie, l'époque glorieuse des grandes charges le sabre au vent. L'homme de
cheval était devenu un piéton empêtré d'une monture et mis à toutes les sauces.
D'où les flots d'humour déversés sur lui par le piotte, sous la forme de
sobriquets variés et toujours inattendus : « Hussards ou cosaques de Bourbourg
», « Sous-marins » – n'avait-on pas sottement comparé la capture d'un U, numéro
quelconque échoué sur la grève, par les cavaliers en manœuvre, à celle de la
flotte hollandaise au Texel par les escadrons de Pichegru ! – nous en
passons et des meilleures. 
Les
cavaliers riaient jaune et répondaient aux sarcasmes par le mépris traditionnel
de l'homme de cheval pour le misérable insecte qu'on nomme fantassin. Survint
l'affaire de Reigersvliet et les rieurs passèrent de
l'autre côté. Tout d'abord à l'idée que les cavaliers encaissaient, les
fantassins, les artilleurs et même « mannen van de genie » peu enclins pourtant à la plaisanterie s'amusèrent
énormément ; mais, quand on apprit que la cavalerie avait non seulement tenu,
mais qu'elle avait poussé à l'attaque et qu'elle avait enrayé net, en plein
soleil, l'élan des fameuses « stosstruppe »,
quand, on vit revenir les escadrons boueux et sanglants, les casques bosselés
et les baïonnettes rouges, ramenant des prisonniers, le rire fit place à la
stupéfaction puis à l'envie. Enfin, n'y pouvant tenir, un fantassin « à qui on
ne la faisait pas » osa émettre certains doutes. Comme il demandait narquois :
« D'où est-ce donc qu'ils viennent ces prisonniers ? » la réponse tomba,
hautaine... « de Bourbourg. » Et la cavalerie était vengée. 

Le retour de l’attaque. – Prise de Papegoed le 11 septembre 1918. Ce fut un des premiers coups de sonde, précédant l’offensive. Les blessés et les prisonniers reviennent vers l’arrière. En haut de la planche quelques types de patrouilleurs et de prisonniers.
Beaucoup d'efforts furent faits, les deux dernières années de guerre,
pour distraire le soldat déprimé par l'interminable séjour dans les tranchées. Déjà
les armées anglaises et françaises possédaient leurs troupes théâtrales, et ce
furent les poilus français qui installèrent à Coxyde
la première salle de spectacle. Le
théâtre aux armées ! A cet énoncé, l'imagination complaisamment situe une
tente aux grands plis. Embourbés dans les chemins d'un camp, de lourds carrosses
encombrés de coffres. Sur un tertre fleuri, des comédiennes haut juchées sur
leurs patins, minaudent, entourées par tout un monde d'officiers, tendant la jambe,
courbant leur perruques poudrées ainsi qu'à Versailles, la main baguée au
pommeau de l'épée à facettes d'acier. Le grand vent qui pousse les nuées fait flotter
les « Steinkerques », les rubans des catogans, écarte
une boucle, ouvre un manteau et découvre un sein rond. Des
acteurs ventripotents et rougeauds s'affairent, aidés par des heiduques nègres
en turbans à aigrette, et transportent à pleins bras des costumes à paillettes,
des houlettes et des tambourins. Ce
sont les préparatifs fébriles mettant tout un monde de courriers, de charpentiers,
de marmitons sur les dents, tandis que la ville assiégée s'endort là-bas, sous
ses toits rouges, ses moulins et ses clochetons, dans sa ceinture de glacis et
de poternes. Devant
son miroir posé sur un grand tambour fleurdelisé, Philaminte
se farde, précieuse, pose ses mouches, en déshabillé du dernier galant : nuages
de dentelles, froufrous de soie. Des madrigaux voltigent sentant bon la
bergamote. Le miroir indiscret et complice montre une épaule ronde, la corolle
d'un sein dans la dentelle, aux cent flatteurs qui se pressent en un
froissement d'acier, de fourrures et de hausse-cols. Au
son des flûtes, des hautbois et des violons, les tendres bergerettes dévideront
leurs vers doucereux devant le public farouche des régiments aux noms sonores. Parti
de la Comédie, le refrain alerte et gaillard s'en ira mourir, ricané par les
fifres, appuyé par le roulement des caisses, chanté par Fanfan-la-Tulipe sur les
routes de Flandre et de Bohême, et, plus d'une fois, pour mener la charge de lourds
escadrons, le refrain mignard se fera chant de guerre et le cri de mirliton,
cri de victoire. Entre
soldats et comédiens régna toujours la bonne entente. Ne doivent-ils pas, les
uns comme les autres, en toute sincérité, se donner en spectacle, plastronner et
s'illusionner sur une scène plus ou moins vaste ? Les
grands gestes, les mots que l'histoire pieusement conserve, furent souvent des
effets de scène voulus. Sur le « plateau » comme sur le champ de bataille, on dira
un bon mot, on exécutera une pirouette pour enlever son public, se camper
premier rôle. Pour
les enfants de Mars aux visages hâlés, aux grands cris farouches, eux aussi
acteurs tragiques prêts à bomber le torse devant la Camarde, ultime
spectatrice, soubrettes et coquettes eurent toujours des complaisances. Les
meilleurs d'entre leurs baisers ; les plus gracieux d'entre leurs sourires
s'envolaient vers ceux-là qui consacraient le faste théâtral, par leurs habits chantants,
étincelants d'or et d'argent, vers ces visages à demi-cachés sous le casque à
la Minerve, vers les centaures aux cuisses soutachées, cambrés ainsi qu'en un
cirque sur leurs chevaux chabraques de panthère, vers ces housards attifés de
fourrures comme des filles, vers tous ceux-là que la munificence impériale ou
royale couvrit de feutres empanachés, d'aiguillettes et de pelisses chamarrées.
Coquettes et soubrettes redisaient tout bas, les devises emphatiques gravées
aux lames des sabres, et, pour charmer les loisirs de ces demi-dieux, la
Comédie entière se serait fait tuer. Comme
elles aimèrent le tumultueux cavalier du Roy, elles aimèrent le volontaire
demi-nu jurant par les héros de Racine. Pour lui, la Montansier,
vint en Flandre... L'histoire
du théâtre aux armées de l'Empire n'a jamais été faite, mais l'on conserve le
nom prédestiné de l'actrice Fusil qui recueillit, pendant l'affreuse retraite
de Russie, Coco Lefebvre, le fils du maréchal duc de Dantzig. Le
théâtre des zouaves en Crimée, eut son heure de célébrité. Là aussi, les
troupes s'immobilisèrent de longs mois durant dans la neige des tranchées. La
guerre d'aujourd'hui s'annonçait si foudroyante, si brutale, que l'on ne
pouvait rêver au retour de ces « fadaises ». Et pourtant, tels que jadis,
ils sont revenus dans leurs vêtements de ville, étranges au pays sanglant, nos
grands amis de la Comédie. Les
routes ont revu modernisé le char de Thespis du Capitaine Fracasse, les lourds
chariots boueux transportant dans les chemins de la réalité, les décors de
l'illusion. Elles
ont assisté un peu pâles, les comédiennes, à des bombardements incendiant
l'horizon et faisant trembler le sol. Elles ont vu passer les ambulances
lamentables, les relèves héroïques. Elles ont vu les coulisses du plus grand
des drames joué sur la plus grande des scènes. Les
hôpitaux, les premiers, eurent des salles de spectacle avec décors, rampes et
rideaux. Dans les cantonnements, on aménageait des tréteaux de fortune et le «
théâtre » était garni de drapeaux, de flammes de lances, de couvertures.
Des devises s'accrochaient aux murs. Et l'illusion, la bonne volonté, faisaient
le reste. 
Le Guetteur. L’attaque bat son plein, les tirs de barrage se précipitent ; tous ceux qui le peuvent sont terrés dans les abris, seul, le guetteur veille, face à l’ennemi. 
L’homme de liaison. Les fils téléphoniques sont coupés ; les signaux lumineux inobservables. C’est au coureur à traverser la zone de mort pour faire liaison entre les diverses unités engagées. Les
acteurs étaient des soldats aux mains rudes, aux masques énergiques. Quant aux
travestis, ils manquaient parfois de finesse ; il était difficile d'oublier que
« l'ingénue » faisait, la veille encore, le rude métier de grenadier ou de
patrouilleur. Mais, comme on dit chez nous, « cela ne piquait pas de si près ». L'homme
de guerre – ceci peut sembler un paradoxe – est essentiellement sentimental. Il
adore entre tout, la chansonnette larmoyante que l'on susurre, la main sur le
cœur. Le chanteur, a dans sa compagnie ou son escadron, une importance, une
autorité extraordinaires. Les hommes l'adorent, font ses corvées. Quant aux officiers,
ils le considèrent et le protègent. Ceci fait partie de la psychologie des
armées en campagne. Ne faut-il pas, aux minutes graves, aux heures déprimantes,
pouvoir compter sur celui qui, par un lazzi, une chanson ou un bon mot,
ranimera les courages défaillants ? Peu
à peu cependant, le théâtre, au sens que nous donnons à ce mot, s'organisait
dans nos lignes. Nos soldats connurent alors de vrais artistes, de vrais
décors. M. Corneil de Thoran,
le réputé chef d'orchestre de la Monnaie, qui fut un soldat sans peur, s'occupa
d'organiser des spectacles au front, et l'orchestre qu'il fonda, n'ayant pour
toute ressource que les éléments de l'armée de campagne, atteignit un degré de
perfection extraordinaire, en dépit des circonstances si difficiles du moment. S.
M. la Reine, dans un beau geste d'affection et de bonté, résolut alors de doter
l'armée, de théâtres assez vastes pour que tous nos braves pussent en profiter. Un
seul fut achevé, à Hoogstade, et son inauguration coïncida
avec l'attaque des Allemands en avril 1918. Cependant, la grande première eut
lieu, malgré la gravité de l'heure et le fracas de l'artillerie. Ce fut
émouvant. 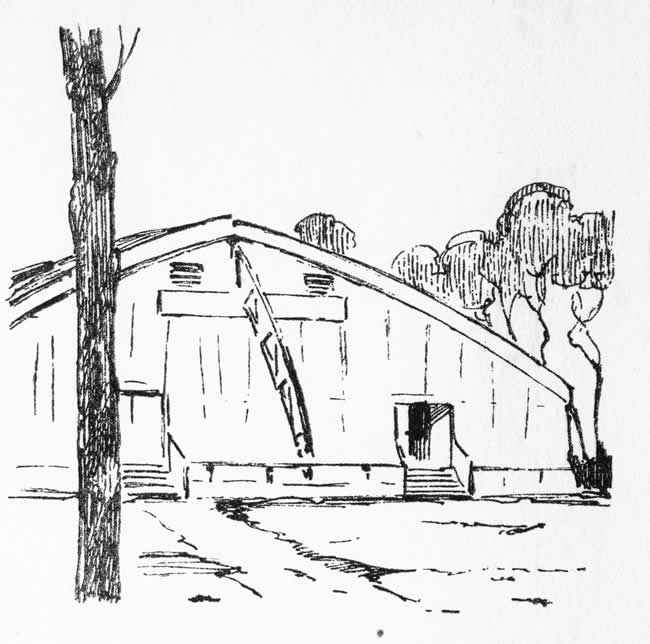
Au
loin, la bataille faisait rage, et le grondement des 120 et des 210 couvrait
par moment la voix des acteurs. Mais la Reine garda son sourire aimable et les
spectateurs, firent aux artistes, un succès mérité. Après
la bataille de Merckem, le théâtre reprit une physionomie plus paisible. Le
spectacle était autant dans la salle que sur la scène. Le public rôtissait sous
la toile et ne manquait pas de prendre ses aises. Et si, par hasard, les
caissons de l'artillerie ou la musique de quelque régiment défilaient sur la
route, l'orchestre agonisait et mourait bientôt pour ressusciter quelques
instants plus tard. 
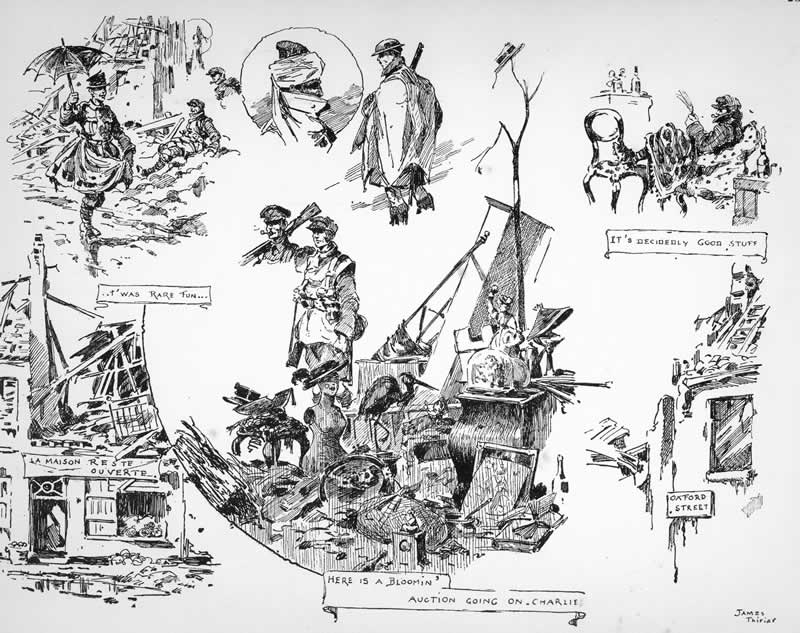
Les Anglais en Flandre. Ypres et Poperinghe, occupées par les Anglais, avaient une physionomie tout à fait différente du restant du front. Dans les ruines et la misère, les Tommies gardaient leur flegme et leur humour. 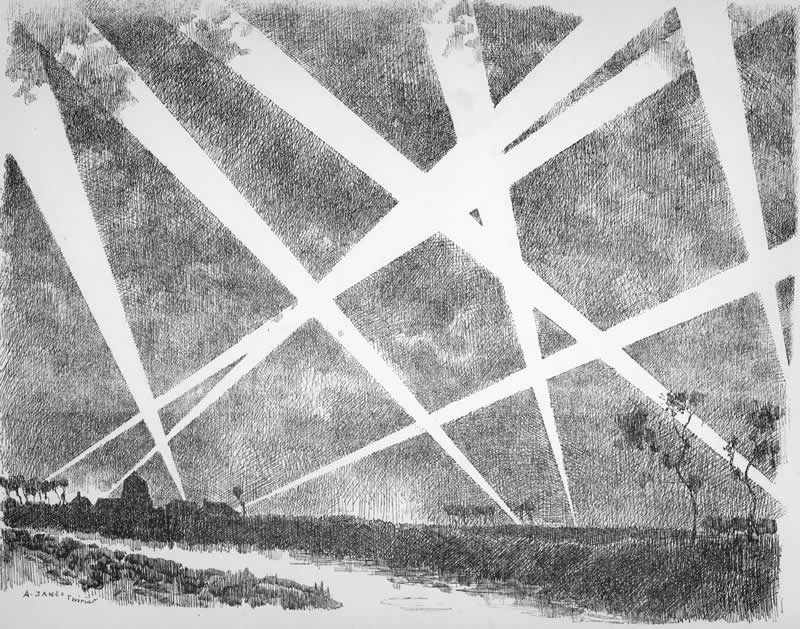
Le ciel de Flandre un soir de raid. Tous ceux qui ont vécu dans la zone de guerre, connaissent ces ciels-là ; les projecteurs balayant la nue, les coup de départ et les éclatements de shrapnells, le grondement des bombes.
En avril, les Allemands vinrent donner de toute la vigueur d'un assaut
furieux sur les premières lignes conquises en 1917. On connaît l'historique de
ces grandes journées : deux divisions belges, la 3e et la 4e,
arrêtèrent net la marche en avant de l'ennemi, dont le but était Poperinghe. Mais au sud, les Anglais s'étaient laissé
arracher Kemmel et ses collines. L'heure était grave. Une
fois de plus, l'héroïsme de nos soldats sauva la partie. Cernés, les blockhaus
résistèrent, tirèrent leurs dernières cartouches. Les éléments en retraite ne
cédèrent que pas à pas, manœuvrant comme à l'exercice. A l'arrière, comme au
front, c'était la fièvre. Les renforts se précipitaient sans arrêt pour aller
boucher la trouée. Les troupes en marche croisaient des colonnes de prisonniers
gris, les hommes aux bottes lourdes, au grand casque de tranchée bizarrement
camouflé, les officiers en casquette, hautains et rageurs. Un
jour, qu'ils passaient ainsi devant le poste de commandement du général
Jacques, celui-ci les accueillit sur le pas de sa porte par un bref : « Parade-marsch » ! L'effet fut instantané. Il sembla qu'on eût
déclenché un ressort. Les Boches se redressèrent. Avec ensemble, les talons
ferrés claquèrent aux pavés, les jarrets se tendirent. Et le défilé commença.
Or, quand il fut terminé, le général, qui voulait s'amuser et surtout amuser
les jass qui l'entouraient, fit la moue et dit : « Pas fameux, hein ? » puis,
d'une voix claironnante, de cette voix qui, à Liège et à Dixmude, dominait le
bruit de la fusillade, il clama : « Demi-tour ! Recommencez ! » Cependant,
les hôpitaux regorgeaient, et, par centaines, les autos d'ambulance y versaient
sans répit leurs flots de souffrance. On
pouvait lire sur la figure des blessés, dans leurs vêtements en loques, toute
la furie de la bataille. Quelle vision que ce cortège de visages hâves,
plombés, souillés de terre et de sang, où s'écarquillent des yeux fous ! Les
pansements suintent goutte à goutte, les hommes titubent, ivres de fatigue ou
de faiblesse, les uniformes à demi arrachés, raidis par la boue jaune de
Merckem. Les civières passent en longues files, amenant leurs guenilles humaines,
leurs choses atrocement mutilées, leurs corps hachés d'où le sang pleut à
larges gouttes et fait au moindre arrêt, de grandes taches sur le pavé. Mais
la minute n'est pas aux attendrissements. Le boche est là, tout près, mettant
ses ultimes espoirs dans un grand coup « qui doit faire trembler l'Europe ». 
Malheureusement pour lui, il était devenu
très difficile de terrifier nos soldats, tannés, bronzés et trempés dans cette
usine formidable que fut la grande guerre. Dans
les champs de Merckem, les Jass avec leur casque d'acier bosselé, avec
leur lourde capote et leur dague à rouelle digne des communiers
flamands, avaient montré ce qu'on pouvait attendre encore de leur énergie.
Jusqu'au grand jour de l'offensive, si impatiemment attendu, ils demeurèrent tels,
tenaces et farouches. Les
souffrances et les luttes de quatre années avaient nivelé les conditions si
différentes, élevé les cœurs de tous ces hommes, nobles ou paysans, artistes ou
bourgeois, illettrés ou intellectuels. Et les cœurs battaient à l'unisson dans
une seule pensée : Bientôt ! Oh !
certes, lorsqu'on le rencontrait à Paris où à Londres, notre petit Belge
n'avait pas grande allure à côté des Ecossais bien ficelés, ni des Anzacs traitant la guerre comme un sport de plus et voilà
tout. Il était un peu balourd. Son laisser-aller choquait. Mais, dans le cadre
de sa Flandre, il se transformait. Sa taille se redressait. Sous le casque, la
mâchoire carrée, le regard froid et calme disaient le soldat éperdument entêté. Quant
vint l'époque des raids, des coups de sonde précédant l'offensive, et dont un
des plus terribles fut la reprise de Papegoed, on put
apprécier le côté farouche, insoupçonné du Jass. On
connaissait sa bravoure, mais il fallait ici plus que du courage : un mépris
complet du danger, l'audace légendaire du poilu français. Il eut tout cela,
avec une nuance pourtant : c'est que son effort fut donné de sang-froid, sans
gestes, sans cris, si ce n'est, au moment décisif, le grondement du dogue
découplé. Car,
c'est une des caractéristiques – défaut ou qualité ? – de notre race, de
n'avoir ni le geste, ni le mot. Là où le Français crie : « La Garde meurt
et ne se rend pas », le Belge tasse ses deux gros pieds, retrousse ses manches,
remonte sa culotte et résolu, se fait descendre sans broncher. Point
d'apothéose ni d'emphase. Parfois, cependant, mais c'est rare, un mot épique
dans sa simplicité. Un soldat flamand prêt à partir pour l'attaque d'un poste
devant Houthulst, résume l'esprit de l'armée. Montrant l'arrière d'un geste que
la nuit magnifie : « C'est là qu'il y a des Flamands et des Wallons, dit-il.
Ici on est des Belges ! » 
Drachens attaqués par avion. Les drachen ou ballon d’observation, étaient de terribles gêneurs pour les mouvements de troupes et les attaques. Des aviateurs s’étaient spécialisés dans la destruction des « saucisses ». Ce fut à cette périlleuse besogne que s’immortalisa Willy Coppens. Un
soldat se penche sur le bissac d'un Allemand tué et y prend une pomme : « Je
puis bien la manger, dit-il, elle est de mon pays ! » Est-il inventé ce mot poignant
du Jass éreinté, fourbu, saignant, affalé au pied d'un de ces grands
crucifix de Flandre vers lequel il lève ses yeux de souffrance : « Qu'en
penses-tu, vieux frère ? ». Mais, en général, nos hommes vont, les lèvres
cousues, le regard perdu dans les lointains. A quoi pensent-ils ? Nul ne sait. Leur
indifférence hautaine, parfois ironique, n'est le plus souvent qu'un masque,
derrière lequel ils dissimulent, comme s'ils en étaient gênés, des sentiments
très simples et très beaux. A
l'étranger, on les taxait de froideur et même d'hypocrisie. Ils furent traités
un peu en parents pauvres. Hélas ! ils n'étaient que des martyrs, les martyrs
d'un pays à l'horizon borné, à l'égoïsme indécent, farouche, qui dédaigna
jusqu'à la minute suprême son armée de parias. Dans
aucun pays du monde, le mot « servir » n'eut autant d'âpreté. L'Angleterre
avait ses colonies et payait royalement ses soldats, la France était
cocardière, l'Allemagne fanatique. En Belgique, rien. Et l'on en est réduit à
se demander comment notre égoïsme et notre indifférence ont pu couver cette
nichée de chefs, et « noss Jacques », et Rucquoy, et Michel, et cent autres. Parmi les soldats, que
de noms à citer à côté de ceux de Camille Dardenne surnommé Jean Dardenne,
d'Ardenne en Ardenne ; de Trazegnies, le héros de
Pont-Brûlé, devenus légendaires ! Un
jour vint cependant, où la Belgique fut bien heureuse de remettre son sort
entre les mains de la petite armée qu'elle couvrait de son indifférence. Et
cette armée se vengea tout de suite, à la façon dont se vengent les cœurs hauts
placés : elle montra au pays, le général Leman et sa poignée de braves,
infligeant à la première nation militaire de l'Europe, un échec dont elle
conservera éternellement la marque. Quatre
ans plus tard, après un calvaire dont trop de gens chez nous ne savent encore
apprécier la hauteur, la même armée allait s'offrir une fois de plus en
holocauste, pour la délivrance de la Belgique ! 
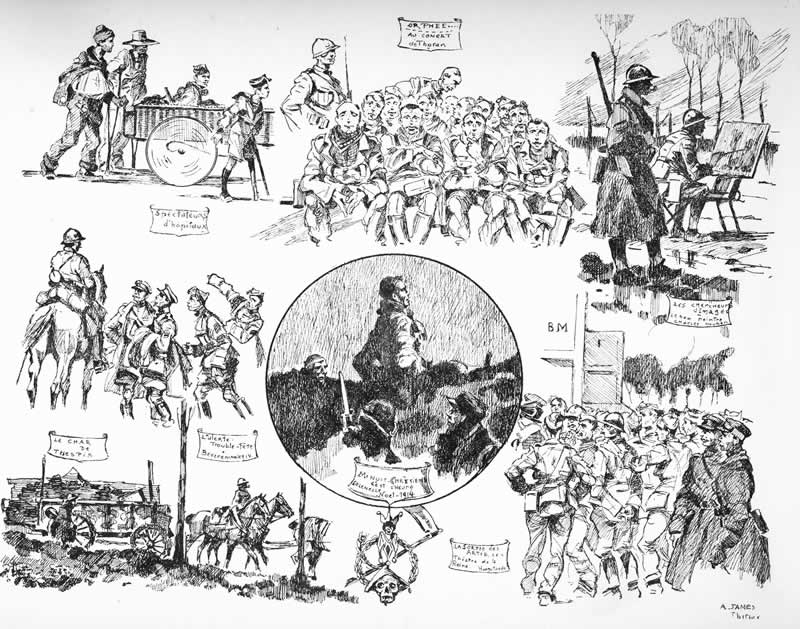
L’art au front. Il est intéressant de constater le succès que tous les efforts artistiques eurent auprès de nos « jass ». 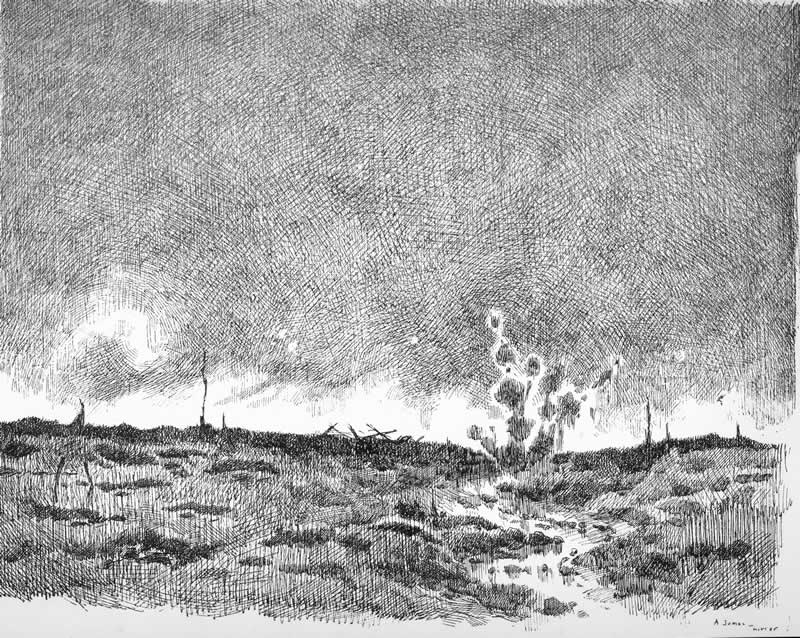
L’heure H. – L’attaque, 28 septembre 1918. Les batteries ont subitement ouvert le feu ; dans les lignes ennemies, les fusées montent affolées.
Enfin l'heure H sonna d'un bout à l'autre de l'horizon, dans un
prodigieux hurlement d'artillerie. Un cri jaillit de nos lignes : « Vive le Roi !
vive la Liberté ! » et toute l'armée se porta en avant. Affolées, les
fusées vertes et rouges montèrent des tranchées ennemies. La surprise fut
complète, mais la défense désespérée. Il
faut connaître le terrain d'où partit l'assaut, pour en apprécier toute
l'effrayante grandeur. Un sol nu, bouleversé, dévasté, troué de cratères
boueux, voilà ce qu'il fallut franchir en combattant pour aborder les crêtes redoutables. Au
nord, la lutte autour de Dixmude avait pris un caractère particulier
d'acharnement. Sous le feu de l'artillerie et les rafales fauchantes
des mitrailleuses, les troupes d'assaut emportèrent Woumen,
Clercken et Blanckaert, semant par grappes les tués
et les blessés, mais clouant sur leurs pièces les servants ennemis, muselant canons
et mitrailleuses. Au
centre, Houthulst tomba avec sa garnison et son artillerie tapie dans les
terriers de feuillage et de rondins. L'offensive
de 1917 en atteignit les lisières, en conquit des parcelles avancées, tel ce
lugubre « bois » de Papegoed : pente de boue
mâchurée où quelques troncs d'arbres, noircis ou écorchés, justifiaient le nom
de « bois » ; un abri formidable dominait la pente. Au sud d'Houthulst, s'étend l'ancienne
zone de l'offensive anglaise de 1917. Elle a laissé dans cette plaine ulcérée,
où quelques arbres dressent leurs squelettes, un charnier énorme, des cadavres
d'hommes, de chevaux à demi enfouis, du matériel démoli et dans ce cimetière
farouche – l'ossuaire des géants de la bataille – les grands tanks pareils à
des monstres de la préhistoire, si ce n'est à ces machines de guerre,
qu'enfanta le cerveau de Wells. Dans
cette zone, les villages ont cessé d'exister, au sens strict du mot. De Westroosebeke, Passchendaele, Langemark,
Poelcapelle, il ne reste rien, et, si des pancartes n'en
indiquaient pas l'emplacement, il ne serait pas possible de savoir s'ils
existaient. A
Poelcapelle reposait, paraît-il, le corps de
Guynemer. En vain y chercha-t-on, parmi les entonnoirs, les abris défoncés, sa
tombe, du moins une tombe. Tout au plus, put-on identifier l'église par les
quelques motifs de sculptures qui gisent parmi les pierres. Ainsi
disparu, sans laisser de trace, celui qui posséda le ciel ; ainsi disparurent
les héros de la mythologie. Et lorsqu'un jour, le paysan trouvera ce crâne qui
fut empli des grands azurs vaincus, il ne verra pas autre chose qu'un crâne
entre cent autres pareils. To be or not to be.
Etrange impression que cette forêt morte où presque toutes les hautes
cimes ne dressent plus que des squelettes mutilés, hachés. Libérés du dôme de
feuillage, les taillis, les fourrés ont pris une vitalité ardente ; les
fougères et les ronces escaladent les arbres abattus, masquent les entonnoirs
marécageux : c'est la forêt du Nouveau monde après le passage du cyclone. Et la
senteur âcre du bois monte, enivrante pour tous ceux-là, qui abandonnèrent leurs
forêts natales. Des drèves aux arbres décapités par la mitraille subsistent;
des pignons démolis se découvrent : ce sont des châteaux pareils à ceux des
légendes, morts après le départ du seigneur ; autour, des pelouses incultes, des
massifs d'aristocratiques hortensias s'embroussaillent. Dans
la forêt, et principalement à ses lisières, la lutte prit la tournure des
combats de partisans ; de taillis en taillis, l'attaque s'infiltra autour des
îlots de résistance que formaient les abris... Une batterie de 210 y fut
capturée ; les artilleurs ennemis la défendirent bravement à coups de carabine,
comme ils défendirent, sur la route de Poelcapelle, une
batterie de 105 surprise en flagrant délit de retraite. Après le combat, le sol
y était jonché de débris de toutes sortes, bandes de mitrailleuses, fusils brisés,
pansements sanglants, cadavres de chevaux et d'artilleurs auprès desquels
étaient venus mourir des fantassins de la Garde aux pattes d'épaules écarlates
et jonquilles, au collet rayé de galons blancs. Leurs faces crispées conservaient
une expression farouche et désespérée. Au
sud du bois, la bataille bondit aux crêtes et lança ses bataillons, à l'assaut
des villages, en avant de Roulers. 
Sur
les routes, ou plus justement sur les pistes en rondins que les auxiliaires du
génie s'acharnent à rendre possibles, les files cahotantes de véhicules,
d'hommes, de chevaux avancent lentement. Il
y a la file de tout le monde qui se porte au combat : les caissons de munitions
faisant craquer la passerelle ; les ambulances allant chercher leur misérable
chargement avec leurs civières noires de sang ; les autos d'officiers
maintenant leur équilibre par miracle et essayant de presser l'allure ; du
ravitaillement de toutes sortes ; des cyclistes s'infiltrant entre les fourgons
et traînant leur machine aux roues voilées par la boue. Le
charroi qui « en revient » : des caissons vides et sonores, des ambulances
automobiles ou hippomobiles bondées de blessés, les yeux fiévreux, la tête
ballante ; puis, ce sont des cavaliers tassés dans leur paquetage, ou traînant
leur monture par la bride; le cortège poignant des blessés légers, les
vêtements déchirés, les mains, la tête ou la cuisse enveloppés de linges
sanglants. Ils sont sans plainte, le regard fixe, presque toujours en armes. Rares
même sont les plaintes qui sortent des ambulances, tressautant sur les rondins. Tout
cela marche, se traîne, boitille, comme une bête énorme, faite de volonté,
d'énergie, de misères. 
Avions ennemis mitraillant une progression d’infanterie. Moorslede, 29 septembre 1918. L’aviation ne fut pas seulement employée à un service de reconnaissance et d’observation, on l’utilisa aussi comme arme de combat. Les
à-côtés de la route disent le calvaire journalier : des cadavres d'hommes figés
sous la couverture jetée en hâte, des caissons renversés, des chevaux morts,
l'œil étonné et épouvanté, les naseaux sanglants, les lèvres relevées dans un
rictus douloureux qui découvre les grandes dents jaunes. Ils seront le
ravitaillement, sur place, des hommes taillant, dans les pauvres carcasses, de
larges tranches de viande sanguinolente. Au
croisement de deux routes, devant un majestueux poteau indicateur taillé à
l'allemande, la division qui attaque, a installé son P. C. (poste de combat)
dans l'ancien abri sous camouflage d'un général ennemi ; devant le poste, le
fanion divisionnaire claque au grand vent de la crête. Un monde affairé
d'officiers, de délégués, d'estafettes, se presse ; des chevaux au piquet s'endorment,
secoués de crispations nerveuses. Au bord de la route, des fantassins, le
regard fixe, se reposent, mangent un biscuit, non loin de cadavres belges et allemands,
masqués pieusement d'un haillon, sauf un grand cadavre de fantassin allemand
qui reste menaçant, les poings serrés. Un
fracas grandit, sonore et métallique ; de l'artillerie défile au grand trot,
hommes, chevaux, caissons sont couverts d'une housse de boue ; sous les
casques, la sueur coule sur la crasse, les yeux disent les bivaques douloureux,
l'haleine brûlante des pièces en action. La
colonne dépasse des autos blindées en station, des cavaliers pied à terre, les
lances fichées dans le sol comme des épis d'acier, et toute la menaçante
cavalcade, à grands renforts de coups de fouet, s'enfonce dans la route qui
mène à l'action. Devant
nous, le terrain de la bataille se découvre, tout entier dominé par les
escadrilles ronflantes des avions. Déjà le sol se vallonne ; des bouquets
d'arbres, des haies étoffent le paysage, entourant des toits rouges, qu'un
rayon de soleil, perçant les nuées qui coulent lentement, fait rutiler. Un toit
d'église trapu entre des arbres : c'est Oostnieuwkerke.
Roulers même se découvre tout entière sous l'élancement de son clocher. Autour
de la ville, la bataille s'encolère ; les fusants
font jaillir des gerbes de terre ; des shrapnells accrochent aux arbres des
flocons jaunâtres ; la fusillade se presse, dominée par le martèlement monotone
des mitrailleuses. Sur
la route, des prisonniers passent, mornes et sombres, la figure blême sous le
grand casque camouflé. D'autres, en bonnet, montrent des yeux fuyants et
inquiets ; des blessés, dont l'un, la face rouge de sang, à demi masquée sous
des linges, les vêtements ensanglantés, se hâte fébrilement vers un but inconnu
; des civières, dont l'une sur les épaules de quatre artilleurs en manteau, s'avance
lentement : une forme s'y immobilise, bottée, éperonnée, une main baguée pend,
comme gantée de pourpre. Dans
un champ où gisent des chevaux culbutés, les obus tapent dur, faisant partir
des galopades sur la route. Au
loin, de l'infanterie se glisse à travers les haies. Cet
ensemble sous le grand ciel, ainsi qu'il est vu dans les tableaux des maîtres
flamands, paraît avoir été composé par quelque panoramiste
militaire, depuis les avant-plans de silhouettes tragiques, jusqu'aux tons chantants
dans la brume de l'horizon. L'attaque
et la prise de Moorslede, le 29, furent parmi les plus beaux et les plus
tragiques épisodes de la bataille. Le village, la gare, transformés en
redoutes, furent disputés furieusement. Il fallut faire taire les mitrailleurs
à coups de grenade et de poignard. La
suite de vallonnements donnait à l'action une physionomie nouvelle et permettait
de jeter sur le terrain un coup d'œil d'ensemble. En arrière, la plaine, à
perte de vue ; une tache grise qui est Ypres, une masse sombre qui est
Houthulst. A l'horizon : les silhouettes bleuâtres des « monts ». Derrière l'empanachement
des crêtes, derrière les fumées héroïques, les clochers de Roulers. On
attend. Signaleurs, délégués, prêts à marcher, officiers immobiles, les yeux
aux jumelles, piétinent dans la boue d'où monte une odeur de pourriture. Dans l'étalement
du vallon la progression, comme à la manœuvre, se glisse de boqueteau en
boqueteau ; les colonnes montent lentement dans les hautes herbes ; le
ravitaillement se presse. Dans le fond du ravin, les obus allemands labourent
le sol, soulèvent des gerbes de terre. Maintenant, c'est la crête proche du
village; les hommes sont terrés, calmes, froids, sans rire ni crainte : à peine
regarde-t-on les blessés qui passent. Les fronts sont hauts: ils ne se baissent
ni pour l'obus qui siffle, ni pour la rafale fauchante
des mitrailleuses. Derrière une masure écroulée, les signaleurs
travaillent, un poste de T. S. F. s'installe ; le calme des hommes domine le
fracas de la bataille. De place en place, une tache grise ou kaki, un visage
crispé, une arme qui scintille dans les herbes. Soudain, à l'horizon, pique une
escadrille d'éperviers. Ils chargent en bon ordre l'infanterie qui monte à
l'attaque ; les mitrailleuses claquent rageusement, dominant le bruit des
moteurs, les balles frappent au hasard. Un gémissement, un râle, le vol
tragique est passé. Coup
de sifflet. Les hommes couchés dressent leur silhouette sur le ciel, dans les
fleurs et les broussailles ; maintenant, de part et d'autre, l'artillerie fait
rage, les mitrailleuses moulinent sans arrêt, des rumeurs montent. U
ne longue file d'hommes, suivis de leurs porteurs de civière, les grenadiers
avec leur tabard, les « fusils-mitrailleurs » pliant sous le poids de leur
arme, – sans hâte entrent dans la zone battue. L'air n'est plus qu'un grondement,
une clameur, et la nuit qui tombe sur Moorslede le voit aux mains de ses
légitimes possesseurs. 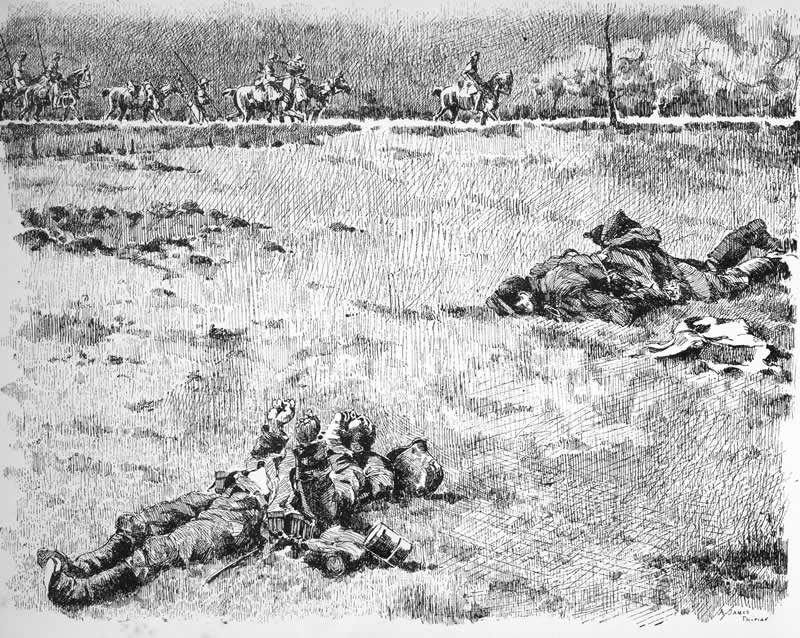
Cadavres allemands devant Roulers. – Octobre 1918. L’imagerie héroïque s’est complue à nous montrer des tués sous un aspect exempt de tout tragique. Il y a loin de là, aux loques humaines tordues par une agonie atroce, aux tas de guenilles misérables entrevues dans un fossé ou étalées au grand soleil d’un chaume. Aujourd'hui
batteries, escadrons, compagnies, tout le train fantastique des armées à la
poursuite, traversent la campagne dans toute la beauté de l'arrière-saison ;
les prés et les champs déroulent leur damier fécond, tapis d'émeraude et de
sillons gras. Blotties entre les arbres et les haies, les fermes trapues
montrent leurs toits de tuiles ou de chaume souvent intacts, sauf aux endroits
où la résistance se carre ; les arbres seuls, ont souffert un peu partout, par
le fait des balles, des shrapnells. Les seules traces de la lutte sont, par-ci
par-là, un entonnoir trouant l'uniformité d'un pré, un caisson culbuté, des
cadavres de chevaux, les sabots en l'air, la croupe rongée, ainsi qu'elle
l'aurait été par un vol de gypaètes ; des armes, des munitions, des casques
surtout, quelquefois tachant la prairie d'un étalement de loques, où l'on
distingue à peine des mains terreuses, une face convulsée : un tué. Aux
environs des centres de résistance, les tués se font plus nombreux : les uns,
figés dans une suprême agenouillâtes derrière une haie, les autres, tassés dans
les fossés, dans lesquels les colonnes cheminèrent ou se retranchèrent. Aux
carrefours, des mines explosèrent, coupant provisoirement la circulation; le
génie, avec une rapidité merveilleuse, s'acharna à combler ces entonnoirs
géants, à jeter des ponts par-dessus. Les
villages ont fatalement plus souffert ; mais ce n'est pas la destruction
définitive, rencontrée jusqu'ici. Bien souvent, le dommage se réduit à des murs
défoncés, des toits troués ; l'avance fut, là, trop rapide, pour que l'écrasement
fût irrémédiable, pour que l'ennemi pût se livrer à ses habituelles
dévastations. Et,
malgré les ruines, les plaies des façades aveuglées, les éclaboussures de
mitrailles, les portes enfoncées ou mouchetées par les balles, les cadavres des
chevaux étalés en plein pavé, les tués des haies et des fossés, un air de fête
flotte; les petits drapeaux sortis, on ne sait d'où, les bannières fabriquées à
la hâte, jettent une note de kermesse dans ces coins où l'on rongea sa misère
pendant quatre années. * * * Parmi
les villes prises, Roulers a beaucoup souffert, surtout dans ses abords et aux
environs de la gare. On sent que l'ennemi s'accrocha désespérément à cette
petite ville où la défaite sonnait, en Flandre, le premier glas. L'artillerie
battit les approches, abattant les pignons et dentelant les toits; les
mitrailleuses fauchèrent en rafales, et, lorsque l'ennemi fut bouté dehors, il
pointa ses pièces sur la ville, l'inondant d'obus toxiques. Au croisement des
rues, les mines qui explosèrent, laissent des fosses béantes, des façades
défigurées, des maisons ouvertes comme des maisons de poupées. La
ville regorge d'inscriptions de toutes sortes : indications routières et
militaires nous renseignant des établissements « pour civils » et « pour
militaires » ; des affiches, où les amendes et les menaces tiennent une large
part. A grands coups de hache, les habitants abattent ces vestiges de
domination. Des gens qui, malgré leurs misères, trouvent un sourire pour nous,
passent courbés sous le poids de leurs hardes, s'affairent à nettoyer leurs
demeures, vides de meubles. Lorsque
les troupes s'infiltrèrent, les armes prêtes dans la ville, que les habitants
virent la délivrance à leurs portes, malgré la mitraillade, les obus toxiques,
ils sortirent de leurs caves pour acclamer les vainqueurs.
A la grand’ place, comme par miracle, la vieille bannière brabançonne,
noire, jaune et rouge, vint s'accrocher, alors que le combat faisait encore
rage. Dans les caves abris, la chasse commença, systématique ; des pancartes indiquent
la date et l'heure de la visite. A
Thourout comme à Iseghem, l'enthousiasme de la population, presque entièrement
restée sur place, éclata en acclamations mêlées de sanglots ; entre les haies
de gens pleurant entre deux cris, criant entre deux pleurs, les soldats
passaient, pesants, boueux, semblant marcher dans le rêve. 
Quelquefois,
un cri comme une plainte de bête blessée, éclatait, deux corps se nouaient en
un baiser fou ; contre une poitrine large de soldat au rude harnois, un pauvre
corps de mère courbé et cassé, ou une taille souple de jeune femme venait
s'écraser. Et
les camarades, avec un sourire ému, lançaient un sonore « Proficiat
! » Les
drapeaux, les cocardes, les rubans tricolores étaient sortis de partout ; de
partout sortirent des provisions secrètes. Comme tout en Belgique se termine ou
commence par des « chopes », dans les cafés où souvent un harmonica criard
chantait un refrain familier, l'aigre bière fut bue à grands verres, le coude
haut-levé, les crosses de fusil sonnant sur les dalles. Ce
sont là des coins privilégiés. Les villages, où la bataille battit sa rude
clameur, ne sont plus que des pignons en ruines, entre des haies hachées.
Affolée, la population s'enfuit dans la campagne, prise de terreur panique,
devant tout ce qui était gens de guerre. Des femmes et des enfants erraient en
guenilles, les pieds sanglants, vivant de nourriture cachée. Les balles, les obus,
les gaz n'épargnèrent pas ces misérables. Lorsqu'enfin ils reconnurent leurs
libérateurs, par la campagne on vit arriver leurs silhouettes minables se
soutenant ; des brouettes portaient des infirmes et des enfants. * * * Un
groupe avait été réuni dans un cabaret en ruines sur la route de Roulers à
Menin. On s'était battu ferme autour de ces pans de mur. La bataille avait
laissé partout ses traces habituelles. Dans
la salle du cabaret, aux fenêtres béantes, pavée de débris de toutes sortes,
ces déracinés se tassaient autour d'un poêle de Louvain que des soldats avaient
allumé ; des pommes de terre cuisaient. Il y avait là des hommes aux visages
blêmes, aux yeux fiévreux, des filles de Flandre aux figures rondes, aux
cheveux blonds, de petits enfants muets. Appuyés sur leurs fusils, les soldats les
interrogeaient. Une odeur d'étoffe mouillée, l'odeur fade de moisissure de la
masure, de pourriture du charnier, flottait dans cette chambre où se
concentraient toutes les misères du monde. Chaque fois que l'on prononçait le
nom d' « Allemand », une lueur de haine éclairait tous les yeux. La main de fer
de l'oppresseur a laissé une empreinte terrible sur ces âmes simples ;
d'instinct, le soldat est redouté. Dans
le groupe, une petite jeune fille, aux yeux clairs, racontait son odyssée.
Bruxelloise, elle avait été, par sa mère, envoyée « à la campagne » chez. « des
parents », parce qu'à Bruxelles la vie était chère, « les pommes de terre
coûtaient cinq francs le kilo ». A peine était-elle là, que l'action
commença. Elle dut s'enfuir dans la campagne, ainsi elle arriva parmi nos
troupes. Dans
de gros camions, joyeusement, tous ces misérables s'entassèrent ; ils allaient
vers l'espoir. Malgré
la route cahotante, les fatigues, les privations, ils surent encore trouver la
force d'acclamer les troupes alliées : Français, aux figures d'audace, la
capote couleur d'horizon, rehaussée de fourragères de toutes couleurs ; soldats
d'Angleterre et d'Ecosse, aux badges étincelants ; Chinois et Annamites,
visages énigmatiques ou simiesques, Hindous, aux épais turbans ; nègres, emmitouflés
d'écharpes sous la bourguignotte, au grand sourire enfantin. Pour tous, les
mains s'agitèrent, les acclamations fusèrent. Et,
vers le cortège émouvant, vers la Belgique revenant d'exil, toutes ces rudes
mains de soldats se tendaient. 

Le retour. L’entrée de nos soldats dans les villages et villes reconquis donna lieu, à des scènes poignantes. 
La dernière étape du calvaire. Pour celui qui a connu toute la gloire, il reste à connaître toute la misère !
Quel que fût le soin mis par la censure allemande à cacher au pays
occupé ce qui se passait en Flandre, la capitale apprit très vite que la grande
offensive des Alliés était entamée, et que, loin de « s'écrouler dans des
assauts riches en pertes sanglantes » contre les fameuses lignes Hindenburg,
les divisions anglaises, canadiennes, australiennes, américaines, françaises et
belges avançaient sans répit et faisaient tout plier devant elles. Après
de longs mois de jeûne, de désillusions, de souffrances variées, la population
de Bruxelles avait fini, non par s'habituer à son sort, mais par accepter
l'état de choses avec une sorte de découragement rageur. Rien
de plus morne que l'aspect de notre grande cité au printemps de I918. La
tristesse se lisait dans tous les regards. Ce n'étaient plus les questions
pressées, fiévreuses des années précédentes. On hésitait maintenant à
interroger. A quoi bon ? Paris était bombardé et ses blessures nous faisaient
mal. Du front, toutes les nouvelles étaient, pour nous, triées sur le volet par
l'occupant, bien décidé à nous abrutir, faute de pouvoir assouvir ses instincts
jadis révélés à Louvain, à Dinant et ailleurs. La Russie croulait, les Anglais
lâchaient Kemmel, les Français, le Chemin-des-Dames. Les armées allemandes se rapprochaient
de Paris, menaçaient de couper l'armée française de l'armée anglaise et
d'encercler l'armée belge. A
Bruxelles, les cafés et les rues regorgeaient d'officiers insolents, les
soldats pullulaient. Mais les belles troupes du début avaient complètement
disparu, et l'état-major allemand avait dû se résoudre à nous montrer le fond
de son sac, les vieillards, les enfants, les infirmes même, et dans quelles
tenues ! A part quelques officiers et l'escadron de cuirassiers blancs caserné
aux Ecuries du Roi, – l'escorte du gouverneur, – que les Marolles avaient
irrévérencieusement baptisés : « les trois aunes pour un franc » ; à part cette
mascarade de gros cavaliers aux habits blancs, aux bourguignotes d'acier poli,
aux grosses bottes, qu'on pouvait voir tous les matins, sur le coup de 11
heures, défiler lourdement, un petit paquet bien ficelé pendu à la main droite,
la garnison et les troupes de passage offraient un mélange d'allures douteuses,
d'uniformes de fortune et d'équipements hétéroclites qu'eussent reniés nos
gardes-civiques les moins convaincus. Casques
gris ou noirs, casquettes de tous les modèles, depuis le béret de 1808 jusqu'au
couvre-chef de toile cirée plaquée d'une croix de cuivre, qui avec la tunique
bleue et le sac de toile évoquait les landwehrs de York et de Blücher ;
vêtements mal coupés, pantalons sans grâce, ceinturons roussis, vieux fusils à
un coup garnis de capucines de cuivre, sabres de réquisition, voire même de
collection, cravates sales, bottes quelconques et pattes d'épaules déteintes. Ces
petits indices d'une grande infortune ne nous consolaient pas des visites
domiciliaires pleines d'arrogance et de grossièreté, ni des pillages
méthodiques exécutés à notre barbe. Mais
passons... 
L’arrêt
subit de l’offensive sur la Marne réveilla les espoirs endoloris. Pourquoi
s'arrêtaient-ils ? Bruxelles
l'apprit un beau matin de septembre par le discours du chancelier sur « le
profond pessimisme qui envahit la nation allemande », et par les allocutions
d'Hindenburg, au sujet de la démoralisation des troupes. Dès
lors, tout est dit. Le sourire renaît, bien pâle d'abord après une si longue
compression. Et l'écroulement s'avère, de jour en jour plus entier, plus
complet. La
joie est au cœur, sur les visages, dans les conversations ; elle se mesure à
cette boulimie de nouvelles, fussent-elles tronquées, et de journaux,
fussent-ils vendus et malpropres : les Belges ont pris l'offensive, le Kemmel est
abandonné, le front bulgare s'effondre en quelques heures, les Américains sont
en Lorraine, l'Autriche et l'Allemagne demandent une trêve. Enfin ! On
peut affirmer que l'illusion a soutenu le peuple belge pendant les trois
premières années de la guerre, et il n'est pas moins vrai de dire, qu'en 1918,
les bonnes nouvelles, exactes cette fois, nous sauvèrent encore. Sans
elles, réduits comme nous étions par le jeûne forcé ou la nourriture
insuffisante et malsaine, nous n'eussions pu résister à cette calamité nouvelle
qui vint s'abattre sur toute l'Europe et qu'on appela la fièvre espagnole. On
mourait beaucoup à Bruxelles, et certaines journées du début de novembre
resteront dans les plus mauvais souvenirs de nos concitoyens. Pour faire face à
cette mortalité qui rappelait un peu les grandes époques du choléra, on
réquisitionnait tous les attelages possibles, et il n'était point rare de voir
un cercueil conduit au lieu de repos sur une simple charrette à bras. Le
ciel gris et bas, les promeneurs endeuillés, l'odeur de feuilles mortes, le
canon qui gronde plus proche, l'obscurité des rues où de rares réverbères
piquent leur étoile bleuâtre, l'absence à peu près complète de voitures et
d'autos, les prix exorbitants qu'affichent les étalages, le fiel que répandent
jusqu'au bout les torchons qui s'intitulent journaux, et qui sont rédigés dans
une langue jusqu'alors inconnue, voilà ce que devront noter nos petits enfants
s'ils veulent décrire Bruxelles aux derniers jours de l'occupation allemande. Longtemps
avant que l'armistice fût conclu, les rues, qu'en grisait la brume d'octobre,
eurent à certains jours un aspect moins lugubre pour nous : le déménagement s'annonçait,
le départ après faillite faite, et la retraite entraînait avec elle, en plus,
des fourgons bourrés d'innommables choses, la foule immense et lamentable des
réfugiés. Ils venaient du nord de la France et de toutes nos villes menacées.
Leur théorie interminable, jalonnée de véhicules de tout genre, nous montra
l'une des plus poignantes misères de la guerre. A
peu près en même temps, Bruxelles risquait les hampes aux fers dorés, n'osant
pas encore arborer les bannières tricolores. Les
premières colonnes en retraite faisaient leur apparition. Ce n'était plus,
cette fois, le simple charroi des arrière-lignes, mais bien l'infanterie,
cheminant au pas de route, alourdie par un formidable paquetage, le béret en
tête, le grand casque au dos, le fusil jeté en travers de la poitrine. Des fifres et des tambours
précédaient les colonnes que suivaient des charrettes remplies de casques, de
fusils, de vélos, de sacs ayant appartenu, sans doute, aux morts et aux
blessés. Vers
le 8 novembre, ces mouvements s'accentuèrent, et, dans la nuit du 9 au 10,
Bruxelles fut tenu en éveil par le grondement d'une canonnade très rapprochée,
cette fois. C'est alors que se produisit le mouvement qui allait décider des
destinées de l'Allemagne. Nous n'en ferons pas l'histoire. Nous dirons
seulement l'aspect de la ville, dans cette journée du dimanche 10 novembre
1918, qui devait donner satisfaction à nos désirs légitimes de revanche. Devant
la gare du Nord, c'était la cohue des grands jours, doublée, triplée par des
milliers de soldats isolés, et coupée dans toutes les directions par
d'interminables files de convois. Ceux-ci n'offraient plus rien de la superbe ordonnance
de 1914. C'était un mélange bizarre qu'on voyait défiler avec une lenteur
processionnelle au-delà des rangs pressés de la foule houleuse. Autos,
camions, chariots, voitures, fourgons, caissons, fiacres remplis d'objets disparates
et défiant toute description, tous les véhicules possibles, attelés de toutes les
races possibles de chevaux, et conduits par des êtres vagues, qu'on devinait
avoir été des soldats en uniforme dans un temps déjà lointain. Les petits
ardennais et les gros mecklembourgeois attelés à des voitures peintes en gris,
alternaient avec les chevaux cosaques traînant des dvoïkas
qui détonnaient étrangement parmi les lourds camions-automobiles. Le flux
et reflux du charroi et des piétons était à certains moments si intense, que
les grands hôtels de la place Rogier donnaient l'illusion de falaises battues
par une mer houleuse, grise comme est la mer dans la tempête. Le
soir venu, la physionomie des grands boulevards prit sous la lueur incertaine
d'un éclairage réduit, un aspect quasi démoniaque, à coup sûr unique dans les annales
de Bruxelles. La révolution militaire parcourut la ville comme une flamme. Elle
débuta par des danses effrénées, des cris insensés, des « alles
kapout », des Marseillaises rauques et
gutturales jetées à la face des officiers. Puis elle devint tragique... Dès
le lendemain matin, des milliers de drapeaux aux trois couleurs jaillirent des
fenêtres. Ce fut la floraison magnifique des premiers jours de la guerre. Et Bruxelles
dédaigneux des palinodies, des appels à la social-démokratie
d'un oppresseur détesté, attendit avec un calme fiévreux la journée promise. On
s'était souvent demandé chez nous comment cela finirait, et l'imagination s'était
donné libre cours pour déterminer, d'ores et déjà,
de quelle manière Bruxelles verrait disparaître l'indésirable. Mais personne au
monde, assurément, n'aurait pu prophétiser le spectacle suivant, l'un des plus
étranges de ces journées fécondes en étonnements. Figurez-vous le boulevard du
Nord à la hauteur du grand bazar. Devant les portes, la foule des camelots
brandit et crie les drapeaux de toutes les nations alliées. Aux promeneurs de plus
en plus nombreux, se mêlent d'étranges fantômes en loques : ce sont les
prisonniers anglais, italiens, français, que l'aigle expirante a dû lâcher, et
qui se prennent à revivre, choyés qu'ils sont par nos concitoyens. 
Quelques
permissionnaires belges, en uniforme brun et bonnet de police, provoquent des
ruées de la foule et des stupéfactions. On n'ose pas encore acclamer bien haut,
car, sur le boulevard, à deux pas des flâneurs, défilent dans une sorte de
désordre de longues colonnes d'infanterie bavaroise. Ces hommes viennent du
feu, la bataille se lit sur leurs tuniques souillées et leurs faces brûlées par
l'air. Ce sont les soldats du prince Rupprecht,
chassé hier par l'émeute. Ce sont les vaincus. Et ils dansent, les misérables !
Leurs yeux désorbités ne voient rien de ce qui les entoure ; ils dansent en
hurlant on ne sait quels refrains sauvages. Inconscients, les officiers montés
ont piqué aux brides de leurs chevaux de gros bouquets de fleurs. Une nausée
monte aux lèvres. Ils dansent ! De quelle folie furieuse, de quelle joie bestiale
est faite cette ronde de démons fouettés par la haine, l'exécration de la foule
indignée et muette qui les entoure. Les
jours qui suivirent furent des jours de fièvre, comparables à ceux des débuts
de la guerre. Ces heures là laissent une impression ineffaçable. Nous renonçons
à les décrire, abandonnant cette tâche à des accents mieux autorisés que les
nôtres. Au hasard des impressions ressenties et des choses vues, c'est la ville
en fête le soir surtout, et comme illuminée, encore qu'elle soit simplement sortie
de l'obscurité qui pesait sur elle depuis des mois. C'est la forêt de drapeaux
claquant au vent ; c'est la foule en délire, chantant la Brabançonne et la
Marseillaise ; les soldats encore peu nombreux, portés en triomphe, tandis
qu'au nord et au midi l'horizon s'éclaire de rougeurs sinistres, et que les
wagons d'obus garés par centaines autour de la ville sautent les uns après les autres
avec le bruit de salves d'artillerie. Nul ne se serait avisé de prédire ce feu
d'artifice tragique, digne adieu d'un ennemi abhorré. D'ailleurs,
en ce laps de temps très court et qui s'étend sur quelques semaines tout au
plus, les impressions se chassent l'une l'autre, rapides, et les émotions succèdent
sans répit aux émotions. Bruxelles est un kaléidoscope. On vit en pleine
histoire, sans pouvoir arrêter les heures fugaces. Journées
sombres d'un printemps maudit, auxquelles succèdent les journées d'espoirs
enfin réalisés, écroulement de tous les fronts ennemis, puis l'armistice,
l'évacuation de Bruxelles, la grande j oie mêlée des épisodes tragiques de la
révolution militaire et d'un désastre avec peine évité. Voici,
maintenant, l'entrée en ville des premiers détachements belges (du carnet de
notes d'un Bruxellois) : 18 novembre, lundi. – Ils sont là. Enfin. Je les ai
vus, je les ai acclamés. En ville, l'animation est de plus en plus grande. On
acclame les autos qui arrivent de nos lignes. Je crie : hurrah ! à deux soldats
américains qui me répondent d'un geste large. Tout à coup des clameurs plus
fortes retentissent : la foule vient d'apercevoir deux officiers supérieurs
français et forme, sur leur passage, une barrière profonde, respectueuse,
enthousiaste ; les chapeaux volent en l'air au milieu des cris de « Vive la
France ». C'est que tous, ici, nous avons deux noms présents à la mémoire :
l'Yser et Verdun... A peine le temps d'exprimer son émotion, et voici qu'un
bruit court dans la foule comme une traînée de poudre : nos troupes défilent à
la gare du Nord ! C'est une ruée dans les boulevards et la rue Neuve. J'arrive
à temps, bousculé, poussé, transporté, mais qui songe à se plaindre des coups
de coude ? Un escadron de guides est passé et gravit la pente du boulevard
Botanique. En voici un second : les cavaliers vont par deux, et, pour nous qui
les voyons pour la première fois, le casque et l'équipement nouveau leur
donnent une allure martiale nouvelle. Sont-ce là nos hommes, nos soldats à nous
? Oui, pas d'erreur possible : un brigadier, raide comme une statue, pleure à
chaudes larmes. Un des cavaliers brandit sa miche de pain blanc. Sans doute
a-t-il su celui-là, que Bruxelles avait faim, et cela l'indigne. Un officier s'adresse
à la foule et la salue de quelques mots que je n'entends pas. Près de moi, une
dame sanglote nerveusement : on devine sur tous les visages une émotion
indicible, une réaction trop attendue. Cent mains s'agrippent aux croupes des
chevaux, aux selles, aux manteaux : car on ne peut pas en croire ses yeux, il
faut toucher, et les lourdes pattes des cavaliers bruns casqués de fer serrent avec
bonheur et au hasard ces mains d'ouvriers, de femmes, d'enfants, qui se tendent
éperdues. Demain, ce seront les grenadiers, les carabiniers, l'artillerie ;
c'est une épopée qui traverse les rues de Bruxelles. Quatre
journées bien remplies de transports, de larmes joyeuses, de visions
empoignantes n'enlèvent rien cependant à l'enthousiasme indescriptible qui
accueille la rentrée du Roi, de la Reine et des Princes dans la capitale. Ce
jour-là, dès l'aube, les rues des faubourgs les plus éloignés montrent
l'animation d'un beau dimanche d'été ; pendant des heures entières, la foule
immense stationnera maintenue sans peine par les rangs de fillettes et de
garçonnets des écoles, trompant son impatience en reprenant en chœur les
refrains des airs de victoire entonnés à tour de rôle par ces groupes
d'enfants. Alternances d'accents cristallins qui montent dans le ciel clair et
de voix graves que répercutent les façades pavoisées, aux fenêtres et aux
corniches noires de monde. C'est l'apothéose. Là-haut, se détachant sur un fond
d'azur très pâle, où, étincelants comme des météores, nos grands oiseaux de
combat, nos avions de chasse ou de bombardement évoluent avec une audace et une
grâce merveilleuses. C'est
l'apothéose ! Et quand passera tout à l'heure l'imposant état-major du souverain,
qu'escortent les gendarmes noirs, gardes de l'étendard royal ; quand défileront
les poilus, tambours, clairons, musique en tête, l'incroyable « Souza band » du 143e américain, et l'étonnante troupe
de cornemuses et de caisses d'un régiment écossais, puis enfin nos jass, nos
carabiniers, nos beaux canons « Jenny », le « Terrible », la « Foudre » , dont les
tracteurs automobiles font trembler le sol, l'enthousiasme tenu en suspens se
déchaînera, les acclamations se feront tempête, au point de couvrir,
d'étouffer, de noyer complètement l'éclat des cuivres, des tambours et des pibrocks.
C'est l'apothéose... Tout
est nouveau pour les yeux : et ces Américains assis, les bras croises, sur
l'avant-train des pièces, et ces musiciens – acrobates d'Ecosse – et ces casques bleus de l'infanterie
française.
Mais ceci est un hors-d’œuvre à peine. La fête des uniformes étrangers,
Bruxelles en jouira de longs mois encore. Ce
sera dans les rues qui vibrent d'une animation, d'une lumière renaissantes, le
va-et-vient des soldats de France et d'Italie, d'Angleterre et d'Ecosse, mêlés
parfois en folles sarabandes à la foule joyeuse, qu'enivrent les pas redoublés
de la retraite militaire, ou d'une fanfare locale. Ce
seront encore, les défilés superbes des divisions françaises en marche sur l'Allemagne
ou les imposantes parades des contingents britanniques. Peu
à peu la victoire s'organise, le vertige disparaît, les yeux s'habituent, le
regard se fait plus réfléchi. A
la foule des beaux gars de Flandre et de Wallonie, de tous leurs camarades en
bleu horizon, en kaki, en kilt ; à cette floraison de casques, de chapeaux de
feutre, de glengarries, de képis et de Balmoral, se
mêle à présent l'humble bonnet de police des mutilés, qui se traînent sur leur
canne ou leurs béquilles, montrant de quel prix il a fallu payer, parfois,
l'insigne des braves qui décore leur poitrine... Et
il est bon qu'il en soit ainsi. Il est bon qu'à notre fièvre de victoire, à nos
élans d'orgueil et de joie se mêle aussi la pensée grave, celle qui s'adresse,
pleine de respect, aux blessés, aux morts... * * * Les
traces de la guerre, si nombreuses encore aujourd'hui, iront s'effaçant peu à peu. Il
faut pourtant que deux choses subsistent de cette époque grande et terrible :
sur nos places publiques, les canons enchaînés, et, dans toutes les âmes, le
SOUVENIR... 
Achevé d’imprimer |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©