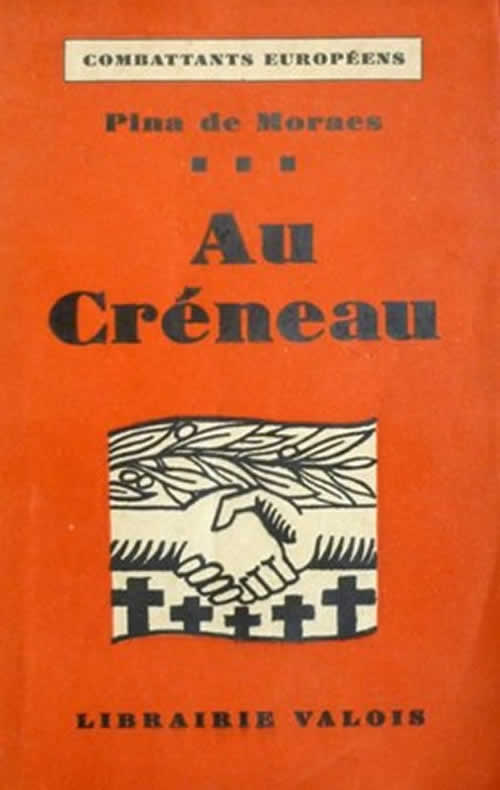Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
L’hôpital
militaire portugais d’Ambleteuse et son patient Pina de Moraes Les Portugais et la Grande Guerre Le 4 avril 1917 les
premières troupes portugaises arrivèrent sur le front. La première victime
portugaise fut le soldat António Gonçalves Curado. Le
Portugal combattit dans les rangs alliés en 1917 et 1918. Ils fournirent deux divisions ainsi qu’un renfort en
artillerie. Au printemps 1918, les soldats Portugais furent assaillis par les
Allemands qui sortirent de leurs tranchées durant la bataille de la Lys. La
sixième Armée allemande avait déployé huit divisions (environ 100 000 hommes)
soutenu par le feu d'artillerie intensif. Contre cette force les Portugais
avaient 20 000 soldats et 88 canons. La 2e Division a très fort souffert
pendant la bataille. Le sort du Corps
Expéditionnaire Portugais se joue le 9 avril 1918 lors de la Bataille de la
Lys. A 8h45, les troupes allemandes surprennent les Portugais, alors en pleine
relève, et lancent l’offensive sur les territoires de Neuve-Chapelle, Richebourg et Laventie. Malgré le courage des soldats qui
se battent aux côtés des Britanniques, les Allemands atteignent la Lys et 7000
Portugais sont tués, blessés, disparus ou prisonniers. Loin de leur base
arrière, les Portugais ne bénéficièrent pas de renfort. Il en résulta
l’impossibilité de donner un minimum de congés aux combattants, facteur qui
contribua à l’épuisement des troupes. Le cimetière militaire portugais de Richebourg dans le Pas-de-Calais, où reposent 1831
combattants portugais nous rappelle le sacrifice des Portugais. Un soldat portugais du corps
expéditionnaire est à signaler, c’est le soldat Aníbal
Milhais, originaire de Valongo,
Murça. Il fut le seul simple soldat à obtenir le
collier de l’Ordre de Torre e Espada, la plus haute distinction portugaise.
Seul, durant plusieurs jours, armé d’une mitraillette Lotz,
il fit face aux colonnes allemandes, permettant au reste de son unité de se
réorganiser à une trentaine de kilomètres. Quatre jours après le début des
hostilités, il sauvera la vie d’un médecin écossais, l’empêchant de se noyer
dans un marais. C’est ce dernier qui informera les alliés de ce fait de
bravoure. « Tu t’appelles Milhais (million en
français) », lui dira son commandant, « mais tu en vaux des millions », et
c’est ainsi que le soldat héroïque fut surnommé le Soldado
Milhões (milhoes est le
pluriel de milhais). Même le nom de son village est
devenu Valongo de Milhais. Ambleteuse, base
arrière des Portugais, accueillit l’Etat-Major ainsi
que l’hôpital. L’état-major portugais s’était installé
à Ambleteuse, sur la côte d’Opale. On y trouvait aussi un hôpital militaire portugais
où s’étaient engagées de nombreuses infirmières britanniques. Nous ne possédons que très peu de photos
de l’hôpital d’Ambleteuse. Celles conservées
par la collection Valois nous sont dès lors très précieuses. La
collection Valois rassemble les photos prises par le service cinématographique
de l’armée française. Toute cette collection est mise en ligne à l’adresse
suivante : La plupart des photos
de l’album accompagnant cet article proviennent de ce site. Le lieutenant
Pina de Moraes témoigna de son passage à l’hôpital d’Ambeteuse Le lieutenant Pina de Moraes (1889-1953) écrivit des mémoires de guerre qui
furent publiées en Français en 1930 sous le titre « Au créneau »
(Librairie Valois). Dans ce livre, les derniers chapitres
sont particulièrement émouvants. L’auteur décrit la visite qu’il fit, en
compagnie d’un ami médecin, dans la section des tuberculeux de l’hôpital
d’Ambleteuse. Plus tard, lui-même, épuisé, souffrit d’une pathologie
pulmonaire qui le conduisit dans ce même hôpital, mais cette fois comme
patient. Comme officier, il bénéficia cependant du privilège d’être logé à
l’hôtel d’Ambleteuse. Pina de Moraes souffrit
beaucoup d’être séparé de sa mère pendant la Grande Guerre. Pendant son séjour
à Ambleteuse, ses pensées s’envoleront souvent vers sa maman dont il ne reçoit
que de rares nouvelles. Découvrons
ci-dessous les belles pages de Pina de Moraes concernant
l’hôpital d’Ambleteuse. Nous y lirons
aussi combien furent profonds les liens qui l’unissaient à sa mère, symbole de
« la Patrie » si lointaine. Une visite à
l’hôpital portugais d’Ambleteuse par Pina de Moraes Nous
étions à Ambleteuse, dans une villa. A la fin du diner, mon ancien camarade
d’école, spécialiste illustre des maladies du poumon, lauréat de la Faculté de Coïmbre vint s'adosser à la balustrade de la terrasse. A la lueur des phares de la
côte anglaise, il me dit, et le bruit de la mer dont la houle expirait à nos
pieds amortissait l'écho de nos paroles : – Demain, on va faire une évacuation de malades. L'aspect
extérieur d'un hôpital de guerre n'est guère engageant. De longs tunnels de tôle
ondulée accompagnés d'autres constructions en bois, ayant plutôt l’air d’une
maison d'habitation, le tout noir, peint au goudron et dispersé à travers la
plaine, comme les pièces d'un jeu de dominos sur une table. Mais l‘intérieur
est tout-à-fait confortable. C'est beaucoup mieux que bien des hôpitaux en
pierre et mortier de chez nous. Ces tunnels sont parquetés de bois ciré ou
verni ; la lumière, tamisée à travers les fenêtres ouvertes en chatières à
travers les tôles, est infiniment douce. Les meubles en fer, et maints détails
sentiment sentimentaux se font remarquer, comme des vases avec des fleurs et
des gravures de revues, appendues aux murs. Les malades, qui le peuvent, se promènent dans les allées du jardin
de l'hôpital et, quand s'arrête une auto de la Croix-Rouge, ils savent par les
infirmières de leur connaissance à quelle infirmerie sont destinés les nouveaux
arrivants. Quand ce sont des blessés qui viennent enveloppés de leurs pansements,
il y a malgré tout dans les yeux de chacun un espoir qui subsiste. Les autres,
ceux de l’infirmerie des poitrinaires, ils les suivent d'un long regard
apitoyé, et ils haussent tristement les épaules comme pour dire : C'est
l’irrémédiable ... Ils savent,
par ce qu'ils voient et par ce qu’on leur raconte, que la tuberculose est une
terrible maladie qui jamais plus ne lâchera ses victimes, qui leur rongera la
poitrine, jusqu’au dernier souffle. Et quand la phtisie est galopante, comme le
sont presque toutes celles qui atteignent ces braves gars de vingt ans, alors
c'est la douloureuse certitude de la mort prochaine ; les poumons vont se
désagréger ; la fièvre minera le malade jusqu’au moment où l'air entrera sans
trouver d’endroit où se fixer, et tournera dans les cavités vides, pour sortir
avec la dernière onde de vie. Ce jour-là, c'était jour d'évacuation, ce qui
donnait à l'hôpital un mouvement inusité. A l'entrée stationne un énorme convoi
d'autos, à l'intérieur, dans les infirmeries, les malades attendent
anxieusement que le personnel les transporte, et c'est une joie tragique qui
frappe jusqu'au tréfonds de la sensibilité, cette allégresse qui anime
l’expression de ces soldats aux figures livides, aux yeux environnés de larges
cernes noir comme des masques vénitiens, aux bouches serrées, aux regards
fiévreux, aux corps squelettiques et démantibulés, qui cherchent leur place
dans l'auto. Leurs maints longues et décharnées soutiennent les minces paquets
de leur triste linge, et avec quelle Joie ils disent adieu à ceux qui restent :
Au revoir, Antonio au revoir ! Les
portières des autos se ferment sur ces jeunes gens, comme si elles se fermaient
sur des tombeaux. Plein d’un espoir superstitieux, ils allaient enfin pouvoir
se baigner dans le beau soleil de leur pays et tarir ainsi cette sueur
affligeante qui ne cessait de refroidit leur pauvre poitrine rongée. Mon ami,
le médecin faisait le cicérone. – Celui-ci guérira peut-être ; il ne va pas trop
mal. Veux-tu voir cet autre par ici ? C’est très curieux : pendant
qu’on le soignait d’une blessure brutale, il a attrapé la tuberculose. Cet air… tu comprends, y est pour quelque chose. Et il
continua lentement sa marche au long de l'infirmerie. Par des phrases pleines
de réticences et, presque sans lien il s'informait, il expliquait. Nous nous arrêtâmes devant un lit d'où partaient des
sanglots haletants et fatigués. Le médecin écarta le drap avec adresse et manda : – Qu'y a-t-il, jeune homme ? Sur le large oreiller très blanc disposé en plan incliné,
s'enfonce une tête de malade. Ses yeux luisants sont bordés de cernes sombres,
profonds et larges. Il y a des bijoux ainsi enchâssés. Son regard ne semble pas
voir la lumière ; il n'a ni tressaillements ni douceur ; les globes oculaires,
on les dirait de métal bien fourbi. La fièvre dégage une odeur tiède et dense
de décomposition. La peau est un parchemin vieux très plissé au cou, et très
tendu plus sur les clavicules et sur le sternum, comme sur une armature en
jonc. De même, c’est de vieux parchemines avec de grandes taches rouges que
sont couverts les maxillaires. La main décharnée qui s'allonge tient un
portefeuille en cuir grossier et très usé, de ceux qu'on ferme d'une courroie à
boucle enroulée autour. Les ongles sont blancs et livides comme des écailles de
pierre. Les cheveux, blonds à la surface, se foncent de sueur près du cuir
chevelu et s'empâtent comme des compresses humides sur les tempes. La bouche
est entrouverte, les lèvres sont blêmes et amollies. Le jeune homme répond à
travers ses sanglots : – Monsieur le docteur, laissez-moi aller au Portugal. Le médecin pâlit et lui fait l’aumône de deux mots de
consolation : il guérirait, ne voyait-il pas qu'il allait déjà mieux ! Le
médecin était là pour le soigner. Allons ! Dans un mois, il serait
debout ! Et s'éloignant du lit, mon ami me dit : – Il doit mourir aujourd'hui : il n’arriverait pas à
Boulogne, si on le met dans une auto ... Et Boulogne était là, à 15 kilomètres. A l'entrée de
l'infirmerie se montrent les brancardiers qui viennent prendre les malades.
Ceux-ci n'ont pas besoin d'être aidés ! Ils font appel à leurs dernières
forces et s’en vont parmi des exclamations de joie. On entend des adieux pleins
d'affection et l’on voit les mains squelettiques joindre leurs os en de suprêmes
étreintes. Le médecin fait des
recommandations aux brancardiers, et nous nous éloignons du malade ; mais les
sanglots qui ont appelé notre attention continuent, et le soldat se soulève
dans de douloureuses supplications. – Laissez-moi partir, Monsieur le docteur ;
j’irai mieux, j’en suis sûr ! Et le malade étendait les bras, joignait des mains
implorantes …Le pauvre ! Le médecin est ému, et moi, je conseille : – Ecoute, si tu lui disais oui ? On le mettrait dans l'auto et on dirait au chauffeur de
marcher et de tourner jusqu’à… – Jusqu'à ce qu'il soit mort, dit mon ami en souriant. – C'est bien parlé, continua le médecin qui discutait
avec lui-même pour se décider ; il mourra mieux qu'ici, n'est-ce pas ? Et se
tournant vers le soldat : – Eh bien ! C'est fait, je te laisse partir ! Il ne me souvient pas d'avoir vu éclater une joie
pareille. Il savourait l'enchantement du retour. A l'allégresse de son rire, de
ses remerciements, on voyait qu'il éprouvait un émerveillement aussi grand que
si l'on avait réveillé d'un tombeau le pauvre soldat pour lui dire : Vis !
Lazare aux vêtements de bure grise, Lazare d'une Bible de l'avenir ! – Vois-tu, mon vieux camarade, c'est bien simple, une
résurrection ! Le soldat gagna du courage et réussit à s'asseoir sur
le lit ; il dit en anglais tout ce que lui avait appris durant sa maladie la
nurse qui l’habille avec un soin affectueux et il s'en alla. La voiture s'éloigna ; bientôt le bruit du moteur
s'éteignit dans la distance. Nous poursuivîmes la conversation et le médecin se
rendit compte que le soldat avait oublié sur la table de chevet le port en cuir
usé et grossier, de ceux qui se ferment avec une bande enroulée autour. Très
ému, il le remit à l'infirmier en disant : – Le jeune homme a oublié ceci. Qu’on le joigne aux autres affaires du malade. Ceci, quand Dieu le veut, c'est toute la vie du soldat
... Du seuil de l’infirmerie, un infirmier en tablier
blanc énonce : – M. le Docteur, l'auto qui était partie il y a
quelques instants est rentrée. Derniers jours
de mai 1918 : Pina de Moraes, malade, s’inquiète
pour sa mère La
toux me fait mal. Je pense que je dois être très malade. Il y a une chose qui
me travaille dans la tête : l’écriture de ta dernière lettre est
tortueuse, inégale, décomposée : on la dirait tracée par une main qui
tremble ; celle de l’avant-dernière était de même. Et toi, ma mère, tu
t’excuses en me disant que tu n'y vois plus. Ce ne doit pas être vrai. Ce pieux
mensonge n'est fait que pour tranquilliser : je connais ton écriture. J'ai
appris à la connaître dans les milliers de lettres que tu m'as écrites depuis
mes dix ans. Tu dois être malade. Mon Dieu, comme cette idée me tourmente !
Peut-être dans ta chambre es-tu en train de regarder de grands yeux
miséricordieux le soir descendre les degrés de la montagne de Saint-Dominique
jusqu'à l'eau du Varosa. Et, de tes yeux pleins de
Dieu, bien des larmes couleront. Tu as à partager en trois : celui qui mort et
les deux qui te restent et qui sont à la guerre. Ta douleur religieuse va de
croix en croix, comme en un calvaire, et tu es ma très sainte mère. Tes mains
qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui ne sont jamais lasses de donner du
pain aux pauvres, égrainent ce chapelet qui fut, me disais-tu, porte-bonheur de
tes couches. Si près et si loin ! Le soir se fait plus triste. C'est mon âme
ombrageuse qui descend avec le jour les degrés de la montagne, et, si l’Angélus
t’a serré le cœur, c'est que, dans les gémissements du bronze, tu as entendu la voix de ton fils.
Tu dois être malade, ma petite mère. Tu comptes les jours qui manquent pour mon
retour. Ils sont beaucoup, hélas ! Beaucoup ! Beaucoup ! Il
valait mieux en oublier le nombre. Il vaudrait mieux n’y plus penser. Je ne
suis pas allé aujourd’hui avec les soldats. C’était impossible ; je suis trop
fatigué. Je n’ai pas de remords ; ce n’était pas pour combattre. Je suis
resté à regarder la forêt de Nieppe qui emplit l’horizon, et à contempler les
braises de la cheminée, qui me réchauffent. Ambleteuse,
mi-juin 1918 : Pina de Moraes est hospitalisé à
Ambleteuse. Il est déprimé. Je
suis arrivé avec une carte jaune, pleine d’identifications et de cachets. Muni
de cette carte, je dois me présenter à l’hôpital. Il ne m’a pas coûté de me
retirer. Les Allemands n’attaquaient pas ; je n’avais pas et je n’ai pas
encore, d’ailleurs de repos. Ici, c’est la Base, comment pourrai-je me
refaire ? Il n’y a pas de place, m’a-t-on répondu successivement dans les
hôpitaux. – Pas de place ! Où aller ? Où ? J'aurais fait
cent fois mieux de rester où j'étais. Pourquoi suis-je venu ? Pour promener la
honte de mon uniforme boueux et ma maladie ? Dans la foule des soldats, on
remarque ceux qui se mettent au garde-à-vous ! Ceux-là doivent être des
combattants. Les autres ne font même pas attention. Cela m’attriste. Toi, ma
mère, malade et si loin ! Le pays désorganisé, livré à d’intestines querelles
entre des victimes et des lâches, ce qui reste de mes soldats divaguant, la
santé ruinée par douze mois consécutifs de tranchée. Vaincu dans la grande
bataille, je n'ai même pas une lettre ; je n'ai même pas mon ordonnance. Je ne
découvre d'amitié que dans le murmure que les vagues font parvenir jusqu’à moi. A la plage il doit y avoir certainement
de la place. C'est la première fois que les larmes me
viennent. Elles tombent sur le sable que la marée haute emportera, après avoir
roulé autour de ma poitrine, comme autour de la carcasse de la dernière
caravelle perdue par « Adamastor ». Cette mer, Maman, c'est l'Atlantique de
chez nous. Atlantique, « Mare
Nostrum » !
Le jour tombe. Le soleil met des teintes de souffrance sur l'eau,
et la mer, tout à l'heure glauque, est d'un rouge de sang. Quel beau fond pour
les attitudes suprêmes, que le délire des combattants a laissées dans mes yeux
pour l'éternité. Les voilà qui passent. Ils s'en vont, les héros ! Laisse-moi
me lever ... Ma mère, je te ferai mon récit plus
tard, veux-tu ? Je te ferai mon récit aux veillées, n’'est-ce pas ? Pendant que tu mettras des franges à cette
couverture au crochet, que tu as commencée quand je suis parti pour faire la
guerre. Les lames s'acheminent de loin ; on dirait qu’elles viennent me voir et
s'achèvent en un clignement de paupières aux longs cils mousseux. Je deviens
plus triste, quand la nuit descend. Les dunes se raient de noir, le sable se
fait grisâtre, et la mer est une grande ombre ondulante, toutes ces ténèbres
auraient de la place dans ma poitrine. Au long de la nuit, une
souffrance profonde me traîne. Ma mère, le bonheur, on le cherche. Il vient du
dehors et finit en nous ; le malheur, c'est en nous qu'il commence et il
s'élargit, il se répand. Le bonheur a une fin, le malheur est un destin sans
bornes. Je me perds dans toute cette douleur, et
je me donne comme en expiation. C'est une veillée de douleur ! La mer, c'est la
larme infinie pleurée par la tristesse des mondes. La nuit sombre et triste
paraît me recouvrir comme la terre d'une tombe. Mes sens s'évanouissent, La
grande mer psalmodie et fait retentir dans les dunes des « Palestrinas » d'eau. Et je rêve que mon pays est une figure
héroïque à diadème de granit, et que l'Atlantique est son manteau de cour
traînant sur une route sans fin. Le plus grand rêve du plus humble des
soldats ! Ambleteuse, début de
juillet 1918. Je suis à l'hôtel de la Plage[1];
de mon lit, je vois l'amoncellement des maisons de Boulogne ; la chambre est
garnie d'un papier à ramages ; un Christ soumis, résigné pour ainsi dire aux
fatalités de la douleur, y est suspendu. La couleur des plaies a tellement
vieilli qu'on dirait en vérité du sang sec et poussiéreux. Mes amis médecins me
soignent avec une tendresse fraternelle, dont je leur suis très reconnaissant.
Quand la lumière baisse, dans ma mémoire passent les souvenirs les plus
lointains. Si tu savais, Maman, ce que je trouve parfois ! Tiens, te
souviens-tu d'un petit pardessus que je n'aimais pas et que tu me forçais à
mettre ? Et quand je suis arrivé à la
maison sans l'avoir ! Ta figure, ah
! – Le pardessus,
mon fils ? – Je l'ai jeté
dans un buisson ! Si tu m'as puni, je ne m'en souviens
plus, mais je pense bien que non. Et beaucoup d'autres épisodes me passent par
la tête. Le matin, une Française mince et blonde, toujours souriante,
m'apporte « Le Télégramme ». Non, les Allemands n'ont pas encore passé la forêt où j'étais. Et cela
me fait une grande joie. La toux commence, quoique bien lentement, à
disparaître. J'ai eu aujourd'hui la visite d'un de mes hommes blessés d'il y a
quelques mois. Il m'a fait le salut de la main gauche ; le bras droit tombait
sans mouvement, terminé par la main, à laquelle les doigts tordus et confondus
donnaient l'air d'un insecte étrange. – Ce bras,
jeune homme, c’a été le diable ? J'ai dit cela de l'air de quelqu'un qui
parle d'une chose sans importance. Et tu veux savoir ce qu'il m'a répondu ? - Ah ! Mon
lieutenant, je ne pourrai plus retourner aux fêtes avec la musique de mon
village ; maintenant, je ne pourrai plus jouer. Et il regarda tristement son
bras infirme. Et sais-tu ce que j'ai pensé ? Qu'en rentrant chez lui, il y aura
quelque chose de cassé dans son étreinte enthousiaste ; il ne pourra pas fermer
la chaîne ; il lui manque l'anneau pour le tour que font les bras, quand ils
donnent ses limites au monde. Et, quand il aura un fils, il ne pourra pas le
hausser à la hauteur de ses yeux. Et suppose, suppose que le petit lui demande
de le faire, pour le distraire ? – Eh bien, mon
garçon, tu t'amuseras encore davantage et tu n'auras pas besoin de te fatiguer
à souffler ... lui dis-je pour le réconforter. Quand il me quitta, il partit content,
Pauvre gars. Aux vitres des maisons de Boulogne, si
sombres, il y a des reflets de couchant, et je vais te quitter pour continuer
de penser à toi, longuement, interminablement, jusqu'à retrouver ton âme.
Encore Ambleteuse. Mes amis médecins sont d'une grande sollicitude. Je me suis
levé. Ambleteuse est triste. Vigny me vient à la mémoire. Il me souvient d'un
de ses contes militaires qui parlent de Napoléon et d'un abordage tragique. Il
me semble qu’il se passe ici. Tes lettres ne me parviennent pas toujours. A ton
souvenir, maman, viennent se joindre mille idées douloureuses. Pourquoi
n'écris-tu pas à ton fils ? Cette tranquillité de la Base finit par me
martyriser. Comme je voudrais te voir, ma mère ! Ambleteuse, fin de
juillet 1918. Retour au Portugal de Pina de Moraes. On m'a donné aujourd'hui une feuille de
route, qui me permet d'aller passer soixante jours au Portugal. A l'expiration,
je dois me présenter de nouveau devant un conseil médical. Je vais te
voir, ma petite mère ! Enfin tu vas finir de compter les jours qui manquent
pour mon retour. C'est terminé aujourd'hui. Tu avais tes raisons, tu devinais
que je te reviendrais un jour, n'est-ce pas ? Tu n'as pas pu écrire ? C'est ta
maladie. Tu t'es trop tourmentée, le jour de la grande bataille, et ta santé a
fléchi. Tu vas voir comme tu guériras, tu vas voir. Si tu savais, mère, le
transport de joie que je ressens à l'idée de retourner chez nous ! Ritorno Ce sont des
mots de résurrection pour de milliers de combattants. C'est l'alléluia de tranchées. Rentrer au bercail ! Je passerai
mes mains dans tes mains, comme si je n’en croyais pas de mes yeux, comme si
j'étais aveugle et ne pouvais les reconnaître sans les toucher. Je les
couvrirai de baisers, qui ne seront jamais aussi nombreux que leurs
bénédictions. Tu sais, mère, je te permets de me
réveiller le matin ; pas besoin de guetter mon réveil. Vois-tu, tu guettes mon réveil depuis
que je suis né. Combien de fois, combien de fois t'es-tu penchée en t'appuyant
des bras sur mon berceau ; combien de fois t'es-tu penchée sur mon lit et sur
tes souvenirs, pour voir si ton petit gars était bien ! Tant de craintes, mère : quand j'étais
enfant, que le petit n'aille pas se réveiller, et maintenant que le petit
n'aille pas mourir à la guerre ! Les souvenirs des mères, elles les portent
avec elles entre leurs deux bras, comme pour les bercer. Le lait se dessèche
dans les seins pour se fondre en larmes dans les yeux. Que veux-tu ma mère,
nous sommes vos enfants toute la vie ! « Ritorno », je vais te voir, je t'avertirai ;
viens au tournant de la route. Tu vas te tourmenter de me trouver si abattu ;
mais tu auras la joie de me voir reprendre des forces. J'entends déjà chanter
les larmes dans tes yeux. Les mères aiment davantage celui qui les a fait plus
souffrir ; le fils bien-aimé, c'est celui qui est mort. Et moi, c'était comme
si je mourais tous les jours ! Viens au grand tournant de la route ! Et
embrasse-moi si fort que tous les regrets de ne pas m'avoir petit en soient
tués. Pour les mères, chaque jour qui passe est un regret. Nous grandissons, et
c'est comme si nous fuyions. Chaque jour fait leurs regrets plus grands. Tu penses
que je ne sais rien de l'immense jalousie que vous causent les berceaux ! Viens
au grand tournant de la route ! Je te raconterai lentement, pendant que
le soleil rentrera de son pèlerinage à la petite chapelle de notre montagne, je
te raconterai un combat, un combat où il y eut de belles attitudes et de
profondes souffrances. Tu t'attendriras sur ton soldat et sur tous ceux des
autres mères. J'entends déjà ton commentaire suprême : – Mon Dieu ! C'est pour te rappeler les pages d'histoire
que tu m'as apprises et que sans doute tu as oubliées. Il y a si longtemps !
Dans 1a montagne s'éparpille le dernier psaume du jour qui descend et, avec
l’habitude que tu as prise de ne pas me voir, il va te paraitre que ce n'est
pas moi qui parle. Les mères, maman, oublient ainsi les fils : comment fait-il
que ce soit lui ? Tout à l'heure encore je l'entendais dans mon cœur ... Dis-moi
un secret. Comment expliquez-vous ce mystère ? Vous pouvez avoir plusieurs
enfants et pour chacun d'eux vous aurez l'air de n'être que sa mère à lui. Le
mystère est plus grand encore d'avoir pour tous ce qui n'était que pour un seul. L'amour des mères, ce qui n'est pas à
nous, c'est seulement ce qui n'est pas contenu en nous. « Voltar », Retour ! C'est comme si tu descendais du calvaire
que je t'ai fait gravir. Les mères ont toutes leur calvaire. Les femmes font
aussi la guerre, et je ne sais pas ce qui vaut mieux ou du sang des combattants
ou de leurs larmes. Tu ne te souviens pas de m'avoir entendu dire que la
résurrection a été bien plutôt le fait des larmes de Marie que du sang de Jésus
? Je vais te voir ! Le fil de coton de ta couverture ne fait
pas plus de tours que le fil de tendresse qui descend de tes yeux pour
envelopper ton fils. Et puis le soleil vu me guérir ; mes montagnes vont me
bercer, berceau gigantesque ! Je suis aussi le fils de la terre. Sur la pente,
les arbres sont tranquilles comme des troupeaux. Ceux des Flandres, ma mère, je
les ai vus tant de fois au long de la plaine, à la lueur des feux ; spectraux,
ils s'enfuyaient comme des perdus. Laisse-moi oublier ! Les yeux sur le Marâo, mon regard s'en ira, comme une aile détachée,
effleurer la cime la plus haute, mains de granit tendues vers le ciel. Voltar ! Ritorno ! Je vais garder ces feuillets ; les
« camones » m'ennuient à crier de la
route : – No light ! No light ! Je suis donc forcé d'éteindre la
lumière. Je vais te quitter ; je reste en la compagnie du Christ, dont je t'ai
parlé et qui, dans la pénombre de la chambre, à la lumière blafarde qui
traverse les carreaux, est étreint d'une agonie si lente, si lente qu'elle se
prolonge jusqu'au matin, quand la toux ne me laisse pas dormir. Je t'envoie ma
dernière « saudade », le suprême élan de mon cœur
nostalgique. Laisse-moi rire ; c'est comme la dernière cartouche ! Bénis-moi,
au nom de Dieu. Quand
cet officier rentra chez lui, sa mère avait succombé ; le cœur de la pauvre
femme s’était tellement fatigué durant deux années de guerre qu'il avait cessé
de battre doucement insensiblement. [1] Je n’ai pas trouvé de témoignages ou de
photos d’un quelconque hôtel de la Plage à Ambleteuse. Il doit certainement
s’agir du Grand Hôtel d’Ambleteuse construit en 1903 et dont la vue à partir
des chambres donnait vers Boulogne. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©