 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Histoire du Père Emeri Cambier, « Roi
du Kasaï », prisonnier pendant trois ans en Allemagne ! 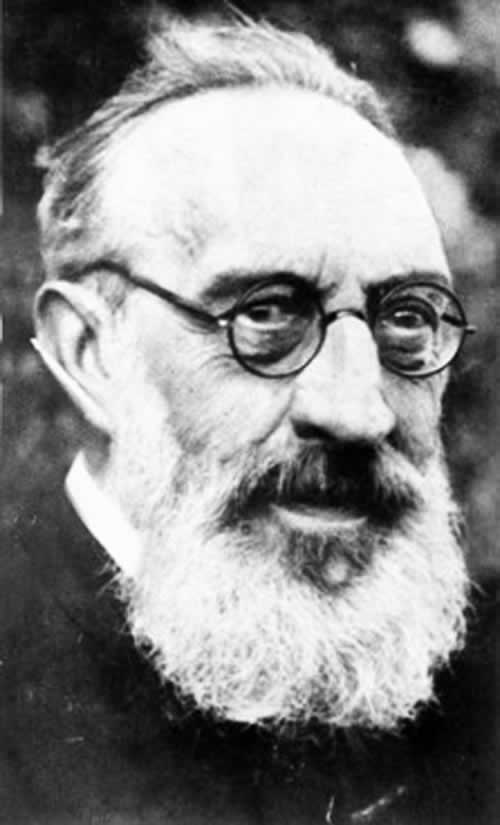
Le Père Cambier était un fameux garnement dans son adolescence ! Interne au collège d’Enghien, il se fait
remarquer par un caractère droit mais fort indépendant et espiègle. Défendant
les souffres douleurs du Collège, il n’hésite jamais à secourir plus faible que
lui, même s’il en coûte d’être puni. Ainsi, le jour où il gifle un
« président de table » pour avoir refusé de donner du café à un plus
jeune. Emeri est puni de son geste par une punition écrite mais la victime
secourue aide son bienfaiteur en « grattant » la moitié de la « colle » tout en
imitant l’écriture de son aîné. Le stratagème est découvert et Emeri est
convoqué chez le Préfet. Il doit bien avouer l’aide reçue mais ne veut pas
dénoncer son petit camarade. La sanction est lourde : la
« séquestration » durant un trimestre entier ! Cette peine signifiait qu’il était exclu de
tous les loisirs prévus pour les internes. Après deux mois de ce régime, le
Principal du collège, le chanoine Deblander, arrêta la punition à la seule
condition d’une excuse chez le Préfet mais sans aucune obligation de dénonciation
! Durant ses humanités, Emeri avait eu un
moment l’idée de devenir missionnaire comme son professeur, le Père Geluy, en
partance pour la Mongolie. Cependant, en fin d’humanités, Emeri, s’était décidé
à devenir officier. Avant de présenter l’examen d’entrée à l’Ecole royale
Militaire, son frère, curé à Châtelineau, lui conseilla de faire une petite
retraite de deux jours. Emeri accepta. Au cours de celle-ci, les projets du
jeune homme changèrent de façon radicale au point qu’il revint à sa première vocation. Emeri, 17 ans, rentre alors dans la
compagnie missionnaire de Scheut, congrégation appelée aussi Congrégation du
Cœur Immaculé de Marie[1].
Après un an de philosophie au petit séminaire de Bonne-Espérance suivi de
quatre années de théologie et de noviciat à Scheut, Emeri est maintenant prêt à
partir en Chine, le terrain de mission de cette congrégation. Cependant, le Roi
Léopold II, en 1888, intervint à Rome pour que les missionnaires Scheutistes élargissent
leur champ d’action vers le Congo. Ces missionnaires n’eurent alors pas d’autres choix que d’organiser
une première expédition vers cette immense contrée, domaine privé du Roi des
Belges. 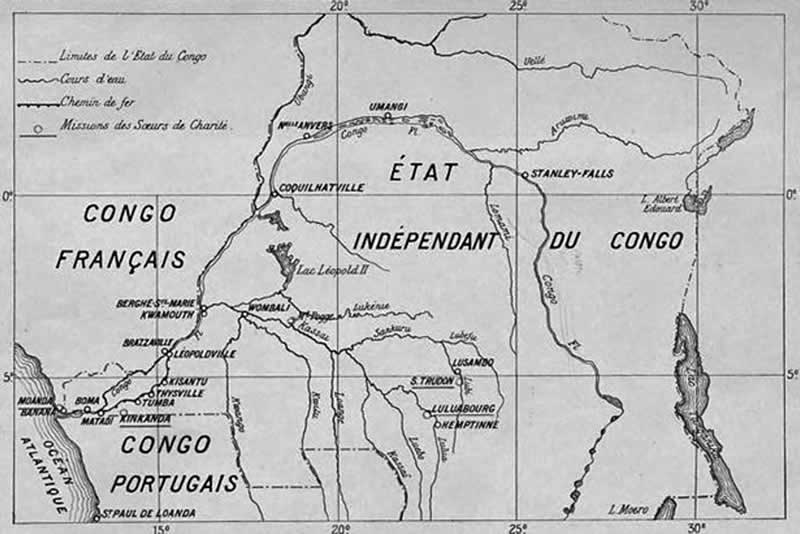
Sur cette carte mentionnant les missions des Sœurs de Charité, on distingue nettement le chemin de fer entre Matadi et Léopoldville passant par Tumba, Thysville et Kisantu mais il ne fut inauguré qu’en 1898. Avant cette date, le trajet se faisait à pied sur la route des caravanes. 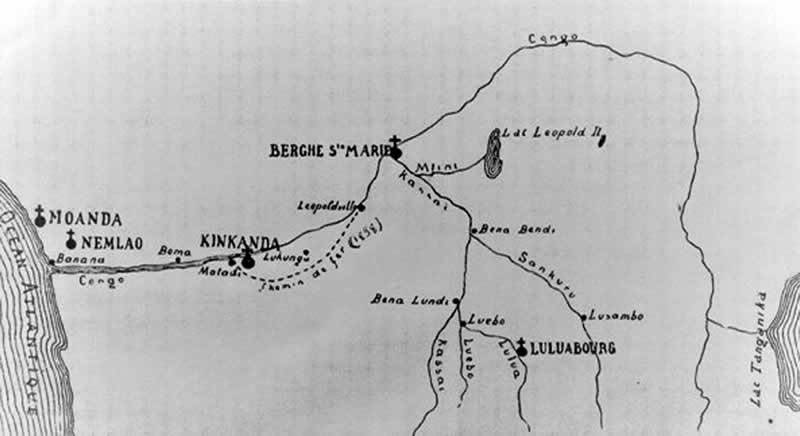
Carte du Congo indiquant les Missions des Sœurs de la Charité de Gand et itinéraire suivi par Ste Marie-Godelière dans son voyage de Moanda à Luluabourg En route pour Léopoldville Le 26 août 1888, les quatre premiers
missionnaires de la Congrégation de Scheut destinés au Congo, tous issus des
anciens du collège St Augustin d’Enghien, s’embarquent à bord du petit steamer anglais, « l’Africa ».
Il s’agit des Pères Huberlant[2],
De Backer[3],
Geluy[4]
et Cambier. Après un voyage de plus d’un mois, le bateau accoste à Banane, le
petit port situé à l’endroit où le fleuve Congo se jette dans l’Atlantique. Les
quatre missionnaires s’embarquent alors en en Pirogue jusque la mission des
pères du St Esprit à Nemlao. C’est un premier contact avec l’Afrique et le
dépaysement est total pour les quatre hommes qui visitent la mission ainsi que le
village voisin dans lequel se déroule une étrange cérémonie. Les veuves du roi
Nemalo décédé depuis plus de deux mois, doivent en effet entretenir le feu dont la fumée épaisse enfume le royal cadavre
et cela, jusque l’intronisation de son successeur. Le 21 septembre, les quatre
missionnaires arrivent à Boma d’où ils partent pour Matadi. Arrivés à
destination, leurs bagages n’ont pas suivi et c’est le P. Cambier, faisant déjà
preuve de ses prouesses de pionnier, qui retourne à Goma les chercher ! 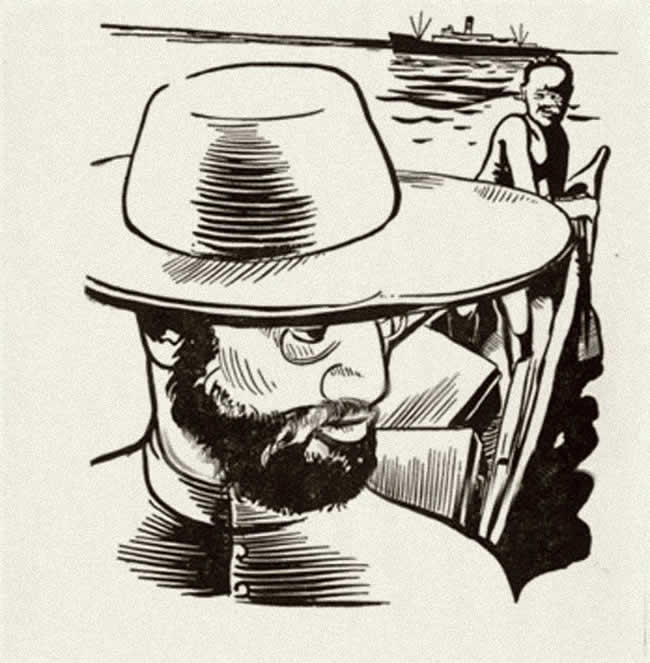
Les premiers contacts avec l’Afrique
sont très décevants. Par manque de vivres, la marche vers l’intérieur sur la
route des caravanes doit être reportée jusqu’au 27 octobre. A cette date,
seuls le P. Cambier et Huberlant sont
valides. Le duo se met alors en route vers la station de Léopoldville. Celle-ci
n’est pas accessible par voie maritime à cause des 32 rapides qui jalonnent le trajet. Il s’agit donc de
24 jours de marche à effectuer avec quelques
porteurs en franchissant de multiples obstacles comme la terrible escalade du
mont Palaballa. La fièvre s’empare du P. Huberlant, et Emeri, lui-même, va
souffrit d’un ulcère au tendon d’Achille. Il faut traverser des marais, une
rivière sur deux fragiles troncs puis la rivière Inkissi dans une pirogue qui,
d’ailleurs, versera lors de la traversée du P. Huberlant. Les tombes de
voyageurs malchanceux côtoient la piste sinistre. Enfin après 400 km de marche,
les pionniers arrivent à Léopoldville le 18 novembre. Les deux missionnaires
entament un « Te Deum » tant ils ont la sensation d’avoir échappé
miraculeusement aux multiples dangers. 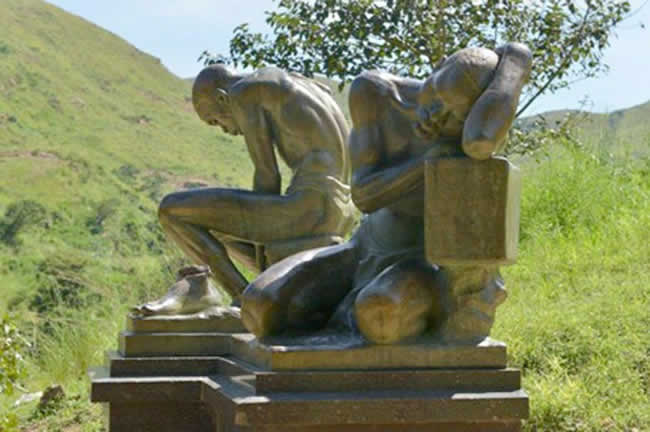
A la sortie de Matadi, un monument rappelle la souffrance des porteurs sur la route des caravanes et cela, jusqu’à l’inauguration du chemin de fer Matadi-Léopoldville en 1898. La fondation de Berghe-Ste-Agathe[5] au confluent du Congo
et du Kasaï Enfin, quelques jours plus tard, ils
peuvent embarquer sur le fleuve Congo qui redevient navigable. Ils arrivent
ainsi le 24 novembre au confluent du Congo et du Kasaï pour y établir la
mission de Berghe-Sainte-Marie, cela après trois mois de voyage. Le 10 janvier
leurs deux compagnons, les P. Gueluy et De Backer, remis de leurs
indispositions les rejoignent. Pendant
des mois, les missionnaires se contentent d’être des pionniers. Le temps se
passe à construire les habitations et à se procurer des vivres sur les marchés
indigènes. Il y a aussi des occasions d’acheter des enfants réduits à
l’esclavage, ce sera la politique des missionnaires pour peupler leurs
missions. De ces enfants, ils en feront des chrétiens, des catéchistes et plus
tard, lorsqu’ils se marieront, ils constitueront les premiers foyers chrétiens.
« J’ai
déjà eu trois fois l‘occasion d'acheter de petits esclaves. Au commencement ce
marché fait si drôle, si triste effet. Dernièrement je débattais ainsi le prix
d’un petit mioche. Les larmes m'en vinrent aux yeux et je faillis me trouver
mal. A voir son visage souriant, ses yeux pétillants d’esprit, j'augurais qu’on
en ferait un bon petit chrétien. Mais le maître impitoyable en demandait 200
francs. Or, vu l‘état de nos ressources, nous ne pouvons poser un tel
précédent, alors surtout qu'aux Bangala et au Kasaï, nous en aurions à volonté
pour 5 et 10 francs. Ce n'était point cependant pour les habits du négrillon
qu'on le fixait si haut, il était nu, comme la main.» (Lettre envoyée à son
frère et datée du 10 février 1889) 
Marie-Hilda avec quelques enfants de l’orphelinat de Berghe Ste Marie Les seules distractions des Pères sont les parties de chasse ou des évènements inattendus qu’Emeri Cambier raconte avec beaucoup de verve et de talent : « Je crois devoir vous rassurer
à propos d'un petit incident, dont le P. De Backer doit avoir parlé dans une
lettre : la renommée grossit tout, et, exagération en exagération, en Belgique,
on pourrait bien vous avoir annoncé ma mort. Je vais vous conter l'histoire
telle qu'elle est arrivée ... Pendant le souper du 20 février, voilà que notre
petit chien sort tout effaré de la chambre du P. De Backer et se précipite hors
de la salle commune ayant l'air de se chamailler avec l'une ou l'autre bête que
nous ne distinguions pas. Je prends la lampe, je cherche, j’aperçois un serpent
long d'un mètre cinquante à deux mètres, attendant paisiblement et avec fierté
l'attaque du chien. Prendre le fusil de chasse, y glisser une cartouche, est l'affaire
d'un instant pour le P. Gueluy. II tire... mais qu'est-ce qu'un grain de plomb
logé dans une anguille ! Le serpent fuit, longeant le mur (si mur il y a)
et disparaît aux environs de ma chambre ; on y retourne des pièces de bois, des
caisses ; recherches infructueuses ! On contourne ma chambre et nous
finissons par découvrir effectivement un serpent. Un coup de bâton l'assomme,
une bêche le coupe et... nous allons achever notre repas... Un instant de
patience pourtant : en entendant la détonation, les Bangala étaient accourus,
et l'un d'eux dans sa course précipitée
avait reçu la douce sensation d'un ongle de doigt de pied arraché par une
pierre aiguë, contre laquelle il était venu chopper. J'ai hâte donc de
retourner à ma chambre, nanti d'une potiche qui me sert de lampion, pour y
chercher du linge de pansement ; je me baisse, j’étends le bras ... et ... de
derrière la boîte s'élance un serpent qui me mord avec gentillesse au dos de la
main droite. Un cri de frayeur m’échappe, vite, je retourne à la salle commune
en suçant la blessure (Ciel, quelle amertume que ce venin !) et après avoir
injecté de l'ammoniaque, je retourne tranquillement tuer la vilaine bête. Elle
l'avait bien gagné ! D'un coup de bêche, j'en fais une division qui tourne à
multiplication ; pour nous c'est une soustraction, et celui-ci avec celui-là,
cela fait une addition. Ce second serpent était, sans nul doute, celui que nous
avions aperçu tout d'abord, et qui, perdu de vue, s'était bel et bien glissé,
par la palissade, dans ma chambre, et blotti derrière les caisses, dans un
coin. Un léger gonflement de main a été la conséquence de cette morsure, avec
quelques éblouissements et battements de cœur. Le lendemain toute trace de l'accident
avait disparu. Quant à nos deux braves chiens (un second était venu à la
rescousse du premier), ils en ont été quittes pour 4 ou 5 jours d'un
aveuglement presque complet ; le serpent cracheur leur avait lancé pas mal de
bave dans les yeux. Il va sans dire que
ma messe du lendemain a été une messe d'actions de grâce. Ce fait me prouve une
fois de plus que le manteau de Marie, notre Mère, nous sert d'égide en toutes
circonstances. Figurez-vous donc ce serpent restant inaperçu dans ma chambre,
venant s'enrouler la nuit autour de mon bras... rien que d'y penser, dira quelqu’un,
me donne le frisson. Mais non, Marie veille sur nous ! ... Ceci s'est passé il y a une quinzaine de
jours. Chaque fois que cette histoire me revient, je ressens la douce
impuissance de retenir un « Ave Maria » sur mes lèvres pour remercier la Ste
Vierge de sa protection. Et vous tous qui m'aimez, si vous voulez me causer un
plaisir qui aille au cœur, remerciez Marie pour moi. Je vous embrasse de tout
cœur. » (Lettre à sa famille) La fondation de la mission de Nouvelle-Anvers En octobre 1889, le P. Geluy avait
choisi chez les Bangalas un site favorable pour y établir, au nord de
l’Equateur, une nouvelle mission appelée « Nouvelle-Anvers » Le 6 décembre,
les Pères Gambier et Van Ronslé quitte Berghe-Ste-Marie à bord du steamer de la
mission française de Brazzaville, le « Léon XIII » piloté par le P. Augouard,
futur premier évêque du Congo français. Ils remontent le fleuve et aborde le 20
décembre à l’endroit choisi. Les Bangala ont une réputation de guerriers
farouches ayant tenu tête à Stanley. Le 4 janvier, l’habitation provisoire est
terminée. La mission des Bangala est donc fondée avec comme chef le P. Cambier.
Pendant que le P. Cambier poursuit ses travaux d’installation, son confrère va
chercher aux « Falls », (L’endroit deviendra Stanleyville), des
enfants orphelins délivrés des marchands
d’esclaves. Malheureusement, victimes de mauvais traitement, beaucoup
décédèrent peu après leur arrivée. Fin février 1891, le P. Cambier découvre que
l’on retient ses marchandises dans un magasin d’Etat. La plupart des caisses en
souffrances avaient été laissées à l’humidité et les tonnelets contenant le vin
de messe avaient été vidés. Il y avait là acte de malveillance de la part des
coloniaux envers les missionnaires. A Nouvel-Anvers, les Pères avaient aussi
découvert une population ravagée par la maladie du sommeil. Il fallait de toute
urgence avertir Léopold II de l’existence de ces deux problèmes. Le P. Cambier
retourna donc en Belgique. Il y signala la situation difficile des populations
par de nombreuses conférences et suscita la charité. Pour ce qui est de
l’esclavage, il soutint la thèse que le meilleur moyen de supprimer la traite
des esclaves était de multiplier les postes de l’Etat pour s’attaquer aux
marchands d’hommes tandis que les Missions devaient en recueillir les victimes.
Le P. Cambier fut reçu par le Roi et ce dernier envoya les télégrammes
nécessaires pour faire cesser les vexations de certains agents dont les
missionnaires souffraient. Le Roi exigea
même que les charges destinées aux missions partent avant celles de l’Etat. Léopold
II tint aussi à contribuer au financement du bateau des missionnaires, le
« Notre Dame du perpétuel Secours ». C’est pendant ce séjour en
Belgique de trois mois que le P. Cambier recueillit les derniers soupirs de sa
maman. Cambier fonde la mission de Luluabourg-St-Joseph (aussi
appelé Mikalayi) mais le P. De Gryse retourne à Moanda Rentré au Congo en juin
1891, Emeri est d’abord désigné pour fonder la mission de Moanda tout près du
port de Banane. A peine cette mission mise sur pied, le voilà qui regagne
Nouvel-Anvers. Son activité est extraordinaire : en un an, il parcourt
trois fois la douloureuse route des caravanes entre Matadi et Léopoldville dont
le trajet, rappelons-le, consiste en trois semaines de marche. Bientôt, le P. Cambier
abandonne Nouvel-Anvers pour s’en aller
fonder une mission à Luluabourg avec le P.De Gryse. Le bateau français
« Ville de Paris » les embarque mais, le lendemain, doit faire
demi-tour car le P. De Gryse est tombé malade. Emeri repart donc seul. Le
bateau le mène jusque Luebo d’où, le 5 novembre, il poursuit à pied sa route
pour Luluabourg où il arrive le 14 novembre 1891. Le 7 décembre, il établit sa
résidence sur les bords d’une rivière à quelques kms du Poste de l’Etat. Le P.
De Gryse le rejoint enfin quelques semaines après mais, hélas, ne peut résister
au climat et doit retourner sur la côte. Il y restera et remplira les fonctions
d’aumônier chez les religieuses de Moanda. 
Moanda – Vue d’ensemble de la Mission 
Mission des Sœurs de la Charité à Moanda (Bas-Congo) 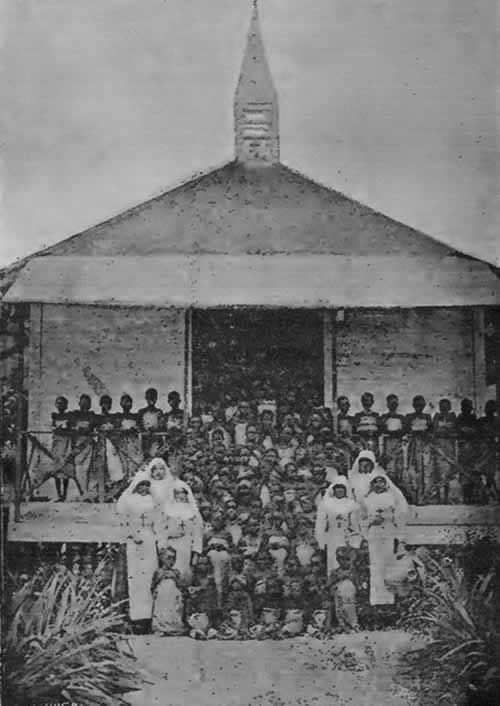
Orphelinat des Sœurs de la Charité à Moanda Le P. Cambier, 26 ans, seul pour
bâtir la mission de Luluabourg A 26 ans, Emeri Cambier se
retrouve donc seul dans un pays immense pour conquérir ses âmes. Pendant une
année, il vivra là un temps très dur de solitude. Plus tard, il répètera :
« Il faut avoir 26 ans pour
supporter cela ! Maintenant je ne pourrais plus le faire ! » Puis,
se reprenant : « Mais si, si
mes Supérieurs me l’ordonnaient, je le ferais encore… » Seul et parfois au milieu
d’une partie de la population hostile qui avait le désir de le tuer pendant son
sommeil ! A la halte d’une nuit, lors d’un voyage, il avait entendu parmi
ses porteurs : « Quand il s’endormira, nous le tuerons… » Le
croiriez-vous, expliqua plus tard le
missionnaire, ce qui m’a été le plus dur cette nuit, ça a été de lutter contre…
le sommeil, un sommeil de plomb qui m’envahissait après 8 heures de marche au
soleil d’Afrique ! » A la fin d’octobre 1882, la
nouvelle mission abritait 305 esclaves rachetés ou libérés. Ce renfort lui
avait été donné en grande partie par le lieutenant Doorme qui avait réussi à
s’emparer d’un camp d’esclavagistes Bakiokos à trois heures de marche de
Luluabourg et cela, avec l’aide de quarante soldats. Ce camp comportait 307
esclaves. Les hommes furent incorporés par le lieutenant tandis que les autres,
infirmes, malades, femmes, enfants furent remis au P. Cambier. Le Père Cambier
dut désobéir aux instructions qu'il avait reçues, à savoir celles qui prévoyaient
qu’il ne pouvait accepter que des jeunes garçons âgés de moins de 14 ans. Sa
désobéissance était réfléchie : en acceptant tous les anciens esclaves, le
P. Cambier fondait ainsi de véritables communautés chrétiennes. Deux mois après
la délivrance des captifs, le P. Cambier pouvait dresser un bilan : « Une rue compte déjà 55 habitations et une autre en a 22 ;
et 10 sont groupées autour de ma cases. Un grand hangar de 30 m. abrite nos
scieurs de long, charpentiers, menuisiers, tourneurs et forgerons. Nous n'avons
que quelques haches et machettes ; il faut bien faire des forgerons pour
fabriquer ces outils avec de vieux canons de fusils rachetés aux indigènes. La
petite scie circulaire, le soufflet de forge, la meule, tout cela est mû par
une grande roue actionnée par une courroie fabriquée avec la peau d'un bœuf.
J'ai tanné moi-même cette peau avec l'écorce très astringente d'un arbre du
pays. » Le P. Cambier est toujours
seul. Il y fait allusion en terminant cette même lettre : « Et moi ... ? Resterai-je seul, seul à
six semaines de tout confrère, seul à fonder une Mission nouvelle, seul à
nourrir, diriger et instruire (…). Certes non. Dieu sait ce qu'Il fait, son œil
me voit perdu au sein du noir continent. Son amour veille sur moi, son bras me
défendra. » (Lettre datée du 24 avril 1892) Cette solitude dont souffre,
malgré lui, l'ardent missionnaire, il ne peut s'empêcher d'en faire part à ses
proches, mais toujours sans amertume, allant même jusqu'à terminer sa lettre en
badinant : « Je suis seul depuis le mois d'avril. Du personnel que j'avais alors,
j'ai presque 200 morts, squelettes en arrivant ! Malgré cela, j'ai aujourd'hui
316 esclaves rachetés ou libérés, dont je suis : le directeur d'âmes, le roi,
le ministre, le sénateur, le représentant, le gouverneur, le conseiller
provincial, le bourgmestre, le gendarme, le conseiller communal, le juge de
paix, le garde-champêtre et ... le médecin. Octave (Ndrl : son frère
médecin en Belgique) me dit que le soin
des malades l'empêche de m'écrire. Il n'en a pas tué 200 en dix mois !!! Depuis
trois mois, je n'ai pas été couché une seule fois avant minuit ; même en me
couchant à cette heure, il y a des nuits où je dois me lever trois ou quatre
fois. C'est pourquoi, depuis que je suis à Luluabourg, je me couche tout
habillé. Je ne crois pas avoir passé mon temps à ne rien faire. Il est
maintenant 10 h. 1/2 et je compte vous écrire jusque vers 1 heure. Cela me fera
5 heures de repos et demain matin, travail, (… .). Impossible d'écrire le jour.
Comment ne suis-je pas malade ? Comment ne suis-je pas mort ? Je n'en sais rien
... Si vous saviez, surtout maintenant que je suis seul, avec quel plaisir
avec quelle joie je reçois des lettres d'Europe ! Dois-je vous le dire ?
Vous me croirez peut-être devenu insensible après quatre ans de Congo. Eh bien,
en lisant votre lettre, j'ai pleuré comme un enfant et voilà encore que les
larmes me viennent aux paupières. Allons, parbleu, j’ai 27 ans ! Oui, vous avez beau dire, voilà sept
mois que je suis seul. Je suis arrivé avec un demi-approvisionnement. Vous
voyez donc quelle a été mon existence ... Mais voilà, je me suis mis à pleurer.
« Grand enfant, me suis-je dit après, n'es-tu pas ici pour faire la volonté du
Bon Dieu ! » Peu à peu je me suis consolé. Mais, si je continue, je vais
vous faire pleurer aussi. Changeons de ton ! (…). (Lettre datée du 16 novembre
1892) 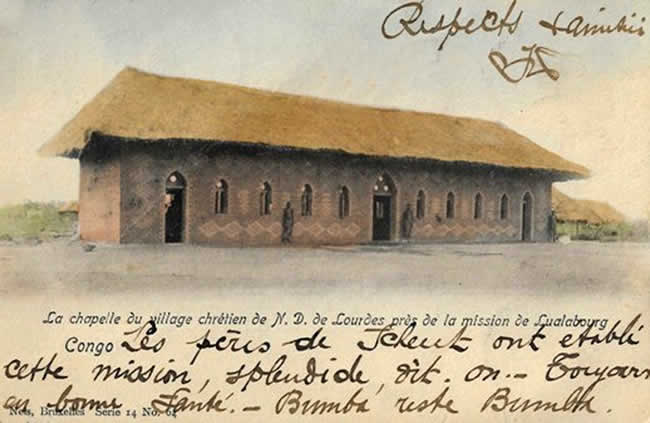
Luluabourg : l’œuvre d’un
véritable pionnier Un an après, en 1893, le
Révérend Père Supérieur Général de la Congrégation de Scheut, vint à Luluabourg
accompagné du P. De Deken, et constata les grands progrès de la mission du P.
Cambier : 530 catéchumènes, deux villages, celui de Saint-Joseph et celui
de Lourdes Notre-Dame... Le Père Supérieur décrit la mission comme une
véritable fourmilière. Des cinquante hectares de la mission, six sont occupés
par les constructions et de larges routes bien nivelées et bordées d’arbres.
Tout le reste est ensemencé. Maintenant, deux grands chefs indigènes réclament
la présence des Pères chez eux, notamment le chef Kalaha Kafoumba résidant à
quatre jours de la mission ainsi que le grand et puissant chef Kassongo. 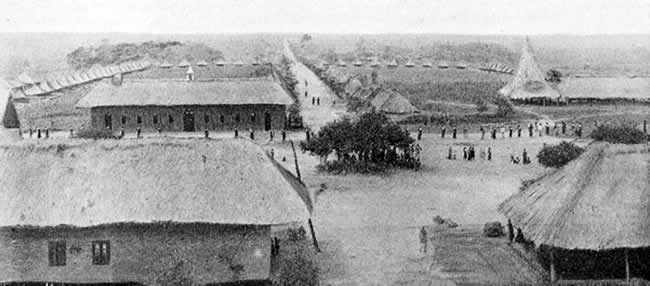
Mission St Joseph du Père Cambier Devant la réussite de la
mission, un renfort est rapidement demandé. En attendant, c’est le supérieur Général
lui-même, Mgr Van Aertselaer, qui aide le P. Cambier. Les Sœurs de la charité
de Gand arrivent en janvier 1894 pour diriger l’hôpital de fortune qu’il vient
de créer. Le Supérieur Général restera plus d’un an et le jour de son départ
avoua à Emeri Cambier qu’il était
d’abord venu à Luluabourg pour le renvoyer en Belgique pour avoir transgressé les
instructions. Et maintenant, il le félicitait de son travail et lui remettait
une lettre élogieuse. Emeri sentit que cette lettre flattait trop son égo et, il la déchira et en brûla les
morceaux ! Le Père Cambier lutte contre la
maladie du sommeil 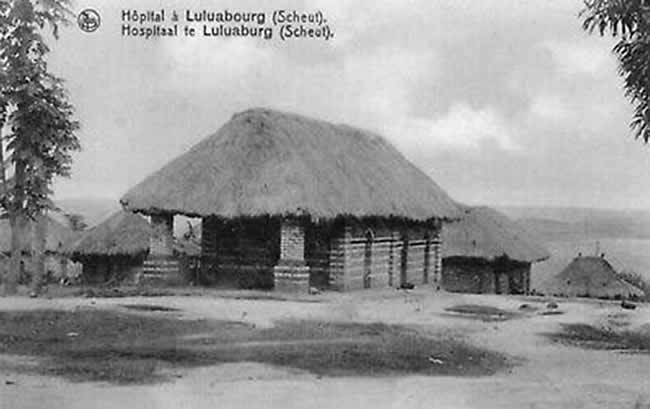
Hôpital à Luluabourg (Scheut) 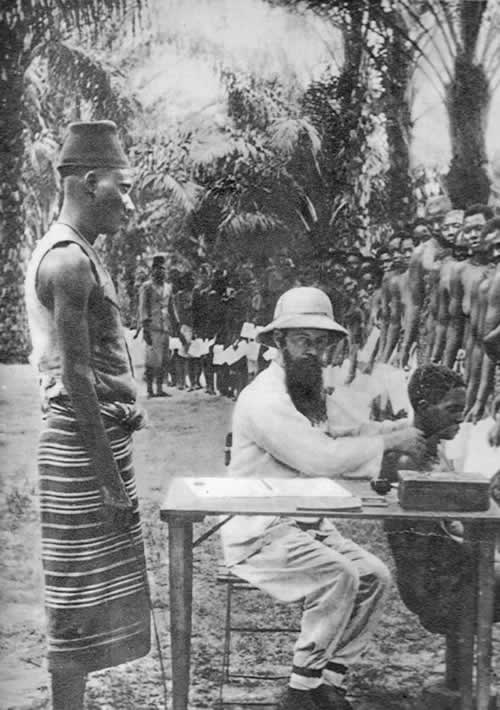
Examen des ganglions pour le dépistage de la maladie du sommeil à la mission de Saint-Jean-Baptiste-Lubefu dans le district de Sankuru, presqu’au centre du Congo. Le missionnaire qui a joint à sa vocation d’apôtre, les fonctions de médecin est le P. Pierre Bouvez qui administre à la population Le P. Cambier sut se faire
aimer des indigènes par la pratique de la médecine. Il possédait la science de
soigner grâce à l’enseignement que lui avait donné son frère médecin. On le
surnomma bien vite « Tata na biso,
Mugangabouka na biso », soit « notre Père, notre
Guérisseur ». Depuis 1900, la terrible maladie du sommeil ravageait de
nombreuses contrées du Congo. Le P. Cambier fit aménager une île dans laquelle
il isola les malades. Une religieuse, deux fois par jour y descendait pour
soigner les « dormeurs ». Les religieuses de Gand dont les premières[6]
arrivèrent en janvier 1894 furent admirables. Six d’entre elles décédèrent en
six ans et le Père Huberlant devait aussi mourir de cette maladie le 24 mars
1893, peu après son retour en Belgique. En 1910, le P. Cambier rentra en
Belgique et y intéressa les autorités à la déplorable condition de ses malades.
Au mois de septembre, il revint au Kasaï ramenant avec lui, le docteur Monnard.
Ce dernier décida alors d’élever un nouvel hôpital en dehors de l’île. C’est le
frère Louis qui construisit celui-ci en remettant à plus tard l’achèvement de
la nouvelle grande église de Luluabourg. Au 18 octobre 1911, il y avait 518
malades soignés avec le médicament à base d’arsenic, l’atoxyl. Les malades
occupent des maisons construites pour eux. Une pompe aspire et refoule l’eau su
ruisseau Kibosshe-Milakai jusqu’à l’hôpital à une hauteur de 50 mètres et sur
une longueur de 1.200 mètres. Quant à la nourriture de ces malades, tout un
personnel est occupé pour acquérir le manioc, le réduire en farine et le
pétrir ! 
Missionnaires de Scheut – Luluabourg-Saint-Joseph – Vue générale Face aux Batetela en révolte A côté de la mission, à
quelques km de là, se trouve la station de L’Etat tenu par trois
Européens : le commandant Pelzer, le lieutenant Cassart[7]
et le commis Lassaux. Les soldats de la station, des Batetela se révoltent et
tuent le 4 juillet 1895, le commandant
Pelzer. On sait que ce dernier a vraisemblablement suscité lui-même la révolte
de ses soldats par ses punitions cruelles qui conduisait souvent à la mort : il
infligeait 300 coups de chicotte à des sentinelles surprises en train de
dormir ! Le Père Cambier, averti de
la révolte fait évacuer les religieuses et les enfants vers le village d’un
chef ami tandis que lui-même reste seul à la mission. Le lieutenant Cassart,
blessé se cache dans les bois puis rejoint la mission pour y être soigné. Le
Père est décidé à brûler toute la mission si les rebelles l’attaquent. Finalement,
les deux blancs avec 400 hommes de la mission quittent avec regrets Luluabourg
pour s’enfoncer dans la forêt sur les traces des enfants et des religieuses. Ils
arrivent vers minuit chez le chef Kanoa. Le lendemain, à 5 heures du matin, les
fugitifs au nombre de 1.200 se remettent en route dans la direction du chef
Pania Mutombo. Cambier est maintenant
hors d’atteinte des révoltés. Après mille incidents, la colonne harassée et affamée
revient à son point de départ, un émissaire ayant averti le Père Cambier que
les rebelles s’étaient éloignés sans investir la mission. Restait un obstacle,
Ngongo, un chef Lulua, qui avait été malmené auparavant par Cassart, avait
profité de la révolte pour prendre sa revanche et comptait retenir prisonnier
toute la caravane lorsqu’elle traverserait son village pour regagner la mission.
Le Père Cambier prit les devants et alla se présenter à Ngongo, tenant le chef
sous la menace de son révolver pendant tout le temps nécessaire à la traversée
du village par sa caravane… Quand il
jugea les siens à bonne distance, il prit alors congé de « Sa
Majesté » en lui souhaitant un au
revoir par un pied de nez exécuté dans
les règles ! 
Mais la révolte continuait à
s’étendre et Ngongo se préparait à nouveau à l’offensive. Le 18 juillet, la
Mission est attaquée et massacrent dans tout le district 26 blancs. Entretemps,
le lieutenant Cassart avait quitté la Mission pour Lusambo afin de quérir
l’agent Dufour et 30 soldats Haoussa munis chacun de 30 cartouches. Ngongo
divisa ses troupes en deux parties, l’une marchant vers la Mission, l’autre
vers le lieutenant Cassart. Devant la Mission, plutôt que d’assister au
massacre des religieuses, le P. Cambier s’avança avec son fusil, un « Express
rifle », s’agenouilla et entrepris de tirer sur les gens de Ngongo. Un boy
lui passait les cartouches au fur et à mesure. Mais à peine avait-il tiré
quelques coups que les rebelles s’aperçurent de la puissance énorme de ce fusil
de chasse et qu’ils se débandèrent. Un peu plus tard, les hommes du chef
Zappo-Zab, allié à la Mission, donnèrent la chasse aux hommes de Ngongo. Le soir ils revinrent
chargés des corps de leurs victimes. Ils allumèrent de grands feux pour manger
leurs victimes. « Ils avaient dit le Père Cambier été jusqu’à dessiner un
grand cercle de têtes coupées dans lesquelles ils avaient planté des bougies
qu’ils allumèrent, puis ils se mirent à chanter et danser tout
autour ! » Grâce au sang-froid du P.
Cambier, le soulèvement fut réprimé à Luluabourg mais la rébellion Batetela
continua de longues années et ne fut totalement réprimée qu’en 1901. Quant à
Ngongo Tshunkenge, le commandant Michaux lui infligea, l’année suivante, une
grosse défaite. La vie dans la Mission
reprit. Le Père Cambier entama la construction d’une tour fortifiée en briques
munies de meurtrières dont les dimensions étaient uniques dans la région
(correspondance du 13 septembre 1895). Elle était destinée à abriter les
religieuses en cas de nouveau danger. Cette tour disparut plus tard lors de la
construction de la grande église. Comment après cela ne pas comparer le Père
Cambier à une sorte de Templier ? D’ailleurs n’avait-il pas hésité à devenir officier ? En tout cas, ses ennemis ne
manquaient pas à l’appel et les premiers étaient certainement les vecteurs des
maladies tropicales. Le Père Cambier perdit en 12 jours deux de ses six
confrères qui étaient venus le seconder. Il avait lui-même aménagé un caveau à
la mission dans lequel une niche restait vide et qu’il s’était réservée. Il se
fabriqua lui-même un cercueil à sa taille ce qui perturba toute la Mission dont
beaucoup de membres vinrent le supplier de ne pas les abandonner ! 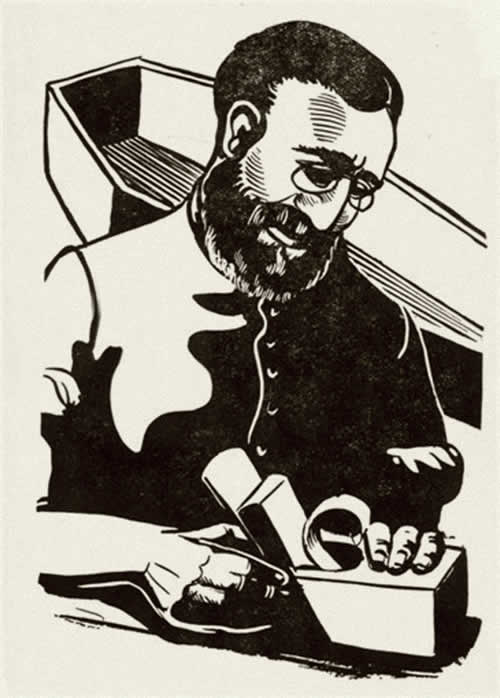
A partir de ce moment,
l’autorité du P. Cambier devint indiscutable dans tout le Kasaï. Des bruits
circulaient que son fusil possédait un pouvoir particulier. « Dix-huit ans après,
rapporte le P. Cambier, un chef indigène vint à la Mission et m'apporta des cadeaux. Alors, il me demanda si je le
reconnaissais. Sur une réponse négative, il me déclara qu’il était un des
révoltés de 1895, échappé au massacre. Il me supplia, comme une faveur, de voir
le fameux fusil, de le toucher et, enfin, de tirer une fois. Mais le recul
était si considérable que ce Noir, qui n'avait jamais eu de pièce semblable
entre les mains, tomba à la renverse
après avoir tiré. Il se releva, sans mot dire, et prit la fuite à toutes
jambes, plus persuadé que jamais que mon fusil était une arme merveilleuse dont
j'étais le seul à pouvoir faire usage. » Le « rescapé » alla, sans
aucun doute, colporter le récit de la scène dans laquelle il venait de jouer un
rôle de « victime » !... A noter que le
précieux fusil lui fut confisqué quelques années plus tard ! On imagine
que le Père Cambier en fut très meurtri ! 
Missions de Scheut – Kasaï - Cathédrale de Luluabourg St-Joseph Le Père Cambier continua d’être
un pionnier exceptionnel. Il fonda les missions de Mérode-Salvador et de
Thielens-St-Jacques. Plus anecdotique est l’élixir
qu’il créa, en référence en sa ville natale, « La Flobecquoise ». En
se souvenant de sa jeunesse écoulée à l’ombre de la brasserie paternelle, il
fabriqua aussi une bière brassée dans une des annexes de la mission. Ses
invités étaient dès lors toujours bien accueillis ! Emeri Cambier atteint le
sommet d’une gloire éphémère quand, en raison du formidable développement des
missions du Kasaï, celles-ci furent érigées en Préfecture apostolique. Le P. Cambier en fut le premier titulaire et
devint dès lors « Monseigneur Cambier » Fondateur de la première mission du
Katanga Après avoir vécu des heures
héroïques au Kasaï, le Père Cambier va encore se faire remarquer en fondant une
des premières missions du Katanga à Ruwe en 1909. Il y arriva au prix de nombreuses difficultés,
une hache dans une main, une boussole dans l’autre, faisant confiance comme son
grand-oncle Jean Dehoust à Saint Christophe dont la statue était vénérée à Flobecq depuis le XIVè
siècle. Jean Dehoust, laissé pour mort lors de la retraite de Russie, se
recommanda au Grand Saint et promis d’assister le 25 juillet de chaque année,
lors de la ducasse de Flobecq à une messe d’action de grâces. A peine le vœu
prononcé, qu’une voiture s’arrêta auprès du moribond étendu dans la neige qui
levait un bras dans un dernier appel au secours ! Le Père Cambier, pionnier dans la
lutte contre la maladie du sommeil Le Père Cambier s’occupa
toujours de soigner activement les malades du sommeil. Il profite même d’un
séjour en Belgique pour suivre les cours de médecine tropicale. Il fut aussi un
des premiers adeptes de la quinine en prévention qu’il prit à la dose de 1 gr
par jour et qu’il employa aussi pour traiter la maladie du sommeil. Voici la
lettre qu’il adressa au Ministre des Colonies le 27 janvier 1910. « J'ai l'honneur de vous remettre
le mode de médication de la maladie du sommeil dont il a été question dans une
précédente correspondance. A proprement parler, il y a deux méthodes qui m’ont
réussi et que j'ai réunies, pour la pratique, en une seule. Comme vous le
remarquerez, ces médicaments ne sont point nouveaux ; la manière seule de les
employer est nouvelle. La première consiste dans l’'administration
de quinine, n'importe sous quelle forme, à très haute dose et de façon continue
... L'autre médication est celle de la liqueur de Fowler (dérivé d’arsenic
comme l’atoxil) administrée à forte dose et sans continuité. » Et le missionnaire de
décrire, avec un luxe et une précision de détails, les avantages et les inconvénients
de ces deux manières de traiter le fléau. Il signale également les expériences
qu'il a pu réaliser à ce sujet. Emile Vandervelde fit reproduire dans le
journal « Le Peuple » du dimanche 27 mars 1910 l’appel touchant du
missionnaire : «Suivez-moi, je vous en conjure, dans l'un ou
l'autre lazaret que la charité catholique a élevés pour recueillir les dormeurs.
Il est huit heures du matin. Déjà ceux qui sont encore les plus robustes parmi
ces infortunés se sont traînés au dehors, pour réchauffer sous les caresses du
soleil leurs membres engourdis par la nuit froide et brumeuse de la saison
sèche. D'aucuns ont gagné le tronc d'un arbre couché
par terre, s'y sont assis, et se sont endormis bientôt après. Les uns s'étant
posés la tête en arrière finissent par perdre l'équilibre et tombent à la
renverse. Les autres, ployés d’abord en avant, leurs mains prenant appui sur
les genoux, s'effondrent bientôt, face première, sur le sol. » Quelques malades
de la même catégorie se sont adossés au mur, à quelque pieu de la palissade, et
là, les genoux à demi pliés, les bras ballants, les yeux ouverts, ils dorment
debout, jusqu’à ce que la fatigue les fasse s'écrouler, sans leur arracher
pourtant ni plainte, ni gémissement. Si on négligeait alors de les éveiller,
ils resteraient sur place et seraient, comme tant d'autres malheureux chassés
ou perdus dans la brousse, foudroyés par le soleil de midi. D'autres malades déjà moins robustes
recherchent plus avidement encore la chaleur du soleil naissant. Mais n'étant
plus maîtres de leur équilibre, ils font un violent effort pour avancer de
quelques pas, et vont s’abattre de tout leur poids contre la muraille, une
palissade, la terre nue, voire même contre d'autres malades. » Maintes fois,
quand nous nous rendons au lazaret pour la visite du matin, nous trouvons la
porte obstruée par un monceau d'hommes impuissants. À se relever. Un premier
malheureux s'étant échoué sur le seuil, d'autres ont buté contre l'obstacle, et
là ont formé une lamentable grappe de corps entrelacés, tandis que des
gémissements, des pleurs convulsifs, des cris de rage vont porter au loin les
accents d’une détresse aux abois. Sommes-nous au dernier terme de la
misère humaine ? Pas encore. Les malheureux que je vous présente
maintenant sont-ils encore vivants ? L'œil pourrait s'y tromper. Voyez ces os
saillants comme ceux d’un squelette ensaché dans la peau ; ces yeux fixes,
exorbités ; ces narines large ouvertes pour aspirer un peu d'air ; ces lèvres
encroûtées, agglutinées par le feu de la fièvre ; cette bouche gangrenée d'où
s’échappe une salive jaunâtre coulant en filets sur la poitrine décharnée : ce
sont nos dormeurs de la troisième catégorie. Et maintenant écoutez encore. J’ai
abordé de pauvres créatures portant des plaies hideuses sur les membres. Par
moments un mouvement convulsif anime ces épaves humaines dont les bras
voudraient s'agiter pour éloigner une nuée de mouches s’acharnant sur des
chairs putrides. Ils feront effort pour se redresser et leurs dents desserrées
laisseront passer deux mots : « Blessure, feu » ; et à bout de forces ces
malades s’effondreront à nouveau sur la natte. Avez-vous compris ? C'est
l'histoire de centaines et de centaines de malheureux qui, sans le savoir, ont
poussé un pied, une jambe, un bras dans le feu qui brûle au milieu de la case,
et qui, vu leur faiblesse, ne sont pas parvenus à le retirer. Et c'est dans cette effroyable position qu’on les
retrouve, parfois après des heures, parfois après toute une nuit, les membres
atteints ne présentant plus que des chairs noircies boursouflées, cuites
jusqu'aux os. L'agonie de ces pauvres dormeurs est souvent bien longue. Pour le
grand nombre, le râle persiste pendant quatre et cinq jours. Dès qu’ils se
trouvent en cet état, on les dépose sur une natte. Le lendemain on les retrouve
exactement dans la même position que la veille, sauf que la bouche est plus
écumeuse, les yeux plus vitreux, les mains plus crispées, et la tête plus
rejetée en arrière par la courbe de l'épine dorsale ployée comme un arc. » Il
n’est pas rare qu'une caravane de fourmis s'acharne la nuit sur ces cadavres
vivants, et, de leurs mandibules d’acier, creuse de larges sillons dans les
chairs. La victime impuissante ne bouge pas. Si je parle encore des rats et
autres animaux qui s'attaquent aux membres inférieurs, c'est pour donner une
idée exacte de l'effroyable torture en durée par ces infortunés, alors que leur
intelligence garde encore toute sa lucidité. A ces spectacles dignes de l'enfer
de Dante, vous croyez qu'on ne peut rien ajouter - Détrompez-vous. Entendez ces
cris de joie féroce, ces ricanements d'hyènes attroupées autour d’un cadavre
dont elles fouillent les entrailles. C'est effroyable. La maladie du sommeil
produit chez certains individus la folie furieuse. Il faut enchaîner ces
malheureux qui gesticulent frénétiquement et qui n'ont conservé de l'homme que
ce qu'il en faut pour dépasser la brute en cruauté. Nous trouvâmes un jour un
dormeur dont l'un de ces déments avait fracassé le crâne. Un autre, mutilant un
cadavre en décomposition, avait découpé une partie du mollet et dévoré cette
chair nauséabonde. Descendons encore un degré, le dernier.
De petits mioches encore à la mamelle, s’efforcent de puiser au sein de leur mère, dormeuse agonisante, un
lait tari depuis longtemps. Aussi c'est à peine si l'on distingue sur le giron
de la femme l'enfant émacié jusqu'à l'invraisemblance. Et tout à l'heure, quand
la mort aura fini son œuvre nous retrouverons le pauvret enchaîné sur une
poitrine déjà glacée, enchaîné dans les bras rigides de la mère qui semble
avoir voulu, par une suprême étreinte, le garder avec elle dans la tombe. »
Mais direz-vous, votre lazaret n 'a donc que des horreurs, et les plus
épouvantables d'entre toutes ! Maintes fois, nous y avons conduit des voyageurs
et des agents de l’Etat. Après la visite, ces messieurs n'ont jamais manqué
d'ajouter à leurs remerciements : « Père, je suis content d'avoir vu ; mais,
quant à revenir, jamais ». Et cependant,
le spectacle le plus sublime s'y trouve aussi, spectacle bien fait pour réjouir
le regard et remonter le cœur. Car, de même que la sombre nuit s'efface devant
l'aurore, les misères si lamentables que j'ai tâché de décrire, disparaissent
devant l'héroïque dévouement de la Sœur de Charité de Gand, qui, sourire aux
lèvres et crucifix sur la poitrine, se donne tout entière à ces rebuts infects
de l'espèce humaine. Et ces pauvres épaves de la souffrance savent apprécier
l'abnégation compatissante de l'ange de la charité, et du plus loin qu'elles
l'aperçoivent, elles lui crient : « Baba,
moyo » : « Bonjour mère ». J'ai parlé de malheureux recueillis dans
nos pauvres asiles ; mais il est des centaines, des milliers d'autres. La
maladie du sommeil décime les villages, dépeuple les contrées, est en train
d'anéantir des races entières. Et nous pourrions ne pas crier à nos
compatriotes, criés au monde, à l'humanité tout entière : « Pitié pour ces malheureux. Pitié, et
sans tarder ». Non, jamais. Ces hommes sont nos frères, et nous devons plaider
leur cause, nous devons faire connaître leurs affreuses souffrances au monde
entier, car le monde entier a le devoir de compatir à pareille infortune. Les
dormeurs sont, au plus haut degré, dignes de notre miséricordieuse compassion. Non
seulement privés de tout ce qui peut rendre la vie, sinon attrayante, du moins
supportable, ils sont encore accablés de maux, de souffrances et de misères.
Rebutés de leurs propres foyers, ils sont chassés dans la brousse à coups de
trique, pour aller y périr de faim et d'inanition. La maladie du sommeil ne
connaît ni limites, ni faveurs ; elle n’épargne ni sexe, ni âge ; elle fauche
toujours et est bien autrement meurtrière que les plus épouvantables
catastrophes. Sans parents et sans amis, le dormeur épuisé par le sommeil se
meurt là où il tombe. Et sur ce corps décharné, mais encore vivant, les
chiques, les mouches et autres insectes, assoiffés de sang grouillent et
déchirent de sorte que leur victime devient bientôt un moignon informe, fait d’horreur
et de souffrance. Eh bien, ces malheureux entre tous les malheureux du
globe, n'ont pas encore un seul hôpital
convenable, et c'est pour édifier cet hôpital indispensable entre tous, pour le
doter convenablement que je prie et supplie la presse du monde entier de reproduire
le présent appel à la charité universelle. Si le Congo réserve aux peuples des
richesses, ces peuples ont cependant avant tout le devoir de s'intéresser au
sort malheureux, souverainement malheureux, de leurs frères du Congo. Il nous
faut un hôpital digne de ce nom, digne de ces innombrables victimes, digne de
notre civilisation. Nos Sœurs de Charité s'y dévoueront, comme elles l'ont fait
jusqu’à présent dans d'infects lazarets. Une religieuse, atteinte de la maladie
du sommeil au Kasaï est morte à Gand. Une autre est malade à Saint-Trudon
(Kasaï). Et cependant, que nous demandions autant de religieuses qu'il faudra
nous les obtiendrons. Nos Pères leur prêteront le concours le
plus généreux. Nos missionnaires, prêtres et frères coadjuteurs, construiront
eux-mêmes cet hôpital indispensable entre tous ; eux-mêmes mettront la main à
la pâte et deviendront ouvriers de chantiers une fois de plus.
Donnez-nous les ressources suffisantes pour soigner convenablement les
malheureux dormeurs. » Si vous pouvez donner pour eux, faites-le, je vous en
conjure au nom du Christ. Je vous
remercie d’'avance en leur nom et au mien. » Signé : Emeri CAMBIER, missionnaire de Scheut, Préfet Apostolique
du Haut Kasaï (Congo). 
Chapelle de l’hôpital de Luluabourg (Scheut) Le P. Cambier vouera une
admiration sans bornes aux religieuses belges qui consacrèrent leur vie à
soigner les malades souffrant de cette terrible maladie. Voilà ce qu’il raconta
à propos d’une d’entre elles. « En 1908, m'étant rendu en visite à, la Mission de Saint-Trudon, près
de Lusambo, le docteur du Poste m'avait dit que la Sœur qui soignait les
malades atteints de la maladie du sommeil, étant malade elle-même, devait
rentrer en Belgique. Le lendemain matin, je me promenais dans une des allées de
la Mission, lorsqu'arrive cette Sœur qui se met à genoux devant moi. Je n'emploie point d’'hyperbole ou
figure de rhétorique quelconque : Cette sœur se met à genoux devant moi. - Mon Père, me
dit-elle, le docteur vous a dit que je dois rentrer en Belgique mais je vous en
supplie, n’en faites rien. Laisser moi mourir près de mes Noirs ... Et la pauvre se mit à pleurer, si
bien que (Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ?) je n'eus pas la force d’exiger
son départ... Quelques mois après, elle mourut, près de ses malades. Quel est
son nom ? Je l’ai oublié. Où est sa tombe ? Je ne le sais plus. Et cela aussi, Messieurs, c'est de la folie,
comme la folie de votre héroïsme. C'est de la folie, mais c'est la folie de la
Croix, la folie de la Charité. Depuis lors, je n 'ai plus jamais rencontré une
Sœur sans la saluer bien bas et sans que ce souvenir me revienne à la tête et
au cœur. » (Discours prononcé par le P. Cambier au monument du cinquantenaire,
le 24 juin 1928) 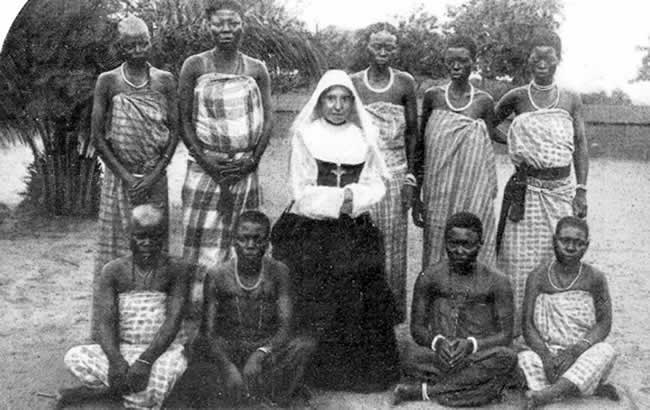
Sœur de la charité à Luluabourg 
Groupe de Sœurs de Luluabourg Honneurs et disgrâces pour le Père Cambier Le 30 septembre 1910, il
reçoit un coup de fusil de chasse dans le mollet droit en pénétrant dans le
magasin. Quelques semaines auparavant, des voleurs s’étaient introduits dans le
magasin et pour les prendre on avait installé un piège à l’entrée. Une corde
tendue devait faire tomber le chien d’un fusil de chasse chargé d’une cartouche
« double zéro ». Tout le monde croyait le P. Cambier était au
courant mais ce n’était pas le cas ! On retire du mollet du Père 14 plomb
mais à peu près 40 restèrent dans la jambe. 
P. Bracq – R. P. Cambier – P. Vandermolen Le 27 août 1911 ;
Luluabourg est en fête : le Préfet apostolique vient inaugurer la nouvelle
église. Le 20 novembre 1912, les 25 ans de prêtrise du missionnaire sont fêtés.
Le Père Cambier, cependant, de par le succès de son œuvre, de par son
indépendance, de par son originalité, attire bien sûr la jalousie. Il a construit
de sa main la première maison en briques de Luluabourg et l’habite. Il distillait
de l’alcool et alla jusqu’à essayer de former une milice armée dans sa Mission
pour prévenir toute nouvelle incursion. Cambier possède aussi, de par son
ancienneté inégalée au Kasaï, une grosse collection de dossiers sur les
errements de nombre d’agents. C’est ainsi qu’on relève qu’en 1904, il fait une
déposition devant l’agent de l’Etat Decock et porte plainte contre de nombreux
abus de l’Etat, en y incluant le meurtre récent de prisonnier par deux soldats.
Les cadavres ayant été abandonnés sur la route et les soldats assurés de l’impunité
pour les meurtres, vols, abus divers commis dans les villages. Sa personnalité
hors du commun lui vaut une terrible campagne de dénigrement dont le comble fut les bruits qu’on fit courir sur Niemba
Johanna, première chrétienne de la Mission, qui fut le bras droit du père
Cambier et gérait les achats de la mission. Des bruits accusaient, en 1911-1912,
le missionnaire d’avoir eu un enfant de cette femme et de lui avoir ordonné
l’infanticide. Une instruction fut menée par le Procureur du Roi, un nommé Munck,
de nationalité norvégienne mais elle déboucha en 1913 sur un non-lieu, les
cheminements de la rumeur accusatrice, ayant été minutieusement reconstitués.
Tout cela, rappelons-le dans un contexte bien particuliers d’une Belgique où
libéraux et socialistes mènent la guerre contre le parti catholique en
s’attaquant notamment aux Missions du Congo. On accusait aussi les missions de
monopoliser l’enseignement. En 1909, le leader socialiste Emile
Vandervelde lançait sa première attaque
contre les missions sur ce thème en estimant qu’au Congo, l’enseignement devait
devenir un service public. Vandervelde se présente ainsi comme le
porte-étendard de l’offensive contre les missionnaires catholiques. Comme dans
les fermes-chapelles tenues par les Jésuites, on accusait la Mission de
Luluabourg de garder trop longtemps sous tutelle les jeunes adultes qui avaient
été libérés des esclavagistes ou qui y avaient séjournés comme orphelins. Il
est vrai que Cambier ne ménagea pas des efforts pour obtenir de Bruxelles la
prolongation au-delà de 25 ans de la limite d’âge de tutelle reconnue par
l’Etat indépendant en 1894. Ses efforts furent vains. On reprochait aussi au Père
Cambier ses relations avec la société C.K. (Compagnie du Kasaï) qui depuis
1902, récoltait dans cette région le
caoutchouc. Au début des années 1910, Cambier affrétait de nombreux jeunes gens
de sa Mission comme porteurs pour le compte de cette société. Le bénéfice
financier atterrissait sur un compte de la congrégation à Scheut mais
le Père Cambier n’avait pas la
liberté d’en disposer comme il le
voulait pour sa Mission. Il chercha un
arbitrage à Rome, ce qui ne lui valut pas la bonne grâce de ses supérieurs à
Scheut. Le Père Cambier pouvait se vanter avoir créé la plus grande mission des
deux Congo (belge et français) et sans doute de l’Angola, mais il rencontrait
aussi, à cause de ce succès, l’immense challenge de devoir assurer le financement de son œuvre. Sans
doute voulut-il le faire avec les moyens qui s’offraient à lui et qui au fil du
temps devinrent contestables. Le P. Cambier, Préfet
apostolique du Haut-Kasaï suscita de plus en plus de polémiques, ce qui conduisit
finalement sa hiérarchie à l’éloigner de la colonie. Un poste est trouvé pour
lui à Rome. Emeri est obligé de quitter sa chère Mission en 1913 pour Rome où
il remplit la fonction de « Consulteur de la Congrégation de la
Propagande ». Renvoyé en Belgique et prisonnier trois
ans en Allemagne Au début de la guerre 14-18,
n’ayant pu obtenir son renvoi en Afrique, le revoilà en Belgique. On le nomme
curé à Roselies, près de Châtelet, pour remplacer l’abbé Joseph Pollart, fusillé
par les Allemands, le 23 août 1914. Quelques mots sur l’histoire de ce martyr :
à Flobecq, une rue porte son nom et un vitrail de l’église Saint-Luc évoque le
sacrifice qui fut celui de l’abbé Joseph Pollart en août 1914. Lorsqu’éclata le
premier conflit mondial, alors que les Allemands avaient pris en otage
plusieurs de ses paroissiens, l’abbé Pollart sauva la vie de deux jeunes pères
de famille en insistant pour être fusillé à leur place ! 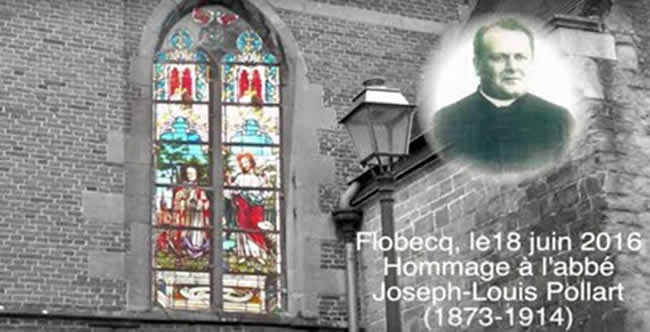
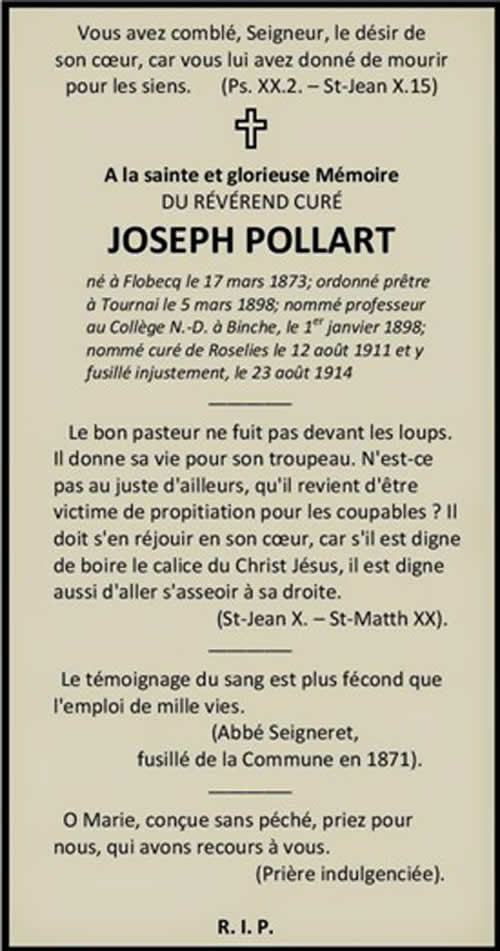
Le grand lutteur qu’est
Emeri Cambier se signale vite par sa témérité et son franc-parler. Un sermon
vexant l’occupant et voici l’ancien Préfet Apostolique dans les geôles
teutonnes. Après un an d’emprisonnement dans la caserne Trézignies à Charleroi,
on le transfert en Allemagne où il connut les bagnes d’Anrath (Crefeld) et
d’Hozminden. Ses derniers mois de détention sont cependant adoucis puisqu’il
est autorisé à les passer dans la communauté des moins de Buren. Il n’empêche,
il demeura prisonnier du 4 juin 1915 au 18 novembre 1918. Les témoignages du
Père Cambier sur ces années d’emprisonnement ne sont hélas pas connus, de même
la teneur du sermon prononcé à Roselies. Mais Cambier, il est certain, n’est
pas un homme qui gémit sur son sort. L’humour l’aida certainement et il en
possédait beaucoup comme le montre cette
anecdote : un dentiste lui avait arraché toutes ses dents et lui avait
placé un dentier complet sans accepter d’honoraires. Le P. Cambier lui envoya deux défenses
d’éléphant montées en porte-bouquet avec ce mot : Je rends toujours œil
pour œil, dent pour dent ! » Une vie d’ermite comme chapelain de
la Croix-Monet (Aische-en- Refail) pendant 18 ans 
L’ermitage accolé à la chapelle de la Croix-Monet. Février 2020. On y vénérait une Vierge miraculeuse sous le vocable de « Notre-Dame des Affligés ». Cette Vierge était invoquée pour la guérison de la fièvre lente. Malheureusement, la statue fut volée dans les années 1970. 
Qui se souciera du clocheton de la chapelle de Croix-Monet qui menace de s’effondrer ? (Février 2021) De retour en Belgique, il
habite d’abord chez son frère prêtre à Châtelineau, puis à Mellet où il fait
office de curé tout en créant une liqueur « La Flobecquoise » qu’il dénomme
« Cordial-Congo-Cambier ».
Entre 1925 et 1943, il se retire dans la chapellenie
namuroise de la Croix-Monet. 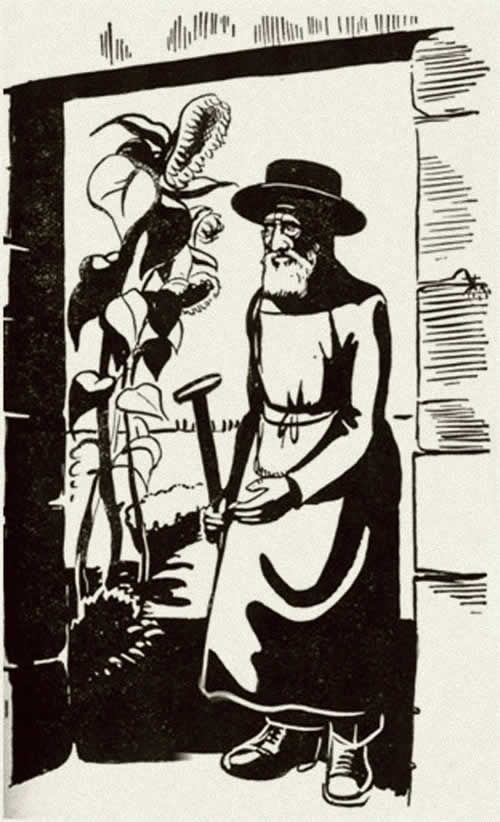
Le 21 novembre, sa paroisse
d’adoption fête ses cinquante ans de prêtrise. Le 10 juillet 1938, on fêta le cinquantenaire
du départ du P. Cambier pour l’Afrique dans la cathédrale de Namur. La
cérémonie se poursuit sur la place d’Armes où défile la musique du 13e
de ligne, des troupes suivies d’un détachement de l’école des cadets et de
nombreux écoliers des écoles de Namur. Le P. Cambier va ensuite fleurir la
statue du Roi-colonial. La cérémonie est suivie d’un banquet. Agrémenté des discours
des autorités et le P. Cambier termine par ses mots en hommage à tous ceux qui
sont morts pour le Congo : « Il n’y a pas au monde de missions
comparables à celles du Congo. Notre Colonie, ce bijou, à côté de ces richesses
spirituelles, œuvre de la charité, en renferme d’autres, trop peu connues et
appréciées. Ce Congo, nous le garderons : il est à nous, car le cœur des
indigènes est à nous. Nous le défendrons s'il le faut. Mais nous le garderons.
Que tous, croyants ou incroyants, aient ce soir une pensée et une prière pour
ceux qui sont morts pour lui. » Les convives font une
ovation interminable au Père Cambier, dont le propos a révélé, une fois de
plus, l'âme ardente, apostolique, vibrante, apparaissant sous la truculente
bonhomie. Et le banquet s'achève, joyeux et fraternel. 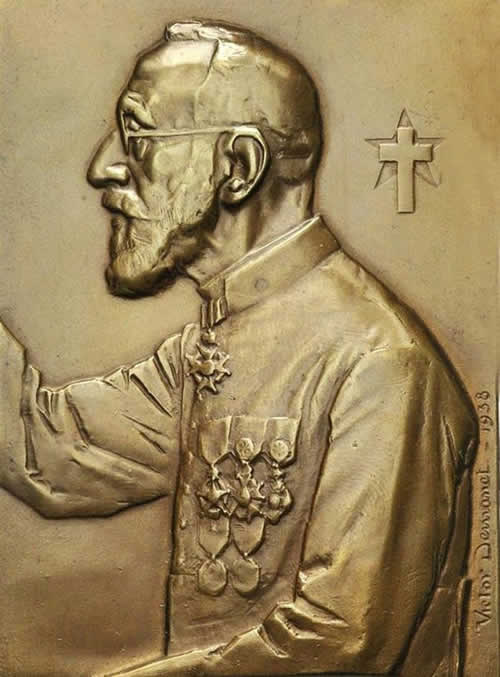
Plaquette en l’honneur du Père Cambier (recto) 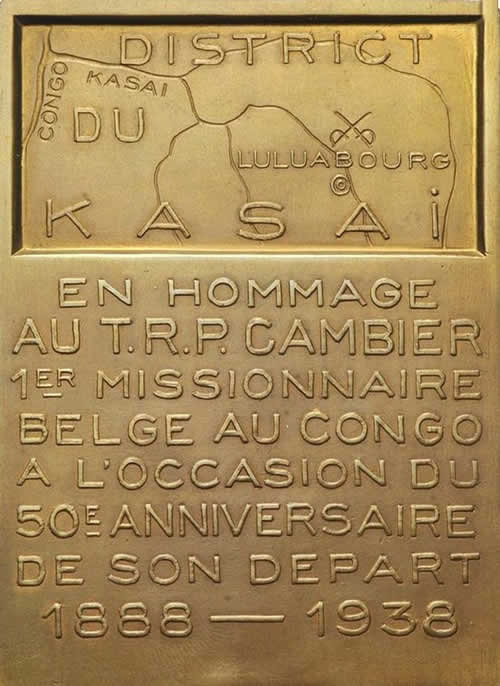
Plaquette en l’honneur du Père Cambier (verso) Le Père Cambier se disait
fier d’être à Croix-Monet le gardien du sanctuaire où l’on vénère une vierge
miraculeuse (malheureusement volée vers les années 1970). Il accordait beaucoup
de conseils aux nombreuses personnes qui venaient lui rendre visite. Léopold
III, lui-même, l’honora de plusieurs visites princières avant de monter sur le
trône. A tous ceux qui l’approchaient, le P. Cambier montra bonhomie, bonté,
humilité. Le 29 septembre 1943, il
décéda à l’hôpital Sainte-Elisabeth de Salzinnes. Conclusion 
Le Père Butaye, Jésuite dans une mission du Kwango 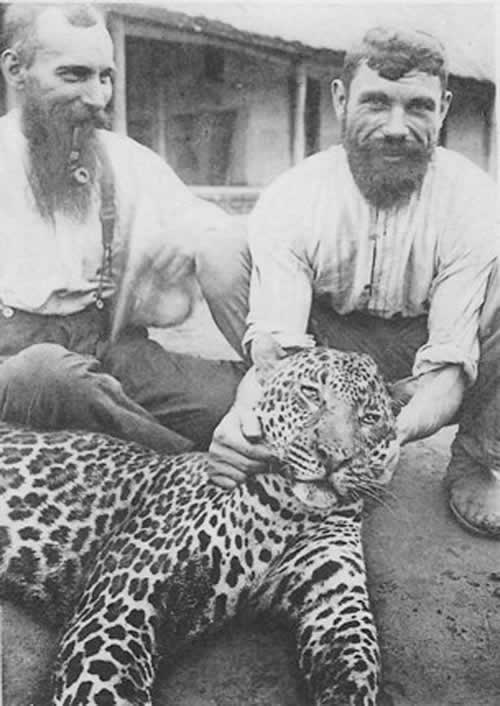
Doucement mon ami ! 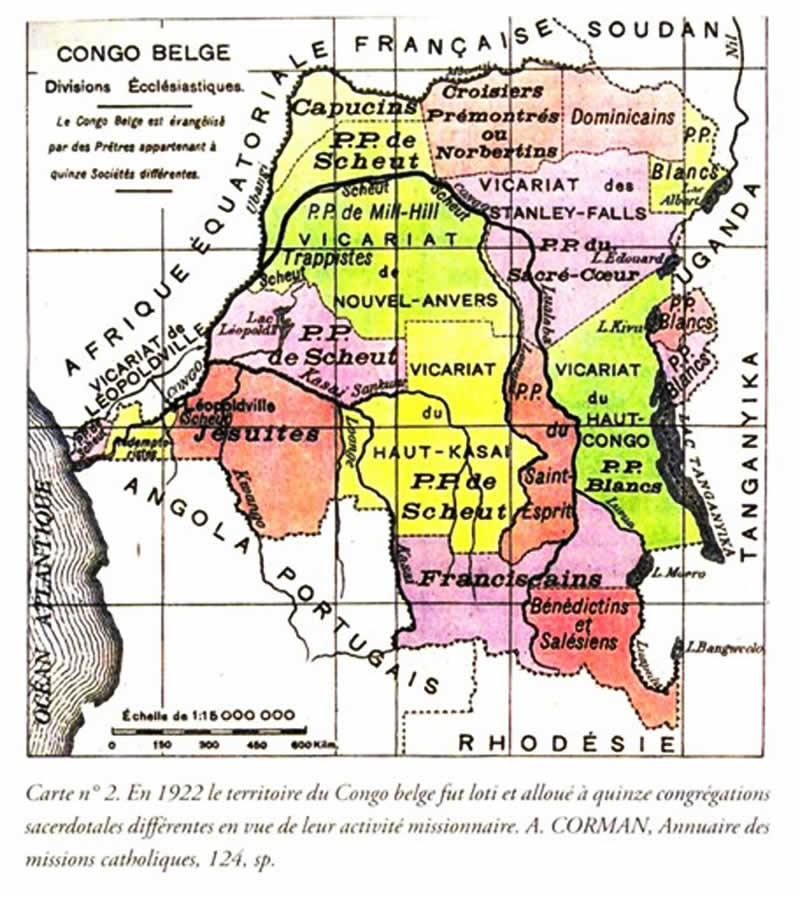
Quel homme fut vraiment le
Père Cambier ? Certainement un homme d’une trempe et d’une énergie peu
courante. Mais, au-delà de sa réputation justifiée de pionnier, je ne peux
m’empêcher de voir aussi dans cet homme indépendant et fier un missionnaire qui
consentit librement à de multiples sacrifices : la volonté de ne jamais se
plaindre, de ne jamais dénigrer ses
supérieurs, de leur avoir toujours obéi malgré le refus de ses demandes et cela,
quoi qu’il lui en coûta et,… il lui en
coûta beaucoup, lui qu’on surnommait, « le Roi du Kasaï » ! Puissions-nous à travers le souvenir du
Père Cambier honorer les nombreux missionnaires et religieuses qui reposent
pour l’éternité en terre congolaise. Puissions-nous aussi garder des liens puissants et fraternels
avec nos frères Congolais. Dr P. Loodts Iconographie : les dessins figurant dans cet article sont l’œuvre
d’A. de Vinck et figurent dans le livre d’Albert Mariaule, Le Père cambier,
Editions Grands Lacs, Namur Sources 1 - « Le Père Cambier », Albert Mariaule, Editions Grands Lacs Namur, 1948 2 - « Dans la brousse congolaise, les origines des missions de Scheut au Congo », R.P. Leon Dieu, Editions Maréchal, Liège, 1946 3 - Note sur
la démission en 1914 d’Emeri Cambier Préfet, Flavien NkayMalu dans la revue
« Histoires et missions chrétiennes s » Karthala, 2008/4 N°8. Voir 4 - « Emeri Cambier (1865-1943) fondateur de la mission du Kasai : la production d'un missionnaire de légende » In : Images de l’Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour : actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles, Textyles-éditions, Kinshasa, Ed. du trottoir, p. 39-74, Jean-Luc VELLUT. 5 - Le lecteur intéressé trouvera sur le site suivant un magnifique reportage d’une religieuse de la Charité racontant son voyage jusque Luluabourg en détaillant la vie des missions des sœurs de la charité de Gand. Ce reportage sous forme de lettres porte comme titre : Voyage au Congo ; lettres d'une sœur de Charité de Gand par une Sœur de Charité de Gand, publié en 1905. TRADUCTION et COMMENTAIRES Par
Monsieur Urbanus De Clerck (Oudenaarde) 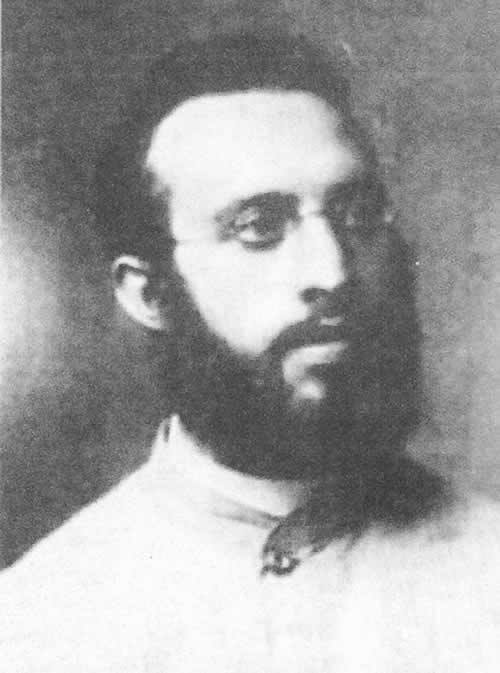
De jonge pater Cambier Emeri. De inhoudstafel. 01. De stichter van de Scheutisten. 02. De Elenchus defunctorum. 03. Flobecq op de grens met Vlaanderen. 04. Afrika in de 20ste eeuw. 05. Afrika in de 21ste eeuw. 06. De jeugdjaren van pater Cambier. 07. De intrede bij de Scheutisten. 08. Koning Leopold II. 09. De Vrijstaat. 10. Een vlugge schets. 11. De eerste zending. 12. De zeereis. 13. De karavaanroute. 14. De karavaandragers. 15. Berghe-Ste-Marie. 16. Ontsnapt aan de dood. 17. De stichting van Nieuw-Antwerpen. 18..Het leven in Nieuw-Antwerpen. 19. De stichting van Moanda. 20. De Zusters van Moanda. 21. De stichting van Luluabourg. 22. Het leven in de missiepost. 23. De eenzaamheid. 24. Het handschrift van pater Cambier. 25. De Aigemene Overste. 26. Een onderonsje met pater De Deken 27. Donkere foto's uit "Twee jaren in Kongoland". 28. Een intermezzo over Broeder De Jaeger. 29. ln luttele woorden: Een held uit Balgerhoeke. 30. Het graf van Broeder De Jaeger. 31. Drie foto's van Broeder De Jaeger; 32. Zuster Remacla - Nathalie De Jaeger. 33. Een land met wilde mensen. 34. Twee Afrikaanse grootouders. 35. Twee Afrikaanse nichtjes. 36. Nog twee mooie foto's .. 37. Twee missionarissen uit de tijd van pater Gambier .. 38. Het vertrek van de Aigemene Overste. 39. Het medisch onderzoek. 40. Ngangabuka, de medicijnman. 41. Het oproer. 42. Houd u koest. 43. De aanval. 44. De doodskist. 45. Het tovergeweer. 46. Monseigneur. 47. De Katanga-missie. 48. Jean Dehoust, de grootoom. 49. De pionier in de strijd tegen de slaapziekte. 50. De oproep van pater Gambier. 51. Pater Gambier en een zieke Zuster. 52. De Gongregatie van de Zusters van liefde. 53. De stichter van de Zusters van Liefde. 54. Nog een paar foto's 55. Een
droevig ongeval. 56. De drie
flinke missionarissen. 57. De
inhuldiging van de tweetorenkerk. 58. 25-jaar
priester. 59. Met een
vrouw in bed. 60. Een raar
beestje. 61. De definitieve
terugkeer. 62. De kracht
van verandering. 63. Pastoor
in Roselies. 64. Priester
Pollart. 65. ln de
Duitse gevangenis. 66. Op
vakantie bij zijn broer. 67. Pastoor
in Millet. 68. De
kluizenaar. 69. 50-jaar
priester. 70. 50-jaar
eerder. 71. De dood. 72. Het
slotwoord. 73. De
kerkelijke indeling. 74. Een
vergadering op hoog niveau. 75. Bronnen. 76. Nota's. 77. De
schrijver. 78. De
vertaler. 79. De
Spakke. 01. De stichter van de Scheutisten. 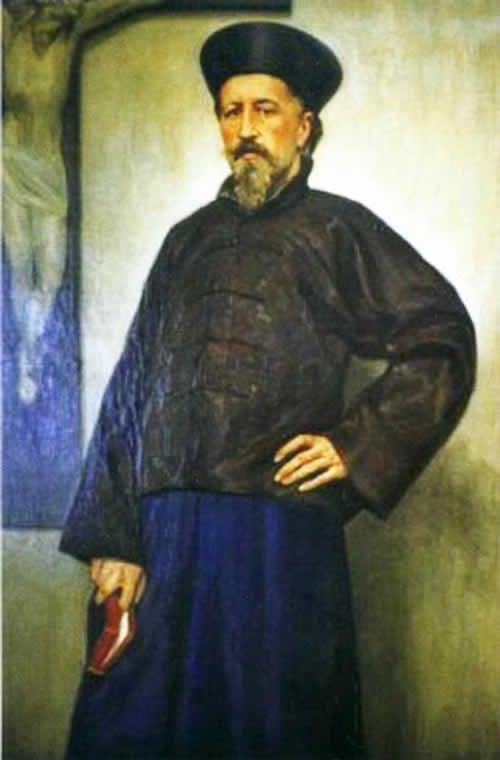
Pater Verbist Theophiel (1823 - 1868). Priester Verbist stichtte in 1862 de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. In het Latijn : Congregatio
Immaculati Cordis Mariae. In afkorting: C.I.C.M. Het moederhuis bevindt zich in
Scheut, een wijk van Anderlecht. Naar de naam van die wijk worden de leden van
de Congregatie Scheutisten genoemd. Pater
Verbist Theophiel, hij is geboren in Antwerpen op 12-06-1823, hij is tot
priester gewijd in 1847, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1864, hij is
vertrokken naar China op 25-08-1865, hij is gestorven in China op 23-02-1868 in
de ouderdom van 44 jaar. 02. De elenchus decfunctorum. In de lijst van de
overledenen van de Congregatie van Scheut wordt pater Cambier als volgt
vermeld : Pater
Cambier Emeri, hij is geboren in Flobecq op 02-01-1865, hij werd tot
priester gewijd in 1887, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1888, hij is voor
de eerste keer vertrokken naar Congo op 25-08-1888, hij is gestorven in Namen
op 29-09-1943 in de ouderdom van 78 jaar. 03. Flobecq, op de grens met Vlaanderen. 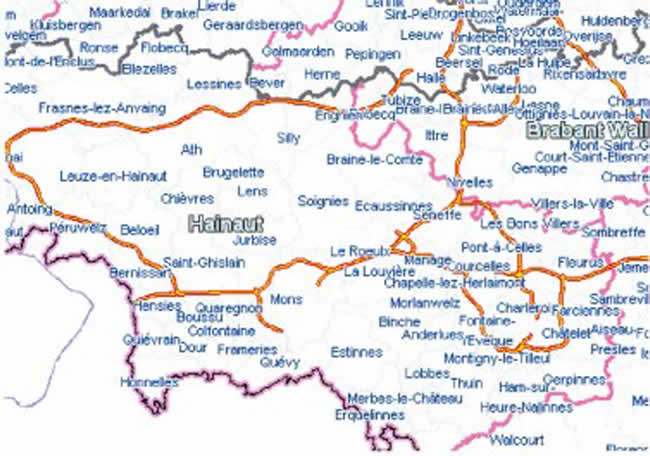

Flobecq, een dorp verloren in het groen. 04. Afrika in de 20ste eeuw. 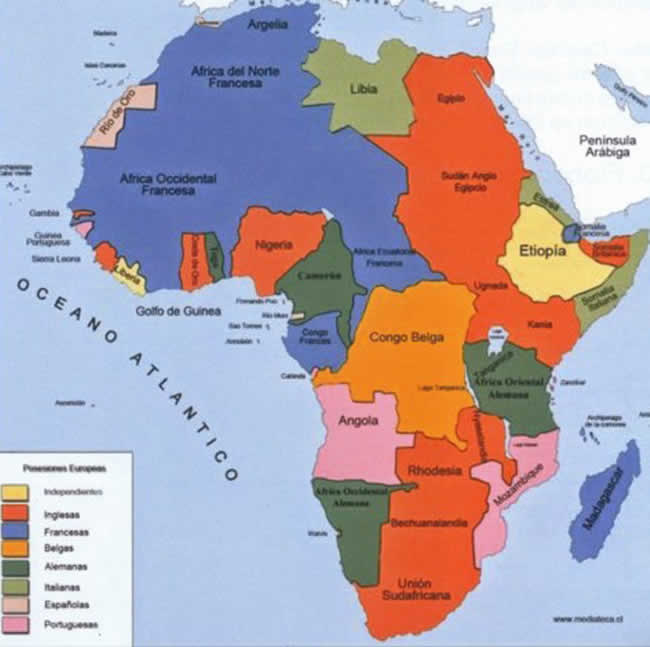
In de 19de eeuw waren enkele
landen ais Liberia en Ethiopië onafhankelijk maar het grootste aantal van de
landen waren een kolonie van een of ander Europees land, België, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Spanje. 05. Afrika in de 21ste eeuw. 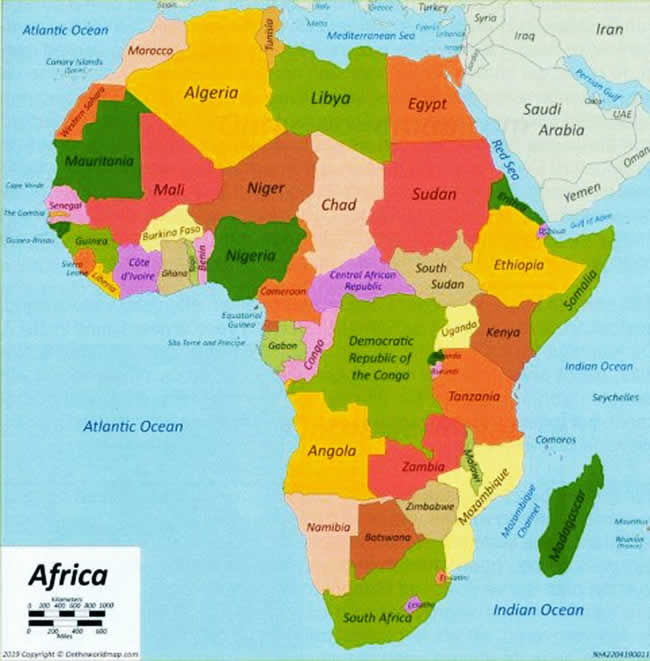
De onafhankelijkheid van Afrika begon traagjes. Zuid-Afrika werd onafhankelijk in 1910, Egypte in 1922, Ethiopië in 1941. Vanaf de jaren 1950 en vooral vanaf de jaren 1960 werden de meeste landen onafhankelijk. Mozambique en Angola werden ais laatsten van de rij onafhankelijk in 1975. 06. De jeugd van pater Cambier. Emeri Cambier, de zoon van een
kroostrijk gezin, was intern op het college van Enghien, inHenegouwen. Hij liet
zich opmerken door zijn sterke, onafhankelijke aard. Hij aarzelde niet zwakke
medeleerlingen te verdedigen. In de refter gaf hij een ferme kaakslag aan de
tafelmeester die weigerde om een jongere metgezel te bedienen. Emeri kreeg voor
zijn kaakslag een schrijfstraf van vele bladzijden. De jongen die door Emeri
was verdedigd probeerde het handschrift van Emeri na te volgen en hijzelf
schreef de strafbladen. De list werd ontdekt en Emeri werd bij de overste van het college geroepen. Emeri weigerde echter
de naam te zeggen van degene die zijn strafbladzijden had geschreven. De straf
was groot, gedurende een gehele trimester mocht hij niet deelnemen aan aile
ontspanningen die voorzien waren voor de leerlingen van het internaat. Eén van zijn leraren, meneer Gueluy, een
priester afkomstig van Anvaing, besloot om in te treden bij de Scheutisten en
hij vertrok naar China in 1877. De jeugdige Emeri Cambier, in zijn laatste jaar
van zijn middelbare studies, dacht eraan om ook missionaris te worden zoals
zijn leraar uit zijn jongere jaren. Hij had twijfels. Hij besloot tenslotte om
toch carrière te maken in het leger en les te volgen in de Hogere Militaire
School van Brussel. Hij wilde officier worden. Zijn grotere broer die pastoor was in
Châtelineau gaf hem de raad om deel te nemen aan een retraite van twee dagen.
Emeri aanvaardde het voorstel en tijdens deze korte retraite veranderde de
jonge kerel van zeventien jaar zijn plan, hij zou geen officier worden maar wei
missionaris zoals zijn leraar die naar het verre koude Mongolië was vertrokken
als missionaris. Hij zou vechten op de voorposten van de pauselijke troepen die
de wereld wilden veroveren, en als het moest zou hij het doen met in de ene
hand het kruis en in de andere hand het geweer. 07. De intrede bij de Scheutisten. Emeri Cambier zal binnentreden bij de
Congregatie van de Scheutisten. Hij zal zijn studies van wijsbegeerte doen aan
het Seminarie van de Bonne Espérance bij Bergen in Henegouwen. Na een studie
van vier jaren godgeleerdheid wordt hij tot priester gewijd in 1887. Hij was
amper 22 jaar oud. Na een jaar van noviciaat spreekt hij in 1888 zijn geloften
uit. Hij laat zijn baard groeien en hij bereidt zich voor om naar China te
vertrekken, daar waar de Scheutisten werkzaam zijn sinds vele jaren. Nochtans
zal dit niet gebeuren want voor de nog jonge Congregatie van Scheut opent zich een
andere wereld, in het hartje van het donkere Afrika, daar waar de wieg van de
mensheid staat. Pater Cambier Emeri vertrekt niet naar China maar wei naar
Congo. 08. Koning Leopold II. Leopold II (1835-1909), de alleenheerser
van een groot land in het midden van Afrika, heeft bekomen dat de Paters van
Scheut naar de Vrijstaat worden gestuurd om hem te helpen in het christenen van
zijn jong en onmetelijk groot land. Leopold" heerst over een land van
2.345.410 vierkante kilometers groot. In België is hij koning van een land van
30.528 kilometers groot. Die staat wordt de Vrijstaat genoemd want volgens de
Conferentie van Berlijn, een conferentie van vijftien landen die gehouden werd
van 14 november 1884 tot 26 februari 1885, hebben aile land en van over de
ganse wereld er toegang toe om er vrij handel de bedrijven. 
Leopold Il, de koning van België en de koning van de Onafhankelijke Staat van Congo 09. De Vrijstaat. 
De Vrijstaat is immens groot, van Schotland tot in Sicilië, van Portugal tot in Zweden, van de zee tot in Polen. 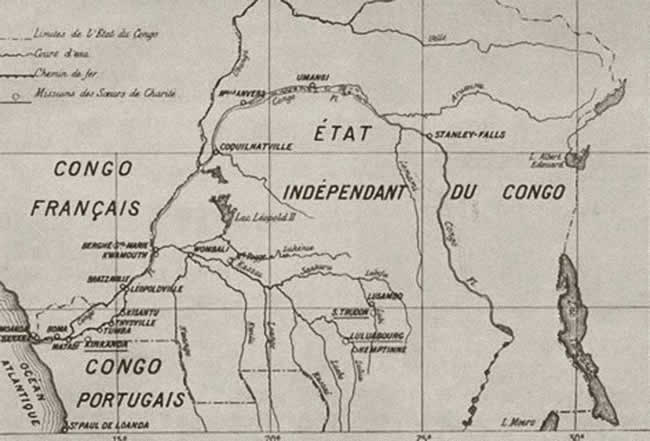
De Vrijstaat is een land met vele rivieren. 10. Een vlugge schets. 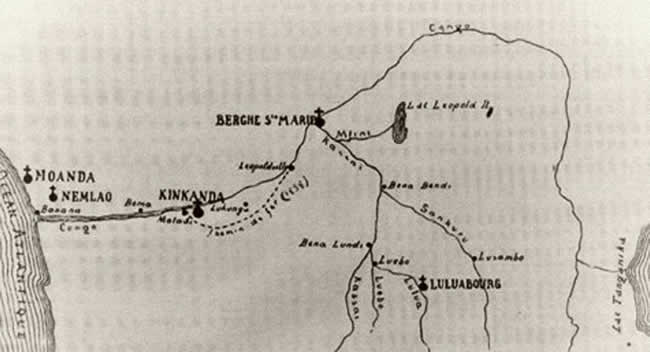
De vijf missies van de Zusters van Liefde van Gent : Moanda, Nemlao, Kinkanda, Berghe Ste Marie en Luluabourg St Joseph.. 11. De eerste zending van de Scheutisten. De vier eerste Scheutisten schepen in op
26 augustus 1888 in Antwerpen, richting Congo. Ze hebben allen iets gemeen met
het college van Enghien, ze waren er leraar of ze waren er student. Het waren
pater Huberlant, pater De Backer, pater Gueluy en pater Cambier. Het zijn ook
allen Walen. Ik vind ze zonder enige moeite terug in de
Elenchus defunctorum van de Congregatie van de Scheutisten. Pater
Huberlant Ferdinand, hij is geboren in Marchienne-au-Pont op 18- 12-1853,
hij werd tot priester gewijd in 1878, hij heeft zijn geloften uitgesproken in
1889, hij vertrok naar Congo op 25-08-1888, hij is gestorven in Scheut op
24-03-1893 in de ouderdom van 39 jaar. Pater
De Backer Albert, hij is geboren in Moustier-les-Frasnes op 06-12- 1851,
hij werd tot priester gewijd in 1878, hij heeft zijn geloften uitgesproken in
1889, hij vertrok naar Congo op 25-08-1988, hij is gestorven in Nieuw-Antwerpen
op 21-02-1892 in de ouderdom van 40 jaar. Pater
Gueluy Albert, hij is geboren in Anvaing op 23-04-1849, hij werd tot
priester gewijd in 1872, hij heeft zijn geloften uitgesproken in 1877, hij
vertrok naar China op 07-03-1877, hij stierf in Scheut op 22-12-1924 in de
ouderdom van 75 jaar. Pater
Cambier Emeri, zie hoofdstuk 02. De Elenchus
defunctorum. 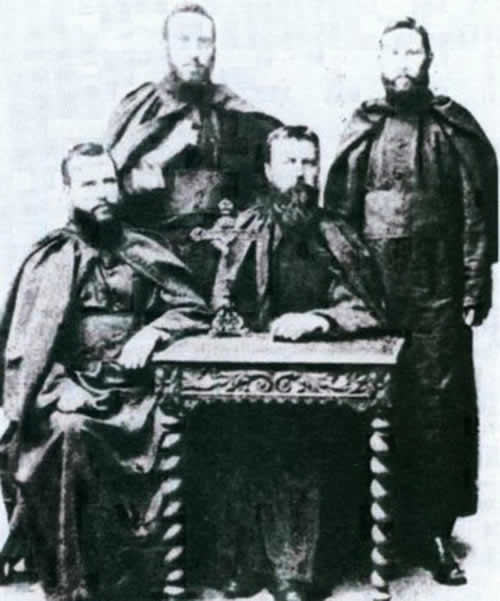
De eerste zendelingen in vol ornaat bij de fotograaf : Zittend : van l. naar r. Pater Huberlant Ferdinand en Pater Gueluy Albert. Staande : van 1.naar r. Pater Cambier Emeri en Pater De 8acker Albert. 12. De zeereis naar Congo. De vier missionarissen komen na een zeereis van meer dan één maand aan in Banana, een kleine haven die zich bevindt op de plaats waar de machtige Congostroom zijn bruin water tot veertig kilometers ver de zee instoot. Ze brengen een vluchtig bezoek aan Nemlao, een missiepost die behoort aan de Franse paters van de Heilige Geest. In een naburig dorp zien ze hoe de vele weduwen van koning Nemlao het lichaam van de overleden koning beroken zolang tot de nieuwe koning zijn intrede niet heef gedaan. Op 21 september 1888, komen de missionarissen aan in Boma, de hoofdstad van de Vrijstaat, de l'Etat Indépendant du Congo, waar Leopold II in 1885 tot soeverein van de Vrijstaat werd uitgeroepen. Ze vertrekken na enkele dagen naar Matadi, de eindstop van de boot want van daaraf tot in Leopoldstad is de stroom onbevaarbaar omwille van de vierentwintig watervallen. Ze stellen vast dat hun reisgoederen in Boma zijn achtergebleven en het is aan de jongste onder hen, aan pater Cambier, hij is nauwelijks drieëntwintig jaar oud, om omkeer te maken en met een kleine boot al hun bagage van Boma naar Matadi over te brengen. 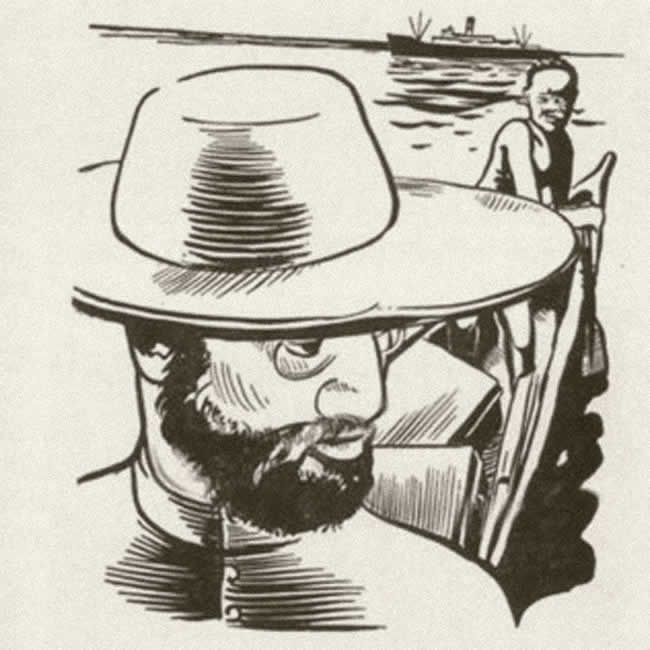
De jonge pater Cambier op de Congostroom met de bagage. 13. De karavaanroute. De eerste contacten met het leven in
Congo zijn niet gemakkelijk en de levensmiddelen zijn moeilijk te vinden. De
staatspost van Matadi bevindt zich op de rotsen van het Kristalgebergte. Bij
gebrek aan levensmiddelen wordt de verdere reis langs de karavaanweg naar
Leopoldstad uitgesteld tot op de 27ste oktober 1888 maar
het zijn enkel pater Cambier en pater Huberlant die de weg opgaan met een
twintigtal dragers. Pater Gueluy en pater De Backer blijven achter in Matadi
want ze zijn ziek. De befaamde karavaanweg over meer dan
350 kilometers, over bergen en dalen, doorheen drassige moerassen, over woelige
waterlopen, vergt zeer grote inspanningen en van de 81anken en van de zwarte
dragers. Pater Cambier krijgt een puisterige zweer juist boven de hiel en dat
belemmert hem om goed door te stappen. Met een prauw zetten ze een brede rivier
over en pater Huberlant wordt kletsnat want hij viel uit de gammele smalle
prauw in het ondiepe water. Eindelijk, na vierentwintig dagen stappen, komen ze
op achttiende november 1888 aan op de staatspost Leopoldstad waar de
Congostroom terug bevaarbaar wordt tot ver in het binnenland. De Congostroom is
de waterrijkste en na de Nijl de langste rivier van Afrika. Hij is 4.700 km
lang. Met zijn vele bijrivieren zal hij voor de blanken de voornaamste weg zijn
om het land te veroveren. Ook de missionarissen zullen langs de stroom en de zijrivieren
het land binnendringen De twee dappere missionarissen beginnen
spontaan samen het Te Deum te zingen om God te bedanken na zo een gevaarlijke
voetreis van meer dan drie weken. Ze hebben echter hun einddoel nog niet
bereikt. Dat einddoel ligt nog vier dagen verder, langs de linkeroever van de
Congostroom bij de samenvloeiing van de stroom met de Kasaïrivier. 14. De karavaandragers. 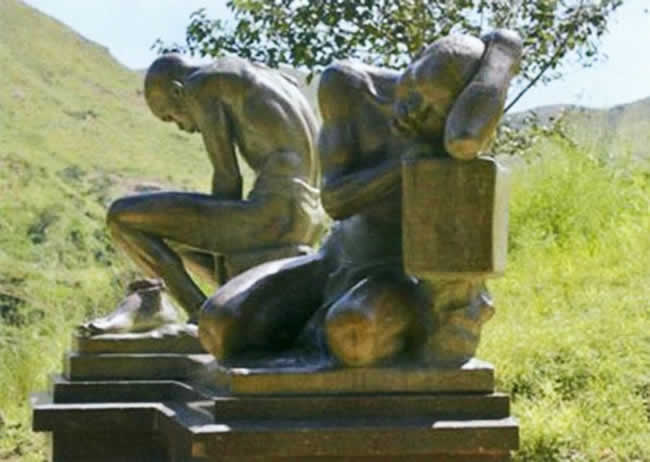
Bij het ingaan van Matadi, dichtbij de Mpozorivier en langs het spoor, staat een mooi bronzen momument ter ere van de karavaandragers. 
Dit is het oorspronkelijk monument zoals ik, De Clerck Urbaan, het zag in 1975. Onverlaten hebben het beeld van de staande man gestolen. 15. De stichting van Berghe-Ste-Marie. Na twee dagen van rust nemen ze een
staatsboot die hen op 24 november 1888 afzet aan de samenvloeiing van de
Congostroom en de Kasaïrivier en waar ze hun missionarisleven beginnen met de
inrichting van hun eerste missiepost. Hier hadden Franse missionarissen reeds
gewerkt. Sinds hun vertrek uit Antwerpen zijn de twee Belgische missionarissen
eindelijk na drie maanden op de plaats van hun bestemming gekomen. Ze noemen
hun eerste stichting Berghe-Sainte-Marie om daardoor een grote adelijke
weldoener te eren, Mgr Oswald van de Berghe, die pastoor was in Antwerpen. Hij
was geboren in 1834 en hij stierf in 1894. Op 10 januari 1889 komen pater
Gueluy en pater De Backer hun confraters vervoegen. De eerste
maanden van hun pionierstijd gaan vlug voorbij. Ze steken hun armen uit de
mouwen, ze bouwen voorlopige woningen in pisé, ze gaan naar de omliggende
dorpen om eten op te kopen. Op de markten kopen ze voor weinig geld jonge
slaven op die ze op de missie vestigen en die ook op de velden werken. Dit
zullen hun eerste christenen worden. Reeds
drie keren ben ik erop uitgetrokken naar de markten om kleine s/aven vrij te
kopen. Di t is echt een triestig gedoe. Laatst moest ik ondehandelen over de
prijs van een kleine jongen. De tranen kwamen me in de ogen toen ik dat klein
joch zag dat me met blinkende oogjes aankeek. Ik wist
dat dit klein joch een goede christen zou worden, maar de prijs was veel te
hoog. Dat was niet zodanig om de kleren die het kind aanhad want het was naakt
als een naakte poedel. (Uit een brief van 10 februari 1889 aan zijn broer). 
Zuster Marie-Hilda met weesmeisjes in Berghe Ste Marie. 16. Pater Cambier ontsnapt aan de dood. Soms gaan de paters op jacht. Dit is een
aangename bezigheid maar van de andere kant bracht de
jacht vlees op de tafel en eveneens aan al het jong volk dat op de missiepost
verblijft. In een andere brief aan zijn familie schrijft pater Cambier hoe hij
ternauwernood aan de dood was ontsnapt. We
zaten te eten aan tafel, het was op de avond van 20
februari 1889, het was reeds donker en de petroleumlamp was ontstoken. Plots
komt onze kleine hond in paniek uit de kamer van pater De Backer naar de eetkamer gelopen, hij keert zich om en loopt terug naar
de kamer van pater De Backer. Ik ben benieuwd, ik neem de lamp in de hand, ik
volg de hond en ik zie hoe hij zich woedend opstelt tegenover een slang van een
meterenhalf, Pater Gueluy neemt ondertussen een geweer, hij laat er een
cartouche inglijden, hij schiet, en pardoes ernaast. De slang is verdwenen in
mijn eigen kamer tussen de vele pakken en al het gerief dat er zich bevindt. Na
veel zoeken vinden we de slang en met een sterke stok sla ik haar de ruggegraat
over en met de scherpe snee van een spade klief ik de kronkelende slang in
twee. We gaan verder met ons avondmaal. Maar op het horen van het geweerschot
zijn de Bangala naar ons huis toegelopen en in de duisternis heeft één onder
hen zijn voet tegen een steen gestoten, de nagel van zijn grote teen bloedt
verschrikkelijk. Ik ga vlug naar mijn kamer om er een windsel te nemen, ik buig
mij, ik strek mijn hand uit en vanachter de doos verschijnt een andere verraderlijke
slang, ze bijt in mijn hand en verdwijnt bliksemsnel. Een luide kreet ontsnapt
aan mijn keel en al zuigend op de beet loop ik naar onze gemeenschappelijke
kamer. Het gif heeft een wrange smaak en met weerzin smijt ik het van mij af
Een confrater helpt mij om met ammoniak de kleine wonde te ontsmetten. En dan
ga ik terug naar mijn kamer op zoek naar die vermetele slang. Ik vind ze en met
de snee van een spade verpletter ik haar valse kop. Mijn ingepakte hand begint
fichtjes op te zwellen, mijn hart begint sneller te kloppen en min of meer
verdoofd leg ik me neer op mijn bed waar ik in een diepe slaap val. De volgende
morgen zijn aile verschijnselen van vergiftiging verdwenen en rustig kan ik de
heilige mis doen in grote dank voor de bescherming van de Allerhoogste en van
mijn hemelse moeder. Ceci s'est passé il y a une
quinzaine de jours. Chaque fois que cette histoire me revient, je ressens la
douce impuissance de retenir un « Ave Maria » sur mes lèvres pour remercier la
Ste Vierge de sa protection. Et vous tous qui m'aimez, si vous voulez me causer
un plaisir qui aille au cœur, remerciez Marie pour moi. Je vous embrasse de
tout cœur. Dit is gebeurd reeds voor een paar weken. Telkens aIs ik aan dit
gebeuren denk komt er in mij een onuitstaanbare neiging om te bidden, dan richt
ik mij tot de Heilige Maagd om ze te danken voor haar bescherming. En gij allen
die me fiefhebben, als ge wilt doet mij een genoegen om samen met mij Maria te
danken. Ik omhels u uit ganserharte. 17. De stichting van Nieuw-Antwerpen. In oktober van 1889 is pater Gueluy ver
de brede Congostroom opgevaren tot aan de Evenaar en hij heeft, dichtbij een
staatspost, een mooie plaats ontdekt aan de stroom om er een nieuwe missiepost
op te richten die Nieuw-Antwerpen zal genoemd worden om te verwijzen naar
Antwerpen aan de Scheldestroom. Onder Mobutu krijgt het de naam van Makanza. Op
6 december 1889 verlaten pater Cambier en pater Van Ronslé de missiepost van
Berghe Ste Marie aan de boord van de stoomboot van de Franse paters van
Brazzaville, de "Léon XIII", met als kapitein pater Augouard die
later de eerste bisschop zal worden van Frans Congo. Ze richten, vele
kilometers verder, halfweg Leopoldstad en de Falls, op de rechteroever van de
stroom, hun tweede missiepost op. Pater
Van Ronslé Kamiel, hij is geboren in Lovendegem op 18-09-1862, hij is tot
priester gewijd in 1886, hij legde zijn geloften in 1889, hij vertrok naar
Congo op 03-07-1889, hij stierf in Boma op 14-11-1938 in de ouderdom van 76
jaar. Hij werd tot bisschop in 1897. Pater Augouard Prosper, hij is geboren in Poitiers (Frankrijk) op 17-07-1852, hij trad toe tot de Congregatie van de paters van de Heilige Geest, hij vertrok naar Afrika, hij werd bisschop in 1890. Hij stierf op 03-10-1921 in het moederhuis van zijn Congregatie in de ouderdom van 69 jaar. 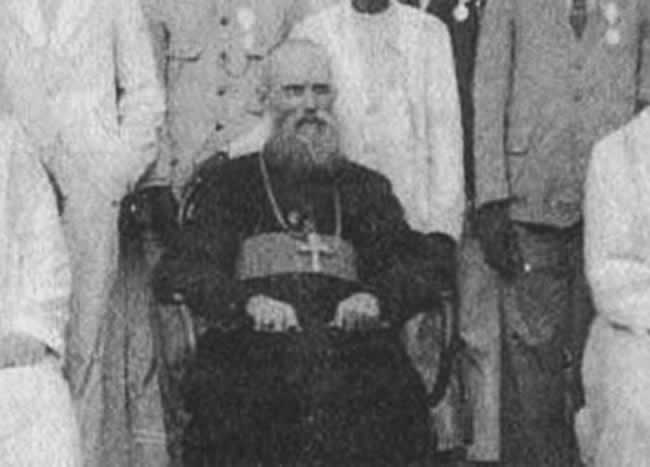
Mgr Van Ronslé Kamiel (1862-1938). 
Mgr Augouard Prosper Philippe (1852-1921). 18. Het leven in Nieuw-Antwerpen. De stoomboot zet de twee paters af op 20 december 1889 op de afgesproken plaats, bij de Bangala, zij die zich indertijd hevig hebben verzet tegen Stanley. Op 4 januari van 1890 is hun eerste voorlopige woning klaar en de missiepost Nieuw-Antwerpen bestaat met als overste pater Gambier. Ondertussen is pater Van Ronslé de stroom verder opgevaren tot aan de Falls, het toekomstige Stanleystad, met het doel de weeskinderen te bevrijden uit de handen van de slavenhandelaars en om ze naar Nieuw-Antwerpen over te brengen. Velen onder die kinderen stierven bij hun aankomst in de nieuwe missiepost. Naar het einde van de maand februari 1890 ontdekt pater Gambier dat de goederen bestemd voor zijn missiepost weerhouden zijn in de magazijnen van de mannen van de Staat. Veel houten kisten hebben geleden door de vochtigheid en enkele tonnetjes met miswijn werden geledigd door die mannen van de Staat. De paters hebben ook ontdekt dat de slaapziekte veel slachtoffers maakt onder de bevolking. Pater Gambier besluit om naar België te gaan en hulp te vragen voor twee plagen, de slavernij en de slaapziekte. Als het moet zal hij zich ook beklagen bij de koning over het gedrag van de staatsagenten. Hij verdedigt de thesis dat het beste middel om de slavernij te bestrijden het vermeerderen is van het aantal van de staatsposten van waaruit men het best kan optreden terwijl de slachtoffers worden ondergebracht op de missieposten. Pater Gambier wordt ontvangen door de koning. Deze laatste stuurde zijn orders naar zijn agenten in Gongo en hij verorderde dat de goederen van de missionarissen voorrang hadden op deze van de staatsagenten. De koning hielp eveneens in de financiering van de "Notre Dame du perpétuel secours", de rivierboot van de missionarissen. Tijdens zijn verblijf in België stond Pater Gambier zijn moeder bij in haar laatste levensstonden. Nota. In mijn boek "Een held uit Balgerhoeke" vertel ik hoe Broeder De Jaeger meehielp aan het bouwen van de boot "Notre Dame du perpétuel Secours"-"Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand" en hoe pater Van Ronslé heeft geprobeerd om de Broeder met deze boot te brengen naar Luluabourg tot bij pater Gambier die helemaal alleen was op zijn missiepost. Broeder De Jaeger Eduard, hij is geboren in Balgerhoeke op 13-01-1858, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1894, hij is vertrokken naar Gongo op 06-09-1894, hij is gestorven in Merode San Salvador op 21-10-1898 in de ouderdom van 40 jaar. 19. De stichting van Moanda. Pater Cambier keert terug naar Congo in juni 1891 met de opdracht een missiepost te stichten deze keer in Moanda niet zover van de haven van Banana. Op 13-01-1892 zullen de eerste Zusters van Liefde er zich vestigen. Hijzelf, na de opbouw van de missiepost in Moanda, keert terug naar Nieuw-Antwerpen. Pater Cambier, een zeer goede organisator, was uitermate actief bij het uitbouwen van de nieuwe missiepost met een kapel, met een huis voor de paters, met een huis voor de zusters, met een huis voor de weeskinderen. Tijdens het verloop van één jaar in Moanda doet hij drie keren de reis van Matadi naar Kinshasa, telkens een zware voetreis van drie weken. Men was echter reeds begonnen, in 1890, met het aanleggen van een spoorlijn die Matadi zou verbinden met Leopoldstad en dit over een afstand van 366 kilometers. De spoorlijn zal ingehuldigd worden ln 1898. Dan ontvangt hij van zijn oversten de opdracht om een missiepost te stichten in de Kasaï, dichtbij de staatspost van Luluabourg (de stad, de vestiging van de Lulua) 20. De Zusters van Liefde in Moanda. 
De missiepost van Moanda. 
De Zusters van Liefde in voile bedrijvigheid in Moanda 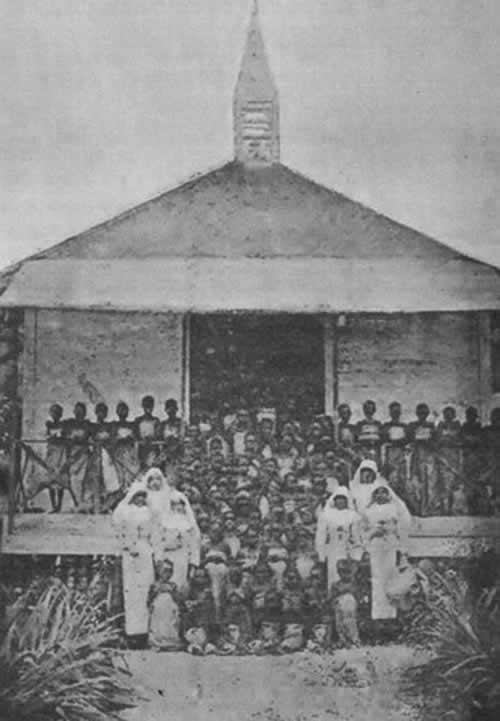
Het weeshuis van de Zusters van Liefde in Moanda 21. De stichting van Luluabourg-St-Joseph. Pater Gambier is vergezeld van pater De
Gryse. Beide missionarissen nemen plaats op een Franse boot, de "Ville de
Paris", die hen via de Kasaï-rivier en de Luluastroom naar de staatspost
van Luebo zal brengen. Pater
De Gryse Jan, geboren in Moeskroen op 27-03-1866, hij is tot priester
gewijd in 1891, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1889, hij is vertrokken
naar Gongo op 06-05-1891, hij is gestorven in Kuttekoven op 13-12-1925 in de
ouderdom van 59 jaar. Na twee dagen wordt pater De Gryse ernstig
ziek. De boot doet rechtsomkeer en brengt de zieke pater terug naar Berghe Ste
Marie. Pater Gambier is nu alleen om de reis verder te zetten en de boot brengt
hem op 5 november 1891 tot in Luebo. Hij zet de reis te voet verder tot in
Luluabourg waar hij aankomt op 14 november 1891. Hij bouwt zijn voorlopige
woning op de boord van een kleine rivier op enkele kilometers van de
staatspost. Pater De Gryse vervoegt hem na enkele weken maar het klimaat is te
zwaar voor hem en hij gaat naar de kust, naar Moanda, waar hij aalmoezenier
wordt bij de Zusters van Liefde die juist zijn aangekomen uit Europa. Nota
1. De ontdekkingsreiziger Hermann von Wissman (1853-1905) richtte zijn kamp
op aan de linkeroever, een kamp dat hij Malandji noemde. Het is de kapitein
Adolphe de Macar (1847-1918) die de staatspost verplaatste naar de overkant van de stroom. Luluabourg, gelegen langs de
spoorlijn Lubumbashi-Ilebo, zal de hoofdplaats van de regio worden. Het oude
Malandji bestaat nog steeds met het kleine kerkhof waar enkele blanken uit de
pionierstijd zijn begraven. In de jaren zestig van de vorige eeuw heb ik met
enkele leden van de Bouworde het kerkhof en de graven proper gemaakt. Nota
2. Luluabourg, op de rechteroever van de Lulua, werd in 1966 door Mobutu omgedoopt
tot Kananga, de stad van de liefde. De missiepost Luluabourg-St-Joseph,
gesticht in 1891, wordt ook Mikalayi genoemd. Het blijft een belangrijke
missiepost, er zijn lagere scholen, er zijn middelbare scholen, er is een
hospitaal en een kraamkliniek. 22. Het leven in Mikalayi. Pater Gambier is nauwelijks 26 jaar oud
als hij zich helemaal alleen bevindt in een onmetelijk groot gebied om de
mensen proberen te bekeren tot het christelijk geloof. Later, nadenkend over
deze verre tijd, toen hij gedurende een vol jaar alleen was op de nieuwe
missiepost, zegt hij, in het Frans natuurlijk : Il faut avoir 26 ans pour supporter cela ! Maintenant je ne pourrais
plus le faire ! Mais si, si mes Supérieurs me l'ordonnaient, je le ferais
encore. Ge
moet jong zijn om dat alles aan te nemen. Nu zou ik dat niet meer kunnen doe,
maar toch wei, moest mijn Oversten het me weer vragen, ik zou niet aarzelen. Alleen was hij, te midden van mensen waarvan een gedeelte vijandig stond tegenover hem, mensen die hem wilden doden. Op bezoek in een afgelegen dorp hoort hij, in het donkerte van de avond, hoe de dragers onder elkaar spraken. "Als de pater aan het slapen is zullen we hem doden." En hij vertelt later hoe hij die gehele nacht niet geslapen heeft, hoe hij vocht tegen de slaap en dit na een tocht van acht uren onder een blakende zon. Op het einde van de maand oktober 1892 woonden op de nieuwe missie 305 mensen die uit de slavernij waren bevrijd of vrij gekocht waren op de markten. Op drie uren marsafstand van Luluabourg had luitenant Doorne met een bataljon van 40 soldaten in een kamp van slavendrijvers 307 slaven bevrijd. De volwassen mannen werden in zijn leger opgenomen en de anderen, zieke mannen, vrouwen en kinderen werden overgegeven aan pater Cambier. Voigens de richtlijnen van de Vrijstaat mocht hij enkel de jongens onder de veertien jaar in de missiepost opnemen. Op deze wijze vermeerderde hij het aantal bewoners op zijn missiepost en zouden er stilaan christelijke families ontstaan en volledige christelijke dorpen. Dat was zijn droom. Twee maanden later maakte hij de bilan op van zijn missiepost, terug in het Frans natuurlijk. Une rue compte déjà 55 habitations et une autre en a 22, et 10 sont
groupées autour de ma case. Un grand hangar de 30 m. de long abrite nos
scieurs, charpentiers, menuisiers, tourneurs et forgerons. Nous n'avons que
quelques haches et machettes ; il faut bien former des forgerons pour fabriquer
ces outils avec de vieux canons de fusils rachetés aux indigènes. La petite
scie circulaire, le soufflet de forge, la meule, tout cela est mû par une
grande roue actionnée par une courroie fabriquée avec la peau d'un bœuf. J'ai
tanné moi-même cette peau avec l'écorce très astringente d'un arbre du pays. 23. De eenzaamheid. Pater Cambier is reeds gedurende vele maanden alleen en de eenzaamheid weegt hem zwaar. In een brief van 24 april 1892 schrijft hij : Et moi ? Resterai-je seul, seul à six semaines de tout confrère, seul à
fonder une Mission nouvelle, seul à nourrir, diriger et instruire des dizaines
de gens ? Certes non. Dieu sait ce qu'II fait, son œil me voit perdu au sein du
noir continent. Son amour veille sur moi, son bras me défendra. En ik ? Zal ik alleen blijven, helemaal alleen op zes weken afstand van elke confrater, om een nieuwe missiepost uit de grond te stampen, in mijn alleen om tientallen mensen eten te geven, te onderwijzen en te besturen ? Wei neen. De goede God weet wat ik doe, zijn alziend oog ziet mij daar ergens verloren in het zwarte continent, met liefde waakt hij over mij, en als het moet zal hij me verdedigen als ik in gevaar verkeer. Ik vertaal hier een gedeelte van een andere brief die dateert van 16 november 1892. Hij is nog altijd de vurige missionaris die zijn ziel uitspreekt aan zijn geliefden in zijn ver vaderland. Sinds de maand april ben ik alleen. Ik had onder mijn uitgemergelde mensen van toen 200 sterfgevallen. Nochtans heb ik nu, zes maanden later, terug meer dan 300 mensen die bevrljd zijn uit de slavernij of vrijgekocht. Ik ben hun vader, hun koning, hun burgemeester, hun rechter, hun dokter en hun verpleger, ik ben hun alles. Octave, mijn broer die dokter is, schrijft mij dat hij weinig tijd heeft om mij te schrijven maar onder zijn zieke mensen zijn er geen 200 die stierven in een tijdspanne van tien maanden ! Gedurende drie maanden reeds ben ik nooit naar bea gegaan voor middernacht, er zijn nachten dat ik moet opstaan tot drie, vier keren toe. Sinds ik toegekomen ben in Luluabourg slaap ik geheel aangekleed. Het is nu 10 u.30 terwijl ik aan het schrijven ben en ik denk dat ik verder ga met mijn geschrijf tot één uur in de nacht, dan kan ik nog vijf uren slapen en in de morgen begint aanstonds het werk. Tijdens de dag heb ik geen tijd om te schrijven, dat moet dus 's nachts gebeuren. Hoe is het mogelijk dat ik altijd in goede vorm ben, waarom ik nog steeds in leven ben ? Ik weet het niet. En als u het moest weten, ik ben toch zo eenzaam, zo alleen, ik ben toch zo blij als ik een brief ontvang uit Europa ! Mag ik u het vertellen ? Ge zoudt denken dat ik na een verblijf van vier jaren in Congo aile sensibiliteit ben verloren, ach neen, allezend een brief van bij u, dan ween ik als een kind zoals dat ook nu gebeurt, dat de tranen me al schrijvend in de ogen komen. Potverdikke, ik ben een man van zevenentwintig ! Ge moogt het wei zeggen, ja, ik ben reeds zeven maanden alleen. Ik ben hier aangekomen met weinige bezittingen. Ik leef ais een arme luis onder mensen die nog minder bezitten dan ikzelf. En ge ziet hoe ik aan het wenen ben. Grote jongen zeg ik tegen mezelf, ben ik hier niet ge komen om de wil van mijn goddelijke vader te vervullen ? Domme jongen dat ik ben, ik ga u allen die deze regels zullen lezen aan het janken zetten. 24. Het handschrift van pater Cambier. 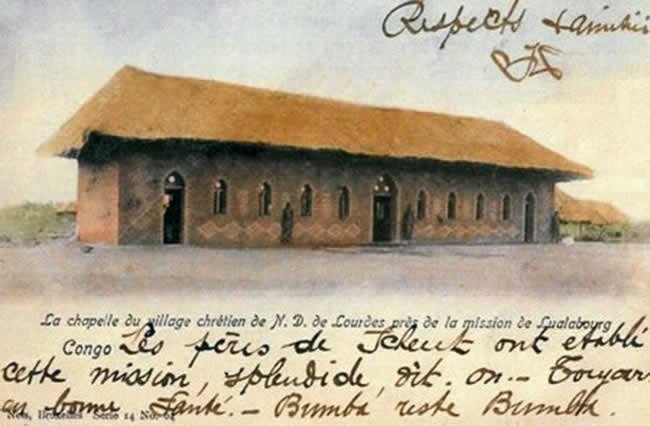
De kapel van het christelijk dorp N. D. de Lourdes van de missiepost van Luluabourg. Pater Cambier schrijft op de kaart: Respects et amitiés. P(ère) E(meri) C(ambier) (PEC). Les pères de Scheut ont établi cette mission, splendide, dit-on. - (Je suis) toujours en bonne santé. - Bumba reste Bumba. 25. De komst van de Aigemene
Overste. Het volgend jaar komt pater Van
Aertselaer Jeroom, de Aigemene Overste van zijn
Congregatie, hem in zijn eenzaamheid bezoeken. Zijn verblijf zal een gans jaar
duren. De pater werd Aigemene Overste van de Congregatie in 1888, en later, in
1898, zal hij tot bisschop gewijd worden. Maar nu zijn we nog in het jaar 1893.
De Generale Overste is vergezeld van pater De Deken Constant die onlangs is
teruggekeerd uit China. Pater
Van Aertselaer Jeroom, geboren in Hoogstraten op 01-11-1845, hij is tot
priester gewijd in 1870, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1873, hij is
vertrokken naar China op 24-03-1873, hij is gestorven in China op 12- 01-1924
in de ouderdom van 78 jaar. Pater
De Deken Constant, geboren in Wilrijk op 07-03-1852, hij is tot priester
gewijd in 1879, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1881, hij is vertrokken
naar China op 01-03-1881, hij is gestorven in Boma op 03-03-1896 in de ouderdom
van 43 jaar. Pater De Deken Constant was eerst
vertrokken naar China waar hij veel heeft gereisd. Over één van zijn reizen, een
reis die duurt van 12 september 1889 tot 23 oktober 1890, schreef hij een boek,
"Dwars door Azië". Nu, in 1893, vergezelt hij zijn Aigemene Overste
van Vlissingen tot in Luluabourg. Hij zal twee jaren in Congo verblijven en het
land doorkruisen. Hij heeft er ook een boek over geschreven, "Twee jaren
in Kongoland", met veel pittige details. Bij zijn eerste ontmoeting met de
zwarten geeft hij van die mensen een lelijke beschrijving die kwetsend kan
overkomen. Bij de zwarten zijn er mooie mensen en lelijke mensen. Bij de
blanken is dat juist hetzelfde. Men mag immers nooit iemand volgens het
uiterlijke beoordelen. Schoonheid zit dikwijls van binnen verborgen. Pater De Deken laat zijn Aigemene
Overste achter bij pater Cambier en hij keert terug naar Boma om enkele Zusters
van Liefde te begeleiden en ze veilig naar Luluabourg te brengen op de
missiepost van pater Cambier. 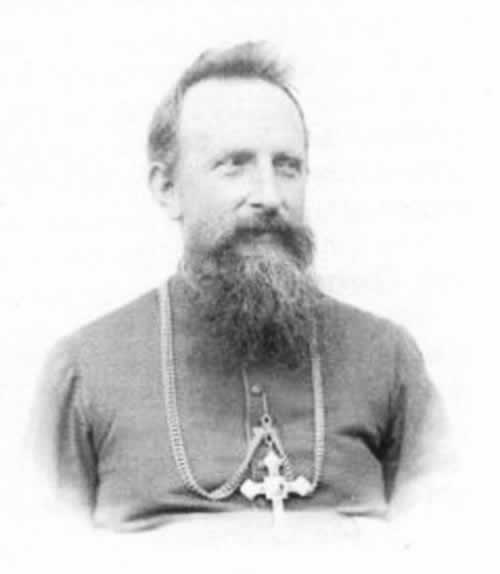
Bisschop van Aertselaer Jeroom (1845-1924). 
Pater De Deken Constant (1852-1896). 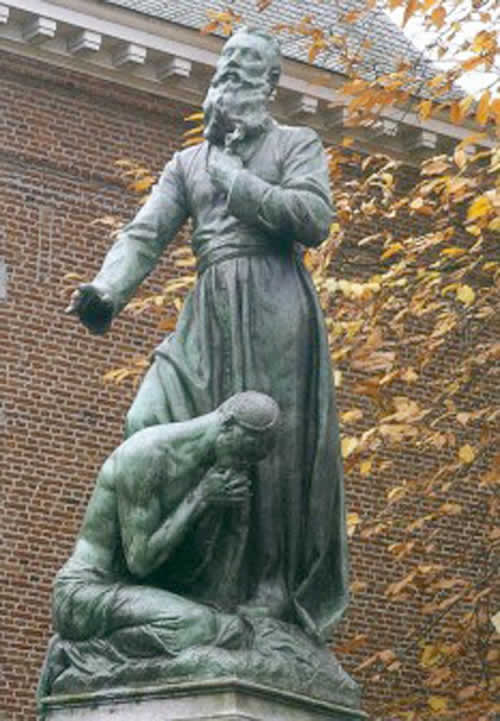
Het standbeeld van pater De Deken in Wilrijk. De blanke man strekt beschermend zijn hand uit over een zwarte nederige man. We zijn dus in Luluabourg St Jozef, in
het jaar 1893. Van 26 maart 1893 tot 27 februari 1894 blijft de Aigemene
Overste in Luluabourg St Jozef. Hij stelt vast hoe de missie is uitgegroeid. Er
zijn 530 catechumenen, geloofsleerlingen, er zijn twee christelijke parochies,
die van Sint Joseph, de andere van Lourdes Notre Dame. De totale oppervlakte
van de missie is 50 hectaren waarvan er zes zijn vol bebouwd, er zijn brede
wegen die afgelijnd zijn door bomen. In de rest van het domein liggen de
weelderige velden waar zijn mensen manioc en aardnoten kweken. Andere dorpen,
verafgelegen, vragen ook om de tegenwoordigheid van blanke paters maar Pater
Cambier is alleen om al het zwaar werk te doen en voorlopig gelooft hij niet
dat de heidense dorpen bereid zijn om zich te bekeren. 26. Een onderonsje met Pater De Deken. Hier volgen nu enkele uiUreksels van het
boek "Twee jaren in Kongoland" van pater De Deken Constant. 01.
Dit werk van de E.H. De Deken wordt in vier delen
verdeeld. 1) Van Antwerpen naar Banana. 2) Van Banana naar Luluabourg. 3) Van
Luluabourg naar de kust, heen en weer. 4) Van Luluabourg naar de watervalle. 02.
Men vindt onder hen niets anders dan apengezichten met dikvlezige lippen,
omgekruld en uitspringend als een snuit, benen met haar bedekt gelijk die van
een orang-oetang, armen zo lang dat de handen tot op de knieën hangen. 03.
Verder de stroom op, op de kust van de Onafhankelijke Staat, onderscheiden wij
de gebouwen van de Belgische zending van Moanda, thans de verblijfplaats van
pater Huberlant die er verblijft samen met vijf zusters die er verleden jaar
zijn aangekomen. Een weinig verderop ligt Nemlao, een andere missiepost die we
van Franse missionarissen hebben overgenomen. 04. De 13de juli begeven we
ons naar het ziekenhuis van Moanda waar we twee van onze confraters bezoeken,
de ene, pater Huberlant, geheel en al uitgeput van vermoeienis. Hij zal zo
haast mogelijk naar Europa moeten terugkeren. De andere confrater, pater De
Gryse, die ook veel geleden heeft van de reis die hij in gezelschap van pater
Cambier naar Luluabourg gedaan heeft, is aan de beterhand. De frisse zeelucht
van Moanda zal hem volkomen herstellen. 05.
In plaats van de dragers gedurig te bekijven en ze te mishandelen, betoont hun
dan liever een beetje vriendschap, beloont een dienst met wat drinkgeld, laat
hun het overschot van uw maaltijd, wanneer er een lastige hinderpaal in de weg
staat, steekt zelf de handen uit de mouwen, trekt of duwt en roept vrolijk
"moed, jongens". Dan zullen die jongens nooit klagen noch over de
zwaarte van hun last, noch over de hitte van de zon, noch over de stenen die
hun blote voeten tot bloedens toe kwetsen. Bij het oversteken van de rivieren
zullen ze elkaar de eer en het genoegen betwisten van u op hun krachtige
schouders naar de overkant te dragen. 06.
Laat in den avond bereikten we onze missie van Berghe-Ste-Marie. De kinderen
hadden het vaartuig reeds gezien, twee uren voordat we aanlandden. Allen, ten
getalle van honderdentien, liepen naar de haven en staken een groot vuur aan om
ons bij de ontscheping te verlichten. De grootsten onder hen sprongen in het
water om ons reisgoed aan te nemen terwijl de anderen op het strand stonden te
springen en te dansen van blijdschap. De E.H. Balthus
en Ronslé brachten ons naar de zending. 07.
Onze staatsagenten, onze dappere officieren, die midden van het zwarte land als
het ware in ballingschap leven, zijn zeker geen heiligen maar men heeft die
moedige arbeiders te erg belasterd. Het doet me genoegen dit hier ter hunner
verdediging te kunnen zeggen. 08. Rond de middag varen we voorbij de puinen van een dorp dat onlangs door de agenten van de Staat is afgebrand. - Door de beambten van de Staat afgebrand ? - Ja toch. - En mogelijk heeft men verschillende inwoners gedood ? - Inderdaad. - Dus is het
waar wat de dagbladen soms vertellen over de wreedheden door de blanken in
Congoland gepleegd ? - Volkomen
waar, alleenlijk is het niet waar dat zekere terechtstellingen volstrekt nodig
zijn voor de bescherming van de zwakkere tegenover de sterkere en tot het
uitroeien van het afschuwelijk menseneten en geenszins de naam van wreedheid
verdienen. Bid liever een rozenhoedje, lezer en lezeres, voor de dapperen die
hun leven voor een schone zaak ten offer brengen. Luistert niet naar mensen die
schrijven over zaken waar zij hoegenaamd niets vanaf weten. 09.
De Bakuba zijn vlijtig, behendig in het weven van stoffen, het smeden van ijzer
en het behouwen van hout. Ze voeden zich voornamelijk met wild en met vis en
soms met mensenvlees. Bij ons vertrek wedervoer ik een groot harteleed. Men
kwam ons een meisje van een jaar of tien te koop aanbieden. Het arm schepselke,
bevend van angst, scheen ons met haar vochtige oogjes te smeken haar toch vrij
te kopen. Helaas, het is negen tegen een te wedden dat men het arme kind heeft
opgeëten. 10.
Nauwelijks waren we op de missiepost van Luluabourg aangekomen of er werd mij
een redelijk zware last opgedragen. De hoogeerwaarde overste, oordelend dat het
ogenblik was gekomen om zusters te roepen om pater Gambier te helpen in het
onderwijzen en opkweken van jonge meisjes, zegde mij dat ik vijf zusters van
Liefde moest ophalen in Boma. Dat zegde hij mij op de zondag en twee dagen later
vertrok ik naar Boma alsof het maar een kwestie was om eens over en weer van
Antwerpen naar Brussel te rijden. Er werd ook nog beslist dat de Aigemene
Overste gedurende verscheidene maanden in Sint Jozef zou blijven ten einde aan
pater Gambier gelegenheid te geven om nieuwe missieposten te gaan stichten,
Merode San Salvador, Sint Benedictus Hemptinne en Sint Trudo bij Lusambo. 11.
De eerste dagen van mijn reis naar Luebo bemerkte ik dat aile opperhoofden,
grote en kleine, vrienden zijn van pater Gambier die ze altijd Ngangabuka
noemen, de medicijnman. 12.
Den 1sten januari 1894 bevind ik mij in Luluabourg met de zusters die ik naar
de zending van Sint Jozef in Luluabourg geleidde. Den 27ste februari
verliet ik voor altijd, in gezelschap van de Hoogeerweerde Aigemene Overste,
deze schone missie die ik zonder aarzeling de parei van Afrika noem. 13.
Te Sint Marie Berghe kwam de H.E.H. Overste aan boord. We bereikten spoedig
Leopoldville, en voor de vierde keer doorliep ik de weg der karavanen, ditmaal
in gezelschap van Baron Dhanis, de roemrijke overwinnaar van de
Araben. Van Nkenge reizen we met de ijzeren weg
tot Matadi. We brengen een haastig bezoek aan Boma en aan Moanda. In september
gaan we scheep op de Koningin Wilhelmina die ons in october, fris en gezond, in
het geliefde vaderland terugbrengt. Pater Baltus Nicolas, hij is geboren in Hombourg op 03-08-1866, hij is tot priester gewijd in 1892, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1889, hij is vertrokken naar Gongo op 06-06-1892, hij is gestorven in Leuven op 22- 08-1898 in de ouderdom van 32 jaar. 27. Donkere foto's uit "Twee jaren in Kongoland". 
Kinderen aan 't schuitjevaren in Nieuw-Antwerpen. 
De E. P. De Deken, Zusters van Liefde en enkele christenen. 
Groep der kleinste kinderen van de staatsschool in Borna. 
In de tuin bij de zusters van Nemlao. 
Dragers op de pleisterplaats. 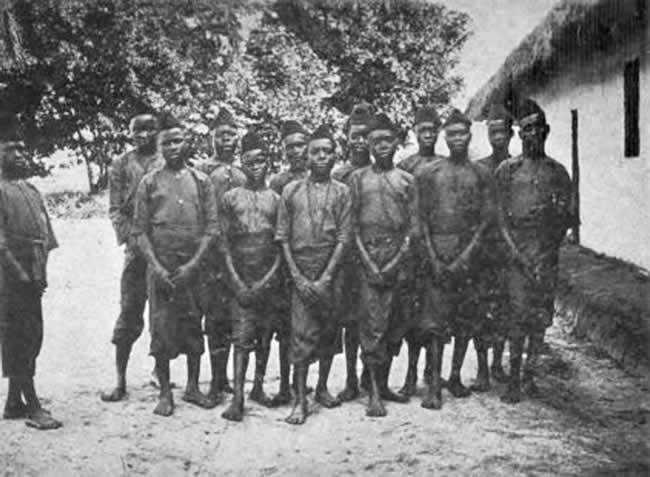
Een foto zonder onderschrift. 28. Een intermezzo over Broeder Eduard. Broeder De Jaeger Eduard schrijft in Berghe Ste Marie zijn achtste brief. In tussentijd vernamen we het droevig
nieuws dat twee jonge missionarissen in Luluabourg waren overleden, onder meer
degene die met mij uit Scheut was vertrokken. Terwijl we aan onze boot aan het
werken waren samen met onze Overste zegde die tot mij: ik ben nog niet zeker,
ik ben in beraad om met deze boot naar Luluabourg te varen en u mee te nemen
want ge zult daar zeer van pas komen na die twee sterfgevallen. Dat bleef zo
enkele dagen duren. Op een avond hoorde ik de Overste spreken met de andere paters over zijn plannen en
die paters keurden ze goed. Na enkele dagen, toen we aan tafel zaten, gaf de
Overste me te kennen dat we naar Luluabourg zouden vertrekken. Ikzelf schreef in de jubileumuitgave over Broeder Eduard het volgende : Broeder
De Jaeger was ook niet voorbereid voor zijn vele taken in de missies. Hij was
al een man van ver in de dertig, hij werd kaal en hij begon al te gelijken op
de oude baobab die in het midden van het dorp staat. Van boerenwerk wist hij
alles, hij werd koster maar hij moest ook voor kok en koopman spelen, hij moest
timmerman zijn en metselaar, bouwer en jager. Terzelftertijd was hij
verantwoordelijk voor vele anderen aan wie hij een stiel moest aanleren die
hijzelf niet volledig onder de handen had. De grote handicap was de taal die
anders was in de Kasaï dan in Berghe Ste Marie of tijdens zijn reis in de
Beneden-Kongo. Reeds van het begin af probeerde hij hun taal te spreken. Van de eerste
Scheutisten die in Congo werkten stierven er heel wat op nog jonge leeftijd. Ik
geef hier de namen van hem en van zijn confraters uit zijn tijd waarover in dit
boek sprake is en die vroeg stierven. Broeder De Jaeger Eduard stierf toen hij
40 was. Broeder Buyle Frederic stierf toen hij 27 was. Broeder Perneel Koenraad
stierf toen hij 40 was. Pater Senden Alex stierf toen hij 52 was. Pater Berton
Joseph stierf toen hij 25 was. Pater Willem van Leuven stierf toen hij 33 was.
Pater Van Damme Jozef stierf toen hij 36 was. Pater de Gryse Jan stierf toen hij
59 was. Pater Dierkens Bernard stierf toen hij 35 was. Pater Bracq Oscar stierf
toen hij 50 was. Pater Stroo Kamiel stierf toen hij 46 was. Pater Vandermolen
Leo stierf toen hij 57 was. Pater Van Hove Florent stierf toen hij 29 was.
Pater Garmyn Ferdinand stierf toen hij 30 was. Pater Hoornaert August stierf
toen hij 26 was. Pater Bracq Arthur stierf toen hij 26 was. Pater De Wilde Juul stierf toen hij 38
was. Pater De Deken Constant stierf toen hij 43 was. Pater 8altus Nicolas
stierf toen hij 32 was. Die lange lijst van namen klinkt als een
luide weeklacht voor al die jonge mannen die onvoorbereid in een tropenland
terecht kwamen, die er jong stierven of ziek naar het moederland terugkeerden
om er te sterven. In zijn brief van 14 juli 1898, de achttiende, schrijft 8roeder Eduard : "Heden pist men rood en morgen zijn we dood." Dit rood was een allusie op de ziekte, het veel rood bloed dat men verloor tijdens het wateren. Het was alsof hij het voorzien had want enkele maanden later zou hij sterven. 8roeder Eduard was fatalistisch. Naast het leven staat de dood. Waar kunnen we beter zijn, schreef hij eiders, bij Jezus onze Heer en bij Maria onze moeder in de hemel. Het kan rap gaan in Congo. Vandaag zijt ge ziek, morgen sterft ge en de dag daarop wordt ge reeds in de grond gestoken. 8roeder Eduard stierf op de 21ste oktober en de dag daarom had zijn begrafenis plaats want de ontbinding van het lichaam gebeurt snel omwille van het warm klimaat. Een tropenland is altijd een gevaarlijk land ; Toen de kinderen kwamen, vier van hen zijn in Congo geboren, was ik nooit gerust. Hebben ze koppijn ? Hebben ze koorts ? Hebben ze ongefilterd water gedronken ? Soms was er de cholera in de stad, maar altijd was er de malaria. Eike avond ging ik naar de kamer van de kinderen om met een aërosol de strijd aan te vangen tegen die verdomde muggen. Ik had vijanden want ik streed tegen corruptie, tegen het verkopen van punten, tegen het vervalsen van rapporten. Heeft iemand een vervloeking uitgesproken, een leraar die ik ontslagen had, een familielid die zich misschien verongelijkt voelde ? Broeder Eduard spreekt in zijn brieven niet echt over die duistere wereld waarin de zwarte mensen leven, een verborgen wereld van fetichen en tovenaars, van dromen en van rituelen, een geheimzinnige wereld die voor hen zo echt is ais de zichtbare wereld waarin ze leven. En wij die kwamen om ze te bekeren, leefden we ook niet in een dubbel leven ? Een leven met engelen en met duivels ? Een leven met een hemel en met een hel ? Hij vraag aan zijn weldoeners dat ze zouden bidden voor die arme heidenen die in de duisternis leven. Ikzelf voelde me sterk tegenover zij die me aanvielen. Ik voelde me sterker dan hun vuile woorden en hun verachterlijke fetichen. Ze beweerden dat ik een Luba was want ik was getrouwd met een meisje uit de Kasaï. Vielen ze mijn vrouw, mijn kinderen aan, dan werd ik zeer voorzichtig. Ik werd aangeklaagd, urenlang bleef ik alleen in een kleine ruimte, week ik geen duimbreedte af van mijn eerste verklaring De leerlingen en de leraren stonden achter mij. Ze wisten dat ik eerlijk was, ze wisten dat hun toekomst in mijn handen lag. De ouders schreven brieven naar mijn hoogste bazen om mij te verdedigen. Ze wilden dat hun kinderen een goed onderwijs kregen, dat hun spaarzame centen niet in corrupte handen terecht kwamen. De wereld van Broeder Eduard was van een geheel andere aard. Zijn mensen konden niet schrijven, ze beschikten niet over geld zoals wij het kenden, hun deuren werden niet op slot gedaan want er bestonden geen sloten en soms geen deuren. Maar ze voelden wei aan dat Broeder Eduard één van hen was, een arme eenvoudige man die leefde zoals zij, die at, werkte en sliep zoals zij. Ze moeten zich wei afgevraagd hebben hoe het mogelijk was dat hij leefde zonder vrouw. Nota. Het bloedwateren of de hematurie is waarschijnlijk de bilharziose of de slakkoorts die men krijgt door het drinken van besmet water waarin schistosomen of parasitaire wormen voorkomen die de urinewegen infecteren. 29. In luttele woorden : de held uit Balgerhoeke. Op de 6de september van 1894
neemt Eduard De Jaeger als broeder-missionaris van Scheut de boot voor Congo in
de haven van Antwerpen samen met vier metgezellen, een medebroeder, broeder
Perneel Koenraad, en drie paters, pater Senden Alex, pater van Leuven Willem,
pater Berton Jozef.. Hijzelf is afkomstig van
Balgerhoeke, een klein dorp gelegen op de grens tussen Adegem en Eeklo, in het
hart van het mooi Meetjesland. Broeder
Perneel Koenraad, geboren in Ardooie op 14-07-1859, geloften afgelegd in
1894, vertrokken naar Congo op 06-09-1894, gestorven in Scheut op 14-04-1900 in
de ouderdom van 40 jaar. Pater
Berton Jozef, geboren in Pâturages op 06-06-1869, priester gewijd in 1894,
geloften afgelegd in 1890, vertrokken naar Congo op 06-09-1894, gestorven in
Luluabourg op 20-04-1895 in de ouderdom van 25 jaar. Pater
Sen den Alexis, geboren in Kozen op 30-05-1857, priester gewijd in 1894,
geloften afgelegd in 1894, vertrokken naar Congo op 06-09-1894, gestorven in
Lusambo St Trudo op 27-01-1909 in de ouderdom van 52 jaar. Pater
Willem van Leuven, geboren in Haarlem op 27-09-1871, priester gewijd in
1894, geloften afgelegd in 1890, vertrokken naar Congo op 06-09-1894, gestorven
in Haarlem op 13-01-1904 in de ouderdom van 33 jaar. Broeder Eduard is zesendertig jaar oud en begint al kaal te worden. In zijn land laat hij vier broers en vijf zussen achter. Zijn beide ouders zijn overleden, de moeder in 1880, de vader in 1890. Van zijn familie komt enkel zijn broer, Broeder Petrus, een Broeder van Liefde van Gent, hem uitwuiven aan de Scheldekade. Sinds het jaar 1885 bestaat de Vrijstaat Congo als een privécolonie van koning Leopold II. Het administratief centrum bevindt zich in Boma, in de Beneden-Kongo, op de rechteroever van de machtige Congostroom met een lengte van 4.700 km. Daarheen vertrekken de vijf onervaren missionanssen. Ze krijgen allen de zeeziekte, de ene na de andere, maar na een rustige zeereis van negentien dagen, met een bezoek aan de zwarte broeders die in de onderbuik van de boot leven, met een bewogen dag toen de boot de evenaar kruist, met een korte halte in Accra en in Monrovia, komen ze aan in Banana, aan de hemelsbrede monding van de Congostroom die zijn bruin water tot veertig kilometers ver de zee injaagt. Van daaruit, met zijn vier confraters, bezoekt Broeder Eduard, te voet, een tiental kilometers verder langs de zee, de missiepost van Moanda waar hij een kort onderhoud heeft met Maria De Keyser of liever luster Vincente, een brave missiezuster die uit Eeklo afkomstig is. Ze brengen daar, in Moanda, rustig de nacht door. De volgende morgen keren ze uiteraard te voet terug naar Banana waar de boot dezelfde dag nog vertrekt naar Boma. Gezond en wei aangekomen in Boma krijgt hij eindelijk zijn benoeming. Hij is bestemd voor de missiepost Luluabourg Sint Jozef in de Kasaï. Het is in het land de verste missiepost waar een zekere pater Emeri Cambier met groot ongeduld op hem wacht. Het zal een lange reis worden, met de trein, te voet en met de boot. Zijn medebroeder, broeder Perneel, blijft in Boma. Vervolgens brengt de boot hen tot in Matadi waar hijzelf dichtbij, op een zevental kilometers, in Kinkanda verblijft bij een priester die uit Gent afkomstig is. Met een pioche en met veel zweet breekt hij de harde grond open. Met veel water ook en met de goede hulp van zingende zwarte kerels legt hij een moestuin aan voor de lusters van Liefde van Gent die in Kinkanda een klein hospitaal runnen. Na negen dagen van een vruchtbaar oponthoud keert hij terug naar Matadi waar hij met zijn drie overige metgezellen de trein met het smal spoor neemt richting het verre Kinshasa. Het wordt een lange vreselijke tocht van driehonderdzestig kilometers. Na een 90-tal kilometers stopt het spoor en dan gaan ze te voet verder, met 72 dragers, tot in Leopoldstad, na een moeilijke lange voetreis van meer dan tweehonderdzeventig kilometers. Hun reis gebeurt tijdens het regenseizoen. Regelmatig worden ze verrast door een harde plensbui. Ze klimmen langs een smal pad over moeilijke bergen, ze trekken blootsvoets door een rivier waar wrede krokodillen hen belagen. Ze verdwalen, de lange karavaan breekt in stukken. Twee van zijn metgezellen worden zo ziek dat ze moeten gedragen worden in een draagzeil. Broeder Eduard drinkt voor de eerste keer van zijn leven palmwijn die hij niet zeer apprecieert, hij drinkt liever Leuvens bier. Op zijn beurt wordt hij ziek en tegen zijn wil in moet hij ook in het draagzeil. Moe en uitgeput komen ze allen aan in Kinshasa. Ze brengen de nacht door bij confraters die hun woonhuis hebben dicht bij de oever van de stroom. Reeds de volgende dag, op Allerheiligendag, vroeg in de morgen, nemen ze met hun gevieren de stoomboot die gezwind de brede Stanley-Pool oversteekt. De Stanley-Pool of Malebo is een kilometersbrede verwijding van de Congostroom. Na een kwartier leggen ze reeds aan in Brazzaville, in Frans Congo, waar ze verblijven bij vriendelijke Franse missionarissen. Na een kort maar deugddoend verblijf van drie dagen waar ze een beetje op adem komen van hun moeilijke reis van Matadi naar Kinshasa, varen ze gezapig verder. De boot stopt bijwijlen om zich van hout te voorzien. Broeder Eduard verlaat gedurende enkele uren de boot samen met pater Senden Alex die een jaar ouder is dan hij. Ze komen terecht in een dorp waar ze een vreemde ontmoeting hebben. In paniek keren ze haastig terug naar de boot. De nachten zijn hard want de Broeder slaapt buiten op de plankenvloer terwijl de drie paters een slaapplaats vinden in de eetkamer. De bootreis duurt zeven dagen tot ze bij de monding van de Kasaïstroom aankomen, daar waar de uitgestrekte missie van Berghe Ste Marie ligt en waar broeder Eduard zijn eerste missieërvaringen opdoet. Met verwonderende ogen kijkt hij naar de aalvlugge geckos, die gekke beestjes die zonder schroom of schaamte overal, tot op zijn bed, in zijn armoedige kamer rondlopen. Hij heeft een diep respect voor de vele kinderen die op de missie leven. Ze leven en ze bidden alsof ze kloosterlingen zijn. Broeder Eduard zal niet vertrekken naar Luluabourg Sint Jozef maar hij wordt benoemd voor Nieuw-Antwerpen, veel verder nog op de Congostroom. Een boot die aanlegt bij Berghe Ste Marie gaat spijtig genoeg niet naar Nieuw-Antwerpen zodat uiteraard zijn vertrek niet doorgaat. Ondertussen helpt hij, gehoorzaam, blij en opgeruimd, bij het bouwen van een eigen boot voor de missiepost. De boot is bij uitstek het gedroomd vervoermiddel in dit land met zijn talrijke rivieren. Broeder Eduard krijgt ais taak te zorgen voor de kinderen, voor de wegen, voor de moestuin, voor de geiten en voor de vele kippen die eieren leggen bijna zo klein als de duiveneieren uit zijn geboortestreek. Met de kinderen spreekt hij Vlaams, Frans en Congolees, alles door elkaar. Daar hebben de kinderen veel plezier mee. Met zijn kennis ais boerenzoon probeert hij tevens aardappelen te kweken maar dat is geen groot sucees. Hij probeert ook tarwe en rogge te kweken maar dat wordt een volslagen mislukking. Als ze intussentijd vernemen dat twee jonge confraters plots gestorven zijn in Luluabourg Sint Jozef beslist zijn overste om de Broeder toch naar die missiepost te brengen met hun eigen afgewerkte boot. De overste zal kapitein zijn. Na een mislukte reis met een onervaren kapitein, een reis waarop de boot meerdere keren op de grond vastloopt, een reis waarop Broeder Eduard met sucees op grote logge nijlpaarden jaagt, dan komt de ongehavende boot terug aan in Berghe Ste Marie, zijn thuishaven. Nieuws gaat vlug zelfs in de verre Congo. Zo vernemen ze met grote ontstentenis en grote schrik voor hun confraters dat er een opstand is uitgebroken in het militair kamp van Luluabourg, dater blanken zijn vermoord, dat de talrijke opstandelingen, goed gewapend, naar Luluabourg Sint Jozef zijn getrokken, dit is onjuist nieuws, waar pater Cambier verblijft, dat ze verder nog zijn getrokken naar Merode waar pater Garmyn verblijft. Een geluk nog bij een ongeluk dat ze op hun haastige tocht met de boot naar Luluabourg op tijd zijn teruggekeerd, zo niet was Broeder Eduard met zijn drie confraters in de handen van de opstandelingen gevallen. Dat hij gered is van een gewisse dood dat dankt hij op de eerste plaats aan de vurige gebeden van zijn familie en van zijn talrijke weldoeners, zo schrijft de Broeder het in zijn brieven. Onverwachts meert na een paar dagen een staatsboot aan die naar Lusambo, in de Kasaï, vaart. Er is nog één plaats vrij en die is voor Broeder Eduard. Meer dan drie weken duurt de lange eentonige bootreis. De Broeder is enkel vergezeld van een jonge knaap. Op de boot heeft hij wei gezelschap van een blanke officier die naar de Kasaï is gezonden om aan de opstand van de Batetelasoldaten een einde te maken. Tenslotte komt hij aan, de eerste augustus van 1895, bij pater Senden Alex, zijn vroegere reisgezel, op de missiepost Sint Trudo langs de Sankurustroom op een tiental kilometers van de staatspost van Lusambo. Pater Senden is alleen op de missiepost en Broeder Eduard blijft bij hem als helper en als duiveldoeal. Hij komt dus nooit aan in Luluabourg St Jozef bij pater Cambier. Het zijn zeer gevaarlijk tijden want de opstand van de soldaten van Luluabourg is nog altijd niet voorbij. Gelukkig komen in Lusambo twee staatsboten aan met goed getrainde soldaten, ze zijn voldoende in aantal om hun veiligheid te verzekeren. Broeder Eduard helpt dan pater Senden bij het verhuis van de missie naar een betere plaats, zes uren verder langs de Lubirivier, een bijrivier van de Sankuru, waar ze hun nieuwe missiepost opbouwen, Sint Trudo nummer twee. Er is niet veel te eten op de nieuwe missiepost zodat de overste zijn factotum, de bereidwillige Broeder Eduard, de baan opstuurt met negen zwarte mannen naar de omliggende dorpen om de nodige inkopen te doen, aardnoten, manioc, geiten, kippen. Het ene dorp na het andere gaan ze voorbij want daar is niets te kopen, de mensen zijn echt arm. Dan komen ze aan in een dorp waar de chef ze vriendelijk uitnodigt om in zijn dorp de nacht door te brengen daar er een onweer dreigt. Leder krijgt te eten en te drinken. Na de maaltijd, het is intussen avond geworden, het onweer is voorbij, en gans het dorp komt naar de hut waar Broeder Eduard verblijft. Ze ontsteken een enorm groot welkomstvuur, ze zingen en ze dansen tot laat in de nacht. De trommels gaan zo luid dat het pijn doet aan de oren van Broeder Eduard. 's Anderendaags worden ze overladen met talrijke geschenken die de Broeder goed betaalt. Hij keert met zijn negen mannen triomfantelijk terug naar de missiepost. Ze zijn beladen met manioc, aardnoten, geiten en kippen. Ledereen, uren in de ronde, kent nu die vriendelijk kleine gebaarde blanke broeder en ze noemen hem "hij die zachtjes gaat", Tshiendebitekete, of ook nog "de Kleine Heer", Mukalenge Kakese. Voor de tweede keer echter krijgt hij die vreselijke gevaarlijke ziekte, de bloedwatering of hematurie. Hij herstelt moeizaam en herneemt eindelijk, na twaalf dagen ziekte, met moed zijn werk. Hij bouwt een kapel, hij maakt een tabernakel. Voor de eerste maal verblijft de Heer dag en nacht bij zijn schamele missionarissen. Broeder Eduard luidt de klok die tot uren ver in de ronde te horen is. Een nieuwe Broeder is aangekomen op de missie. De beide Broeders maken samen brood met meel van bonen, het is zeer lekker brood, het smaakt heel goed. De komst van die tweede Broeder zal echter de oorzaak of liever de gelegenheid zijn dat zijn overste hem laat vertrekken met pater Garmyn, de vroede stichter van Merode Salvador, hij die bij hen gevlucht was toen de opstandelingen zijn mooie missiepost hadden verwoest. Op de 18de februari 1897 verlaat pater Garmyn samen met Broeder Eduard de missie van Sint Trudo voor Merode San Salvador. Het is een grote enge onderneming die veel tijd en inspanning zal vragen. Ze vertrekken in een oneindig lange sliert van mensen, ze zijn met meer dan honderdvijftig, twee blanke mannen vergezeld door hun vrijgekochte slaven, mannen en vrouwen, en door de kinderen die de Staat hun toevertrouwde. De mannen dragen de mondvoorraad, de vrouwen het keukengerief. Vooraan stappen dapper de grootsten van de kinderen. Hoog boven de hoofden dragen ze de witte vlag met een blauw kruis in het midden. Rovers wachten in het hoge gras om de karavaan aan te vallen. Bij het zien van de vlag met het kruis krijgen ze opeens grote schrik. Zoiets hadden die rovers nog nooit gezien. Ze verdwijnen spoorloos in de broesse. De kronkelende lange karavaan sleept zich zeer langzaam voort doorheen het golvend landschap over een smal pad tussen het hoog en sterk broessegras. De pater, de mfumu of de baas, laat zich gewillig dragen maar de broeder, de knecht, legt de hele reis te vaet af. Een paar vrouwen moeten ze onderweg achterlaten omdat de reis voor hen te vermoeiend is geworden. De reis is werkelijk uiterst vermoeiend en zeer gevaarlijk. Ze trekken door een dicht bas waar iedereen gemakkelijk door een woelige beek gaat maar voor de pater, voor de chef, maken ze een kleine brug met een boom die ze omhakken. De chef raakt zonder natte voeten aan de overkant. De avond valt vlug, de nacht wordt lang. Ze zijn verplicht deze door te brengen in dit dicht bas waar vreemde baardige wezens verblijven en gevaarlijke tijgers. De mensen hebben schrik. Ze maken een groot vuur aan. Met zijn geweer naast zich rust Broeder Eduard in een primitieve hut van gras en takken, klaar am bij het minste gevaar naar buiten te springen. In de dorpen die ze benaderen brengt er meestal paniek uit, de mensen vluchten met hun hebben en hun houden de bossen in. Als ze bemerken dat die twee vreemdelingen met hun groot gevolg geen kwade bedoelingen hebben keren ze naar het dorp terug. Hier en daar kopen die twee gebaarde eigenaardige blanken met kleurige stoffen en blinkende kralen een paar slaven vrij. Na een lastige voetreis van tien dagen komen ze aan op de verwoeste missiepost van Merode waar ze onderdak vinden in een woning zonder vensters of deuren. Dit is geen probleem, Broeder Eduard maakt deuren en vensters. Hij legt velden aan met de hulp van de vrouwen. De missie groeit en bloeit. Er zijn geen tijgers in de streek maar wel luipaarden die 's nachts door het missiedorp sluipen. Een ongelukkige dorpeling wordt in het aanliggend bas door een luipaard gedood. Met Pasen krijgen ze hoog bezoek van twee Belgische officieren en Broeder Eduard moet zorgen dat het eetmaal goed verzorgd is. De bisschop, Mgr Van Ronslé, zijn vroegere overste van Berghe Ste Marie, komt oak op bezoek am een honderdtal christenen te vormen. Hij feliciteert de goedwillige Broeder Eduard met zijn goede gezondheid. Volhouden, beste Broeder ! Het is een ijdele wens. Na een heftige aanval van hematurie, het is de derde keer dat hij die ziekte krijgt, sterft plots Broeder Eduard na een dag en half, op de 21ste oktober 1898. De volgende dag wordt hij al begraven. Gans de missie, 850 personen, leiden de goede Broeder naar zijn laatste rustplaats. Vooraan in de begrafenisstoet gaan de kinderen met de vlag met het kruis. le verstaan uiteraard geen Latijn maar ze zingen zo hard ze kunnen het In paradisum dat pater overste hun in de catechismuslessen aanleerde. In paradisum deducant te angeli-Dat de
engelen u geleiden naar het paradijs. Dan volgen ingetogen de twee priesters, pater Garmyn en pater Calan, beiden in witzwart lang gewaad. Ze zijn gevolgd door zes dragers die de ruwe zware kist met het stoffelijk overschot van de Broeder op hun schouders dragen. Dan volgt een grote menigte van armzalige mensen. De enen bidden stil en ingetogen tot de God van de Blanken. De anderen bidden luidop tot de God van de lwarten. Anderen nog uiten luide weeklachten, ze kloppen zich hard op de borst. Halfnaakte moedertjes heffen in diepe wanhoop hun klein kind ten hemel op terwijl ze hartverscheurend wenen. Toen de dragers de kist met Broeder Eduard erin neerleggen naast de diepe put wordt alles doodstil. De honderden mensen scharen zich rond de kist met de dragers, met de twee priesters en met het kind dat het vaandei met het kruis draagt. Al die bedrukte mensen kijken toe met diepe droefheid in hun hart en met vreesachtige eerbied in hun donkere ogen terwijl pater overste plechtig de ruwe zware kist met veel wijwater besprenkelt. Leder van hen kijkt aandachtig toe en luistert met scherpe voile aandacht naar de geheimzinnige woorden uit een boek, Latijnse woorden die pater overste, mompele Talatala, de man met de bril, de bijnaam van pater Garmyn, langzaam uitspreekt. Het is een laatste liturgisch gebed. Memento homo, quia pulvis es et ad pulverem reverteris-Bedenk o mens,
dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Allen keren dan in stilte terug naar hun eenvoudige woonst die de Broeder voor hen bouwde. Ze weten dat ze leven maar dat de dood altijd nabij is. Ze betreuren hem die ze Tshiendebitekete noemen, hij die zachtjes gaat, de kleine Broeder Eduard die ze ook Mukalenge Kakese noemen, de Kleine Heer. De vrouwen denken liefdevol terug aan die vriendelijke opgewekte blanke man. Hij had een armoedige woonst, geen vrouw deelde met hem zijn bed maar het is met de vrouwen dat hij op de velden werkte. Hij had geen eigen kinderen maar altijd kwamen de kleintjes hem opzoeken in zijn werkhuis, ze zegden een gebedje, ze zongen een liedje. De goede Broeder gaf ze plankjes om mee te spelen. Toen de vrouwen hun kleintjes kwamen halen gaf hij ze een kruisje op het voorhoofd. Daaraan dachten die magere vrouwtjes toen ze naar hun vele dagelijkse bezigheden teruggingen. De mannen denken eveneens met respect terug aan die vriendelijke onverschrokken blanke man die nooit schrik had, die alles kon, hij was kok en jager, schrijnwerker, metser en bouwer. Hij bouwde met hen mooie grote huizen, hij trok met hen op jacht, hij sprak met hen in hun eigen taal. Lang nog vertellen ze later rond het oplaaiend avondvuur hun straffe verhalen over die vriendelijke, eenvoudige blanke man, over die speelse gebaarde Tshiendebitekete met over zijn linkerschouder het gevaarlijk geweer waarmee hij grote rivierpaarden en geslepen luipaarden doodde, over die goedgemutste Mukalenge Kakese met altijd in zijn rechterhand zijn eeuwige paternoster waarvan ze veel schrik hadden vooral van het kruisje met die halfnaakte dode witte mens. Waarom vragen ze zich vertwijfeld af, waarom toch moest hij sterven, hij die goede man, die kaal werd maar nog geen grijze haren in zijn baard had ? Was hij niet iemand van hen, een chef die na zijn dood reisde naar het land van de witte mensen, de bantu batoke, en die nu als een witte man, een muntu mutoke, na zovele jaren was teruggekeerd ? Hadden zijzelf geen schuld aan zijn dood ? De goede Broeder hield niet van hun vuile fetichen en van hun gevreesde gore tovenaars. Zouden ze zich niet beter laten dopen zoals enkelen onder hen reeds deden, om alzo de gunst te bekomen van de machtige God van Mukalenge Kakese, van Tshiendebitekete ? In zijn ver geboortedorp, vertelde veel later, in 1949, een oude missionaris op de preekstoel van Balgerhoeke dat er na de dood van Broeder Eduard nooit meer bekeringen waren geweest dan in de streek van Merode San Salvador. 30. Het graf van Broeder De Jaeger. 
R.I.P. dat hij ruste in vrede. 31. Drie foto's van 8roeder Eduard. 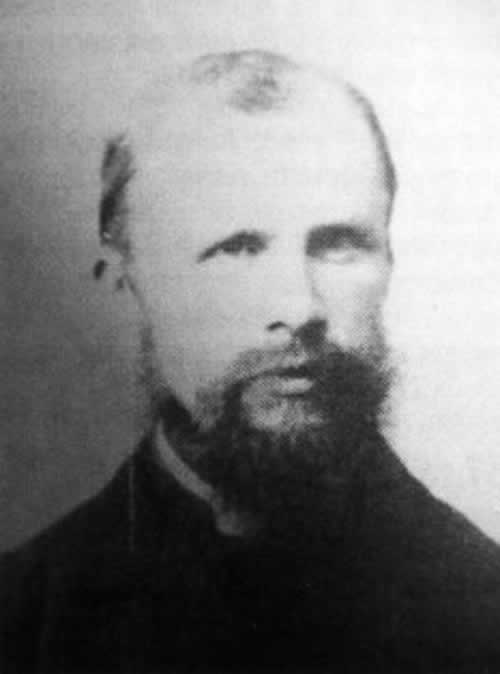
Broeder De Jaeger Eduard bij zijn vertrek naar Congo. 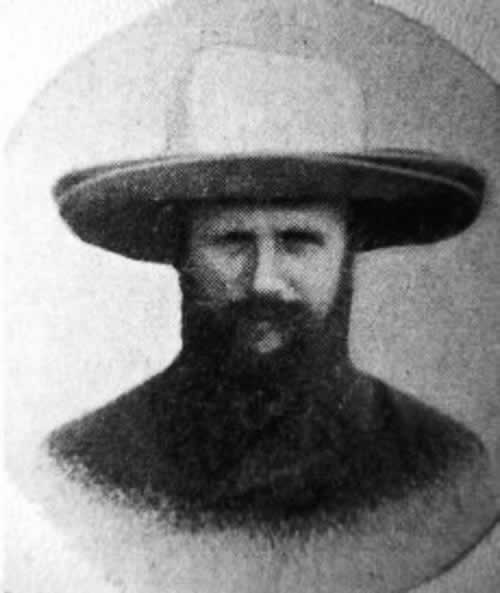
Broeder De Jaeger Eduard in Congo, met zijn tropenhoed. 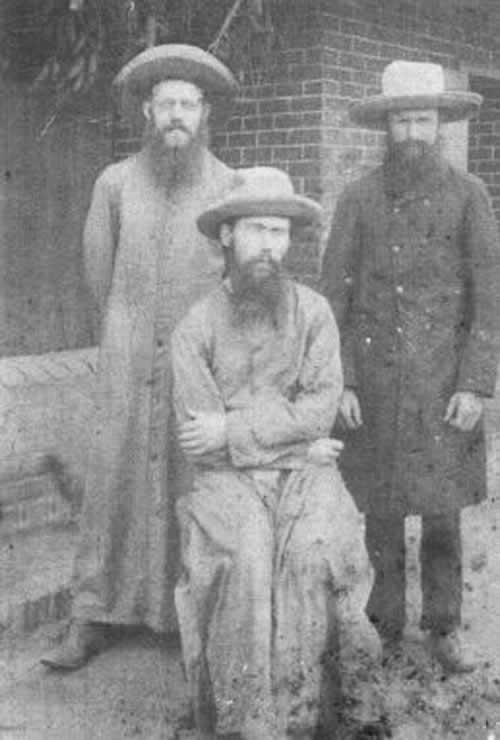
Broeder Eduard met twee confraters, in Merode. Van L. naar r. : Pater
Calon-Pater Garmyn-Broeder De Jaeger. Pater Calon Eugeen, hij is geboren in IJzendijke (Nederland) op 23-04-1861, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1892, hij is tot priester gewijd in 1892, hij is vertrokken naar Congo op 06-04-1893, hij is gestorven in Congo op 01-08-1939 in de ouderdom van 78 jaar. *Pater Garmyn Juul, hij is geboren in Beveren-Roesbrugge op 10-04-1861, hij is tot priester gewijd in 1884, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1890, hij is vertrokken naar Congo op 06-04-1893, hij is gestorven in West-Fleteren op 06-11-1926 in de ouderdom van 65 jaar. Broeder De Jaeger, zie hoofdstuk 18, Het leven in Nieuw-Antwerpen. Nota. Broeder Eduard komt uit een christelijk gezin met tien kinderen waarvan er vijf in het klooster gaan, een jongen bij de Broeders van Liefde, een jongen bij de Scheutisten, en drie meisjes bij de Zusters van Liefde. 32. Zuster Remacla - Nathalie De Jaeger. De zus, Nathalie De Jaeger, geboren in 1861,
is ingetreden in 1885 ais zuster Remacla. Ze vertrok naar Congo in 1910. Ze
leefde en ze werkte in Luluabourg waar ze stierf in 1932. 
Zuster Remacla, links op de foto, 
Zuster Remacla, links op de foto. 
Zuster Remacla in Luluabourg Sint Jozef met haar medezusters. 
Zuster Remacla in Congo. 33. Een land met wilde mensen. 
Op oude foto's en filmbeelden zie je de moedige missionaris of de blanke staatsagent gedragen als een grote chef over berg en dal. In 1895 schreef een zekere pater De Wilde Juul : … je me range du côté de ceux qui font descendre les nègres de Cham, le fils maudit de Moïse. Ze zijn polygaam, ze zijn menseneters, ze hebben slaven. Vroeger al, in 1889, drukte de grote Leo XIII zich nog scherper uit, in beeldrijke termen, toen hij schreef aan de Generale Overste van Scheut, pater Van Aertselaer Jeroom : … door toedoen van de dienaars van de Kerk, de Scheutisten, glanst het licht der waarheid voor de Afrikanen, en deze, onttrokken aan hun woeste levenswijze, gewennen zich aan de zeden en de wetten van een wel gegrond staatswezen. Leo XIII vergelijkt ze vervolgens aan wilde dieren : ... daaruit volgt dat zij, wilde dieren, vee gelijk, die naar eigen goeddunken leefden, nu uit de slavernij des bederfs ingeënt worden op de glorierijke vrijheid van de zonen Gods. Die voorgaande teksten heb ik overgeschreven uit de studie van een Scheutist, pater Anckaer Leopold. Ik vind zijn naam niet terug in de elenchus van Scheut. Heeft hij Scheut verlaten ? De zwarten waren wilde mensen, zonder enige cultuur. Het was ons recht en onze plicht om ze te koloniseren, om ze te christenen. Meneer Keters Roger en ik, wij ook behoorden tot de besten van de Broeders die vertrokken om de wilde mensen uit Congo te bekeren. We trouwden beiden met een meisje dat een nazaat was van die wilde mensen. Mijn kinderen hebben hogere studies gedaan en ze zijn fier op hun Afrikaanse grootouders. 34. Twee Afrikaanse grootouders. 
Angélique Kulondi Mutanga, de grootmoeder van onze kinderen. 
Vital Nkongolo Muamba, de grootvader van onze kinderen. 35. Twee Afrikaanse nichtjes. 
Sophie, een kleindochter van Angélique Kulondi. 
Angélique Kulondi met Hélène, een andere kleindochter. 36. Nog twee mooie foto's. 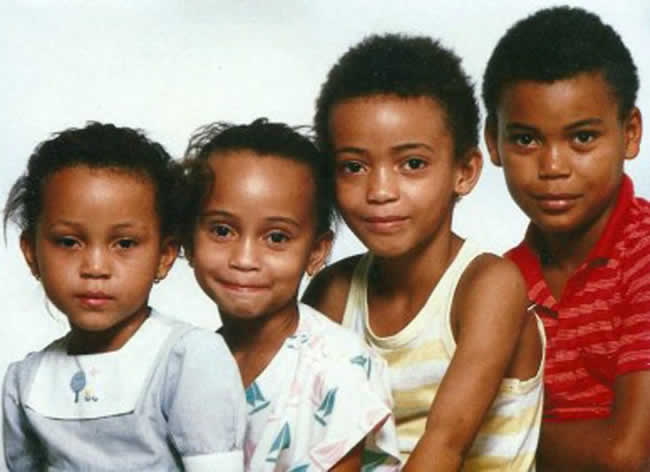
Vier kinderen van Urbaan en Hélène tijdens hun vakantie in België. 
De familie De Clerck-Tshibuabua tijdens een uitstap aan zee. 37. Twee missionarissen uit de tijd van pater Cambier. 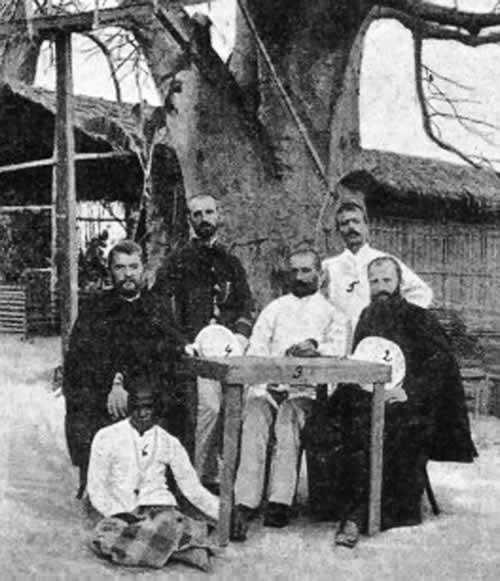
Een foto uit Borna: Pater Bracq Arthur (1), pater De Wide Juul (2), de heer Corona, de consul van Italië in Boma (3), dokter Van Campenhout (4), de secretaris van de consul ((5), en de kleine prins Nemlao (6). 
Pater Bracq Arthur, hij is geboren in-Gent op 25-11-1864, hij is tot priester gewijd in 1887, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1889, hij is vèrtrokken naar Congo op 06-07-1890, hij is gestorven in Congo op 21-09-1890 in de ouderdom van 26 jaar. 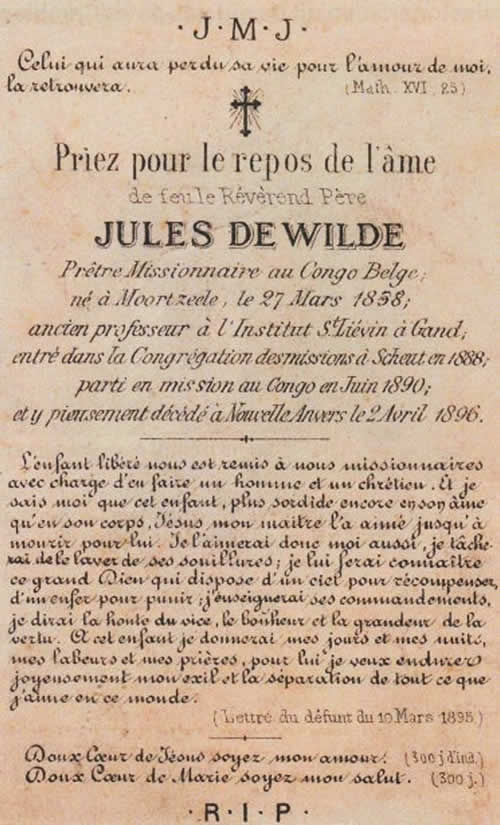
Pater De Wilde Juul, geboren in Moortsele op 27-03-1858, hij is tot priester gewijd in 1883, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1889, hij is vertrokken naar Congo op 06-07-1890, hij is gestorven in Nieuw-Antwerpen op 02- 04-1896 in de ouderdom van 38 jaar. 38. Het vertrek van de Aigemene
Overste. De dag van zijn vertrek bekent de
Aigemene Overste aan pater Gambier dat hij eerst gekomen was om hem naar België
terug te roepen omdat hij reeds verschillende keren de richtlijnen van zijn
Hogere Oversten in de wind had geslagen maar nu dat hijzelf heeft gezien wat 'n
goed werk pater Gambier heeft gedaan mag hij blijven. Hij overhandigt hem een
brief waar-in hij de lof zwaait van de stoere missionaris. Pater Gambier leest
de brief, hij verscheurt hem in stukken die hij in het vuur smijt. Dat feit
werpt een blik op het karakter van pater Gambier. Hij is een man uit één stuk
die weet wat hij wil, die geen lofbetuigingen, zelfs goed gemeende, aanneemt. 
De missiepost van pater Cambier. 
Het voorlopig hospitaal van Mikalayi. 39. Het medisch onderzoek. 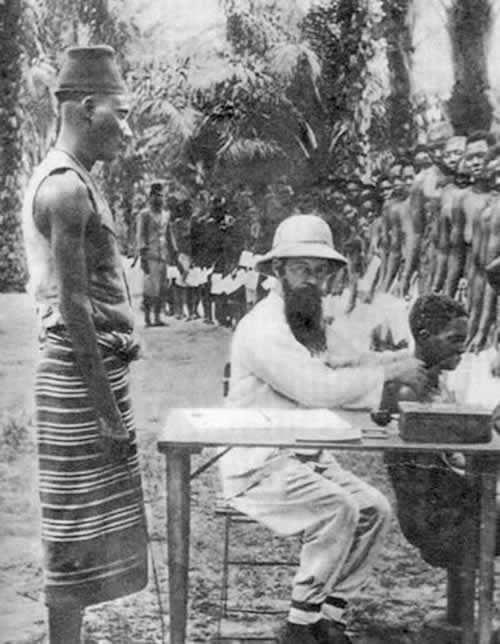
Pater Pierre Bouvez is hier, in de missiepost van Lubefu, bezig de bevolking te onderzoeken in de strijd tegen de slaapziekte. Pater
Bouvez Pierre, hij is geboren in Jemappes op 31-05-1886, hij is tot
priester gewijd in 1910, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1905, hij is vertrokken
naar Congo op 10-09-1910, hij is gestorven in Resteigne op 14- 03-1952 in de
ouderdom van 65 jaar. Nota.
In 1885 schatte men het aantal inwoners van de Vrijstaat tussen de elf en de twintig miljoen. Vanaf 1920 werd er meer geteld
en rond 1930 waren ze met tien en haIf miljoen inwoners. De
oorzaken van de terugval waren vooral de ziektes en het geweld. Met de
onafhankelijkheid in 1960 waren ze met vijftien miljoen. Heden ten dage spreekt
men van 75 tot 80 miljoen inwoners, 35 man per
vierkante kilometer. 40. Ngangabuka, de genezer. 
Luluabourg Saint Joseph - Vue générale. Pater Gambier was geliefd door zijn
mensen vooral omdat hij ze hielp bij hun ziektes. Hij bezat de gave van de
mensen te kunnen helpen door zijn vroegere omgang met een broer die dokter was.
De mensen gaven hem de bijnaam van Ngangabuka, hij die geneest, de genezer.
Sinds enkele jaren was er ook de verschrikkelijke slaapziekte die gehele dorpen
deed verdwijnen. Zelfs zijn vorige missie, Berghe Ste Marie, de vroegere missiepost
van Franse paters die pater Gambier met zijn confraters hadden overgenomen,
moest zich verplaatsen omdat de slaapziekte bij de samenvloeiing van twee grote
waterlopen, de bevolking teisterde. In Luluabourg liet Pater Gambier de zieke
mensen verzamelen op een eiland in de Luluastroom en twee keren per dag gingen
de Zusters van Liefde de "slapers" verzorgen. De Zusters waren echt
te bewonderen, enkelen onder hen stierven na enkele jaren van hun aankomst.
Pater Huberlant kreeg ook de slaapziekte, hij ging terug naar België waar hij stierf
kort na zijn aankomst in 1893. Nota. De slaapziekte, de trypanosomiase,
is een tropische ziekte die door de tseetseevlieg verspreid wordt en waardoor
het zenuwstelsel wordt aangevallen. Ook in Mikalayi verspreidde de
slaapziekte zich. In 1910 vertrok pater Gambier naar België om hulp te vragen
en hij kwam met een dokter terug, de heer Monnard. Hijzelf profiteerde van zijn
kort verblijf in zijn land om de eerste beginselen van de tropische geneeskunde
aan te leren. In oktober van 1911 werden er 518 zieke mensen behandeld in een
nieuw hospitaal met een medicament gemaakt op basis van arseniek of met het
innemen van kinine. Het hospitaal werd gebouwd door een zekere 8roeder Louis
die later ook de grote tweetorenkerk van Mikalayi zou bouwen. Nota.
Ik vond nergens iets over Broeder Louis maar misschien was het een zekere
Broeder Aloïs die als Louis werd aangesproken. Broeder
Audenaert Aloïs, geboren in Haasdonk op 12-04-1883, geloften afgelegd in
1905, vertrokken naar de Kasaï op 07-09-1905, gestorven in Scheut op 10-03-1943
in de ouderdom van 60 jaar. 41. Het oproer van de Batetela. 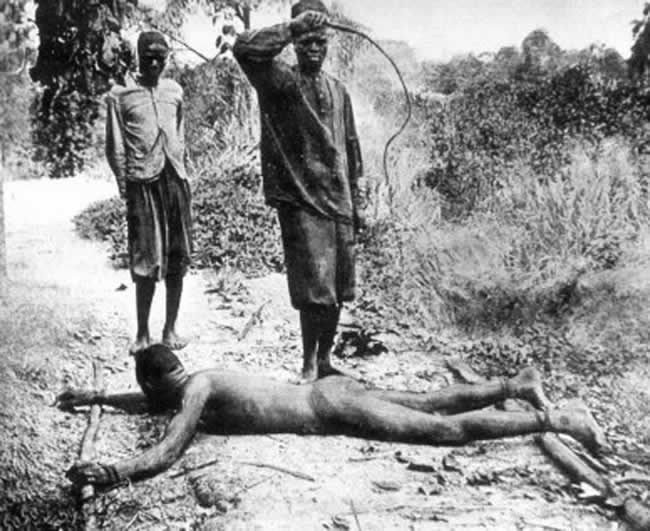
We keren enkele jaren terug in de
geschiedenis. We zijn nu in het jaar 1895. Dichtbij de stroom, op enkele
kilometers van de missiepost, ligt de staatspost van Luluabourg waar drie
blanken verblijven, de commandant Peltzer, de luitenant Cassart en de commies
Lassaux. In het kamp verblijven de zwarte soldaten waarvan het merendeel
behoren tot de stam van de Batetela. Als deze vernemen dat hun grote chef,
Ngongo Lutete, door de blanken is gefusillieerd in Lusambo, komen ze in opstand
op 4 juli 1895. Ze doden hun strenge commandant die gekend was om zijn zware
straffen. Een soldaat Op wacht die in slaap viel kreeg tot honderd slagen met
de chicotte, een zweep gemaakt van het vel van een nijlpaard. Pater Cambier, snel op de hoogte gebracht
van de opstand, doet zijn Zusters en de kinderen
vertrekken naar een dorp van een bevriende chef. De luitenant Cassart is
gekwetst en hij verbergt zich in een bos om tenslotte op de missiepost aan te
komen en waar hij verzorgd wordt. Ook de commies komt op de missiepost aan.
Pater Gambier is vast besloten om de missie in brand te steken moesten de
rebellen hen aanvallen. Tenslotte verlaten de drie blanken de missie met 400
mannen van de missie om de Zusters en de anderen te vervoegen verderop. 42. Houd u koest. 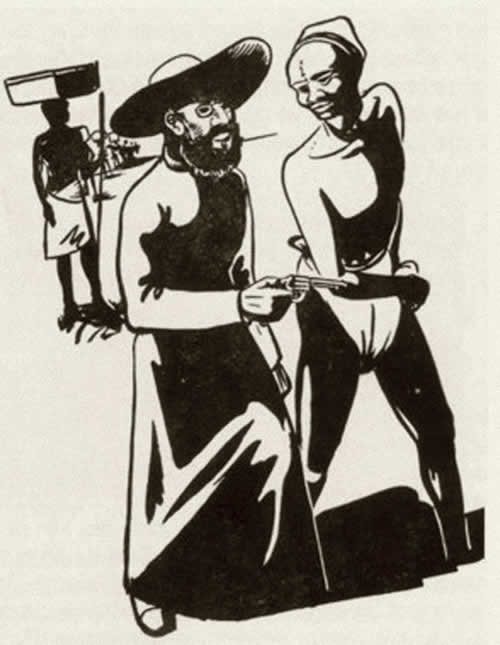
Pater Gambier verneemt dat de rebellen de
missiepost niet hebben aangevallen en hij besluit terug te keren met de ganse
groep van honderden mensen. Er was echter een zwaar obstakel. Een belangrijke
chef, Ngongo Tshunkenge was zijn naam, was niet vergeten dat luitenant Gassart
hem in het verleden zeer mishandeld had. Hij zinde op wraak en hij wou de gehele
sliert van mensen gevangen nemen bij hun doortocht door zijn dorp, dat was zijn
plan. Maar pater Cambier, van niets vervaard, ging de karavaan voorop en
aangekomen voor de grote hut hield hij met zijn revolver de grote chef onder
schot en wei zolang totdat de lange karavaan het dorp verlaten had en ver van
de gevaarlijke chef in de broesse was verdwenen, in veiligheid. Pater Cambier
groette hoofs zijne Majesteit en ging vlug zijn mensen achterna. Maar het gevaar was niet geweken. De opstandelingen
hadden de missiepost van Merode San Salvador vernietigd en de overste, pater
Garmyn Juul, een oud-gezel van pater Cambier in Luluabourg, was gevlucht naar
de missiepost van Sint Trudo, gelegen nabij de staatspost van Lusambo. *Pater
Garmyn Juul, zie het hoofdstuk 26, Een onderonsje met pater De Deken. Nota.
Het asteriks, het sterretje, voor de naam in de Elenchus
defunctorum, betekent dat de pater of de broeder de Congregatie van Scheut
heeft verlaten. Het is mogelijk dat het over zijn broer gaat, pater Garmyn
Ferdinand. Neen, het gaat werkelijk over Juul Garmyn want zijn broer, pater
Ferdinand, was reeds gestorven in 1892. Pater
Garmyn Ferdinand, geboren in Beveren-Roesbrugge op 03-07-1862, geloften
afgelegd in 1891, tot priester gewijd in 1887, vertrokken naar Congo op
03-07-1889, gestorven in Congo op 05-10-1892 in de ouderdom van 30 jaar. 43. De aanval op de missiepost. Luitenant Cassart verliet de missiepost van Lualubourg St Joseph voor Lusambo om bij de staatsagent Dufour 30 soldaten op te eisen, elk met 30 cartouches. De opstandelingen verdeelden zich in twee groepen, de ene groep trok op naar luitenant Cassart met zijn klein legertje, de andere groep trok op naar de missiepost van pater Cambier die zich met zijn geweer opstelde aan de ingang van zijn missiepost waar de Zusters en hun weeskinderen zich schuil hielden in bange verwachting. Een boy stelde zich op achter de pater en hij moest de cartouches gereed in zijn handen houden. De pater beschikte over een zwaar geweer, een "express rifle". Links en rechts in het hoge gras lagen zijn miliciens die hijzelf had gedrild. Nauwelijks had hij enkele schoten gelaten of de rebellen sloegen op de vlucht. Ze hadden bemerkt dat de pater over een zeer sterk geweer beschikte. Een bevriende chef, Zappo-Zab was zijn naam, kwam met zijn strijders de pater ter hulp en ze kwamen terug van hun achtervolging met de lijken van enkele rebellen. Ze staken grote vuren aan om hun slachtoffers te braden en op te eten. Ze aten veel, ze dronken veel, ze zongen veel, ze dansten veel, gedurende de godganse nacht. Dank aan de dappere houding van pater Cambier verdwenen de rebellenuit de omgeving van de missie maar het oproer van de Batetela zou nog gedurende enkele jaren de streek teisteren tot de rebellen tenslotte werden verslagen in 1901. En wat de chef Ngongo Tshunkenge betreft, de commandant Michaux heeft hem volledig in de pan geslagen. Het leven op de missie ging stil vooruit. In een brief van 13 september 1895 schrijft pater Cambier dat hij een versterkte toren aan het bouwen is. Daarin gelijkt hij op de Tempeliers van vroegere tijden, trouwens was hij vroeger niet van plan geweest om officier in het leger te worden ? De bouw van de toren was vooral om de Zusters te beschermen moest er opnieuw gevaar opduiken. Op de plaats van de toren bouwde hij later met de hulp van Broeder Louis een grote kerk met twee torens die verwezen naar de tweetorenkerk van het moederhuis is Scheut. 
Het oude moederhuis van Scheut. Trouwens er waren nog andere vijanden, de tropische ziektes zoals het bloedwateren, de malaria en de slaapziekte. In een tijdspanne van 12 dagen waren twee van de zes confraters die hem door zijn oversten waren toegewezen gestorven. Hijzelf maakte met eigen handen zijn doodskist op voorhand klaar. Gans de missie stond op haar kop en ieder smeekte hem om er mee op te houden en niet aan zijn dood te denken. Nota. De Tempeliers waren een christelijke kruisridderorde die ten tijde van de Kruistochten vochten tegen de Moslims in het Heilig Land. 44. Zijn doodskist. 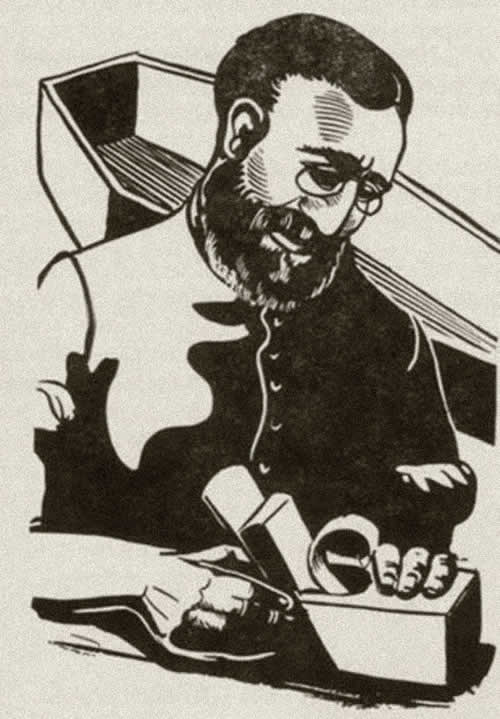
Pater Cambier maakte zijn eigen doodskist. 45. Het tovergeweer van pater Cambier. Over de gehele streek van de Kasaï was
Pater Cambier gekend en ook gevreesd. Als hij sprak werd er naar hem
geluisterd. 's Avonds, gezeten rond het vuur, sprak
men over die wondere dappere man die speciale gaven bezat om zieke mensen te
genezen, de man die een tovergeweer bezat waar tegenover niemand beveiligd was.
Pater Cambier vertelde vele jaren later hoe een chef bij hem op bezoek was en
die hem vele geschenken gaf. Alors,
il me demanda si je le reconnaissais. Sur une réponse négative, il me déclara
qu'il était un des révoltés de 1895, échappé au massacre. Il me supplia, comme
une faveur, de voir le fameux fusil, de le toucher et, enfin, de tirer une
fois. Mais le recul était si considérable que ce Noir, qui n'avait jamais eu de
pièce semblable entre les mains, tomba à la renverse après avoir tiré. Il se
releva, sans mot dire, et prit la fuite à toutes jambes, plus persuadé que
jamais que mon fusil était une arme merveilleuse dont j'étais le seul à pouvoir
faire usage. HeweI, de dorpschef vroeg mij of ik hem
herkende. Ik zegde van neen en hij legde me uit dat hij behoorde tot de
opstandelingen van 1895, dat hij was ontsnapt tijdens de aanval op de missie.
Hij smeekte mij, als een gunst voor hem, dat hij even het geweldig geweer mocht
zien, het even aanraken en als het mocht er even mee schieten. Hij schoot ermee
en de weerslag was zo heftig dat hij achterover viel. Hij richtte zich
vliegensvlug op en verdween zo vlug hij maar kon uit mijn ogen, zonder me nog
maar iets te zeggen. Hij had begrepen dat mijn geweer een wondergeweer was en
dat ik alleen het kon gebruiken. 46. Monseigneur Cambier. Over geheel de Kasaï werden missieposten
gesticht, de missiepost aan de oever van de rivier Lubudi, Merode San Salvador,
dichterbij, aan de andere oever van de Lulua, Hemptinne St Bénédict, verderop,
aan de rivier Sankuru, St Trudo nr 1 en nr 2, en bij de Kanioka Tielen St
Jacques. Het ganse gebied werd tot een Préfecture Apostolique uitgeroepen op 18
maart 1904. Pater Cambier werd er de
eerste apostolische prefect en mocht hij de titel van monseigneur dragen.
Hij ondertekende zijn brieven met "Emeri Cambier, missionnaire de Scheut,
le Préfet Apostolique du Haut Kasaï". 47. De oprichter van de eerste
Katanga-missie. Na heroïsche uren in Kasai te hebben beleefd, zal pater Cambier nog steeds worden opgemerkt door de oprichting van een van de eerste missieposten van Katanga in Ruwe, in 1909. Hij arriveerde daar met veel moeilijkheden, een bijl in de ene hand, een kompas in de andere, vertrouwend zoals zijn oudoom Jean Oehoust in Saint Christophe wiens standbeeld sinds de 14e eeuw in Flobecq werd vereerd. 48. Jean Dehoust. Jean Oehoust die voor dood werd achtergelaten tijdens de terugtocht van het leger van Napoleon uit Rusland in 1812, zocht al biddend zijn toevlucht bij de Grote Heilige, de heilige Christophe. Hij beloofde op 25 juli van elk jaar, tijdens de grote processie in Flobecq, een mis van dankzegging bij te wonen. Nauwelijks was de gelofte uitgesproken of er stopte een wagen in de buurt van de uitgeputte man die in de sneeuw lag. De halfdode man stak een arm op in een laatste gebaar om hulp. Het was zijn redding. 49. De pionier in de strijd tegen slaapziekte. Pater Cambier zorgde altijd voor een
actieve zorg voor de slapende zieke mensen. Hij maakte zelfs gebruik van een
verblijf in België om cursussen in tropische geneeskunde te volgen. Hij was ook
een van de eerste aanhangers van kinine ais
preventieve maatregel tegen de malaria. Als dosis nam hij één gram per dag en
dat schreef hij ook voor ais middel om de slaapziekte te behandelen. Hier is
uittreksel uit de brief die hij op 27 januari 1910 aan de Minister van Koloniën
richtte. Ik
heb de eer u de medicatie tegen slaapziekte te sturen die in een eerdere
correspondentie was besproken. Strikt genomen zijn er twee methoden die voor
mij hebben gewerkt en die ik voor de praktijk heb gecombineerd tot één. Zoals u
zult merken, zijn deze medicijnen niet nieuw ; de manier om ze afzonderlijk toe
te passen is nieuw. De eerste is de toediening van
kinine, in welke vorm dan ook, in zeer hoge doses en continu. De andere
medicatie is die van Fowler's drank (afkomstig van arseen zoals atoxil)
toegediend in hoge dosissen en zonder continuïteit. En de missionaris beschrijft, met luxe
en precisie van detail, de voordelen en de nadelen van deze twee manieren om
met de plaag om te gaan. Ook noemt hij de experimenten
die hij met deze voorschriften heeft kunnen uitvoeren. Emile Vandervelde
(1866-1938), een bekende socialist, reproduceerde in de krant "Le
Peuple" van zondag 27 maart 1910, de ontroerende oproep van de
missionaris. 50. De oproep van pater Cambier. Volg
mij, ik smeek u, naar een of ander lazaret dat de katholieke liefdadigheid
heeft opgericht om slapers op te vangen. Het is acht uur in de
ochtend. Degenen die nog steeds de sterkste zijn onder deze
ongelukkigen, hebben zichzelf reeds naar buiten gesleept, om hun ledematen te
verwarmen onder de liefkozingen van de zon, verdoofd aIs ze zijn door de kilte
van de mistige nacht in het droog seizoen. Sommigen hebben de stam van een boom
bereikt die op de grond lag, gingen erop zitten en vielen spoedig daarna in
slaap. Anderen die hun hoofd naar achter hebben laten rusten, verliezen
uiteindelijk hun evenwicht en vallen achterover. Anderen nog, eerst
voorovergebogen, hun handen Ophun knieën, storten al snel in elkaar, met hun
gezicht naar voren vallen ze op de grond. Enkele zieken van dezelfde categorie
leunden tegen een muur of tegen een paal van de palissade, en daar, met hun
knieën half gebogen, hun armen bungelend, hun ogen open, slapen ze rechtop. Als
we dan verzuimden ze wakker te maken, zouden ze blijven waar ze stonden en,
zoals zoveel andere ongelukkigen die verdreven of verdwaald waren in de
broesse, zouden ze worden getroffen door de kracht van de middagzon. Andere
zieke mensen die al minder robuust zijn, zoeken nog ijveriger dan de vorigen de
warmte van de opkomende zon op. Maar ze hebben hun
evenwicht niet meer onder controle, ze doen een gewelddadige poging om een paar
stappen naar voren te doen en zullen met hun lijf tegen de muur, een palissade,
de kale aarde of zelfs tegen andere zieken aanbotsen. Vaak, wanneer we naar het
lazaret gaan voor het ochtendbezoek, vinden we de deur geblokkeerd door een
hoop van hulpeloze mannen. Opstaan !
Een eerste ongelukkige is op de drempel gestrand, anderen zijn tegen elkaar
gestoten en hebben ze zich tot een betreurenswaardige cluster van
ineengestrengelde lichamen gevormd, terwijl gekreun, krampachtige tranen,
kreten van woede, de accenten van een wanhopige nood, zich laten horen. Zijn we
aan het einde van de menselijke ellende ? Nog niet. Zijn de ongelukkige mensen
die ik u presenteer nu nog in leven ? Het oog kan zich vergissen. Bekijk deze
uitstekende botten ais die van een skelet ingekapseld in de huid ; bekijk die
uitpuilende ogen, die neusgaten wijd open om wat lucht naar binnen te zuigen,
die met korstjes bedekte lippen, samengeklonterd door het vuur van de koorts,
deze gangreneuze mond waaruit een geelachtig speeksel ontsnapt dat in flodders
op de uitgemergelde borst valt : dit zijn onze slapers van de derde categorie.
En luister nu nog een keer. Ik was bij arme wezens met afschuwelijke zweren aan
hun ledematen. Soms bezielt een krampachtige beweging deze menselijke wrakken
waarvan de armen willen bewegen om een zwerm vliegen te verdrijven die
meedogenloos rottend vlees aanvallen. Ze zullen een poging doen om overeind te
komen en tussen hun losse tanden zullen ze twee woorden uitspreken "pijn
en vuur". Uiteindelijk, volledig uitgeput, zullen deze zieke mensen weer
in elkaar zakken op de mat. Hebt u het begrepen ? Het is
het verhaal van honderden en honderden ongelukkige mensen die, zonder het te
weten, een voet, een been, een arm, in het vuur hebben geduwd dat in het midden
van de hut brandt, en die er, gezien hun zwakte, niet in slagen om ze terug te
trekken. Het is in deze erbarmelijke positie dat we ze aantreffen, soms na
uren, soms na een hele nacht, waarbij de aangetaste ledematen alleen
zwartgeblakerd, opgeblazen vlees vertonen, tot op het bot gekookt. De pijn van
deze slechte slapers duurt vaak zeer lang. Voor het grootste aantal houdt de
doodstrijd vier tot vijf dagen aan. Zodra ze zich ln deze staat bevinden,
worden ze op een mat gelegd. De volgende dag vinden we ze in precies dezelfde
positie ais de dag ervoor, behalve dat de mond meer schuimend is, de ogen meer
glazig, de handen meer gebald en het hoofd meer naar achteren geworpen door de
kromming van de rug die zich spant ais een boog. Het is niet ongewoon dat een
karavaan mieren deze levende lijken 's nachts besluipt en met hun stalen kaken
brede voren ln het vlees graaft. Het hulpeloze slachtoffer beweegt niet. Dan
heb ik het nog niet over ratten en andere dieren die de onderste ledematen
aanvallen, dat doe ik om een exect beeld te geven van de verschrikkelijke
langdurige marteling voor deze ongelukkige mensen, terwijl hun intelligentie
nog steeds aile helderheid behoudt. Aan dit beeld dat Dante's inferno waardig
is, geloof me, kan er niets anders meer worden toegevoegd. En toch wel ! Hoor
die kreten van fel en diep gegrom, die roep van hyena's die zich verzamelen
rond een lijk waarvan ze de ingewanden doorzoeken. Het is verschrikkelijk.
Slaapziekte veroorzaakt bij bepaalde mensen woedende waanzin. Het is
noodzakelijk om deze ongelukkigen af te zonderen, ze maken vervaarlijke gebaren
en ze hebben datgene bij zich gehouden dat nodig is om de bruutste mens in
wreedheid te overtreffen. Op een dag vonden we een slaper wiens schedel was
verbrijzeld door een van deze gekken. Een andere slaper die een rottend lijk
verminkte, sneed een deel van het lijk af en verslond het vuile viees. Laten we
nog een stap verder gaan, de laatste. Kleine snotaapjes nog aan de borst,
proberend uit de borst van hun moeder, een stervende slaapster, melk te zuigen,
melk die al lang was opgedroogd. Het is dus nauwelijks mogelijk om toch op de
schoot van de vrouw het vermagerde kind te onderscheiden. Weldra, wanneer de
dood zijn werk zal hebben beëindigd, zullen we het kleine joch vinden in de
doodskist, het is vastgeklemd in de stijve armen van de moeder die het door een
opperste omhelzing bij haar wil houden tot in het graf. Maar zal
je zeggen, je lazaret heeft niets dan verschrikkelijke dingen te tonen. Dit is
zoo, Vele malen hebben we reizigers en staatsagenten daarheen gebracht. Na het
bezoek hebben deze heren nooit nagelaten hun dank te zeggen en eraan toe te
voegen : "Pater, Ik ben blij dit te hebben gezien ; maar er terugkeren,
nooit". Toch
is er ook een ander spektakel, het meest sublieme, een spektakel dat het oog
streelt en het hart verheft. Want net zoals de donkere nacht vervaagt voor de
dageraad, verdwijnt de treurige ellende die ik heb geprobeerd te beschrijven
voor de heldhaftige toewijding van de Zuster van Liefde van Gent, die met een
glimlach op haar lippen en een kruisbeeld op de borst, zich volledig overgeeft
aan de zorg voor deze weerzinwekkende afwijzingen van de menselijke soort. En
deze arme wrakken van lijdende mensen weten de barmhartige zelfverloochening
van de engel van liefde te waarderen, en zodra ze de Zuster zien, roepen ze tot
haar : "Baba, moyo"-"Dag, moeder". Ik heb
gesproken over ongelukkigen die zich in onze arme huizen hebben verzameld, maar
er zijn nog honderden, duizenden meer over de ganse streek. Slaapziekte
decimeert dorpen, ontvolkt regio's, is bezig met het vernietigen van hele
rassen. En we mogen niet schreeuwen tegen onze landgenoten, tegen de wereld,
tegen de hele mensheid : "Jammer voor deze ongelukkigen !"
Alsjeblieft, geeft ons steun en dit zonder uitstel. Deze mannen zijn onze
broeders, en we moeten hun zaak bepleiten, we moeten hun verschrikkelijk lijden
aan de hele wereld bekendmaken, omdat de hele wereld de plicht heeft om met
zulk ongeluk mee te voelen. Slapers zijn in de hoogste graad ons barmhartig
medeleven waard. Niet alleen beroofd van alles wat het leven zo niet
aantrekkelijk, in ieder geval draaglijk kan maken, zijn ze nog steeds belast
met kwaad, lijden en ellende. Ze worden uit hun huizen gejaagd, ze worden met
knuppels de broesse in gejaagd om daar van honger en van dorst om te komen.
Slaapziekte kent geen grenzen of gunsten ; ze spaart seks noch leeftijd ; ze
maait alles neer en is veel moorddadiger dan de meest verschrikkelijke rampen.
Zonder familie en zonder vrienden, de slaper, uitgeput door slaap, sterft waar
hij valt. En op dit uitgemergelde maar nog levende lichaam scheuren de
bloeddorstige varkens, zwermen er moordende vliegen en andere insecten rond,
zodat hun slachtoffer al snel een vormeloze stronk wordt, gemaakt van afschuw
en lijden. Welnu, deze ongelukkigen onder aile ongelukkigen van de wereld
hebben nog geen enkel geschikt ziekenhuis, en het is om dit onmisbaar
ziekenhuis te bouwen en het passend uit te rusten, dat ik bid en de pers van de
hele wereld smeek om dit te realiseren al beroep doende op de universele
liefdadigheid. Als Congo rijkdom in petto heeft voor de volkeren, dan hebben
deze volkeren toch vooral de plicht zich te interesseren voor het ongelukkige,
uiterst ongelukkige lot van hun broeders in Congo. We hebben een ziekenhuis
nodig dat de naam van ziekenhuis waardig is, deze talloze slachtoffers waardig,
onze beschaving waardig. Onze Zusters van Liefde zullen zich eraan wijden,
zoals ze tot nu toe hebben gedaan in smerige lazaretten. Een non, die leed aan
slaapziekte in Keseï, stierf in Gent. Een andere is ziek in Saint Trudon aan de
Sankuru. En toch, als we om zoveel nonnen vragen als er nodig zijn, zulen we ze
ook krijgen. Onze Paters zullen hun de meest genereuze steun verlenen. Onze
missionarissen, de priesters en de broeders, zullen dit onmisbare ziekenhuis
bouwen, zelf zullen ze hun handen in de mortel steken en weer bouwvakkers
worden. Geeft ons voldoende middelen om de ongelukkige slapers goed te
verzorgen. Als u voor hen iets kunt geven, doe dat dan, dit smeek ik u in de
naam van Christus. Ik dank u bij voorbaat namens hen en namens mezelf. Gesigneerd : Emeri CAMBIER, missionaris
van Scheut, apostolisch prefect van Haut Kasaï (Congo). 
De Kapel van het hospitaal van Luluabourg. 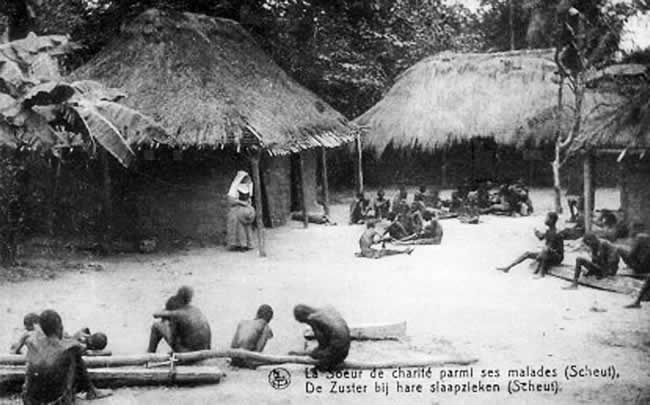
De Zuster bij haar slaapzieken. 51. Pater Cambier en een zieke zuster. Pater Cambier had een groot respect voor
de Zusters van Liefde die zich toch zo volledig inzetten om degenen te verzorgen
die leden aan die verschrikkelijke slaapziekte. Op 24 juni 1928 vertelde hij in
een toespraak over één van de Zusters die hij ontmoette tijdens een bezoek aan
de missiepost van Sint Trudo. Het
was in het jaar 1908. Ik was op bezoek bij mijn confraters op de missiepost van
St Trudo, niet zover van de staatspost van Lusambo. De dokter van deze
staatspost had me ingelicht dat de zuster die de zieke mensen die aan de
slaapziekte leden verzorgde, dat zijzelf ook de ziekte had betrapt. Hij had
haar bevolen om naar België terug te gaan om er zich te laten verzorgen. De dag
daarop, ik was een wandeling aan het doen op de grote missiepost met haar brede
wegen, verscheen plots voor mij die zieke zuster. Ik overdrijf geenszins maar
de zuster viel op haar beide knieën neer op de grond, vlak voor mij, met haar
armen naar mij gestrekt. "Mon
Père, le docteur vous a dit que je dois rentrer en Belgique mais je vous en
supplie, n'en faites rien. Laissez-moi mourir près de mes Noirs." De
arme vrouw begon diep te wenen. Ik kon niets anders dan haar wens vervullen.
Heb ik goed gedaan, heb ik slecht gedaan ? Enkele maanden later vernam ik dat
de zuster gestorven was te midden van haar zieke medemensen. Hoe heet die
zuster ? Ik ben haar naam vergeten. Waar bevindt zich haar graf ? Ik weet het
niet meer. Mesdames,
messieurs, c'est de la folie, comme la folie de votre héroïsme. C'est de la
folie de la Croix, la folie de la Charité. Depuis lors, je n'ai plus jamais
rencontré une Sœur sans la saluer bien bas et sans que ce souvenir me revienne
à la tête et au cœur. 
De Zuster met de zieken van de missiepost St Trudo bij Lusambo. 52. De Congregatie van de Zusters van Liefde. De Zusters van Liefde van Gent zijn een
Congregatie van vrouwelijke religieuzen die in 1803 door kanunnik Petrus Jozef
Triest werd gesticht in Lovendegem, in Oost-Vlaanderen. 53. De stichter van de Zusters van liefde. 
Kanunnik
Triest Jozef Petrus. Hij is de stichter van verschillende religieuze
congregaties o.a.; de congregatie van de Zusters van
Liefde en de congregatie van de Broeders van Liefde. 54. Nog een paar foto's. 
Een Zuster van Liefde in Luluabourg. 
Een groep van Zusters van Liefde in Luluabourg. 55. Een spijtig ongeval. Het ongeluk gebeurde op 30 september
1910. Enkele weken terug was er een diefstal gebeurd in het magazijn van de
missiepost. Buiten weten van de overste, van pater Cambier, had men een val
opgesteld aan de ingang van het magazijn, een koord
die verbonden was met de haan van een jachtgeweer. Pater Cambier ging het
magazijn binnen, hij raakte de koord aan, het geweer ging af en het schot
raakte de pater in de benen. De pater vloekte als een ketter. Men haalde 14
korrels uit de kuiten van de ongelukkige overste en de grote rest, een 40-tal,
bleven er voor altijd zitten. 56. Drie flinke missionarissen. 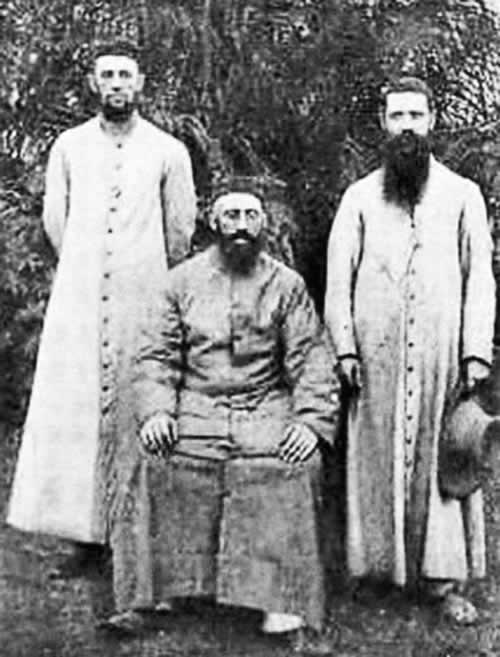
Pater Bracq Robert-Pater Cambier Emeri-Pater Vandermolen Leo. Een groep van Zusters van Liefde in Luluabourg. Pater
Bracq Robert, hij is geboren in Gent op 18-01-1881, hij is tot priester
gewijd in 1905, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1902, hij is vertrokken
naar de Kasaï op 20-09-1906, hij is gestorven in St Denys-Westem op 25-05-1962
in de ouderdom van 81 jaar. Pater
Vandermolen Leo, hij is geboren in Hoegaarden op 02-09-1869, hij is tot
priester gewijd in 1896, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1891, hij is
vertrokken naar Congo op 06-09-1896, hij is gestorven in Brussel op 20-01-1924
in de ouderdom van 54 jaar. 57. De inhuldiging van de tweetorenkerk. De Apostolisehe
Prefeet, Mgr Cambier, heeft op 27 augustus 1911 de grote tweetorenkerk
ingewijd. Gans' de missiepost was in feest. 
58. Het feest van 25 jaar priester en de jaloersheid. Op 20 november 1912 vierde men de 25ste
verjaardag van de priesterwijding van pater Cambier. Zijn priesterwijding had
plaats in 1887. De pater werd geëerd zoals het moest. Hij
was 47 jaar oud, hij was de Apostolisehe Prefect, hij had de grootste
missiepost uit Congo uitgebouwd, hij had versehillende andere bloeiende
missieposten gestieht. Soms werkte hij tegen de riehtlijnen van zijn Hogere
Oversten in, hij maakte een eigen bier, hij vormde zijn eigen mensen om de
missiepost te verdedigen, hij hield dossiers bij over de wandaden van sommige
staatsagenten. Hij had succes maar hij had ook vijanden, bij zijn eigen eonfraters,
bij de staatsagenten, bij de inlandse bevolking. 59. Met een vrouw in bed. Een zekere Niemba Johanna, de eerste christelijke vrouw op de missiepost, werd de rechterhand van Pater Gambier. Zij was het die in de dorpen de nodige aankopen deed voor de missiepost. Sinds 1911 circuleerden de geruchten dat Pater Gambier een seksuele verhouding had met deze vrouw, dat hij zelfs een kind bij haar had, dat pater Gambier ervoor had gezorgd dat het kind stierf. Er volgde een rechtszaak die geleid werd door de Procureur du Roi, een zekere Munck die afkomstig was uit Noorwegen. In 1913 volgde de uitspraak : un non-lieu / een vrijspraak. 60. Het raar beestje. Heeft pater Gambier een verhouding gehad
met een zwarte vrouw ? Misschien wei, misschien niet. Dat heeft niet zoveel
belang. Wat belangrijker was is het feit dat hij beschuldigd werd van
kindermoord en waarvan hij werd vrijgesproken. De priesters en de kloosterlingen
spreken drie geloften uit waaronder de gelofte van zuiverheid, Ze gaan voor
eeuwig en altijd de verbintenis aan om zonder vrouw door het leven te gaan. Hoe
is dat mogelijk ? Dat is toch tegen de natuur van de mens. Niemand kan u toch
verplichten om een dergelijk engagement aan te gaan en toch gebeurt het. De eerwaarde zuster : voor het leven zal
ik niet huwen, zal ik nooit kinderen hebben. De eerwaarde pater of de eerwaarde
broeder : voor het leven zal ik nooit een vrouw bevruchten, zal ik nooit
kinderen hebben. Eike gemeenschap die voor het leven het
celibaat eist van zijn leden, elk klooster dus, zou moeten verboden worden want
dat is tegen de rechten van de mens. Toen ik gedurende vijftien jaren in de
Kasaï verbleef gebeurde het bijwijlen dat een confrater, een pater of een
broeder, bij een zwart meisje een kind verwekte. Als u de natuur geweld aandoet
dan, vroeg of laat, wreekt de natuur zich. Waar het raar beestje kruipt dan
vindt het steeds zijn weg. Dat ondervond een bisschop van Brugge, dat ondervindt
een lid van het Lagerhuis in Londen of Jan Fabre uit Antwerpen. Gelukkig was er
voor de katholieke zondaars de biecht, dit sacrament, waarin hij vergiffenis
kan krijgen voor al zijn zonden, grote of kleine, vuile of zeer vuile. De stoute pater of de stoute broeder
verdween plots uit de samenleving, hij ging naar België of hij ging werken in
Duitsland of in een ander missiegebied. Dat alles werd met de mantel van de
liefde bedekt. Maar voor hem is het ook een groot drama als hij eraan denkt dat
ginds, in het verre Congo, een kind van hem rondloopt, dat het hem nooit vader
zal noemen want het kind kent zijn vader niet. De congregatie betaalde aan de familie
van het meisje een grote som gelds uit en het mulattenkind kwam meestal in een
weeshuis terecht zoals ook de kinderen van kolonialen tijdens de kolonisatie
die in Europa een vrouw hadden maar die bij hun zwarte maîtresse kinderen
hadden die bij hun terugkeer naar het moederland bij eerwaarde Zusters werden
ondergebracht. Een schande voor die eerwaarde Zusters en een nog grotere
schande voor die mannen die hun kinderen in de steek lieten. De Kerk van Rome eist van haar zwarte
priesters zoals overal in de wereld dat ze in celibaat leven. Het is niet aan
mij, een uitgetreden priester die gehuwd is, om het celibaat aan te vechten. De
zwarte priesters zullen dat zelf doen. Bij hun wijding tot diaken beloven ze
plechtig nooit te huwen. Eenmaal priester ontdekken ze de harde werkelijkheid
van het celibaat. Ze trouwen niet maar ze leven toch met een vrouw, ze hebben
kinderen. Laat de man man zijn, laat de vrouw vrouw zijn maar legt aan niemand
het celibaat op. Het verplichtte celibaat is niet gemaakt voor Afrika zoals
trouwens ook voor nergens anders in de wereld. De zwarte priesters doen ondertussen
wat ze willen want Kinshasa is Rome niet. 61. Het vertrek uit Congo. Geheel deze trieste affaire rond pater Cambier had plaats in speciale omstandigheden toen in België de Liberalen en de Socialisten een aanval deden tegen de katholieke missionarissen die het onderwijs helemaal in handen hadden. Ze beweerden ook dat pater Cambier in Luluabourg St Joseph de jongens die uit de slavernij kwamen veel te lang op de missie hield. Pater Cambierdeed werkelijk alles om de wezen langer op de missie te houden en dit tegen de wetten in. Ze zegden ook dat pater Cambier nauwe banden had met de Compagnie du Kasaï die sinds 1902 werkzaam was in de streek om caoutchoux op te halen. Hij bood veel van zijn jonge mensen aan om ais dragers voor die Compagnie te werken en de inkomsten werden op de rekening van zijn Congregatie gestort. In 1913 tenslotte besloten zijn Hogere Oversten hem terug te roepen. Hij moest zijn missiepost verlaten om als raadgever te fungeren in Rome, op het Vaticaan, bij de diensten van de Propaganda des Geloofs. 62. De kracht van verandering. Zoals hij en zijn confraters het deden
in Moanda, in Berghe Ste Marie, in Nieuw-Antwerpen, zo had pater Cambier zijn
missiepost in Mikalayi opgebouwd rond het opvangen van vrijgelaten of
vrijgekochte slaven en het verzorgen van kinderen, jongens en meisjes, die door
de staatsagenten aan de paters werden toevertrouwd. Reeds vlug deden de paters
beroep op Zusters uit hun vaderland om zich bezig te houden met de opvoeding
van de meisjes. De jongens zouden huwen met de meisjes en zo zouden echte
christelijke dorpen ontstaan. Doch in de omliggende
dorpen werden er geen bekeringen gedaan. De missieposten zouden, zoals bij ons de abdijen in de Middeleeuwen, stilaan de buitenwereld
beïnvloeden. Dit was hun droom. In de Kasaï, naast Luluabourg St Jozef,
werden andere burchten gebouwd rond de slaven en de kinderen. Pater Alex Senden
werd overste van St Trudo, pater Garmyn Juul werd overste in Merode, pater
Seghers Karel werd overste in Hemptinne, pater Stroo Kamiel werd overste in
Tielen St Jaak. Een andere pater, een dichte medewerker van Pater Cambier en
door deze opgeleid, zou later zelfs zijn Provinciaal worden en de eerste
bisschop van de Kasaï worden. Zijn naam is De Clercq August. Pater De Clercq bestudeerde de taal en
maakte een eerste woordenboek van het Tshiluba. Hij zal er pater Cambier en de
andere confraters ertoe aanzetten om catechisten te vormen en naar de dorpen te
trekken om er het geloof te preken. Uiteindelijk zouden op de centrale
missiepost twee paters verblijven, de overste die de mfumu, de chef was, en de
schoolpater die voor de scholen zorgde. Een derde pater, de reispater, zou als
taak hebben naar de dorpen te trekken om de catechisten bij te staan. Pater
Senden Alexis, zie hoofdstuk 29, In luttele woorden. Pater
Garmyn Juul, zie hoofdstuk 20 : Een onder onsje met pater De Deken. Pater
Seghers Karel, hij is geboren in Gistel op 10-01-1868, hij is tot priester
gewijd in 1896, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1891, hij is vertrokken
naar Congo op 06-09-1896, hij is gestorven in Brugge op 21-08-1939 in de
ouderdom van 71 jaar. Pater Stroo Kamiel, geboren in Moerkerke op 03-01-1873, hij is tot priester gewijd in 1897, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1892, hij is vertrokken naar Congo op 06-09-1897, hij is gestorven in Londen op 31-08-1916 in de ouderdom van 45 jaar. Pater De Clercq August, hij is geboren in Avekapelle op 30-04-1870, hij is tot priester gewijd in 1893, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1889, hij is vertrokken naar Congo op 06-09-1893, hij is gestorven in Schilde op 28-11-1939, in de ouderdom van 69 jaar. Hij werd tot bisschop gezalfd in het jaar 1918. De Zwarten gaven hem de naam van Kele Katwe, het Scherpe Mes, omdat hij bij palabers vlug de oplossing aangaf. In Mikalayi werd een huis gebouwd voor de bisschop. De Kerk groeide en bloeide overal in het grote land. Bij de Witte Paters werd reeds in 1917 de eerste zwarte priester gewijd. In de Kasaï zou dit eerst gebeuren in 1934 toen een zekere Charles Mbuya tot priester werd gewijd. Pater Seghers verliet Hemptinne voor Kabwe waar hij de plaatsen aanduidde om er een Klein Seminarie en een Groot Seminarie te bouwen. 
Het Klein Seminarie in Kabwe. 
Het huis van de bisschop in Mikalayi. 63. Pater Cambier, pastoor in Roselies. In 1914 wil pater Cambier opnieuw naar
Congo vertrekken maar zijn aanvraag wordt afgewezen en hij keert terug naar
België. Hij wordt in het begin van oorlog '14-'18 benoemd ais pastoor in
Roselies, bij Châtelet, waar hij de pastoor Joseph Pollart vervangt. Die
priester was op 23 augustus 1914 door de Duitsers gefusilleerd. Een straat in
Flobecq draagt zijn naam en in de kerk bevindt zich een glasraam die zijn
tragische geschiedenis vertelt : de priester had zich aangeboden om de plaats
in te nemen van twee jonge huisvaders die door de Duitsers zouden gefusilleerd
worden. 64. Priester Pollart. 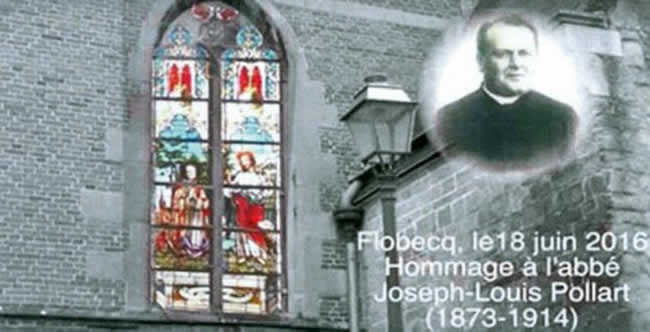
Pastoor Pollart is afkomstig uit Flobecq waar ook Pater Cambier geboren is. 
Priester Pollart Joseph, geboren in Flobecq op 17-07-1873, gestorven in Roselies op 23-08-1914. 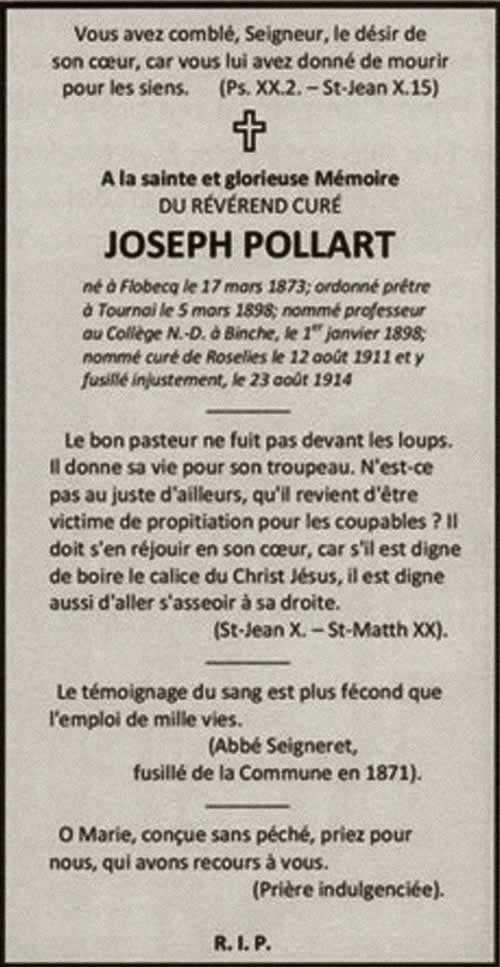
Een aandenken aan de heldhaftige priester. 65. Gevangen door de Duitsers. Pater Cambier was van niets bang en
vanop de preekstoel sprak hij stoere taal die niet zeer behaagde aan de Duitse
bezetters. Hij werd eerst gevangen gehouden inde kazerne van Charleroi.
Vervolgens werd hij overgebracht naar Duitsland waar hij moest werken eerst in
Anrath (Krefeld), vervolgens in Hozminden. Nochtans de laatste maanden van zijn
gevangenis werden verzacht want die mocht hij doorbrengen bij de monniken van
Büren, een stad in de deelstaat NoordRijn-Westfalen. Een feit is dat hij in
Duitsland werd vast gehouden van 4 juni 1915 tot 18 november 1918. We weten
verder niets over zijn verplicht verblijf in Duitsland. 66. Op vakantie bij zijn broer. Na zijn terugkeer uit Duitsland verbleef
Pater Cambier bij zijn broer-priester in Châtelineau. Hij was nog altijd goed
ter tale en te pote. Een tandarts had al zijn tanden getrokken en hem een nieuw
gebit gegeven en dat zonder hem maar iets te vragen. Pater Cambier stuurde hem
twee opgezette olifantentanden met een bos bloemen en met er bovenop een
kaartje waarop hij schreef : Je rends
toujours oeil pour oeil, dent pour dent. 67. Pastoor in Mellet. Vervolgens werd hij tot in 1925 pastoor
in Mellet waar hij een likeur maakte die hij "la Flobecqoise" doopte. 68. De kluizenaar in Croix-Monet (Aische-en-Refail). 
L'ermitage accolé à la chapelle de la Croix-Monet. En 1925, à l'âge de 60 ans, il se retire
dans la chapellerie namuroise de la Croix-Monet. Il y restera pendant 18 ans.
Le Père Cambier se disait fier d'être à Croix-Monet le gardien du sanctuaire où
l'on vénère une vierge miraculeuse sous le vocable de "NotreDame des
Affligés". Malheureusement la statue a été volée vers les années 1970. Pater Cambier ontving regelmatig mensen,
gewone mensen en ongewone mensen. Hij luisterde en aan wie wilde gaf hij
raadgevingen. Zelfs de kroonprins, de toekomstige koning Leopold III, kwam
verschillende keren bij hem op bezoek. A tous ceux qui l'approchaient, le Père
Cambier montra bonhomie, bonté, humilité. 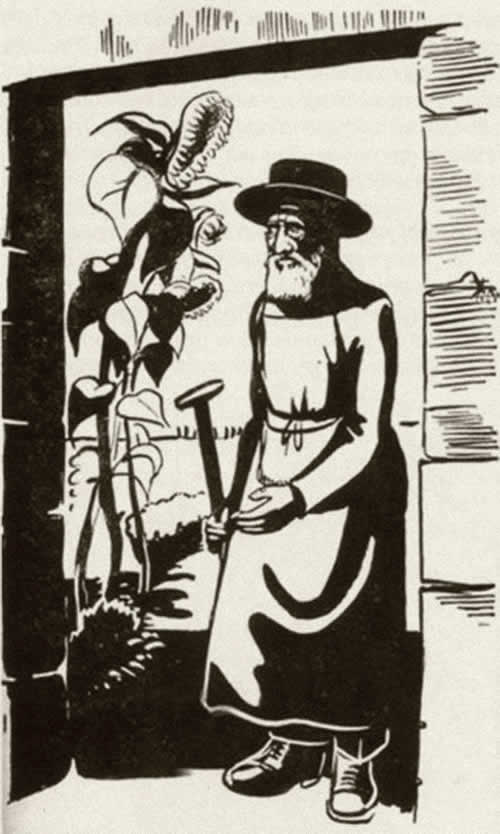
Pater Cambier als kluizenaar. 69. 50 jaar priester. Op 21 november 1937 vierde men de
50-jarige verjaardag van zijn priesterwijding: 1887-1937. 70. 50 jaar terug. Op 10 juli 1938 viert men de 50-jarige
verjaardag van zijn vertrek naar Congo : 1888-1938. Deze viering begint met een
dankmis in de kathedraal van Namen. De plechtigheid gaat verder door op de
"Place d'armes". Het militair orkest speelt en een bataljon soldaten
defileert voor de held. Ze worden gevolg door de Kadetten en de leerlingen van
de scholen van Namen. Vervolgens legde pater Cambier bloemen neer voor het
standbeeld van koning Leopold II, de koning van België en van de Vrijstaat.
Tenslotte begeeft men zich aan tafel waar pater Cambier een lofrede afsteekt
voor al degenen die gestorven zijn voor Congo. Il
n'y a pas au monde des missions comparables à celles du Congo. Notre Colonie,
ce bijou, à côté de ses richesses spirituelles, œuvre de la charité, en
renferme d'autres, trop peu connues et appréciées. Ce Congo, nous le garderons
: il est à nous, car le cœur des indigènes est à nous. Nous le défendrons s'il
le faut. Mais nous le garderons. Que tous, croyants ou incroyants, aient ce
soir une pensée et une prière pour ceux qui sont morts pour lui. Les convives font un applaudissement sans
fin pour ce missionnaire courageux. 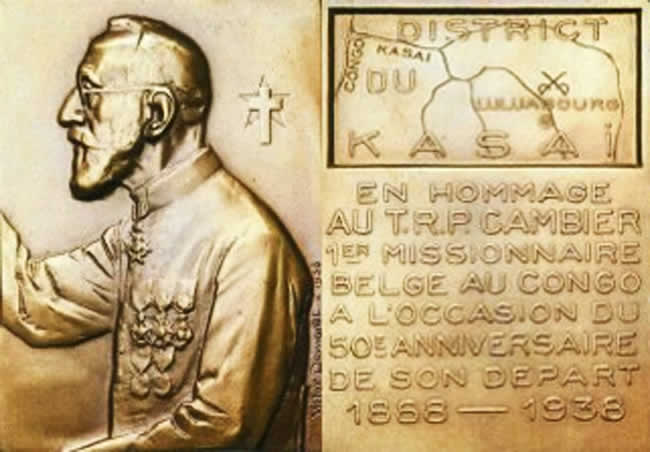
La plaquette en l'honneur du Père Cambier (recto et verso) 71. De dood van pater Cambier. Op 29 septernber 1943, overlijdt pater
Cambier Emeri in het hospitaal Sainte Elisabeth van Namen. Dat hij ruste in
vrede. 72. Het slotwoord. Welk voor een mens was in werkelijkheid
pater Gambier ? Zonder twijfel was hij iemand zonder weerga, iemand die een
bovenmenselijke kracht in zichzelf bezat. Hij had de reputatie altijd als
eerste in actie te treden, hij was altijd op de eerste plaats, daar waar er
gevaar was. Hij was een man met een vaste overtuiging, onafhankelijk in zijn
denken en in zijn daden, Een fiere mens ook, een echte missionaris die moedig
alle ontberingen aannam, die nooit klaagde en respect vertoonde jegens zijn
oversten zelfs als ze niet met hem akkoord waren, hij die als de Koning van de
Kasaï werd beschouwd. Al denkend aan Pater Gambier willen we hulde brengen aan
alle missionarissen zo mannen als vrouwen die begraven liggen op Afrikaanse
grond. We willen ook verbonden blijven met aile mensen uit Gongo die ook onze
broeders zijn. 73. De kerkelijke indeling van Congo. 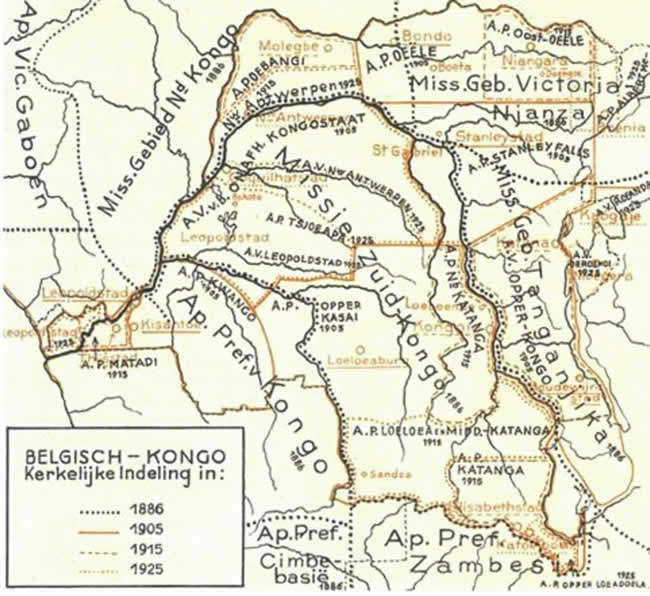
74. Een vergadering op hoog niveau. 
Staande
van L. naar r. :
Pater Nivard (Mill-Hill) - Pater Donsen (Trappist) - Pater Cambier (Scheutist)
(Préfet apostolique du Kasaï) - Pater Heintz (Redemptorist) (Préfet apostolique
du Matadi) - Mgr Grison (Congregatie van het Heilig Hart) (Vicaire apostolique
van de Falls) Zittend
van L. naar r. :
Pater Banckaert (Jezuïet) (Préfet apostolique du Kwango) - Mgr Roelens (Witte
Pater) (Vicaire apostolique du Haut-Congo) - Mgr Van Ronslé (Scheutist)
(Vicaire apostolique du Congo-Belge) - Pater Derickx (Prémontré) (Préfet
apostolique de l'Ouellé) . 
Mgr Roelens Victor (1857-1947). 
Mgr Emile Gabriël Grison (1860-1942). 75. Bronnen. 1.- « Le Père Cambier », Albert Mariaule, Editions Grands Lacs Namur, 1948. 2.- « Dans la brousse congolaise, les origines des missions de Scheut au Congo », R.P. Leon Dieu, Editions Maréchal, Liège, 1946. 3.- Note sur la démission en 1914 d'Emeri Cambier Préfet, Flavien Nkay Malu dans la revue « Histoires et missions chrétiennes » Karthala, 2008/4 N° 8. 4.- « Emeri Cambier (1865-1943) fondateur de la mission du Kasaï : la production d'un missionnaire de légende ». En: Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour: actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles, Textyles-éditions, Kinshasa, Ed. du trottoir, p. 39- 74, Jean-Luc VELLUT. 5.- Le lecteur intéressé trouvera sur le site suivant un magnifique reportage d'une religieuse de la Charité racontant son voyage jusque Luluabourg en détaillant la vie des missions des sœurs de la charité de Gand. Ce reportage sous forme de lettres porte comme titre : Voyage au Congo, lettres d'une sœur de Charité de Gand par une Sœur de Charité de Gand, publié en 1905. 6.- De Elenchus defunctorum van de Congregatie van de Scheutisten. 7.- "Twee jaren in Kongoland" van pater De Deken Constant. 8.- "Een held uit Balgerhoeke" van De Clerck Urbanus. 9. "De evangelisatiemethode van de missionarissen van Scheut" van L. Anckaer. 76. Notas. 1.- La congrégation du Cœur Immaculé de
Marie fut fondée par le P. Théophile Verbist, aumônier à l'Ecole royale
Militaire de Bruxelles dans le but d'évangéliser la Mongolie. Le Père Verbist
s'y rendit avec trois autres missionnaires en 1865. Il devait y mourir en 1868.
2.- Le Père Huberlant naquit à
Marchienne-au-Pont, le 18 décembre 1853, fit ses humanités à Enghien. Ordonné
le 13 octobre 1878, il est nommé professeur à Chimay puis vicaire à Binche. Il
entre dans la Congrégation de Scheut le 21 mai 1888. Rentré à Scheut, malade,
il y meurt le 24 mars 1893. 3.- Le Père De Backer est né à
Moustier-au-Bois le 6 décembre 1853. Professeur à Ath puis vicaire à Flobecq
puis à St-Piat à Tournai et enfin à Gosselies ; il entre dans la Congrégation
de Scheut en 1888. Il meurt à Nouvelle-Anvers, le 21 février 1892. 4.- Le Père Gueluy est né à Anvaing le
23 avril 1849. Effectue ses humanités à Enghien. Entre ensuite dans la
Congrégation de Scheut en 1875. Part en Mongolie puis au Congo. Occupe
différentes fonctions importantes dans la congrégation avant de succomber à
Scheut le 22 décembre 1924. 5.- Berghe Ste Marie fut ainsi nommée en
mémoire de Mgr Oswald Van den Berghe qui avait fourni les ressources
nécessaires à cette fondation et qui avait obtenu du Saint-Siège que la Ste
Vierge fut déclarée « Patronne du Congo ». 6.- Les premières religieuses à
Luluabourg St Joseph furent Sœurs Albanie, Godelielve, Humilienne, Hydina et
mère Amalia. Sœur Humilienne mourut à Luluabourg le 29 décembre 1950. 7.- Lieutenant Cassart Florent
(1869-1913). Déjà célèbre au Congo pour avoir accompagné Alexandre Delcommune
dans son exploration du Katanga. En rentrant de cette expédition de trois ans,
il voulut combattre les esclavagistes et se mit sous les ordres de Dhanis. Il
prit part à l'assaut de Nyangwe. Rentré en Belgique, il est reçu et félicité
par Léopold II. A Luluabourg depuis 1884, il se distingue encore en luttant
contre les guerriers de Kalamba, le chef des Kiokos. 8.- De lijst van de Algemene Oversten van de Congregatie van Scheut in de 19de eeuw. Verbist Theophiel werd Algemene Overste in 1862. Vranckx Frans werd Algemene Overste in 1869. Van Aertselaer Jeroom werd Algemene Overste in 1888. Van Hecke Adolf werd Algemene Overste in 1898. 77. De schrijver. Patrick Loodts. Un médecin belge, passionné d'histoire, créateur
du site Internet de Médecins de la Grande Guerre, auteur de La Grande Guerre
des soignants. Nota
1. Vandaag, de 19-03-2022, had ik een telefoongesprek met meneer Loodts.
Hij is geboren in Gongo, in Bukavu, hij heeft later ais dokter vijf jaar in
Afrika gewerkt, hij is nu 69 jaar oud. Hij verheugt zich over het feit dat ik
zijn schrijven over Gambier vertaal naar het Nederlands en hij vertelt dat
hijzelf Vlaamse voorouders heeft. Nota
2. Cher monsieur, Avec grand plaisir je vous envoie deux de mes libres et
je vous remercie en même temps du fait que vous m'avez donné la permission de
traduire votre texte concernant le père Gambier. Je ferai éditer la traduction
chez mon éditeur de Wingene. De Gierek Urbain. 78. De vertaler. De Clerck Urbaan. Hij heeft priesterstudies gedaan, twee
jaar wijsbegeerte en vier jaar godgeleerdheid. In Leuven behaalde hij het
licenciaat in Klassieke Filologie en een diploma in de eerste
beginselen van de tropische geneeskunde. In Parijs volgde hij vrije lessen aan
de Sorbonne en verkreeg hij bij de Alliance Française het diploma om het Frans
te onderwijzen. Nota
1. De vertaling van het Frans naar het Nederlands is zeer vrij. Bij de
oorspronkelijke foto's worden er enkele anderen bijgevoegd. De
indeling van de tekst in kleine hoofdstukken komt van de vertaler. De inhoudstafel kornt eveneens van de vertaler. Nota
2. De Gierek Urbaan heeft verschillende boeken geschreven, onder meer : 1.
Een held uit Balgerhoeke. Een boek over Broeder De Jaeger, een Scheutist,
die in 1894 vertrok naar Gongo. Hij werkte in Berghe Ste Marie, in St Trudo bij
Lusambo, en in Merode San Salvador waar hij stierf in 1898 aan het
bloedwateren. Er zijn
nog enkele exemplaren te koop bij De Jaeger Ludwine, Zeeweg, 4, 9988
Watervliet-Oudeman. Tel. 093 79 70 43. De Clerck
Urbaan is een ex-Scheutist die een boek maakt over een andere Scheutist die
zoals hij geboren is in Balgerhoeke. Broeder Eduard vertrok in 1894 aan het
begin van de kolonisatie toen Congo in de handen viel van de Blanken en de Kerk
mede op verovering trok. De andere vertrok in 1959
toen de kolonisatie in vraag werd gesteld en hijzelf ontdekte dat Kerk en
Missie een illusie en een vergissing waren. Broeder Eduard schrijft zijn
brieven zoals hij spreekt, in een eenvoudige, volkse taal. Hij vertelt over
Negers en over Zwarten, maar hij houdt van zijn Negers en van zijn Zwarten en
hij heeft een groot hart voor de kleintjes onder hen. Broeder Eduard is groot
door zijn eenvoud. 2. Le boiteux de Stene. Een boek over een ex-Scheutist, een Broeder die lange jaren in Congo verbleef, van 1954 tot 1990. Als Broeder werkte hij in de Kasaï, als ex-broeder werkte hij in Lisala, in Lubumbashi en in Kinshasa. Er zijn nog enkele exemplaren te koop bij Roger Keters, Ooievaarslaan, 4, bus 0004, 8400 Oostende, tel. 059 55 11 72. Met een bijbedoeling geef ik hier ook zijn banknummer: BE 12 2800 4317 0592. Roger helpt mee bij het betalen van het drukken van dit boek. Daarom staat hij ook op de achterflap van dit boek. Avec De Clerck Urbain, son ami et compagnon de route, le lecteur ou la
lectrice de ce livre parcourt l'histoire époustouflante d'un garçon handicapé
de Stene qui malgré lui devenait religieux et missionnaire. Il part au Congo
quand ce pays était une colonie. Il enseigne, il construit des ponts et des
églises, il voyage de poste à poste. Il tombe amoureux d'une fille noire. Il se
marie quand il a cinquante ans, il aura cinq enfants. Il travaille dans la
forêt équatoriale. A Kinshasa il construit pour les Américains un bunker. A
Lubumbashi il travaille pour un Juif. A Gbadolite il collabore dans la
construction du palais de Mobutu. Il redevient un enseignant brillant jusqué ce
que le mauvais sort le frappe. Continuez doucement la
lecture. Vous le retrouverez comme Job de la Bible sur un fumier. Il crie au
ciel son malheur et sa misère mais jamais il ne perd son courage. 3.
Een kap, een haag en 275 bokkensprongen. Een boek waarin de schrijver, een
ex-Scheutist, o.a. vertelt over zijn wedervaren in Congo van 1959 tot 1992. Ais
pater werkte hij in de Kasaï, als ex-pater werkte hij in Matadi en in Kinshasa.
Er zijn geen exemplaren van dit boek nog beschikbaar. 79. De Spakke. Het was een mooie zomerdag van het jaar
2017. We vierden mijn geboorte die plaats had in 1927, in Balgerhoeke in het
Meetjesland van OostVlaanderen. Ik werd dus negentig jaar. Terzelfdertijd
vierden we ook de veertigste verjaardag van ons huwelijk dat plaats vond in
1977 in Matadi, in de Beneden-Congo. Ik heet Urbaan, mijn vrouw heet Hélène.
Een tachtigtal genodigden stonden mij en mijn vrouw op te wachten in de tuin
van de oude pastorie van Welden. De Spakke, de mankepoot, hij die met zijn been
sleurt, zat rustig in zijn rollator. Zijn dochter, Alice, stond naast hem samen
met haar zoontje Benjamin, een mooie krullenbol. De Spakke is vier jaar jonger
dan ik, hij is dus ook oud en bijna even versleten zoals ik. Zijn levensloop
gelijkt op de mijne. We waren allebei Scheutisten, allebei
waren we missionarissen in Congo, allebei begonnen we in de Kasaï. Hij was
broeder, ik was pater. Ik was de heer, hij was de knecht. Hij werkte in de
sacristie, ik stond bij het altaar. Ik trad uit in 1974, hij trad uit in 1981.
We bleven in Congo werken en wonen. We probeerden samen CTB'er te worden
(Coopérant technique Belge). Hij won, ik verloor. We waren allebei ver in de
veertig toen we trouwden met een jonge zwarte vrouw. Hij trouwde met Lulua
Marthe, een meisje van de stam van de Bena Lulua. Ze is van 1958. Ik trouwde
met Tshibuabua Hélène, een meisje uit dezelfde stam. Ze is van 1957. Ik kreeg
vijf kinderen, hij kreeg vier kinderen van eigen kweek en een zwart kind dat ze
adopteerden, dat is ook vijf. De meeste van onze kinderen zijn geboren in
Kinshasa en ze volgden les in dezelfde school, in dezelfde sectie, de Vlaamse
sectie van de Prins van Luikschool in Kinshasa aan de Avenue des Huileries. Ons
laatste kind werd geboren in België. Onze vrouwen spreken allebei het Tshiluba,
één van de vier landstalen in Congo. Wij ook spreken deze taal, Spakke zeer goed,
ik een beetje minder goed maar voldoende om biecht te horen en te preken
tijdens de mis. Zijn vrouw was er niet bij op het feest in Welden, een bijgemeente van Oudenaarde. Meer dan twintig jaar terug, in 1995, ze woonden toen in Middelkerke, verkochten ze hun appartement aan zee, een mooi appartement met drie slaapkamers. Met de helft van de opbrengst van de verkoop reisde moeder Marthe naar Congo om diamanten op de zwarte markt te kopen en opnieuw zoals voorheen rijk te worden. Met de andere helft kochten ze een verloederd huis waar de Spakke jarenlang aan werkte om het min of meer bewoonbaar te maken voor hem en voor de kinderen. De Spakke had indertijd veel geld verdiend in Congo. Ze kochten drie grote percelen grond in Kinshasa, ze kochten in Middelkerke een mooi appartement met zicht op zee. Ze kochten in Oostende een perceel met de gedachte er later een villa op te bouwen. In Congo hadden ze twee auto's, ze woonden in een appartement met airco, ze waren werkelijk rijke mensen toen. Alles echter verloren ze toen president Mobutu al de blanke medewerkers die door de Belgische Staat werden betaald het land uitzette. Ze gingen wonen in Middelkerke in hun appartement waar De Spakke een derde kamer bijmaakte. De ouders hadden hun kamer, de jongens hadden hun kamer, de meisjes hadden hun kamer. Hijzelf ging werken bij de stadsdiensten. Moeder Marthe was niet gelukkig. Ze was niet gewend om op de centente moeten passen. Ze liet in België haar man achter met vier opgroeiende kinderen en een peuter, een meisje van tweeëntwintig maanden. Moeder Marthe keerde nooit terug. Spakke zat ais Job uit de Bijbel op een vuile mesthoop, zonder rijkdom, zonder vrouw, maar nooit was hij verbitterd, nooit verloor hij de hoop op een betere toekomst. Na zeven jaar, zonder enig nieuws van zijn vrouw en overtuigd dat ze dood was, liet de Spakke haar officieel voor dood verklaren om alzo dubbel kindergeld te verkrijgen, wat hij kreeg. Toen hun oudste zoon William bijna twintig was, wierp hij zich in Beernem voor een trein, in 2002. Hij was op slag dood. Langs de telefoon vertelde de Spakke mij de dood van William en de dag en het uur van de begrafenis in Oostende. Hij weende niet. Als de arme Job uit de Bijbel aanvaardde hij zijn droevig lot. Mijn vrouw ging naar de begrafenis en zorgde dat de genodigden bij hem thuis een goede maaltijd kregen. Zijn tweede zoon, Philippe, een zeer goede voetballer, ontmoette slechte vrienden, hij nam drugs, hij dronk, hij verwaarloosde zijn studies. Tenslotte vertrok hij naar Brazilië om dat stinkend goedje over te smokkelen en veel geld te verdienen. Hij werd opgepakt en hij verbleef in de gevangenis van Rio. Na vijf jaar kwam hij terug als een sukkelaar, een blonde dertiger met kroezelhaar die zijn middelbare studies niet had afgemaakt en die niet weet hoe van hout pijlen te maken… Er waren wei een paar straaltjes hoop in het donker bestaan van Roger. Karelle, zijn jongste dochter, is op kot in Gent waar ze studeert aan de universiteit. Zijn andere dochter, Alice, genoemd naar zijn moeder, trouwde met een paracommando en ze kreeg een zoontje dat Benjamin heet. Zijn vijfde kind, Kapinga, een kind van het tweede huwelijk van zijn vrouw, woont in Halle bij Brussel als moeder van een groot gezin. Plots kwam er een telefoon uit Kinshasa. Het was moeder Marthe die uit de doden was opgestaan. Ze had een kind met zich en ze vroeg om geld op te sturen zodat ze naar huis kon terugkomen. Ze keerde niet terug. Ze bleef ergens hangen in Kinshasa, een miljoenenstad met veel dieven en veel moordenaars. Nu woont de Spakke helemaal alleen in Oostende, in een serviceflat waarvoor hij als huur zevenhonderd Euro's betaalt. Van zijn pensioen blijft nog vierhonderd Euro's over om er spaarzaam van te leven. Hij heeft geen auto meer want zijn dochter reed hem in de prak. De Spakke, de ex-Scheutist, Roger Keters is zijn naam, zat rustig in zijn rollator, zijn déambulateur zegde hij. Mijn oudste zoon, zijn petekind, had hem uitgenodigd op het feest. Onze wegen hebben elkaar dikwijls gekruist, eerst in Congo, later in België en nu, de laatste keer, in Welden, in de mooie tuin met eeuwenoude bomen en een donkere vijver. Als oude vrienden begroetten we elkaar met een lach op de lippen. 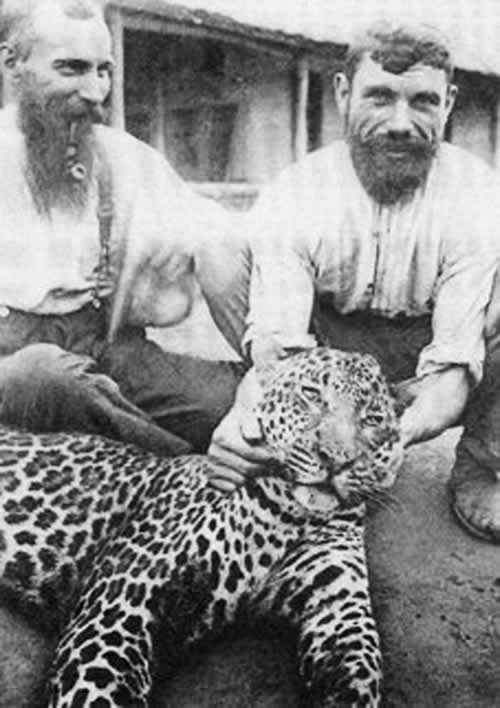
Een groet uit het oude Kongo. Eine,
24-04-2022. [1]
La congrégation du Cœur
Immaculé de Marie fut fondée par le P. Théophile Verbist, aumônier à l’Ecole
royale Militaire de Bruxelles dans le bit d’évangéliser la Mongolie ! Le
Père Verbist s’y rendit avec trois autres missionnaires en 1865. Il devait y
mourir en 1868 ! [2] Le Père Huberlant naquit à
Marchienne-au-Pont, le 18 décembre 1853.fit ses humanités à Enghien. Ordonné le
13 octobre 1878, il est nommé professeur à Chimay puis vicaire à Binche. Il
rentre dans la congrégation de Scheut le 21 mai 1888. Rentré à Scheut malade, il y meurt le 24 mars
1892 [3] Le Père De Backer est né à Moustier-au-Bois le 6 décembre 1853. Professeur à Ath puis vicaire à Flobecq puis à St-Piat à Tournai et enfin à Gosselies ; il entre dans la Congrégation de Scheut en 1888. Il meurt à Nouvelle-Anvers, le 21 février 1892 [4] Le Père Gueluy est né à Anvaing le
23 avril 1849. Effectue ses humanités à Enghien. Entre ensuite dans la
congrégation de Scheut en 1875. Part en Mongolie puis au Congo. Occupe
différentes fonctions importantes dans la congrégation avant de succomber à
Scheut le 22 décembre 1924. [5] Ainsi nommée en mémoire de Mgr
Oswald Van den Berghe qui avait fourni les ressources nécessaires à cette
fondation et qui avait obtenu du Saint-Siège que la Ste Vierge fut déclarée
« Patronne du Congo » [6] Les premières religieuses furent Sœurs Albanie, Godelieve, Humilienne, Hydina et mère Amalia. Sœur Humilienne mourut à Luluabourg le 29 décembre 1950 [7] Lieutenant Cassart Florent (1869-1913). Déjà célèbre au Congo pour avoir accompagné Alexandre Delcommune dans son exploration du Katanga. En rentrant de cette expédition de trois ans ; il voulut combattre les esclavagistes et se mit sous les ordres de Dhanis. Il prit part à l’assaut de Nyangwe. Rentré en Belgique, il est reçu et félicité par Léopold II. A Luluabourg depuis 1884, il se distingue encore en luttant contre les guerriers de Kalamba, chef des Kiokos. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©