 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Le brancardier Thans Hilarion raconte la vie à l’hôpital de Cabourg 
Le brancardier Thans Hilarion Introduction. Thans Hilaron est né le 12
janvier 1884. Il était le cadet d’une famille de 14 enfants. Il deviendra
prêtre en 1909 dans l’ordre des Franciscains. Thans
manifeste un talent d’écrivain et de poète. 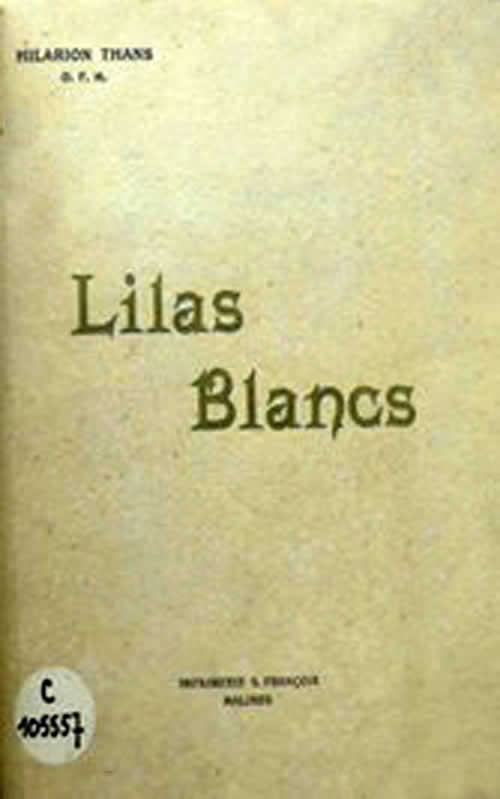
En 1915, il
publie en français un recueil de poésie « Lilas blancs » dont un
des poèmes « l’attente » est un hymne pour une armée belge qui, un
jour reviendra triomphante de l’ennemi. Ce poème lui vaut des menaces de
l’autorité militaire occupante et Thans décide alors
de rejoindre le front pour échapper à un emprisonnement qu’il sent inéluctable.
Son évasion, en décembre 1915, est rocambolesque puisqu’il arrive à atteindre la
Meuse via une bouche d’égout démarrant à la cure de Smeermaas
(Lanaken). 
Smeermaas avec son presbytère et son église, vu de la Maasbank. 
Révérand Lord Claes, pasteur de Smeermaas. Il
traversera ensuite le fleuve pour atteindre la Hollande. Arrivé en Angleterre,
il s’engage comme volontaire et est désigné comme élève brancardier à Auvours.Après sa formation, il est désigné pour l’hôpital
de Cabourg près d’Adinkerke qui vient d’être
abandonné par le chirurgien Derache au profit d’un
nouvel hôpital construit selon ses plans à Beveren. L’hôpital de Cabourg est dorénavant
sous le commandement du Dr Nolf qui le consacre uniquement aux soldats atteints de maladies. Thans arrive donc au moment où le « Cabourg
chirurgical » devient le « Cabourg médical ». Il occupera le poste de brancardier pendant
presque deux ans dans cet hôpital. De son
expérience, Thans tirera un livre très détaillé de
plus de 250 pages « Mijnoorlog ».Ce
témoignage est exceptionnel car Thans est un des
rares, si pas le seul soldat, à témoigner de la vie d’un brancardier dans un
hôpital de campagne. Ce livre n’a jamais été traduit en français. Pour combler
partiellement cette lacune, j’ai entrepris de résumer en français cette très
belle œuvre. Le lecteur sera certainement surpris par plusieurs témoignages de Thans qui nous éclairent beaucoup sur la vie quotidienne à
l’hôpital et en particuliers sur discipline à laquelle les brancardiers étaient
soumis, ainsi que sur les rapports qu’ils entretenaient avec les infirmières et
les patients… Le lecteur sera aussi surpris des séances d’autopsie auxquels Thans dut participer. A noter que l’univers très dur de
l’hôpital décrit par Thans
contient aussi des moments de joie avec des anecdotes truculentes qui peuvent
faire penser à celles qui figurent dans le film Mash
sorti en 1970 et qui, lui, concernait un hôpital militaire américain au Viet-Nam. Après la
guerre, Thans Hilaron fut
enseignant dans l’école des Franciscains à Rekem où
étudiaient les novices. Thans Hilarion continua aussi
d’écrire poésie et prose. Son souvenir reste très présent en Flandre où
aujourd’hui un concours de poésie porte son nom. Il est décédé en 1963. 
Condensé en
français du livre de Thans Hilarion « Mijn Oorlog » (Traduit et résumé par le Dr Loodts
P.) Le camp d’Auvours Voilà donc Thans débarqué en France après s’être engagé en Angleterre
comme volontaire. Il est alors dirigé en janvier 1916, vers le camp d’Auvours où se trouve le C. I.B.I. : le Centre
d’Instruction des Brancardiers-Infirmiers. Le premier contact consiste en son
inscription dans les registres, puis la prise du matériel réglementaire dont un
sac de couchage à remplir d’algues encore humides et parois moisies et qu’il
doit lui-même coudre. Ensuite c’est la connaissance avec la chambrée, une
baraque de 6 mètres de large sur 25 de long avec trois petites fenêtres. Le sol
est à nu mais c’est du sable. Au-dessus
des planches sur lesquels on dépose les sacs de couchage court une étagère sur
toute la longueur du mur. Dans cette baraque logent 32 prêtres-brancardiers
sous la direction d’un « Garde-chambre ». Une autre
baraque a été divisée en deux, dans la première partie se trouve des bancs et
tables devant servir à l’étude. L’autre partie est le dortoir des séminaristes
et frères. Thans se couche sur sa misérable couche et essaie de se reposer quand tout d’un coup
il perçoit une conversation au-dessus de sa tête. - Déjà au lit ce nouveau ? - Je crois qu’il est malade - C’est un beau début, je vais le couvrir d’une couverture sinon, il sera un
oiseau pour le chat car il tousse et le sol gèlera cette nuit ! Thans n’ose pas ouvrir les yeux, il se sent misérable. Plus
tard il apprendra que son protecteur est le nommé Jack Leyssens
qui après la guerre affrontera comme missionnaire le désert de Mongolie à Ortos. L’ambiance
est lugubre dans ce camp où l’on se sent perdu dans les 6.000 ou 7.000 hommes
qui y résident. Heureusement que l’ambiance dans la baraque des prêtres est
conviviale. Plus de trente prêtres dont beaucoup étaient des missionnaires
provenant de Constantinople, d’Egypte et du Congo. Les prêtres candidats
aumôniers pouvaient employer la salle des fêtes le week-end pour dire la messe
et la petite chapelle pendant la semaine mais les aspirants brancardiers
devaient utiliser leur chambrée comme lieu de culte. Cela commençait chaque
matin à 5h30 jusque 7h30 du matin. Plus de trente messes y étaient dites !
Cela faisait penser au temps des catacombes ou au temps de la révolution
française. Evidemment à côté des officiants, la vie continuait et que sur les
paillasses certains dormaient encore ou s’habillaient ou cassaient la glace de
leur bac afin de pouvoir se laver. Après cela,
venaient l’instruction militaire donnée par le sergent Louis qui était un
religieux instituteur. En français, on
leur donna la manière de plier nos couvertures, de cirer nos chaussures et
comment ranger le matériel sur l’étagère. Pendant des jours, on leur apprit
comment se tenir au lever du drapeau, comment réagir à la rencontre d’un
officier Général. Et même comment saluer si par hasard ils étaient à ce moment
décoiffés ou empêchés de saluer parce que les deux ou la main droite portaient
un objet. La théorie sur la manière dont ils devaient traiter les officiers se
terminait pas une phrase ronronnante : « …et
procurent leur gloire » que
retint toute sa vie Thans. Evidemment, les candidats
brancardiers ne pouvaient manquer la leçon sur la description des grades. Les
leçons du pauvre Louis à ce sujet ne trouvaient pas d’auditeurs assidus car
l’on considérait son cours comme le temps idéal pour rédiger l’abondant courrier
aux proches et amis. Evidemment, ne pas l’écouter portait à quiproquo lorsque
l’instructeur Louis se mettait à interroger ses élèves. - A quoi reconnaît-on un Général portant l’ancienne tenue ? Il fallait
répondre à deux galons qui tournent et à un qui monte. Mais le futur brancardier
Maréchal répondait par la même réponse à la question concernant les grades du
colonel et du sous-lieutenant. Le pauvre Louis ne savait plus comment s’y
prendre pour enseigner ses cancres ! Quand il
demanda à Hauspie, le missionnaire de Constantinople ce qu’il devait faire s’il
rencontrait un général, ce ne fut pas mieux que la réponse de Maréchal sur les
grades. Hauspie répondit : - Je fais face et halte à quatre pattes ! (au lieu de : je fais
face et halte à quatre pas) Bien
évidemment l’examen sur ces matières du savoir-vivre militaire constitua une
véritable délivrance. Le drill fut
aussi souvent séance de rire. Nos 6 moines trappistes y étaient vraiment
rebelles. La manière
de demander la visite médicale était parfois très compliquée pour un militaire
néophyte. Il arriva un
jour que Thans fût malade et un matin à 7 heures, toujours dans son lit, un
gradé lui demanda alors s’il s’était inscrit dans le cahier des malades comme
« malade au lit ». Hilarion Thans ne connaissait
pas encore le système et fit part de son ignorance : « Que dois-je
faire ? » Le gradé lui répondit : Si vous n’êtes pas inscrit
dans le cahier des malades, vous devez
vous lever ou vous recevrez 6 jours d’arrêt. Le jour suivant quand un gradé, le
livre des malades en mains cria dans la salle :
« Malades ? » Hilarion cria son nom « Thans ».
Le gradé s’approcha alors de son lit et lui demanda : « Rapport ou au
lit ? ». Thans crut préférable de
s’inscrire au rapport (le rapport pour la
visite médicale au bureau du docteur) du docteur à 8 heures. Mais arrivé dans
l’infirmerie, il constata qu’il y avait au moins 200 hommes occupés à patienter
devant le bureau des docteurs afin de pouvoir être examiné. Après une attente
de deux heures, le tour de Thans vint enfin. Il
pénétra dans la salle où se trouvaient deux docteurs, un de chaque côté. Les
médecins étaient accompagné de leur servant qui traduisait les plaintes des
flamands. Ceux-ci avaient beau expliciter leur cas longuement, l’assistant se
tournait vers le docteur et résumait la pathologie en deux coutres phrases,
soit mal à la tête, soit mal au ventre. Il y avait seulement deux
remèdes : la teinture d’iode ou la quinine. Thans
eut droit à trois comprimés de quinine et à une consultation spécifique au
cabinet spécial afin que l’on examine ses oreilles. Il se mit alors à la
recherche du cabinet spécial, le trouva mais à 15 h45, il s’entendit
dire : « Finis pour aujourd’hui, revenir demain ». Les jours suivants se fut le même
scénario : une attente continuelle jusqu’à l’heure de 16 heures sans
pouvoir être examiné. Le troisième jour, il put enfin pénétrer dans le cabinet
ORL mais le médecin refusa de l’examiner car Thans ne
possédait pas « la demande écrite du médecin de l’infirmerie ». Il
renonça alors à la visite spécialisée, retourna sur sa couche et se déclara
cette fois « malade au lit ». Il reçut alors trois nouveaux comprimés
de quinine et 6 jours d’exemption de service. A trois
heures de l’après-midi, un autre jour, Thans eut la
surprise d’avoir l’inspection « dépaquetage » effectué par le
lieutenant surnommé « Chocolat ». Le sergent Louis donna les derniers
conseils : « Votre sac de
couchage doit être cousu, regardez à tous les boutons et coutures de votre
équipement, frotter cuiller et fourchette, avec un linge mouillé, nettoyer
l’intérieur des souliers. Les pieds sont nettoyés et votre équipement doit
briller et les semelles des souliers doivent être sans un grain de sable… Commencez
par tout cela, je reviens dans deux heures… » Quand il
revint, ce fut pour d’autres conseils : le sac ne pouvait présenter ni
creux, ni bosses. Dans le sac, rien de plus ou de moins que l’équipement
règlementaire signalé par le « feuillet 13 ». Tout ce qui n’est pas
prévu comme les livres, carnets, vivres… doit être soigneusement empilé sous le
sac. Les vêtements doivent être pliés de manière réglementaire… Enfin le
lieutenant pénètre dans le bloc pour l’inspection. Le garde-chambre crie :
« à l’ordre ! » C’est
alors l’immobilité et le silence. Chacun est debout en position fixe sauf… Thans qui vient de se déclaré malade au lit. « Chocolat »
rouspète sur un bouton, sur une tache de rouille puis s’approche de la couche
de Thans. « Celui-là est malade, explique le
sergent Louis ». Chocolat avertit : « Si quelqu’un tire sa carotte,
qu’il prenne garde ! » Pas de
chance pour Bertrand, le voisin de Thans, il y a du
sable entre ses orteils ! Il devra subir un nouvel « Dépaquetage »
la semaine suivante ! Après une demi-heure, Chocolat s’en va. Deux Pères Blancs
s’exclament : « Et c’est pour cela que nous avons quitté le
Congo ! » « Les amis, reprend un curé francophone,
pas de panique, avec de tels dépaquetages, les Allemands peuvent bien se tenir
tranquille ! » Le frère Kartuizer est décédé. Qui était-il ? Personne ne le
sait vraiment. Un garçon calme qui avait pris froid et qui ne se plaignait pas.
Le docteur lui avait prescrit trois comprimés de quinine mais cela ne fit rien
sur la double pneumonie. Chacun y va pour se décharger de sa responsabilité. Le
docteur traite les autres « frères » d’idiots pour ne pas avoir vu
l’état grave de leur compagnon de chambre ; le lieutenant est dans ses
petits souliers et le colonel demande pourquoi on ne l’a pas fait hospitaliser
à l’hôpital. « Il ne semblait pas
en avoir besoin, dit le docteur et de toute façon, il n’y a jamais de
place » L’enterrement
doit se passer de façon digne. Le cercueil est veillé dans la baraque 46 entre
deux candélabres. Les « Cibistes » veillent nuit et jour leur
compagnon. Puis viennent rendre hommage les autorités en grande tenue,
décorations sur la poitrine et le sabre qui pend sur le côté. Après la levée du
corps, le cercueil est conduit au cimetière du village Champagné. C’est la
première fois que Thans sort du camp. La mère du
décédé vit-elle encore ? Personne ne répond. Plus tard, à table, on
procède à une collecte pour acheter une croix funéraire. Chocolat a reçu dix
francs pour la croix et son inscription. Le curé francophone lui dicte l’inscription « Tombé pour la patrie ». La formation
touche à sa fin. Les « Cibistes » ont malgré tout progressé dans le drill et le lieutenant ose les emmener
dans quelques marches printanières sans devoir rougir de ses hommes. Dans les
villages traversés, on leur lasse une demi-heure de temps libre. Les hommes se
rendent d’abord à l’église et puis écument les magasins et cafés. Un beau
jour, c’est l’appel et la désignation des postes sur le front. « On demande 25 brancardiers pour Cabourg
et l’on donne la priorité aux religieux. » Thans se porte volontaire et le voilà parti. L’hôpital de
Cabourg, près d’Adinkerke vient de changer de visage.
De « chirurgical », il devient maintenant « médical »,
consacré aux maladies infectieuses. Tous ses occupants, blessés, brancardiers,
médecins, infirmières sont partis avec le chirurgien Derache
dans leur nouvel hôpital de Beveren. Cabourg tombe sous la direction du Dr Nolf mais il les anciens occupants ont laissé l’hôpital
dans un état déplorable. Tout doit être nettoyé, désinfecté. 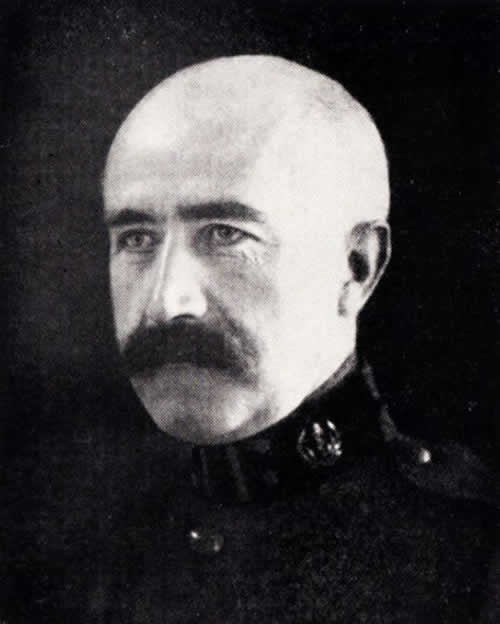
Le Dr Nolf Avant de
quitter Auvours, Thans
reçoit son équipement militaire. Rien n’est à sa taille. Il n’y a rien pour les
gars qui sont plus grands qu’un mètre 76, les bonnets de police sont pour des Lilliputiens.
Finalement, avec du rafistolage effectué par des tailleurs militaires, un
samedi matin vers le 10 mars, Thans reçoit un
équipement complet comprenant couverture, souliers, casque, gamelle. Le soir
même, il se retrouve assis à la gare de Champagné. C’est le début de la
première étape vers la Belgique, une étape qui doit d’abord le conduire au Mans.
Arrivé à 10 heures du soir, il cherche à se
loger, pénètre dans un grenier mis à la disposition des permissionnaires mais y
renonce tant le grenier est plein. Ce sont alors de longues heures d’attente
dans la cantine de l’YMCA mais surtout à
l’extérieur où règne le froid ! Finalement, Thans
et deux compagnons se retrouvent sur un banc à côté d’un poilu qui leur raconte
ses pérégrinations et combats de la Somme à l’Argonne. L’heure du train est
enfin arrivée. Il faut transiter pour raisons stratégiques à travers toute la
Normandie. Le trajet durera trois jours avec de nombreux arrêts comme à Mezidon où les brancardiers en profitent pour assister à la
messe de la paroisse. Il y eut aussi une halte à Lisieux puis à Serquigny où conversation fut tenue avec des réfugiés
belges westylandriens. La ville d’Eure apparut
ensuite aux brancardiers comme une sorte de paradis avec ses fermes ressemblant
à des villas suisses et avec une très
belle campagne. Elbeuf, Sotteville suivirent avant
d’arriver le deuxième jour dans la vallée de la Somme parcourue par de très
nombreux convois militaires anglais. Enfin, Calais apparut et puis Adinkerke. Il ne
restait plus qu’une marche de 30 minutes avec tout le barda pour rejoindre
Cabourg. Thans proposa de laisser tout l’équipement personnel dans une auberge toute proche et
de venir rechercher tout cela avec un véhicule de l’hôpital mais cette solution
fut abandonnée car elle pouvait conduire à un geste qualifié d’« abandon
d’effets militaires ». Mais quand les brancardiers passèrent devant l’auberge
« in den Ploeg », Thans
ne résista pas et fit faux bond à ses compagnons. Il se rua
dans l’auberge puis dans la cuisine où il trouva une mère de famille devenue
vite émue d’avoir un prêtre devant elle. Elle lui promit alors de garder ses
effets militaires le temps qu’il faudrait. Thans
rattrapa vite ses compagnons et Cabourg apparut enfin, assez lugubre série de
baraques grises. Louis, l’ami d’Hilarion conduisit le groupe à la baraque des
bureaux et un lieutenant parut sur le porche. Il portait la tenue bleue et
commanda : « Mettez-vous sur deux rangs, je vais passer
l’inspection ». Il passa entre les rangs et tint ce discours : « Amis, vous êtes les premiers
brancardiers du « Cabourg Médical ». Vos collègues, qui sont partis
avec hâte ont laissé l’hôpital dans un grand désordre et une grande saleté. Ça doit
rapidement changer. Nous ne possédons pas encore d’hommes de corvées. Je sais
que vous êtes des religieux et que vous avez beaucoup étudié. Ne pensez pas que
je puis vous employer suivant vos capacités. L’armée reconnait des aumôniers
mais non les « pères ». Pour moi vous n’êtes que des brancardiers,
soldats de deuxième classe. Demain vous commencerez le grand nettoyage. Allez
manger et dormir. Demain, le réveil est à 6 heures. Vous pouvez
disposer ! » Mais avant
de quitter le lieutenant, Thans voulut, pour dormir
en paix, avouer son péché qui avait consisté à l’abandon de son équipement
militaire à l’auberge. A ces mots, le lieutenant s’exclama « Tous des curés ! Quelle collection ! » Il
ajouta cependant : Demain soir
à 18 heures, vous serez libre d’aller rechercher votre équipement ! » 
Vue aérienne de l’hôpital de Cabourg L’hôpital de Cabourg à nettoyer Le lieutenant
n’avait pas exagéré, il y avait, comme après une attaque, une multitude de
déchets à évacuer. En fait, tout ce que les prédécesseurs n’avaient pu
emporter. Il y avait même encore trois salles qui contenaient des opérés qui
avaient été jugés intransportables et que gardaient deux infirmières. Le matin
donc, à six heures du matin, le travail fut partagé : deux d’entre eux,
les chanceux, allaient en salle comme infirmiers tandis que les autres
veillaient à la mise en ordre du camp. Un père-trappiste reçut la charge de
l’étable. A Huybrecht et au petit curé francophone
fut donné la tache de transporter et de vider les seaux hygiéniques. Ils
étaient aidés par un âne tirant un tonneau installé sur roues. Trois Pères
avaient en outre étés désignés pour aller chercher du charbon à la gare d’Adinkerke. Thans fut quant à lui
désigné pour nettoyer les cloisons et les planchers des
baraques. A midi, fut servi de la
bidoche dans une soupe et l’après-midi se passa pour Thans
à laver les plats au mess des sous-officiers. Après une corvée à la réserve de
charbon, Thans rejoignit ses camarades dans le bloc
réfectoire où le lieutenant avec une troupe de sous-officiers derrière lui leur
refit un discours mémorable : « Vous allez bientôt recevoir les malades qui
proviennent des tranchées et nos compagnons d’arme ont le droit de trouver ici
tout en parfait état. La discipline doit aussi régner. Pour cela il y aura le
cachot, la chambre de police, et les arrêts disciplinaires qui sont à notre
disposition. Bientôt arriveront les premières les infirmières et il est rappelé
que l’accès à leur baraque est strictement interdit. Seulement un pied sur leur
seuil sera sévèrement puni. Il n’y aura aucune excuse de valables et aucune
entorse au règlement. Il est aussi annoncé l’arrivée d’un peloton d’hommes de
corvée. Quand ils arriveront, vous serez alors considérés progressivement comme
des soignants et vous aurez deux obligations : obéissance aux docteurs et
aux infirmières. La mauvaise volonté sera punie de 6 jours d’arrêt pour la
première fois. Le brancardier est un soldat de deuxième classe et l’armée ne
tient aucun compte de ce qu’il était autrefois. Le brancardier n’a pas à se
soucier des âmes. Toute tentative de se soucier d’elles sera punie de six jours
d’arrêt pour commencer. Toute propagande religieuse est une atteinte à la
conscience et sera punie de six jours d’arrêt et cela, même si le malade est à
demi-inconscient ! » Finalement,
tout ce discours fut utile pour les brancardiers qui, grâce à cet intermède,
eurent une heure de travail en moins. Quand le lieutenant et ses sous-officiers
partirent, les brancardiers reprirent leurs activités. A 6 heures du soir, ils
cherchèrent dans les dunes une mare pour nous rafraîchir, et puis
bénéficièrent du souper dont le menu ne changera jamais : de la bidoche en
soupe avec des haricots noirs qui, à cause de son apparence, sera appelé
« béton armé ». Après le souper décevant, les nouveaux brancardiers
se rendirent à la chapelle puis regagnèrent leurs palliasses. Thans devient le « Garçon » du mess
sous-officier Ici règne un
drôle de climat. Bientôt mi-mars et encore aucune trace de vert sur les
arbres. Le vent crée des amoncellements
de sable et aussi des trous. Un sergent vient de dire à Thans
« Kommee, fieu ». Il répond : « Ja sergent » mais s’entend
répondre : « Je ne suis pas sergent mais
premier-sergent-major ! Appelez-moi
« premier chef ». Les brancardiers,
appelleront ces premiers chefs autrement : les Flamands les surnommeront
« eerste Piet » tandis que pour les francophones ce sera « premier Bidon ». Le « eerste Piet » emmena alors Thans
dans la baraque où hier il avait fait la vaisselle. « Nous n’avons pas de garçon, si vous nous
aidez, vous pourrez avoir le même repas que nous mais alors à 6 heures du matin
le poêle doit être chargé et vous devez faire la vaisselle et gardez tout
propre ! Het is
dus eengoie carotte ! » Il y avait
un autre avantage à accepter la proposition ; dans leur mess, il y avait des
tables et chaises sur lesquels Thans pourrait écrire
et lire son bréviaire. Mais que diront de cela ses amis qui le prenaient pour
un héroïque soignant ? Provisoirement il décida de ne pas en parler !
Le cuisinier
du mess était un jeune de 21 ans provenant d’Amérique. Il avait eu des ennuis pour avoir été déserteur et
avoir tiré sur des gendarmes. Il instruisit Thans sur
la manière de servir la table au moyen des différentes casseroles et poêles. A midi
les sous-offs rentrèrent et trouvèrent les tables bien mises. Le Président du
mess après le repas cria à Thans qu’il avait réussi
son test. L’après-midi, Thans nettoya à fond le mess
puis conseilla un « eerste Piet » qui était chargé de dessiner le plan du futur jardin. Cela se passa si
bien que le soir le Président du mess fit un petit speech dans lequel il
raconta que le mess avait un véritable savant à son service ! A partir de
ce moment, il n’appela plus Thans par « garçon » mais par son nom. Thans garda ce job dix jours et ce ne fut pas pour lui la
pire période de son engagement de volontaire. Evidemment beaucoup de ses
compagnons n’hésitèrent pas à aller lui mendier un peu de lait, une tartine
beurrée ou un morceau de viande qui restait. Les premières infirmières Le premier
groupe d’infirmières arriva des hôpitaux de Calais et de Londres. Les
brancardiers étaient, ce soir-là, déjà couchés quand on leur ordonna d’aller
chercher les bagages de ces dames. Un autre jour, arriva l’équipe longtemps
attendue des hommes de corvée. Parmi eux beaucoup provenaient d’Auvours et étaient instituteurs. C’est à cette époque que
commença au-dessus de l’hôpital des combats aériens impressionnants. Les soins en salle 16 Cette
après-midi-là, Thans était occupé à nettoyer la
chapelle quand un sergent–major du bureau des soins fit irruption et déclara
que l’on recherchait un brancardier pour ouvrir une nouvelle salle dans la
baraque 16. Thans se porta volontaire. La salle était
divisée en quatre chambres de 6 ou 7 lits. Le sergent lui dit : « Veuillez aux couvertures, eau,
équipement de la petite cuisine. Le premier malade est annoncé et peut arriver
d’un moment à l’autre ! » Après une
heure Thans avait déjà réuni un tas de matériel après
avoir fait signer sa liste pour accord. C’est à ce moment-là que rentra son
infirmière. C’était une jeune femme de 29 ans qui portait un uniforme gris-bleu
et de hautes chaussettes blanches.
Derrière sa coiffe, on remarquait des crolles blondes. Elle était
maquillée et les docteurs l’avaient nommée pour cette raison « Madame
Blanc-mat ». -
Et bien dit-elle à Thans, ce n’est pas encore
fait et moi qui pensais que les malades allaient pouvoir renter
immédiatement ! Tu dois te dépêcher, « Mon petit », remuer tes
jambes. Le colonel va venir et … regarde, les tasses sont noires de poussières.
Mon Dieu, nous ne serons jamais prêts. Il faut laver tout cela ! Thans fit alors un kilomètre sur les passerelles glissantes
pour ramener une cruche d’eau. Il s’assit ensuite à même le sol pour faire la
vaisselle et tendre les ustensiles à l’infirmière qui, elle, assise sur un
banc, les essuyait. Les deux personnages formaient d’après Thans
lui-même, un assez curieux duo. La vaisselle
faite, « Madame » procéda à une rapide inspection. Le linoleum était
recouvert de taches d’encre et « Madame » pria Thans
de le nettoyer avec une brosse à dent. Le robinet qui ne servait encore à rien
et qui attendait sa liaison avec de futures conduites d’eau, devait, d’après
elle, briller comme de l’or. Et la baignoire, dit-elle encore, devait briller grâce à l’huile de bras ! Bientôt
le premier malade arriva. Il fallut le déshabiller, envoyer ses vêtements au
service de désinfection et ensuite le laver avant de le placer sur son lit. Le
bain n’était pas une sinécure pour Thans. Pour le
remplir, il nécessitait 20 seaux d’eau que Thans
devait aller chercher dans les dunes et
10 cruches d’eau très chaude provenant de la cuisine ou de la buanderie !
Après cela, arriva le docteur pour un examen clinique et la prescription de
médicaments. « Madame » était
très intimidée pendant tout ce temps car elle avoua à Thans
n’avoir soigné jusque-là que quelques blessés. Elle lui demanda ce que pouvait
bien être « le périscope (stéthoscope) » que le colonel lui avait
demandé. Elle finit par avouer après ce premier
patient qu’elle était épuisée ! Les jours défilent Le clairon
réveille l’hôpital à 06H30. Lui-même a été réveillé par le garde-nuit !
Il saute dans son pantalon, va souffler
dans son instrument dans le froid matinal puis s’en revient se recoucher vite
sous ses couvertures. Personne n’a bougé de son lit à ce signal ; c’est
pourquoi un sergent entre dans le dortoir et va crier entre les lits
« debout ». Pour les « curés », c’est un peu différent car
ils sont déjà debout vers cinq heures afin d’avoir l’occasion de dire leur
messe à la chapelle. Les moines trappistes eux se lèvent à cinq heures et demie.
Pour ce qui concerne la toilette journalière, le personnel se débrouille comme
il peut. Pendant la journée, chacun cherche un moment pour se laver. Les hommes
de corvée dans les dunes, les brancardiers dans leurs salles. Dans la chapelle,
le brancardier Marechal a réussi à garnir sept autels pour sept officiants. Des
chandeliers proviennent d’Ypres, les missels de Diksmude
etc… A 6 heures,
c’est le déjeuner. Les hommes de corvée vont chercher à « la
dépense » le pain et, à la cuisine, les containers de café. A 6h et quart,
les brancardiers sont en salle et prennent le relais des veilleurs de nuit. Il
faut alors aller chercher les vivres pour le déjeuner des malades. De retour en
salle, si le veilleur était un « sale type », il avait laissé le
poêle s’éteindre et n’avait pas nettoyé les pannes. Il avait parfois volé les
sucres des malades et bu l’alcool de la petite pharmacies. Alors il fallait
remédier à tout cela avant l’arrivée de l’infirmière. Lorsque
« Madame » arrivait, elle saluait Thans
d’un « bonjour mon Père » lorsque tout allait bien, sous un beau ciel
mais quand le baromètre était mauvais, la journée commençait par de rudes
phrases : « Pas encore en train
de nettoyer ? Comment puis-je alors commencer mon travail ?
Etes-vous levé trop tard ? Je vais certainement recevoir un cigare du
colonel. Vous seriez alors content qu’il me fiche dehors ! Mais vous devriez
alors faire les lits à ma place ! » Avec un tel discours,
on avait une idée exacte du baromètre : le temps était couvert ! Thans gardait un souverain calme malgré cet accueil
matinal. Un malade lui avait d’ailleurs dit qu’il avait la patience de cent
mille hommes et que c’est cela qui rendait sa patronne furibonde ! Et
quand c’était comme cela, elle cassait un thermomètre, ses pansements ne
tenaient pas et elle renversait de la teinture d’iode sur le sol puis, tout
d’un coup, allait s’asseoir sur la petite chaise du coin cuisine pour verser
des larmes. Alors les malades regardaient Thans en
lui faisant un clin d’œil. Un canonnier qui allait mieux de son typhus osa même
lui murmurer : « Elle varie
vraiment comme le temps ». Après un moment, « Madame » se
repoudrait, ouvrait un de ses flacons de parfum et réapparaissait dans la
salle en même temps que le calme
réapparaissait. A la fin Thans comprit que sa
« Madame » vivait un chagrin d’amour. Son beau fiancé était
sous-officier dans une petite ville de France chargé de garder un dépôt de
véhicules et qui, malheureusement, ne trouvait pas le temps de répondre aux
lettres de sa belle. Entretemps,
un autre signal sonnait pour 8 heures : il fallait chercher le lait et
cela ne pouvait attendre, qu’il pleuve ou qu’il vente. Puis, il y avait la
visite des docteurs. Celui chargé des soins était un charmant jeune homme qui
considérait Thans comme son égal. Il y avait aussi le
colonel qui apparaissait accompagné de son secrétaire du bureau des soins chargé de prendre note des régimes prescrits
par le colonel pour les patients typhiques ou souffrant de méningite. Même s’il
y avait 600 patients dans l’hôpital, le colonel (docteur Nolf)
les visitait chaque jour, jamais interrompu, jamais distrait. « Quatre
lait, commandait-il, une compote, trois riz. » Et comme un écho, son
secrétaire répétait en écrivant le menu prescrit. Tous le temps que le colonel
restait dans la salle, personne n’osait ronchonner. Les brancardiers ne
semblent pas exister pour lui tant qu’ils ne commettaient pas de faute. Pendant
la visite, on utilisait la feuille de prescription avec laquelle le brancardier
se rendait ensuite à la pharmacie. Il en ramenait alors les médicaments urgents
et y retournait l’après-midi pour aller quérir les autres. Devant le comptoir
de la pharmacie, c’est le lieu de rencontre des brancardiers qui échangeaient
sur leur travail et comparent leur « bazin ».
Derrière le comptoir, trônait parfois le commandant de la pharmacie. Il fallait
alors prêter attention à ses propos anticléricaux. Comme il était jeune et que
les brancardiers finissaient par bien le connaître, ses propos ne touchaient
plus les brancardiers qui étaient prêtres ou religieux. Chargé de fioles et de paquets de médicaments,
Thans retournait alors à sa baraque. En chemin sur la
passerelle, il faisait souvent des rencontres comme l’instituteur Amaat ployant sous les ordures qu’il transportait et qui
avaient les yeux mouillés de larmes. - Mauvaises nouvelles ? Interrogea Thans - Non, mais mon infirmière, la baronne, m’en fait voir de toutes les
couleurs toute la journée ! - Tue la !, répondit Thans qui n’avait pas le
temps de rentrer dans le vif du sujet plus longuement. A 12 h30,
c’est maintenant une longue procession des brancardiers pour aller chercher le
repas de midi des malades. Ensuite il faut retourner à la cuisine pour y
chercher les menus spéciaux comme le lait et les oranges. Après vient l’heure
du repas des brancardiers. Ils pénètrent dans la baraque salle à manger où un
« eerste Piet » les accueille en leur
criant : « La baraque vient d’être nettoyée, tapez vos pieds dehors,
c’est frotté ». Il y a à
l’intérieur une centaine d’hommes qui fait la file devant les chaudrons de
soupe et de bidoche. L’attente est longue sauf si l’on possède « un
poteau » (NDRL : poteau est l’expression signifiant ami, copain) qui
prend les rations de tous ses potes. Le dessert, correspond à l’heure où le facteur
vient distribuer le courrier. Il y a celui des marraines qui est fort commenté
mais les « curés » ne peuvent pas avoir de marraines. Ils compensent
ce désavantage par un large réseau de connaissances. Ainsi, Marechal reçoit une
saucisse et du fromage de chèvre tandis que Thomas reçoit des livres provenant
de Forest Gate
et du tabac de Sheffield. Les moines trappistes reçoivent des boules de
fromage de Mont-des-cats, leur abbaye. Quand le courrier n’est pas abondant,
les conversations ont comme sujet, les blagues des malades, les comportements
des médecins et des « juffers ». Un moine
d’un mètre nonante explique qu’il gardera un souvenir toute sa vie de sa
« Madame » qui marmonne toute la journée comme une mitrailleuse et
qui lui donne dix ordres à la minute. D’autres parlent avec amour de leur
infirmière. Quand il reste de la nourriture en surplus dans les chaudrons, on
crie « Rabiot » et des dizaines d’hommes se ruent hors de leurs
tables. Les
après-midis sont remplies des mêmes tâches que durant
la matinée. Il faut faire la vaisselle, vider les pannes et les nettoyer,
amener le charbon, aller chercher le lait à la cuisine, les médicaments à la
pharmacie, conduire un matelas au service de désinfection, assister à des
heures de théorie, faire des exercices anti-incendie et assister aux visites
des médecins. A six heures du soir arrive enfin le veilleur de nuit avec tout
son barda comme s’il partait au Spitsberg. On lui donne quelques instructions
sur le feu, la lumière et quelques malades graves et puis les brancardiers
peuvent se rendre à nouveau dans leur réfectoire sous le commandement d’un « eerste
Piet » qui leur crie « Tous
instinctivement au réfectoire ! » à la place de « tous
indistinctement au réfectoire ». Visite royale « La
reine vient » 
Sa Majesté la Reine Elisabeth C’est la
première fois qu’elle vient dans l’hôpital. C’est une grande alerte. Toutes les
passerelles doivent être nettoyées des crasses qui se trouvent entre les
lattes. Les petites dunes qui se forment avec le vent entre les baraques
doivent être aplaties. Les baraques doivent briller et même les infirmières acceptent
le balai. Les malades deviennent nerveux. L’un réclame un nouveau pyjama,
l’autre des draps neufs. Beaucoup veulent avoir auprès d’eux le coiffeur mais
celui-ci, comme d’habitude, est introuvable. Les malades sortent alors de dessous
leurs matelas leur rasoir et un petit miroir et entreprennent de longues et
pénibles séances de toilettes. La « basin »
de Thans est allée cueillir des fleurs et plantes
dans les dunes pour orner sa salle. Elle a même découpé dans un de ses propres
draps des napperons pour les tables de nuit et la table à manger. Thans lui-même s’est préparé à ce grand événement : il
a taillé avec soin sa barbe, répandu un baume sur ses cheveux et passer au
« sidol » le montant de ses lunettes. Le moment est arrivé et Thans
est placé en sentinelle devant la salle. Il doit avertir sa
« Madame » de l’approche de la Reine. Il voit la reine rentrer dans
la salle 13. Un gendarme se tient dehors avec les bras surchargés de cadeaux.
Les malades reçoivent du chocolat et du tabac. Mais Thans
a vite remarqué que les brancardiers ne reçoivent rien de la Reine. Sa Majesté
sort maintenant de la salle 13 et se dirige vers celle de Thans
qui donne l’alerte. Peu avant l’entrée de la Reine dans la salle 15, le docteur
en charge de ce pavillon, rentre et d’un malheureux signe ordonne à Thans d’aller se cacher dans le kot-cuisine. Pauvre
brancardier ! Il faisait sans doute trop impression avec sa barbe
assyrienne, son haut front dégarni et ses lunettes réfléchissant la
lumière ! Thans a laissé entrouvert la porte et
jette un coup d’œil dans la salle. Malheureusement il ne voit que le dos du
colonel en train de commenter la pathologie d’un malade : « Angine de
Vincent…Sa Majesté remarquera cet érythème polymorphe… » Après la
visite de la Reine, Madame rentre dans le réduit ou a dû se cacher Thans et elle lui dit : « Même pas un compliment
pour ma salle, rien d’autre qu’un hochement de tête… » Thans
ne sait comment répondre à celle qui, il en est convaincu, a construit un véritable
château de vent ! Les soldats
sont contents de la visite royale. L’un d’entre eux commente : « La
Reine m’a demandé depuis combien de temps j’étais au front ! J’espère que
cela me vaudra une mutation vers l’arrière ! » Un autre très jeune
est tombé amoureux de sa souveraine et déclare qu’il voudrait retourner de
suite sur la ligne de feu pour lui donner sa vie ! Ce ne fut
pas la seule visite royale à l’hôpital mais Thans n’y
donna plus son cœur. S’il se réjouissait pour les malades, il ne voyait
personnellement dans ces visites que l’occasion agréable d’aller fumer une
bonne pipe pendant une demi- heure derrière la baraque ! Les malades C’étaient
des hommes du front et beaucoup avaient vu la mort de près. Quand ils
arrivaient ici, ils cachaient d’abord leurs souffrances. Ils ne parlaient pas,
ne demandaient rien, se laissaient laver, buvaient quand on leur présentait à
boire. Comme des enfants ! Mais,
les douleurs des premiers jours passées, ils commençaient alors à s’ennuyer.
C’était pour eux trop calme, trop étrange. Alors ils demandaient où pouvait
bien se trouver leur compagnie et comment leurs camarades se débrouillaient en
n’ayant plus de quatrième comparse pour jouer aux cartes ! C’était la
période où ils se cachaient sous les couvertures et où ils pouvaient rester les
yeux fermés pendant des heures pour rêver. Envers l’infirmière qui ne parlait
que français, ils ne se sentaient pas à l’aise quand elle les appelait
« Mon petit » et qu’elle faisait les soins sans tenir compte de leurs
sentiments de pudeur. Cette phase
passée, les jass commençaient à regarder leurs voisins de lit et ils leur
posaient leur première question qui était invariablement la même:
« De quelle unité fais-tu partie ». Alors commençaient de longs
récits sur des assauts et des bombardements, sur des plaintes ou des louanges concernant
un sous-off ou un officier. Quand le brancardier approchait alors des causeurs,
ces derniers se taisaient de peur de lâcher un « GodVerdomme »,
ce qui aurait été peu respectueux en présence d’un religieux. Thans était aussi impressionné
par la fraternité entre flamands et wallons et entre eux naissait rapidement
une sorte de langage typique fait de patois flamand et wallon. Leur plus grand
plaisir était de se jouer des docteurs et infirmières. Quand ils étaient
capables de prendre leurs médicaments sans aide, ils prenaient un grand plaisir à les recracher dans leur
crachoir et ensuite affirmaient au docteur que ses prescriptions étaient très
efficaces. Les malades
de la diphtérie, par ordre du médecin, ne pouvaient pendant trois semaines,
ingérer uniquement du thé et du lait. Après dix jours, beaucoup allaient mieux
et réclamaient une portion de pain. Rien n’y faisait, le colonel déclarant
qu’il avait déjà soigné des centaines de cas et que la guérison ne pouvait
survenir qu’avec au moins trois semaines de ce régime lacté strict. La chance
souriait cependant à ces hommes car notre baraque était la dernière à être
servie pour les repas. Les cuisiniers vidaient alors les surplus dans les
chaudrons de notre baraque. C’est une énorme quantité d’haricots cuits, appelé
béton armé qui arrivait et lorsque Madame avait le dos tourné, (Elle avait
souvent des courses urgentes à faire, disait-elle), les hommes au régime
pouvaient se servir d’une ration digne d’un docker. Ainsi, sans trop de
plaintes, la période cruciale des trois semaines se passait. Le colonel
félicitait les patients pour l’état qu’il montrait et les malades
reconnaissaient que la diète prescrite était la cause de leur magnifique amélioration.
Les patients
connaissaient la psychologie de leur patronne et savaient flatter sa fierté.
Lorsqu’elle rentrait en salle avec un visage blanc comme un mur, ils
s’inquiétaient de sa santé. Envers Thans, ils
éprouvaient de l’admiration pour son calme imperturbable envers sa « bazin ». En effet, Thans lui
répondait toujours par un « oui, Madame ». Il était
devenu dans tout l’hôpital une légende à propos de sa patience. Sa
« Madame » lui dit un jour que ce serait formidable s’il pouvait
arriver le matin une heure en avance pour nettoyer le sol et repartir le soir
plus tard pour nettoyer le poêle… « Nous aurions alors dit-elle, une salle
comme un boudoir ! » Thans lui
répondit : « Oh oui Madame, ce serai en effet
magnifique ! » Evidemment Thans s’en tint à l’horaire traditionnel mais les malades prirent
alors plaisir lorsque « Madame » demandait : « Ou se
trouve le Père ? » à répondre qu’il faisait encore noir le matin
quand il nettoyait et qu’il avait même usé d’un kg de savon ! La vie du
brancardier n’était pas une sinécure. Un matin, ce n’était pas
« Madame » qui était dans la salle mais
l’ « aviatrice ». L’aviatrice était appelée ainsi parce qu’elle
était l’infirmière volante. Elle s’installa près du poêle dans le transat et se
mit à lire « Une passionnelle »
de Gyp pendant qu’une petite casserole répandait ses
effluves de thym et d’eucalyptus. Thans était occupé
derrière le rideau à laver un malade dans la baignoire et l’aviatrice allait de
son commentaire acerbe. - Employez bien la brosse dure et frottez jusqu’à ce que les pustules
saignent. - Les jambes et bras doivent devenir rouges comme de la viande
fraîche ! Le pauvre
piot acquiesçait. Thans lui disait : « tu
vas tenir le coup ? » Le pauvre
piot répondait par « Bah jaok » Jusqu’au
moment où le pauvre s’évanouit en tombant dans les bras de Thans
qui cria choqué : « Vite Mademoiselle, Van den Plas
s’est évanoui ! » - Portez le sur son lit, cela va
passer fut la seule réponse de l’ « aviatrice » Heureusement,
que les malades en convalescence pouvaient aider Thans.
Contre la moitié de sa ration de pain ou du tabac, ils acceptaient de nettoyer
le sol le matin. Thans finalement avait aussi un
homme pour les vitres, un autre pour la vaisselle. Toutes ces bonnes volontés
lui permettaient de ne pas trop se presser le matin. Il leur rendait aussi bon
nombre de services dans la rédaction de leurs courriers. Leurs mains toujours
employées à de rudes travaux ou aux armes n’étaient pas très habiles pour
écrire. Thans s’appliquait à écrire pour eux à leurs
marraines. Dans certains cas, il allait jusqu’à composer de petits poèmes qui valait
leur pesant d’or pour attirer les bonnes grâces des marraines. Thans avait l’immense satisfaction de recevoir très souvent
un courrier des « sortants » rentrés au front. Bien souvent, la
lettre écrite terminait par cette phrase : « Jamais je ne
pourrai vous oublier, votre ami pour la vie ». A cette
période, l’infirmière jouissait aussi d’une vie facile et plus d’une fois Thans excusa son absence quand elle recevait des visites.
Pour Thans, c’était une demi-journée gagnée sans la
présence de sa « Madame ». Malheureusement
les bons jours finirent quand un adjudant des auto-mitrailleurs fut
hospitalisé. C’était un « Monsieur » qui appartenait à la
« haute société » qui devait normalement être admis dans la baraque « officier »
mais qui le fut dans la baraque 15, celle des maladies contagieuses. Cet
adjudant fut la seule déception de Thans durant son
épopée de brancardier. Il fallait voir comment « Madame » fut
subjugué par ce personnage qui l’appelait
« Sister » comme dans un hôpital du secteur anglais.
« Madame » était ravie de ce titre qui la mettait aux anges.
Evidemment Thans trouvait cette appellation assez
injurieuse car devant être réservée aux religieuses. Un adjudant devait sans
doute avoir un régime plus favorable car « Madame » se trouva bientôt
continuellement au chevet de ce haut gradé et c’est de ce lit qu’elle
commandait le service de son pavillon. De sa kitchenette, Thans
entendait toute les conversations d’une romantique sentimentalité. Souvent
aussi, le couple parlait de Thans. L’adjudant disait
même que, s’il était à la place de la « Sister »,
il ferait mener à Thans un autre pas de danse !
Comment Thans pouvait-il se faire aider des
malades ? Pour l’adjudant, c’était un vrai scandale ! Le plus grave,
fut que l’adjudant répétait ce discours aux infirmières des autres services
quand ces dernières étaient invitées par « Madame » à venir
parler à cet homme d’une gentillesse exceptionnelle ! « Je
vais faire une réputation à ce brancardier » disait l’adjudant à la
« Sister ». Il y réussit pas mal en
entraînant les « jass » à refuser d’aider Thans.
En peu de temps ce dernier commença
effectivement à perdre le sourire. Le congé Heureusement,
une bonne nouvelle vint apporter un peu de joie au pauvre Thans.
Il pouvait partir en congé à Lourdes. Il avait tant de fois regardé avec envie
les files de permissionnaires prendre le train à Adinkerke
et maintenant c’était son tour !
Sur le quai, Marechal l’avait prévenu : « Il faut jouer du
coude pour atteindre au plus vite une place assise car dans le cas contraire,
une nuit infernale serait au programme… » Pour
atteindre Paris, il fallut 20 heures dans un wagon bondé dans lequel pénétraient
la pluie et la fumée par les carreaux cassés. A partir de Paris commença un
véritable tour de France pour atteindre Lourdes. Thans
visita Lyon, Avignon, Tarascon et Nîmes sans parler de Carcassonne et de
Toulouse. A l’approche des Pyrénées, ses compagnons de voyage, des chasseurs
alpins se mirent à chanter « Montagnes Pyrénées… » Le silence majestueux des cimes était alors
pour Thans, la
certitude d’une paix éternelle, reflet de la sagesse de Dieu. Et puis,
Lourdes apparut enfin avec sa basilique. Le matin ce fut la visite de la
basilique et l’après-midi, la prière devant la grotte. Le soir, les 200 soldats
belges qui, jour après jour, se renouvelaient à Lourdes formaient une petite
procession. Après un chapelet à la grotte, ils allaient avec une chandelle
allumée rejoindre la plaine pour réciter le rosaire puis regagnaient leurs
logements. Avec une vingtaine de compagnons, Thans
résidait chez Madame Sarrat. La pension coûtait 3, 5
francs et cette entrée d’argent, assurément, ne la rendait pas riche ! Le
lendemain, Thans fit les traditionnelles excursions ;
Bétharram, Cauterets, et le cirque de Gavarnie. Après
ces quelques jours, il fallut déjà reprendre le chemin du retour. A
Fontenay-le-Comte, une escale où il est reçu comme un prince par son confrère Valerius Mahy qui lui fit visiter
Les Sables d’Ologne et sa baie. Arrivé à Paris, Thans eut encore l’occasion de d’entreprendre un petit
pèlerinage à Montmartre avant de reprendre le train qui le ramena sur le front. Dans son wagon, il se
retrouvait avec d’autres soldats qui avaient complètement oublié la misère du
front et qui manifestaient vigoureusement leurs intentions de retourner au plus
vite visiter les bouges de la Place d’Anvers à Montmartre… Ainsi, pensa avec
tristesse Thans, c’est avec de telles pensées que ces
hommes retournent vers le front et vers la mort ! Promu Après 12 jours
d’absence, voici Thans de retour. Dans sa salle 12,
il apprend que c’est Thys qui l’a remplacé avec… très
peu d’entrain. Tout le monde s’est plaint de lui ; Thys
ne faisait rien, son hygiène personnelle était déplorable et il était bien loin
l’époque où la salle ressemblait à un boudoir ! Madame supplia Thans de reprendre au plus vite son service. Ce qu’il fit
avec entrain et même avec l’aide de l’adjudant qui prit le balai. Cet état de
choses était merveilleux pour Thans qui voyait ainsi
sa réputation rétablie. L’adjudant lui offrit même des sous pour une messe en
remerciement de sa guérison. Il écrivit même une phrase mémorable dans le
bréviaire de Thans : « Mon malheur, vous
l’avez transformé en joie ! » Sur cette
entrefaite, Thans rencontra le vieux Père Hermant, docteur en théologie, chargé de la salle 6 et qui
se plaignait amèrement de devenir neurasthénique avec les soins à donner aux
officiers. « La salle n’a pas assez de lumière, dit-il et je suis toujours
dans la kitchenette dans laquelle se
trouve la rigole d’où s’écoule l’eau des bains et qui sent mauvais. Je reviens
de chez le lieutenant qui m’a désigné pour ta salle ! » Thans s’en va immédiatement trouver sa « Madame »
qui devint furieuse à cette annonce : « Quoi, je vous ai formé pendant
trois semaines et voilà qu’on veut vous reprendre ! » « Madame »
s’encourt chez le lieutenant puis vers le colonel sans succès ! Elle
propose à Thans d’aller rouspéter de même mais Thans refuse car il se considère comme un soldat devant
obéissance ! Pauvre Père Hermant. Après six semaines chez « Madame », il
revint voir Thans pour lui demander durant combien de temps il était
resté au bloc 12. Thans lui répondit qu’il y avait
travaillé six mois. « Six mois, répliqua le Père Hermant,
alors je te déclare sanctifié ! Moi j’en ai
marre. Cette femme est rasante, et je ne sais plus sur quel pied danser. Pas un
instant à moi et elle me reproche les
quelques moments où elle me voit lire mon bréviaire ! J’ai perdu l’appétit
et le sommeil ! Je vais chez le
lieutenant demander mon changement ! » Depuis lors,
l’ancienne « Madame » de Thans a usé
beaucoup de brancardiers. Toutes les trois semaines, un nouveau ! Elle emmenait
de temps en temps Thans pour lui montrer sa
salle ! Elle lui montrait alors l’ancien « boudoir » avec un
geste aussi désespéré que celui d’un curé devant son église vide. Après
l’armistice, Thans revit sa « Madame » à
l’hôpital militaire de Bruxelles. Elle venait juste d’avoir teinter en brun
flamboyant sa coiffure blonde. Plus tard, Thans
apprit que son fiancé avait disparu mais qu’elle avait retrouvé un nouveau et
riche aspirant. La salle 6 des officiers malades Thans travaillait donc maintenant dans le bloc réservé aux
officiers malades. Ce bloc avait été emménagé en de petites chambres de chaque
côté d’un couloir où régnait la pénombre. Une des chambres du milieu avait son
lit remplacé par un banc, six chaises, une table et un poêle. Elle était
devenue le « salon » et c’est là que les officiers pouvaient se
réunir et lire leurs revues « Fantasio », « Sourire » et
« Vie parisienne ». Ils y jouaient aussi aux cartes ou racontaient
leurs exploits au front. Quand ils parlaient de leurs permissions à Paris, ou
de leurs marraines, ils veillaient à ne pas être entendus par le personnel.
Parfois ils appelaient cependant Thans, spécialiste
de la religion et de l’éthique pour qu’il propose une solution à un problème
épineux rencontré dans leur vie martiale. Tout au bout
du couloir, il y avait à droite la petite pharmacie et à gauche la kitchenette
contenant aussi la baignoire. A l’extrémité se trouvait un kot muni d’un WC,
d’un orifice par où on éjectait les
immondices à l’extérieur et d’une rigole pour l’évacuation des eaux sales. Thans était appelé le « Grand père » tandis que
son compagnon brancardier était appelé « Petit Père ». Ces surnoms
leur avaient été donnés en voyant leur taille. Le « Petit Père »
s’occupait de nettoyer le sol des 15 kots tandis que le
« Grand Père » s’occupait de vider les eaux et poubelles des chambres
tout en veillant aux approvisionnements du bloc. Les 11 chambres étaient toutes
occupées et les officiers malades se comportaient comme dans les
tranchées : la ouate, les compresses, les lettres ratées et déchirées, les
mégots, les pelures de pommes étaient jetées à même le sol ! Ils faisaient grand usage des pannes et des
crachoirs et laissaient les tasses sales
sur leurs tables de nuit. C’était une grosse prestation du matin pour rendre
ces chambres propres. A six heures
quart « Petit Père » commençait son sport journalier. Tout ce qui
était à nettoyer, il le mettait dans le couloir. Les crachoirs, les pannes, la
vaisselle, tout était alors transporté par Thans dans
son arrière-cuisine pour être nettoyé ! Il fallait en même temps être
attentif aux demandes des officiers. Ces derniers appelaient alors le
brancardier dans leur chambre en criant « Grand Père, numéro
11 ! ». Avec humour, le couloir
était appelé par les brancardiers « notre boyau de la mort ». Il
fallait un moral d’acier pour rentrer dans chaque chambre avec sourire et calme
tandis qu’au même moment d’autres officiers appelaient et que dehors, on
entendait le clairon signalant qu’il fallait aller chercher le charbon ou le
pétrole ou encore le lait. Les officiers étaient cependant la plupart du temps
polis mais ils appelaient pour des motifs futiles comme pour ouvrir leur stylo
ou ramasser leur encrier tombé par terre. Heureusement que les infirmières étaient malignes. La plus vieille,
restait calme et ne donnait des ordres que quand c’était nécessaire. Son seul
défaut était de passer des heures entières dans la chambre du plus jeune gradé
en laissant tout son travail pour les brancardiers. La deuxième infirmière était
solitaire, elle ne parlait à personne, faisait vite son travail puis allait
s’enfermer dans le kot ou la pharmacie pour lire ou broder même si la moitié
des patients du bloc se trouvait en train de mourir ! Elle était fiancée
avec un officier qui avait, auparavant, séjourné dans le bloc comme malade. Il
venait assez souvent voir sa dulcinée et les deux amoureux essayaient de
s’isoler dans la pharmacie. Les brancardiers prenaient plaisir à les déranger sans
les prévenir. L’infirmière était alors obligée de reprendre ses activités. Le
soupirant, n’ayant pas envie de rester seul dans les fioles et médicaments,
suivait alors sa fiancée dans la cuisine où elle tournait le lait chaud ou bien
pressait des citrons ! Les
brancardiers du bloc 6 étaient des interlocuteurs importants pour les
infirmières de tout l’hôpital qui veillaient spécialement à la santé des
officiers malades hospitalisés. Elles devaient en effet s’enquérir souvent
auprès des brancardiers si l’infirmière titulaire ou le docteur se trouvaient
dans le bloc. Dans le cas d’une réponse négative, elles s’invitaient
elles-mêmes pour une courte visite, prétextant que c’était par charité qu’elles
venaient tout en demandant expressément aux
brancardiers de ne pas signaler leurs visites. C’est ainsi que Thans fut fier…. d’avoir « marié » 6 patients
avec des infirmières. Les
officiers malades sont différents des soldats malades. Bien entendu ils ne
manifestent pas la passivité des soldats. Ils veulent être servis et
vite ! Cependant Thans constata que plus ils
sont gradés et plus ils sont raisonnables. Il y avait dans le bloc un colonel
qui nettoyait lui-même ses souliers alors qu’un sous-lieutenant demandait de
nettoyer son rasoir et de le remettre dans son étui ! Tous montraient une grande camaraderie envers
les brancardiers tant qu’ils étaient immobilisés au lit. Mais dès qu’ils
pouvaient revêtir leur pantalon, immédiatement se rétablissait le fossé entre
officier et soldat de seconde classe ! Pour thans, on pouvait classer les officiers malades en trois
catégories : - Il y avait les fantaisistes
comme ce gros et grisonnant major ne confiant sa guérison qu’à ses pipes et son
bourgogne. Il arrivait à se maintenir avec les coudes à sa petite fenêtre pour
observer l’animation des passants sur la passerelle. Quand une infirmière
l’invitait à lui donner la main, il la serrait de sa main droite tandis que la
gauche lui jetait une tasse d’eau dans le cou. Sa santé s’en trouvait fort
améliorée. - Il y avait les timides. Ils ne
criaient jamais, n’avaient jamais besoin de rien et à chaque soin, ils
s’excusaient. Il n’y avait rien à épousseter dans leurs chambres. Ces malades
ne se plaignaient jamais et il fallait que le brancardier aille de lui-même, de
temps en temps, dans leurs chambres pour s’assurer qu’ils ne manquaient de
rien. - Il y avait enfin les peureux.
Parce qu’il toussait un peu, le peureux voulait 6 couvertures pour transpirer.
Si la température montait à 37, 2, il demandait s’il était en danger. Et si la
nuit, il éprouvait la moindre colique, il demandait à voir le docteur. Ils éprouvaient la peur de la
piqure et suppliaient de ne pas leur causer de douleurs. Par leurs relations,
ils parvenaient à se procurer d’autres remèdes que ceux prescrits ! Ils
s’extasiaient devant leurs fèces et demandaient qu’on les examine au
laboratoire. Au nom de l’humanité, ils réclamaient que l’on garde fermée les
fenêtres et la nuit ils priaient le brancardier de garde d’aller chercher une
échelle pour obstruer avec de l’ouate une fente le long d’un panneau de leur
plafond. Ils étaient éternellement reconnaissants aux infirmières en leur
disant « Vous m’avez sauvé la vie ». Guéris, quand ils occupaient un
haut poste dans un magasin d’approvisionnement, ils envoyaient aux infirmières
du chocolat et aux brancardiers un cigare. Et quand l’un d’entre eux avait
perdu sept kilos sur les 103 qu’il avait auparavant, pour éviter tout risque de
tuberculose, il partait en convalescence à Nice ou à Cannes. - Il y avait aussi les égoïstes. A
ne pas confondre avec les précédents. L’égoïste est terriblement malade et tout
l’entourage doit le payer ! Tout doit être laissé quand ils ont besoin de
quelque chose. Ils ont froid, les poêles doivent être incandescents et tous les
occupants de la baraque doivent suer. On ne peut pas rire ni échanger de blagues,
il ne devait y avoir aucun bruit dans le
couloir et pas de phono dans le salon. Il appelle le brancardier toutes les
cinq minutes et la plupart du temps sans raisons. Il est couché sur deux matelas
et s’appuie sur trois oreillers mais il n’est jamais bien et demande à être
relevé mais pas trop haut ! Après trois minutes, il rappelle à nouveau
pour que l’on secoue les oreillers. Sa porte doit rester ouverte mais seulement
de trois centimètres. L’égoïste appelle toujours quand le brancardier passe
devant sa porte. Il crie quand il entend les brancardiers parler à leurs
voisins de chambre. Le lait est trop chaud ou trop froid et trois fois il
envoie le brancardier à la cuisine. Il faut souvent attendre dans sa chambre
qu’il ait tout bu et il boit par petites gorgée avec de grandes pauses. La
nuit, il faut faire la garde dans sa chambre et laisser la lumière. Tous les
quart d’heure, il demande la panne inutilement et finit par faire dans son
lit ! Il veut que l’on lui tienne la main ! Mais on ne peut lui faire
aucune remarque sinon il brandit la menace du colonel ou du conseil de guerre.
Il pleure comme un enfant et vous traite de « sans cœur ». Quand il
va mieux, tout le monde soupire mais alors il se passe un changement étrange.
Il va manger beaucoup d’œufs, de vin et de gâteaux. Il commence à interpeller
les autres malades, il chante et tape la mesure avec son pied, il fait tourner
le gramophone l’entièreté du jour et tiens un « five o’clock »
bruyant avec des infirmières. Même Petit Père et Thans
doivent se mettre à cuisiner. Finalement il part à Nice et écrit qu’il
n’oubliera jamais son séjour agréable à Cabourg. La salle 6 n’aurait jamais été la même,
sans les égoïstes zèbres ! En un an, trois zèbres « pur-sang »
comme dit le docteur se sont succédés et chacun pour un séjour allant d’un mois
à cinq ! Thans se demande comment il a pu sortir
indemne de la salle 6 avec ces malades difficiles tout en faisant face aux
malades de la scarlatine, aux blessés de l’Ypérite, aux syphilitiques du
dernier stade, aux deux cas de folie et aux victimes de la peste
pulmonaire ! Le lieutenant Bidel fait régner l’ordre Revenons à l’année 1917. Le
lieutenant essayait de réduire les coûts dans tous les domaines et cela pour
obtenir sans doute une promotion. A un moment donné, un vent de révolte
souffla. Les brancardiers se disaient épuisés par un horaire où des journées de
trente heures subsistaient quand, dans l’horaire de jour, s’ajoutaient les
gardes de nuit. Les brancardiers ne comprenaient pas pourquoi on ne créait pas,
comme autre part, des équipes de nuit et des équipes de jour qui iraient en
s’alternant toutes les deux semaines ! En outre, le menu était d’une
monotonie extrême avec la « Bidoche au béton armé ». Quant aux temps
libres, c’était une après-midi toutes les deux semaines tandis qu’un congé
demandé était toujours reporté au futur. Un samedi après-midi, le lieutenant réunit
tous les brancardiers et hommes de corvées pour faire ce discours : « Soldats, il semble que je doive vous
rappeler pourquoi nous sommes dans un hôpital militaire ! On murmure au
sujet de congé, promenades et repos. Les individus qui souffraient de faim à la
maison demandent maintenant un beefsteak salade ! Je vais vous enlever
toutes ces illusions. Vous êtes des soldats de deuxième classe. Soyez
convaincus que vous n’être pas intéressants ! Vous êtes ici pour soigner
les malades et non votre santé ! Vos camarades sont dans les tranchées
sous les bombardements et dans la boue, et c’est à eux que vous devez penser et
non à vous ! Vous n’avez aucun droit, seulement des devoirs. Dans un
hôpital, il n’y a pas de temps libre. Le repos est permis mais vous ne pouvez
pas l’exiger. C’est seulement, si on n’a plus besoin de vous, que vous pouvez
aller manger ou dormir. Vous pensez avoir droit à un jour de sortie, c’est un
tort. J’avais décidé de vous offrir un jour toutes les cinq semaines mais je
retire cette faveur! C’est seulement après plusieurs mois de travail ce que
nous pourrons vous accorder un congé. Je reste ici le maître et celui qui n’est
pas d’accord pliera. J’aime la manière forte ! Si la machine cafouille, je
serre les vis ! » Ainsi Bidel, le dompteur s’adressa à son troupeau ! Le vent de
révolte souffla d’autant plus fort après ce discours que chaque brancardier ne
ménageait jamais ses efforts pour les malades et lorsque qu’il était nécessaire
de faire face à un afflux d’arrivants. Aussi il y
eut toute une vague de rébellion. Un matin le sergent « de baard » qui réveilla Janssens en lui enlevant les
couvertures se vit répondre : « Laisse-moi tranquille, espèce d’emmerdeur
! » Quand le
sergent « de baard » exigea une nouvelle
corvée dans la salle à manger, il fut sifflé ! De saegher fit plus : il gifla un caporal qui lui donnait
« un savon » et se retrouva au cachot. Samain qui
demandait à Bidel une permission, de façon correcte
et polie, reçut une réponse négative. Bidel lui
disant encore une fois de penser aux gars des tranchées. Samain lui montra
alors les cicatrices de son bras en lui disant : « J’y étais mais
vous-même n’y avez jamais mis les pieds ! » Un peu plus tard Samain dans le dortoir lança
un cri de révolte : « Pour Bidel,
…MERDE ! ». Et de tous les
lits, les gars reprirent ensemble le même slogan ! Plus grave,
on entendit un jour au matin, une infirmière crier que les deux brancardiers
n’étaient pas à leur poste ! Le lieutenant fouilla les environs à la recherche
des deux brancardiers qu’il trouva finalement en train de fumer tranquillement
leur pipe dans un pré avoisinant. Ils refusaient de travailler tant qu’ils
n’auraient pas obtenu leurs congés. Au réfectoire, ils furent arrêtés par les
gendarmes pour paraître devant le
conseil de guerre ! Quelques
jours après, ce furent le tailleur et un autre gars qui se taillèrent et furent
déclarés déserteurs. Ils trouvèrent le moyen d’avertir leurs compagnons qu’ils
étaient cachés à Paris ! Pauvre Bidel, tous les moyens étaient bons pour lui pour se faire
reconnaître par l’Etat-Major. Ainsi, il supprima les
verres du réfectoire pour les remplacer par des boites de conserves munies
d’une préhension soudée. Il envoya un rapport sur cette intéressante innovation
mais ne reçut pas de réponse ! Il envoya
aussi à l’Etat-Major un rapport concernant la
centaine de poulets que la ferme de l’hôpital avait réussi à élever et qu’il
offrait à l’Armée. Cette fois, l’Inspection Générale lui répondit en lui
demandant pourquoi il n’utilisait pas ces poulets pour les malades ! Avec tous
ces rapports, Bidel avait attiré sur lui l’attention
de l’inspection Générale et bientôt le sous-lieutenant devint lieutenant. Il
fit savoir aux brancardiers qu’il recevrait à cette occasion une délégation de
ces derniers mais des amateurs pour cette mission particulière ne furent pas
trouvés ! Dans toutes
les inspections qu’il faisait dans les pavillons, Bidel
avait une attitude réservée auprès des infirmières tandis qu’il manifestait
toute sa hargne contre les brancardiers : le linoleum n’était jamais assez
rouge et les napperons des tables de nuit assez blancs... C’est ainsi qu’ayant
trouvé beaucoup de poussières dans les étagères supérieurs de la pharmacie et
de la kitchenette d’un pavillon, il menaça de 8 jours d’arrêt le brancardier.
Dommage pour le lieutenant, il y avait des médecins qui appréciaient leur
brancardier. Ils entrèrent dans le bureau de Bidel et
l’avertirent qu’il ne devait pas songer à mettre aux arrêts Van Heuverswijn. C’est dans
la salle 6 que Bidel vécut une aventure. Il avait
l’habitude de ne pas remplacer le brancardier parti en congé. Cela signifiait
que son compagnon avait déjà son congé à moitié gâché en pensant au travail
excessif qu’aurait son collègue. Les malades en souffraient aussi. Un samedi
que « Petit Père » était à Dublin et que « Grand Père »
savonnait les 11 chambres, Bidel rentra dans le
pavillon et exigea de l’infirmière d’appeler son brancardier. « Grand Père »
laissa tomber son balai et alla se présenter devant Bidel
qui lui montra avec son doigt des taches sur le rebord de la porte de la
cuisine. Thans lui répondit que tout seul, il n’avait
pas eu le temps de faire les poussières et il retourna à son travail. Par trois
fois, le lieutenant rappela Thans pour lui faire des
remarques similaires, par trois fois Thans répondit
de la même façon. Mais un médecin en visite dans la chambre 7 avait tout entendu
et fit résonner sa voix forte dans tout
le pavillon : « Quel imbécile vient vous ennuyer ? Il se croit
dans une caserne mais il est dans un hôpital ! » Et Bidel, tout penaud, quitta le pavillon beaucoup plus
doucement qu’il y était entré ! Le samedi suivant
eut lieu le miracle, sur la plaine, devant tous le personnel réuni, le
lieutenant eut des mots doux pour chacun, pour les hommes de corvée et pour les
« ecclésiastiques » qui prenaient tant au sérieux leur job de
brancardiers. Aucun autre hôpital ne comptait un personnel aussi dévoué !
Les brancardiers avaient dorénavant l’autorisation de nommer une délégation pour discuter du menu tandis que
les inspections n’avaient plus de raison d’être et que les permissions seraient
à nouveau autorisées dans les délais réglementaires. 
Père Hilarion pose Les soirées Au soir,
avaient lieu les vêpres qui étaient un véritable moment de dévotion mais aussi
de relaxation pour les brancardiers qui s’étaient donnés à fond dans leur
travail. Les chants sous la conduite de l’harmonium donnaient joie et espoirs à
tous les participants. Il y avait
aussi des combats aériens impressionnants au-dessus de l’hôpital. Les
brancardiers assistèrent à trois combats d’un Aviatik
contre nos saucisses d’observation. Quand le combat leur donnait le temps, les
observateurs tombaient en parachutes… A l’été 17,
les anglais préparaient leur offensive de Passendaele
et avaient établi près de l’hôpital un vaste parc de réparations de véhicules
près du bois de pin nommé « Palestina ». On
y réparait aussi des canons et lorsqu’un de ceux-ci s’ensablait et que l’on
faisait appel à l’hôpital pour prêter mains fortes aux Anglais. Les brancardiers
s’en allaient alors pour tirer câbles et cordes ! Cabourg se
trouvait entre la plaine d’aviation française de Ghyvelde-Braydunes et la plaine d’aviation belge des Moeres. Les
canons et avions allemands essayaient de les atteindre. Pour être mieux
protégés, durant l’été 18, lors de l’offensive allemande, on marqua les toits
de l’hôpital d’immenses croix rouges. Cela n’empêcha pas l’hôpital de recevoir
quelques obus dont l’un détruisit notre étable. Au cours d’un bombardement
aérien, un des brancardiers fut malheureusement blessé à mort. Les Français
furent chargés de fortifier notre coin de dunes comme zone de repli. Et ce ne fut
pas tout, des abris furent creusés pour des cent vingt longs. Cette batterie de
canon possédait un équipage de 300 hommes qui logeaient dans des abris de bois
disséminés et creusés dans les dunes. Ils attendaient souvent la visite des
brancardiers, le soir, dans leurs petits salons enterrés. Ils offraient du vin
et les brancardiers leur donnaient en échange des cigares. Mais ces
promenades dans les dunes n’étaient pas possible en hiver. Alors, il fallait
s’occuper mais les chambrées avaient à peine une table et quasi jamais de
chaises. Les trois lampes donnaient aux 40 lits un éclairage glauque et
insuffisant. Certains essayaient de faire un peu de gymnastique et, d’autres
quelques matchs de boxes. Pour garder le sourire, c’était l’époque des blagues :
un bassinet d’eau suspendu à la toiture et maintenu par une cordelette pouvait
humidifier régulièrement la tête d’un copain ! On faisait des
lits-portefeuille ou on attachait les deux extrémités d’un matelas par un fil
de cuivre pour le faire tomber ! Il
y avait aussi des brancardiers qui se levaient pour aller, de nuit, coudre les
manches ou les pantalons d’uniforme d’un
camarade. Il y en avait d’autres qui disposaient les pieds amovibles du lit
d’un collègue de la mauvaise façon de telle sorte qu’une petite traction sur
une mince ficelle reliée à un pied suffisait à faire tomber le lit par
terre ! Mais chacun ne réagit pas
de la même façon à une blague. Certains au caractère fort font semblant de
rester endormi malgré la chute du lit. Dans ce cas tous ses voisins se rendent
à son chevet et lui demandent comment il va, comment il se sent ! L’homme
de caractère ne bronchera pas malgré cette assemblée nocturne. Quand chacun a
regagne son lit, il attendra que tout le monde s’endorme pour se lever le plus
discrètement possible, sortir de la baraque puis y entrer brusquement en
allumant les lampes et en criant « debout la baraque » comme si
c’était l’heure du réveil normal ! Les tripots Le bruit
courait que des maisons dans les dunes abritaient des tripots où il faisait bon
d’aller se relaxer le soir. Thans et son ami se
mirent à leur recherche le soir. Ils allaient toquer à toutes les petites
maisons sous prétexte d’acheter du beurre ou des œufs. Quel fut leur surprise
de voir nombre d’entre elles remplies de lanciers et même de gendarmes autour
d’une table en train de jouer aux cartes ou même de flirter avec la population
féminine du coin ! Alors Thans et son copain
prirent l’habitude d’aller de temps en temps boire une pinte et dépenser de
l’argent pour manger un camembert mais après un temps, ils voulurent
trouver des endroits indemnes des
gendarmes qu’ils détestaient. L’occasion
leur fut donnée un jour. Thans et son compagnon eurent
l’idée de suivre le soir une travailleuse de l’hôpital qui rentrait chez elle
en emportant du linge sale à nettoyer ainsi que des mules d’infirmières et des
souliers d’officiers à réparer ! Les brancardiers étaient à la recherche
d’un cordonnier et c’était peut-être là une piste intéressante. Il faut
préciser que ce besoin venait de l’incohérence du lieutenant Bidel qui refusaient que les brancardiers puissent disposer
des souliers de repos qu’il avait pourtant à sa disposition en grand nombre
dans le magasin. Le motif était que ces souliers devaient être réservés aux
soldats qui marchaient beaucoup avec leurs bottines la journée, ce qui, pour
lui, n’était pas le cas pour les brancardiers. Ces derniers étaient alors
obligés d’acheter des scandales civiles peu chères et donc de mauvaise qualité
et qui devaient être souvent réparées. Thans suivit
donc cette femme qui pouvait la mettre sur la piste de ce précieux artisan.
C’est ainsi qu’il entra finalement dans la modeste demeure de cette famille de
réfugiés provenant de Thourout et qui
avait construit de ses mains une maison faite de bois de pins, de papier
asphalté et consolidée à l’extérieur par des sacs de sable qui gardait la
chaleur et protégeait contre les éclats d’obus. La pièce principale était
divisée en trois : un coin cuisine, un coin pour le lit et un dernier pour
l’atelier du « baas ». La mère et sa
belle-fille disposaient d’un coffre pour s’asseoir tandis que les invités
avaient à leur disposition une planche sur deux caisses comme banc. Sur cette
planche, le dos appuyé sur un chevron, Thans et son
copain passèrent de nombreuses heures tandis que, dehors, l’obscurité régnait
sur un paysage d’hiver désolant. Dans cette pièce seulement éclairée par une
bougie, régnait une odeur de cuir, de saumure et de lessive que tentaient de neutraliser
les pipes des visiteurs. Au milieu de tout cela, Gustje,
le petit-fils se régalait de crème au riz qu’avaient emportée les brancardiers.
Pour sa gourmandise, ils lui faisaient alors réciter son catéchisme. Parfois
les brancardiers assistaient au repas de la maison qui consistait en pommes de
terre et en un peu de viande qui leur faisaient envie. Ils récitaient alors le
Notre-Père en insistant sur « Ne nous soumets pas à la tentation » et
en assurant à leur hôtesse qu’ils n’avaient pas faim ! A 9 heures
moins quart, ils quittaient le cordonnier pour rejoindre l’hôpital tout en
récitant les mystères heureux du rosaire. Cependant la
maison du cordonnier n’était pas encore l’idéale car de temps en temps lanciers
et gendarmes s’y rendaient. C’est à la frontière française, à l’orée du bois
Palestine, que Thans trouva une meilleure planque,
une petite auberge-magasin tenue par Emilie qui l’occupait avec ses deux vieux,
ses deux sœurs et un frère. Les deux cadettes travaillaient à l’hôpital comme
repasseuses tandis que le jeune homme travaillait dans l’usine de munitions de Leffrinkshoucke. Chaque soir, l’auberge était pleine et les
curés avaient le droit de se réfugier dans la cuisine. Ici au moins, il y avait
là une table et des chaises. Dans cet estaminet, se retrouvaient des canonniers
français et des Anglais de la batterie anti-aérienne. Chacun y allait de son
chant ! Pour les deux vieux, le contentement venait du tiroir-caisse :
plus ils entendaient son ouverture et plus ils paraissaient
paisibles ! Avec le temps, ils
voulurent faire la loi et les filles les quittèrent pour s’installer à leur
compte en ayant acheté une baraque de l’autre côté de l’hôpital ! C’est cette
maison qui fut notre troisième refuge. Les trois jeunes filles avaient du
succès. Les piottes s’y retrouvaient nombreux pour
profiter d’un peu de présence féminine. Ils invoquaient des motifs de toute
sorte pour franchir le seuil. Comme les trois demoiselles avaient des frères au
front, il y avait toujours un piotte qui pensait de
son devoir d’informer les sœurs qu’ils avaient rencontré avec un de leurs
frérots et qu’il allait bien. D’autres, comme carte d’entrée, se disaient
parent lointain ou présentaient un petit cadeau comme des bougies, des
allumettes. Les Anglais arrivaient parfois avec un cadeau plus important comme
une bouteille de rhum. Pendant que les sœurs derrière la table tricotaient, les
piottes échangeaient du tabac et remplissaient la
cahute de fumée. Quand il y avait un peu de café sur la cuisinière, alors ils
le partageaient dans des tasses faites de boites de conserve ! Pendant les
bombardements terribles de Pâques 1918, les églises environnantes ne furent pas
accessibles et toute la population civile put jouir de la chapelle de l’hôpital
pour célébrer leurs Pâques. La chapelle remplie ravisait le copain de Thans, Marechal, qui servait la messe et avait un œil sur
tous les fidèles présents. Il rentra après la célébration dans la kitchenette
de Thans pour lui raconter les présences. Celle de Sister Thérèse, l’infirmière qui chantait de façon
angélique, celle du chef du génie qui fit pleurer l’assemblée en chantant « Inter
Vestibulume », celle d’un curé qui commanda une
nouvelle messe et d’une « Demoiselle très-bien » qui mit remit cinq
francs pour acheter des fleurs ! Dans les jours qui suivirent, Marechal
donna des précisions sur cette demoiselle. Il avait appris qu’elle était la
fille du chef de la station d’Adinkerke, qu’elle habitait dans une fermette non loin. Il
avait même été invité à venir dire bonjour à ses parents. Marechal était
convaincu qu’il venait de découvrir une quatrième maison, un quatrième foyer
pour se réchauffer ! Un jour ou
deux après, Thans et Marechal s’y rendirent !
Ils purent se servir du tabac contenu dans le pot du papa, on leur servit des
couques et même une bouteille de vin fut ouverte ! C’était comme si
la guerre était passée ! Sans négliger la maison des trois sœurs, Thans et Marechal se rendirent encore de nombreuses fois
chez ces braves gens. Ils partagèrent leur joie lorsqu’un de leurs parents pu
traverser la frontière pour les rejoindre mais aussi leur chagrin lorsque leur
plus jeune fils fut tué au front par une grenade. Dans cette maison le long du
chemin « Het Veld », Thans
et Marechal trouvèrent l’appui et la fraternité d’un vrai foyer. Les nuits de garde Veiller
était la corvée la plus crainte ! Si au moins, les brancardiers de nuit
avaient pu récupérer du sommeil le lendemain, mais non, il fallait poursuivre
la nuit par un horaire de jour normal. Cette situation conduisait les
brancardiers à remplacer le repas de midi par une sieste dont le besoin était
souvent impérieux… Mais souvent alors, les copains les tiraient de leur lit
pour les emmener au réfectoire et leur faire conter comment s’était passée
leurs nuits de garde. Les matinées succédant à la nuit de garde, ils
travaillaient aussi durement que les autres jours. De 14h 30 à 17h 00 ils
pouvaient néanmoins rejoindre leur baraque mais le sommeil était illusoire avec
une table où les copains jouaient aux cartes bruyamment. A 17h 00, jusque 19h
30, il fallait reprendre le service normal en salle. Généralement
c’est un « eerste Piet » qui annonçait le
matin au brancardier qu’il était de garde pour la nuit. Le soir, le brancardier
de garde pouvait quitter sa salle une demi-heure plus tôt. Il se rendait alors
à « la dépense » pour recevoir un peu de pain, de beurre et de pinard
qui devait lui servir de provisions nocturnes. Il rejoignait ensuite le corps
de garde où il revêtait une vieille capote et recevait des pantoufles et
couvertures. Généralement les « curés » emportaient aussi en-dessous
de leurs bras des livres et cahiers d’écriture. Après cela, le sergent de garde
faisait l’appel et les brancardiers répondaient présents. Seuls quelques
flamands répondaient dans leur langue : « aanwezig ».
C’était pour eux la seule circonstance où ils pouvaient affirmer de tout leur
cœur leur origine. A chaque nom appelé, le sergent ajoutait le numéro de la
salle à laquelle le brancardier était affecté. Il y avait les
« bonnes » et les « mauvaises » salles. Dans les bonnes, il
n’y avait qu’un seul poêle à entretenir, les malades étaient faciles et ni le
docteur, ni l’infirmière n’y ferait la ronde. Par contre, étaient archi
mauvaises les salles avec quatre poêles et où des malades souffraient de
méningite, de diarrhée ou même de neurasthénie… Thans se rappelait de sa première nuit de garde en salle 6,
quand inexpérimenté, on l’avait chargé de veiller sur deux officiers. C’était
des hommes quasi guéris qui devaient bientôt rejoindre leurs bataillons. Ils
avaient eux-mêmes trouvés drôle le fait d’avoir reçu un veilleur et lui
dirent : « Pour nous deux, tu ne dois faire attention qu’à une seule
chose : ne pas nous réveiller ! » Thans,
consciencieux ou naïf crut de son devoir de ne pas s’endormir. Il veilla toute
la nuit sur une chaise souffrant du froid et sous la lumière glauque d’une
lampe à huile. Bien sûr, il
y avait des souvenirs de nuits magnifiques. Pendant la journée, les
brancardiers étaient des genres de coolies où la vie intérieure, la
spiritualité ne trouvait pas sa place. Elle ne prospérait que sous la lampe
éclairant une « bonne nuit ». Les belles pensées étaient pendant la
journée comme des graines empêchées de croître par les orties alors que pendant
la nuit elles pouvaient monter en épi. De l’extérieur ne montaient plus aucun
bruit, le long des parois les lits blancs ressortaient de moins en moins dans
l’obscurité grandissante, les
respirations des malades tendaient au bourdonnement et, on entendait à peine le bruit d’un
ressort de lit ou un court gémissement. C’était une atmosphère anoblissante pour le gardien qui veillait sur le sommeil de
tant de personnes ! Sans tracas, les malades savaient qu’avec un seul mot, ils
pouvaient faire venir auprès d’elles le brancardier. Au bout de la salle, Thans avait installé sa petite table juste en-dessous de la
lampe veilleuse et y avait déposé ses lectures préférées. Sa lecture pouvait
parfois n’être dérangée que par le petit geste de satisfaction qu’il devait
faire lorsque l’infirmière de garde pénétrait dans sa salle pour faire sa ronde en éclairant chaque lit de sa
lampe. Dans ces gardes calmes, Thans écrivait à ses
proches et lisait aussi son bréviaire, ce qui ne savait jamais faire pendant la
journée. De temps à autre, il interrompait ses lectures et écritures pour se
promener dans la salle, donner à boire à un fiévreux ou aller dehors prendre
l’air quelques instants et admirer le ciel étoilé. A l’arrière-saison, les
peupliers nus pleuraient sous le vent et les baraques étaient secouées. La
pluie, quand elle tombait en trombe, faisait un bruit de cascade sur les
planches du toit. Evidemment il y avait
aussi des nuits claires où le canon rugissait et où les fusées éclairantes parcouraient le ciel mais en dehors de ces
nuits, il arrivait que Thans écrive ou lise de 10
heures du soir à 5 heures du matin sans prendre un moment de repos mais,
habituellement, vers 3 heures, il sombrait dans un sommeil de quelques heures,
le plus souvent couché par terre entre deux lits, les pieds dirigés vers la
buse de chauffage car, même en été, les nuits étaient fraîches. Couché par
terre, le moindre son de voix le réveillait mais, aussi la plus petite
vibration déclenchée par un pas sur le plancher de la chambre ou de la
passerelle. C’est ainsi qu’il pouvait être debout avant même que le docteur ou
l’infirmière de ronde pénètre dans sa salle. Devait-il donner de la poudre ou
une boisson à un malade, il se réveillait toujours à l’heure prescrite. C’étaient
des bonnes nuits que celles-là mais il y en avait de très mauvaises ! Quand dans
une salle, il y avait des malades graves, on préférait y envoyer des
brancardiers prêtres. Cette confiance procura à Thans
des nuits de cauchemar. Ainsi un jour de libre, Thans
était parti, avec son camarade Marechal, promener à Hondschoote. Ils avaient
parcourus 30 km quand ils revinrent de leur randonnée en début de soirée. Ils
étaient rentré dans l’hôpital à proximité de ce bloc 16 où on entendait pleurer
et crier « Maman,
Maman ! » ou encore « Oh que j’ai mal, tuez-moi ! ».
Marechal plaignit le malade mais aussi le brancardier de garde ! Il ne
savait pas mieux dire car Thans rencontra sur le
chemin de son dortoir un « eerste Piet »
qui lui demanda d’aller prêter main-forte au veilleur dans la chambre D du bloc
16. (Ce bloc réservé aux maladies très contagieuses comportait quatre chambres
de quatre lits chacun) Thans dans la chambre 16 D entendit toute la nuit les
plaintes du pauvre malade qui effrayaient tant les autres occupants qu’il devait
empêcher ces derniers de se ruer dehors dans les dunes. Le hurleur voulut se
jeter contre le poêle brûlant et se tuer. S’engagea alors une lutte entre le
malade qui s’était levé et Thans qui parvint
finalement à le ceinturer de ses bras tout en appelant à l’aide tandis que les
autres malades hurlaient de peur ! Après une terrible lutte pour remettre le malade au lit, le médecin
arriva finalement. On fit une piqure de morphine au pauvre malade… Cela le
soulagea jusqu’au matin où il recommença à crier après sa maman ! 
Père Hilarion au camp, en uniforme, avec un autre frère Thans avait aussi passé une nuit mémorable avec le vieux
Daniel. Ce pauvre soldat avait la peau devenue entièrement noir à cause de son
infection. Il avait un rictus affreux, ne parvenait plus à parler et émettait
seulement des grognements affreux. Cela dura des heures … Il y eut
aussi un soir, ce colonel grisonnant qui délirait en croyant que son voisin de
chambre avait enlevé sa femme et la maintenait captive. Il se jeta de son lit
et cogna du sol son front et cria le nom de sa femme en lui disant qu’il allait
la délivrer. Il poussa ensuite Thans contre sa porte
et le frappa de ses poings fermés. Ici aussi, ce fut pour lui une nuit
affreuse…. Et puis il y
eut aussi cet anglais blessé au bras par une bombe lancée d’avion et dont on
craignait la gangrène. Dans la blessure, il y avait un drain. Le pauvre homme
mordit le drain pour s’en débarrasser ce qui entraîna une hémorragie et de la
douleur. Pâle comme un mort, il ne se plaignit pas mais gémit d’un ton monotone
et étouffé en réclamant sans cesse à boire ! Quel
soulagement de voir après de pareilles nuits le soleil se lever et quel besoin
alors d’aller alors à la chapelle et de prier à l’autel mettant notre espérance
en Dieu car l’aimant encore ! Le côté léger Il y avait les jours d’été où les
convalescents étaient réunis sur la plaine de sable. On les mettait sur des
chaises longues avec un chapeau de paille sur la tête. Ceux qui avaient
l’autorisation d’un bain de soleil étaient couchés sur des couvertures dans le
sable. A leur côté, sur une natte tressée, l’infirmière lisait ou brodait.
Comme distraction, il y avait le ballet des avions dans le ciel. Il arriva
qu’un avion lance au-dessus de l’hôpital une missive qui tourbillonnait dans le
ciel avant d’atteindre le sol et sur laquelle était inscrit un message adressé
aux « fleurs souriantes de la vallée
des larmes de Cabourg ». Sur
l’heure de midi, on entendait la musique d’un gramophone. Parfois une musique
de régiment était invitée et pouvaient entendre leurs airs favoris dont « A doll »
qui était chantonnée par beaucoup d’entre eux. A cette occasion, tous ceux qui
pouvaient quitter leurs lits se rassemblaient et le
lieutenant revêtait sa plus belle tenue munie du sabre qui faisait l’objet de
beaucoup de commentaires de la part des médecins. D’autres fois, c’était une
pièce de théâtre ou de la musique classique. Cela avait lieu dans la chapelle.
Les brancardiers avaient peu de chance de se trouver dans le public car il y
avait toujours des malades à garder dans les pavillons. L’été était cependant une période reposante
car il y avait moins d’entrées et les brancardiers trouvaient le temps de faire
de longues promenades le dimanche. Ils essayaient de se rapprocher au plus près
du front malgré les rondes de gendarmes et cela pour essayer d’apercevoir les
tranchées, l’Yser et les inondations. Une fois près d’Oostduinkerke,
les Allemands tirèrent quelques obus en direction de Thans
et de ses amis. Ce fut leur fierté de raconter leur aventure aux copains.
Quelques fois, l’expédition tournait mal et les brancardiers étaient arrêtés par
une sentinelle. Il fallait expliquer une perte de chemin mais le pire était
quand un coup de téléphone était donné à l’hôpital. Un jour Thans
et Marechal parvinrent à pénétrer dans la ville de Veurne. Ils y contemplèrent
les dévastations. La seule personne qu’ils rencontrèrent fut une vielle
religieuse qui leur sourit, heureuse peut-être d’avoir rencontré autre chose
qu’une patrouille. Parfois
l’excursion se faisait en France, notamment à Hondschoote, petite ville avec un
canal minuscule et une grosse église. En rue, on parlait français mais à
l’intérieur des maisons, c’était le patois flamand que l’on parlait. Dans un
magasin, les brancardiers achetaient pain et fromage, le repas du soir qu’ils
prenaient tout en retournant à l’hôpital. Parfois, par hasard, ils
rencontraient une vielle « mama » qui
apprenant qu’ils étaient prêtres, les invitait à rentrer chez elle. Elle
revêtait alors la table d’une nappe blanche et leur servait un café
« d’avant-guerre ». Parfois une grand-mère ne voulait pas s’asseoir à
leurs côtés, car elle était de la vielle école qui éprouvait de l’indignité
face à un prêtre. Mais la
promenade la plus fréquente était la ville de La Panne. Pour les brancardiers,
c’était la « grande » ville, la même impression que d’être dans la
rue neuve de Bruxelles. A La Panne, il y avait des beaux magasins où nous
pouvions même trouver un peu de littérature comme « Les moines » de
Verhaeren. On pouvait voir passer les Ecossais habillés de leur kilt, précédés
de leur chèvre mascotte, et tapant sur leurs tambours. On y rencontrait aussi
toujours l’un ou l’autre copain oublié. Après une visite à l’église paroissiale
ou à la chapelle des Oblats où un jour, ils rencontrèrent le roi en personne,
si les finances le permettait, ils allaient s’acheter quelques fins cigares,
des gâteaux à la crème fraîche, nommés « Boules de l’Yser » et du
papier à lettre illustré qui était destiné à être envoyés à leurs
correspondants qui leur envoyaient des colis. Quand ils avaient décidé, de
dîner en ville, ils se rendaient dans une cabane mansardée en face du cinéma.
Là on pouvait manger des moules, des œufs et des harengs en plein air. Il y
avait des planches sur piquets qui faisaient office de tables. La mère se trouvait devant le fourneau et la fille servait.
Elle s’adressait en français aux clients par un « Mossieu » mais en flamand
s’était plus rapide : « Wat moedde gij hen ? » (Qu’est que tu veux ?) Elle donnait
seulement un couteau pour deux car beaucoup commettaient l’indélicatesse d’emporter
avec eux cet ustensile. Une fois, elle voulut entamer la conversation avec
Marechal qui gêné, lui fit comprendre pour éviter tout malentendu, qu’il était prêtre.
Cela ne la mit pas dans l’embarras car, dit-elle, elle avait un frère dans la
même situation. Elle ne pouvait cependant le décrire, disant seulement qu’il
portait des lunettes, le signe pour elle de son état clérical. Un soir qu’un
gars l’ennuyait, elle lui lança un « Foert, smeerlap » et comme le gars voyait
cela comme un compliment, elle lui envoya une gifle qui lui fit comprendre que
ce n’était pas un mot d’amour. Après avoir payé le repas d’un franc vingt, les
brancardiers allaient ensuite se promener sur la digue en passant devant le célèbre
hôtel Teirlinckx pour y admirer derrière les vitres les quelques copains qui
avec des vestes fantaisies et des bonnets de police essayaient de rivaliser
avec les officiers aux belles tenues. La promenade se poursuivait ensuite pour
arriver devant la villa royale et les dunes proches ou ils gravissaient la plus
haute pour de là admirer la mer ! Une mer qui était pour les brancardiers
une source de joie car ils y retrouvaient la beauté de la nature, reflet de
l’infini et de son créateur et que ne pouvait dénaturer l’homme en guerre. Pour
eux, le spectacle de la mer en toute saison était manifestement une aide précieuse pour garder le moral. Les gaz C’était en
avril 1917 que les premières victimes des attaques au gaz arrivèrent dans notre
hôpital. L’hôpital avait été prévenu par téléphone. La salle 16 D où reposaient
les cas de typhus furent vidées et les parois et plancher passées à la créoline. Des bidons d’oxygène furent alors posés au milieu
de la salle et les lits mis en cercle autour d’eux. Les gazés arrivèrent pâle,
sans forces et respirant péniblement grâce aux efforts de leur cage thoracique.
Six médecins les accueillirent et les relièrent aux bonbonnes par des tuyaux en
caoutchouc mis dans leur nez. L’oxygène passait d’abord dans un flacon d’eau
pour être humidifié. Le soir, on ne constata aucun décès. Au mois de
mai, apparurent dans notre ciel des nuages de gaz. A peine dans leurs lits, les brancardiers entendirent l’alarme du
clairon. Chacun devait alors mettre son masque puis tous les médecins y compris le colonel, se
ruaient, accompagnés des infirmières, dans les salles pour faire mettre aux
malades le masque que chacun disposait au-dessus de son lit. Au mois de juin,
ce fut plus grave. On entendit le bombardement et l’alerte fut donnée à 1 heure
du matin. Thans mit son masque mais ne put le
supporter qu’un quart d’heure après quoi, il eut l’impression que son crâne éclatait.
Heureusement, le gaz n’atteignit pas l’hôpital. Trois heures après, nouvelle
alarme. Thans avoua ne pas avoir mis son masque mais
le tenir sous les couvertures, serré dans ses mains. Ouf, l’alerte passa
encore sans dommage pour l’hôpital. Le
matin, arriva alors une flopée de soldats débarqués par les ambulances.
Plusieurs fois, en seulement quelques heures, ce sont deux cents soldats gazés
qui arrivèrent à l’hôpital. Ils étaient rouges comme des parois de poêle. Un
jeune capitaine avait porté un gazé et seulement à cause du contact avec ses vêtements avait été, à son tour,
atteint jusqu’aux jambes. Presque tous
les blessés avaient les yeux congestionnés et restaient aveugles plusieurs
jours. Leurs nuits étaient affreuses et les brancardiers devaient supporter
leurs plaintes et leur toux. Parfois, comme Thans,
ils se tenaient la tête avec les deux mains et se demandaient s’ils n’étaient
pas plutôt deux mille ans avant le Christ. Quelle catastrophe que cette
innovation de la science ! Un jour
tragique fut le 29 janvier 1918. C’était justement le mariage dans notre
chapelle de la fille d’un général. Le soir on donnait un concert dans le salon
des infirmières quand on amena à l’hôpital des gazés en nombre gravement
atteint et émettant par la bouche des secrétions teintées de rose. La plupart reprisent conscience avec
l’oxygène mais hélas, en 24 heures, 14 soldats ne purent être sauvés. L’autorité
décida de faire de l’enterrement une grande cérémonie. Toute personne qui
n’était pas de garde y participa. Dans la chapelle, les officiers et docteurs
prirent place au premier rang à droite tandis que les infirmières occupèrent le
premier rang gauche. Les clairons résonnèrent à la consécration. Les cercueils
après la messe furent conduits dans la cour d’honneur où quatre voitures
d’ambulances attendaient. Les cercueils furent ensuite chargés et le cortège se
dirigea vers le cimetière de La Panne. Arrivés, un docteur fit un discours
d’adieu puis un officier et enfin un général qui décrivit les allemands comme
des lâches et des traitres. Il leva son sabre vers les cercueils et cria
« Nous vous vengerons ». Personne ne pleura. Un soldat trouva que
l’on aurait dû plaindre plus les victimes. Un prêtre trouva que l’on aurait dû
parler de sacrifice. Les soldats casqués qui avaient rendus le dernier hommage
à leur frère se dépêchèrent alors de se rendre à la cantine pour réclamer une
bière. L’autopsie de Mielke Thans était dans l’arrière-cuisine quand un « eerstePiet »vint le trouver pour le prier d’aller
aider le docteur en vue de réaliser une autopsie. « Va, dit-il, dans la
morgue, installe le corps de Mielke sur la table
d’autopsie et attend le docteur ! » Mielke mort ! C’était un blessé intransportable du
vieux Cabourg « chirurgical ». Thans s’en
était occupé dès son affectation à Cabourg. Son bas ventre était une immense
plaie. Il ne ressentait plus son bassin car il était paraplégique, ayant reçu
une balle dans la colonne. Sœur Thérèse nettoyait sa plaie avec de l’eau chaude
pendant que Mademoiselle Huybrecht expliquait à Thans le pourquoi de l’absence de douleur ressentie par Mielke. Ses copains se demandaient pourquoi Mielke ne mourait pas mais Mielke
avait tout au plus 24 ans et ne désirait pas mourir. Il tint bon longtemps. Thans trouva la
morgue cachée derrière des arbres dans un coin désert. Il ouvrit la porte
fermée à clef et pénétra dans la salle d’autopsie dans laquelle ses yeux et sa
gorge furent de suite irrités. A côté de la table, il y avait un seau destiné à
recueillir les liquides corporels qui s’écoulaient par la rigole de la table.
Une armoire vitrée contenait les instruments et quelques bocaux ; un bocal
contenait un morceau de cœur, un autre un morceau d’intestin. A côté du mur, se
trouvait aussi une table à laver avec bassin et robinet. Sous la table de
dissection se trouvait des bacs métalliques avec des restes humains, des morceaux
de muscles, des morceaux de jambes. Sur l’armoire vitrée se trouvait aussi un
paquet. Thans l’ouvrit et découvrit deux mains
jaunies avec de longs ongles et des doigts bleuâtres. Une odeur infecte de formol le fit tousser. Traversant la salle
d’autopsie, il pénétra dans la morgue. Contre le mur chaulé, se trouvait une
croix sans Christ et sous cette croix trois cercueils. Celui du milieu était
celui de Mielke. Ce corps martyrisé et cependant
libéré faisait penser à l’image d’un Christ byzantin. Entre ses doigts, il
tenait un chapelet. Retirer le corps du linceul se révéla très difficile. Les
bras étaient trop raides. Finalement Thans employa
les ciseaux. Apparut alors l’immense plaie remplie d’ouate. Quand Thans saisit le corps pour le mettre sur la table, les
cheveux de Mielke touchèrent sa joue et Thans eut alors le besoin vital d’aller respirer l’air du
dehors. Apercevoir les filles du lavoir suspendre le linge sur les cordes lui
apporta un grand réconfort. Au loin, résonnaient des notes de piano provenant
du salon des infirmières. Mais il fallait à nouveau rentrer près de Mieke, lui retirer l’ouate de la plaie, allonger ses bras
le long du corps. Cette tâche effectuée, Thans
s’assit sur la chaise et pensa à Mielke. Il s’avoua
ne pas connaître grand-chose de ce soldat à l’exception qu’il était fils de
paysan. Quelque part dans une ferme, son père, sa mère, ses sœurs devaient être
occupés à boire du café, assis le long d’un champ et à
penser à lui. Le soir ils devaient certainement prier pour lui. Le deuxième
jour de la pentecôte, ils ont été certainement à pieds prié la vierge à Scherpenheuvel et la plus jeune des sœurs, un médaillon
avec le portrait de son frère suspendu à son cou, s’est rendue à Zutendaal. Pour rien au monde,
Mielke ne voudrait être vu dans cet état par sa
famille ! Enfin le
docteur rentre dans la salle. « Déjà fatigué, Thans ?
Ce ne sera pourtant pas une autopsie facile, car nous devons examiner la
colonne et le cerveau. Donne-moi mes gants et prépare les trois couteaux, le marteau
et le ciseau ! Désinfecte tes doigts et fait attention de ne pas te
blesser car Mieke contient assez de virus pour
décimer un régiment ! » Avec un
scalpel, le docteur coupe le cuir chevelu d’oreille à oreille puis le rabat sur
le visage en le faisant tirer entre pouce et index par Thans !
Ensuite, le doc demande à Thans de tenir la tête de Mielke
par les oreilles tandis qu’il emploie la scie. Dur travail ! La sueur
perle sur le visage de Thans et du docteur ! La
voûte crânienne soulevée, le docteur saisit le cerveau et le porte sur la table
du lavabo et le dissèque pour enfin dire « dans l’ensemble c’est
normal ! ». La deuxième partie de la dissection commence : il
faut examiner la colonne. Mielke est mis sur le
ventre ; un long lambeau de chair découpé fait apparaître la colonne que
coupe au marteau et ciseau le docteur. Tout à coup on toque à la porte, une
infirmière avec un visage encore juvénile demande d’assister à
l’autopsie. « Je ne tomberai pas dans les pommes car j’ai pris mes précautions,
dit-elle ». Le docteur est furieux. « Sortez
Mademoiselle ! » - Docteur, de grâce… - Dehors, nous n’avons pas besoin d’un public féminin ici ! » Le docteur
examina chaque vertèbre découpe puis les laissa tomber dans un bac en zinc. « Maintenant,
Thans, remet Mielke sur le
ventre, nous allons examiner ses organes. » Une longue
incision est faite du menton jusqu’au bas ventre. Les organes sont extraits et
examinés « Atrophie,
décoloration…, commente le docteur. » Puis tout
d’un coup, le docteur enlève ses gants et dit à Thans : « Vous
les nettoierez minutieusement et vous désinfecterez les instruments » - Avez-vous déjà vu un cordonnier recoudre du cuir ? Vous ferez la même
chose avec le corps ! Bien, vous m’avez beaucoup aidé ! Et le
docteur laissa Thans avec le pauvre Mielke ! Thans s’assit d’abord en laissant la porte ouverte !
« Pourquoi tout cela ? Pensa-t-il ! »
C’est la guerre et ce corps est le résultat de la guerre ! Blesser et tuer, le premier devoir de
celle-ci ! Pourquoi ? La guerre est vraiment une folie
collective ! Thans, en une fois, quitte ses pensées car maintenant son
objectif immédiat est de sortir de ce trou le plus vite possible. Il saisit les
organes et les remet plus ou moins à leur place mais les vertèbres glissent
l’une sur l’autre et les morceaux de cerveau ne veulent pas tenir sous le
crâne ! Finalement il remet le tout sans ordre dans le corps et remplit le crâne d’ouate. A
grand coup d’aiguille, le corps est suturé mais Thans
se pique deux fois. Il lave ensuite Mielke et puis
saisit le corps pour le remettre dans le cercueil. Sa chemise pliée servant de
coussin pour sa tête tandis qu’il dispose d’une couverture pour le
recouvrir ! Thans
récite ensuite le De Profundis et se fait un devoir de remplacer la maman de Mielke en donnant un baiser sur le front de son cher fils
qu’elle ne verra plus. Les instruments sont ensuite nettoyés. Quant au sol,
ouf, il sera nettoyé le lendemain par les hommes de corvée. Thans
peut enfin quitter cet endroit et son premier réflexe est de se diriger vers la
chapelle pour retrouver la présence du Saint-Sacrement et vaincre ainsi
l’obscurité pénétrée dans son cœur par la vision de Mielke
autopsié. 
Chapelle de Cabour Intermède : Fête secrète
dans la sacristie Le 13 juin,
jour de la St Antoine, Thans voulut fêter son
ami ! D’ailleurs l’occasion d’une petite ripaille se faisait pressante car
depuis six mois, les brancardiers n’avaient plus mangé de véritables pommes de
terre, seulement du béton armé encore et toujours ! Mais comment organiser
une ripaille en secret. Thans avait son idée :
on prendrait le prétexte d’une réunion fraternelles des Franciscains et, pour
faire « distingué », Suster Thérèse serait
aussi invitée (Suster
Thérèse était une infirmière qui prenait soin de la chapelle et qui cousait ses
ornements liturgiques). Le père Peeters de La Panne serait aussi invité. Pas
moyen de réserver la salle de la ferme
Jordaens car des aviateurs et infirmières l’ont réservée. Au dernier moment Thans décide de célébrer dans la sacristie annexe de la
chapelle. Le poêle Primus sera prêté par une salle de malade, de même qu’une
table. La nappe serait un drap et les serviettes des mouchoirs blancs. Thans répondit aux objections en considérant que le fait de
souper dans une sacristie n’était pas un sacrilège car les premiers chrétiens
soupaient dans leurs églises ! Le souper
secret du soir de la Saint Antoine fut très réussi et cérémonieux. Le menu
prévoyait : Sardines à l’huile avec pain et beurre.
Saumon avec pommes de terre et sauce au beurre. Jambon aux œufs et pain
militaire. Saucisse de la Meuse avec salade de tomates. Café filtre avec sucre.
Vin rouge, vin blanc et cigares Keystone. Il fallut
cependant souper dans le noir pour ne pas éveiller la curiosité des promeneurs
et ne pas faire trop de bruit car l’aumônier qui logeait de l’autre côté de la
chapelle était rentré dans sa chambre plus tôt que prévu ! Après le repas,
ces messieurs étaient invités au fumoir dans les dunes ! Le souper
prolongé dans les dunes dura jusqu’à 11 heures du soir, heure à laquelle des
« Aviatiks » apparurent dans le ciel et commencèrent
à lâcher des obus. Comme le spectacle était « facultatif », les
brancardiers alors choisirent de rentrer à toute vitesse dans leur
dortoir ! Ainsi se termina cette mémorable assemblée de Franciscains à
l’hôpital de Cabourg. L’apostolat Il y avait
trois blocs dortoirs pour le personnel brancardier et de corvée. Un des blocs,
celui de Thans était appelé la baraque des curés
parce que les religieux arrivés dans les premiers à l’hôpital s’y étaient
concentrés. Dans cette baraque les religieux occupaient l’extrémité, au milieu
se trouvaient les brancardiers instituteurs et à l’autre extrémité, il y avait
un mélange d’autres professions. La baraque des curés connaissaient la même
ambiance que les autres dortoirs : on jouait aux cartes, on s’y faisait
des blagues mais ce qui dominait, c’était le respect mutuel. Personne ne se
moquait quand l’un des occupants se mettait le soir ou le matin à genoux à côté
de son lit pour prier. Chaque fois qu’un lit se libérait, il y avait une
quantité de candidatures pour venir l’occuper. Il est clair que l’apostolat des
religieux était réduit au minimum à Cabourg. Néanmoins, il ne fut pas nul. Il y
avait d’abord l’exemple donné de religieux qui exerçaient sans se plaindre les
taches les plus humbles. Cette attitude fit en sorte que beaucoup d’officiers
malades qui étaient jusqu’alors des anticléricaux forcenés révisaient leur point de vue. Et puis il y
avait des occasions où l’amitié avec un prêtre brancardier aboutissait à une
conversion ou une reprise d’attitudes chrétiennes. Thans
raconte ainsi deux rencontres. La première eut lieu lorsqu’il occupait le
« poste réserve » dans le bloc d’admission. Le règlement
prévoyait que deux brancardiers devaient se tenir du matin au soir dans ce bloc
afin de faire face aux arrivants pour les déshabiller, les laver, et puis après
une première visite médicale les conduire dans un bloc d’hospitalisés. Ce job
appelé « réserve » revenait toutes les deux à trois semaines pour
chaque brancardier. Thans donc se retrouva donc un
jour « de réserve » avec l’infirmière Moreels, une remarquable
infirmière hollandaise et avec Vlierman, un rude
chauffeur flamand. Comme tout était calme sur le front, Thans
profita de sa corvée de garde pour s’installer dehors et lire un livre. Avec
une certaine curiosité, Vlierman s’approcha de son
compagnon de corvée et lui demanda si sa
lecture était plaisante. Thans lui répondit que
c’était un livre didactique pour apprendre comment bien manger et boire et
comment rester heureux sans devenir malade. Vlierman
lui répondit alors qu’il était ce type d’homme avant la guerre, qu’il
fréquentait les cafés avec joie et qu’il y chantait car il connaissait une
centaine de complaintes. Un beau jour, il eut envie d’en écrire lui-même et
montra à Thans, en sortant de sa poche quelques
papiers, une de ses réalisations. C’était une drôle de
complainte qui racontait une tragique méprise. Un jeune homme s’était disputé
avec son père, avait quitté le foyer paternel, fait fortune à l’étranger puis
était revenu chez lui en se faisant passer pour un voyageur cherchant une
chambre. Les parents avaient alors constaté la richesse contenue dans le
portefeuille du voyageur et pendant la nuit le père avait égorgé le
voyageur ! Dans le portefeuille se trouvaient des tas de billets mais
aussi l’identité de la victime et le père se rendit compte qu’il venait de tuer
son fils !!! Vlierman venait de terminer son
récit quand l’aumônier passa à proximité des hommes de
« réserve ». Vlierman dit alors à Thans :
« Ce n’est pas un mauvais garçon cet aumônier, j’ai même reçu un peu
d’argent de lui en récompense de mes services car je lui porte journellement
dans sa chambre son charbon mais je l’envie car il est trop instruit pour moi. - Tu devrais peut-être lui parler quand même ! - C’est trop demandé, répondit Vlierman, j’étais un
pauvre gars chassé de la maison à vingt ans et j’étais saoul tout le temps tout
en commettant des vols, des bagarres au couteau et tout en courant les filles
de mauvaise vie. Mais maintenant, j’ai changé et je viens de trouver une brave
femme qui attend quelque chose de moi. Penses-tu que je doive me marier ? - L’aumônier pourrait alors t’aider !
Mais veux-tu que j’aille le trouver ? - Précisément répondit Vlierman. Thans servit alors d’intermédiaire entre l’homme rude et
l’aumônier. Et c’est ainsi que Vlierman eut un
« congé d’urgence » et que le mariage fut célébré. Depuis lors,
Vlierman vint à toutes les messes du dimanche. Une autre
histoire d’apostolat déguisé fut racontée par Thans.
Un jour qu’il était dans l’arrière-cuisine de son bloc de malade, un vieil
homme de corvée, « Papa Pinard » vint le trouver. Thans
ne précise pas si c’était un soldat volontaire ou un civil rémunéré pour
travailler à l’hôpital. « J’avais
l’habitude de recevoir du père Hermant une bouteille
d’alcool pour laver mon crâne. J’ai 41 ans et je suis encore trop jeune pour
devenir chauve. » Thans alla donc remplir une bouteille d’alcool pour ce
vieux qui lui faisait pitié. Mais plus tard en discutant avec ses collègues à
table, il apprit que l’homme était surnommé
« Papa Pinard » et qu’il prenait prétexte de sa calvitie
débutante pour aller quémander partout de l’alcool avec lequel il se saoulait
chaque nuit. Thans résolut alors de donner une leçon
à Papa Pinard. Il remit à l’intéressé une bouteille avec de l’alcool très dilué
dans de l’eau. Quand il revint vers Thans, ce fut pour lui dire : « Espèce de curé,
va ! Je ne t’ai pas demandé de l’eau bénite ! » Mais à partir de ce moment, Papa Pinard et Thans devinrent de grands amis. Il arrêta de boire et
montra à Thans la photo de sa femme et de ses cinq
enfants. Il lui avoua, qu’il ne s’était pourtant encore jamais marié ni à
l’église, ni à l’hôtel de ville. Et bientôt arriva le jour où « Papa
pinard », devenu abstinent, régularisa sa situation. Les prêtres
brancardiers faisaient donc peu d’apostolat sauf les jours où régnait une
épidémie. L’aumônier (de Meurichy) était alors
dépassé et avait demandé de l’aide. Les prêtre-brancardiers couraient alors
dans les blocs avec les Saintes Huiles pour donner les derniers sacrements. A part quelques cas, jamais un soldat ne
mourait à l’hôpital sans les recevoir. Il faut dire qu’il y avait une certaine
insistance auprès des mourants. Certains ne se rendaient pas compte de la
gravité de leur état et promettait de remettre à plus tard, lorsqu’ils seraient
guéris, leurs confessions et prières. Il
fallait alors leur dire assez durement qu’ils n’en auraient peut-être pas la
possibilité au vu leur état très grave. La plupart, alors, acceptaient la confession et le sacrement des malades. Peu
importe, écrira Thans, qu’ils se remettent à jurer
comme des hérétiques, par après dans un délire, les braves étaient
sauvés ! 
Avec la cruche à l'étang. Virzinie Thans fut encore appelé quelques fois pour aider le docteur
dans les autopsies. Beaucoup refusaient ce travail ou bien acceptaient mais
défaillaient rapidement à la vue du corps. Thans se
rappelle d’autres aventures survenues lors de ces autopsies. Un jour, son bras
gauche faillit lorsqu’il leva le corps pour le mettre sur la table et celui-ci tomba
sur le sol avec sa tête la première… Aussitôt deux jets de liquide trouble
sortirent de ses narines ! Une autre fois, il n’eut d’autres solutions pour hisser le corps sur la table que de le
mettre debout et de le tenir serré contre lui et ainsi de le faire avancer par
de petites pas de « danse ». Une autre fois, il dut couper le tube digestif en
entier et le remplir d’eau par une de ses extrémités afin de constater
l’endroit de la perforation. Après quoi, il dut couper l’intestin en segments
d’un mètre et ensuite les ouvrir sur toute la longueur ! Une autre
dissection le marqua. C’était celle d’un civil habitant derrière le front. Le
médecin voulut disséquer toute sa musculature. Quand tout fut fini, et le corps
en morceau remis dans le cercueil, Thans constata en
sortant de la morgue qu’une femme habillée comme une veuve se dirigeait vers le
bureau des entrées. Elle désirait voir son mari qui venait de décéder ! Elle tenait par la main une petite fille !
Heureusement que l’adjudant la fit attendre
dehors en lui disant d’attendre un officier. Ce dernier sachant que le décédé
n’était pas présentable, ne rejoignit pas la veuve qui, au bout d’un très long
moment, s’en retourna d’où elle était venue avec sa fille qui pleurait à
chaudes larmes ! Thans une fois refusa cependant d’aider à une autopsie. Il
s’agissait de Virzinie. Virzinie
fut une des rares femmes hospitalisées à Cabour. Quand
les Allemands menacèrent d’envahir notre littoral en tentant un assaut furieux
au printemps 1918, il fut décidé d’évacuer les malades d’un hôpital civil situé
à proximité vers Montreuil en France. Virzinie très
gravement malade, qui souffrait d’une tuberculose étendue à de nombreux
organes, fut déclarée non transportable et exceptionnellement admise à
l’hôpital militaire. On lui consacra une chambre dans le bloc 16 et Thans fut le premier brancardier à la soigner car il était de
garde de nuit lors de son admission. L’infirmière lui recommanda de ne pas lui
donner à manger à l’exception d’une cuillère de lait écrémé toutes les
demi-heures. Virzinie avait entendu l’infirmière
appeler Thans par son surnom « Grand-Père ». Elle lui demanda pourquoi ce nom alors
qu’il n’avait même pas de cheveux gris. C’est de cette façon qu’une
conversation surgit entre Virzinie et Thans. Comme elle ne pouvait s’endormir, la jeune fille de
18 ans demanda à Thans de réciter avec elle le
chapelet puis lui conta son histoire. Elle était depuis des années malade et
confinée dans une mansarde au-dessus de l’auberge que tenait sa mère. L’hiver,
il y faisait très froid et, en été,
torride. Les jours lui semblaient interminables. Le soir elle entendait danser
en bas mais la nuit, les obus faisaient trembler les tuiles de son plafond.
Elle se sentait alors complètement abandonnée et n’avait d’autre recours que
son chapelet. Un jour, une auto avec des « juffrauwen
« débarqua à l’auberge et emmenèrent Virzinie à
l’hôpital. C’était là un séjour plus agréable malgré l’absence de sa mère qui
ne pouvait lui rendre visite faute, disait-elle, de ne pouvoir abandonner son
auberge un seul instant. « J’ai
18 ans, disait Virzinie, et je connais si peu de la
vie. Ah si je pouvais au moins être plus costaude pour pouvoir aider ma
mère ! » Après cette confession, Virzinie
se sentit prête à essayer de dormir. Elle demanda à Thans
de la soulever pour la placer comme il faut au milieu de son lit. Thans qui avait l’habitude de soulever les lourds soldats
leva ses bras avec la force habituelle qu’il employait d’habitude et fut alors
surpris par l’extrême légèreté de la jeune fille. Après cela, Thans alla s’asseoir devant sa table et commença à rédiger
son abondant courrier mais, à chacun de ses correspondants, il demanda de prier
pour la petite Virzinie qui l’avait ému. Quelques
jours plus tard, l’aumônier confia à Thans qu’il
avait réussi à atteindre la maman de Virzinie par
téléphone et qu’il lui avait proposé d’envoyer une ambulance la chercher pour
qu’elle puisse se rendre au chevet de sa fille. Elle aurait alors un trajet
d’une à deux heures. A la stupéfaction de l’aumônier, la maman avait alors
refusé prétextant que l’hôpital était vraiment trop loin ! Le
lendemain, c’était un dimanche, Virzinie mourut. On
appela Thans pour aller voir au chevet de la morte. Virzinie était magnifique. On l’avait revêtue d’une robe
blanche et l’infirmière madame Drubbel avait disposé
des roses blanches à sa tête et des rouges à ses pieds tandis qu’elle tenait
son chapelet entre ses mains. Thans priait à son
chevet quand le lieutenant rentra, fit un salut militaire et posa la question
de savoir qui fournirait le cercueil car il n’était pas possible que l’armée en
fournisse pour une personne civile. « Peut-être, dit le lieutenant, que l’on
pourrait envisager une collecte … » Thans ne
laissa pas le lieutenant continuer sa phrase et lui dit qu’il paierait le
cercueil lui-même. Thans ne paya rien car Madame trouva que c’était aux
infirmières à y veiller. Le soir quand il rentra dans sa salle, un docteur vint
le trouver. « Thans, nous avons une très intéressante autopsie à
réaliser. » Thans lui répondit : « Non
docteur ». Le docteur avait certainement vu dans les yeux de Thans qu’il ne pouvait insister ! 
Écrire une lettre qui rime Un brancardier indispensable Le temps
passait et beaucoup d’amis de Thans trouvaient qu’il
méritait mieux comme affectation et que ses qualifications devraient être mieux
utilisées. Beaucoup de ses relations essayèrent de lui trouver un poste
d’aumônier. Thans posait alors sa candidature mais à
chaque fois, les autorités de l’hôpital émirent un avis défavorable sur sa
demande de mutation en signalant que l’intéressé était indispensable à Cabourg.
Voici quelques exemples de ces tentatives malheureuses : L’aumônier
de l’hôpital de Beveren demandait un aumônier adjoint. Le colonel Nolf mit un avis favorable mais le lieutenant Bidel exigea que Thans trouve
d’abord son remplaçant ce qu’il ne parvint pas à faire. Un peu plus
tard, on demanda un prêtre-brancardier pour le service religieux du
cantonnement de Ghyvelde. Là, sa demande fut refusée
par la hiérarchie avec la mention « indispensable ». Le Père
Bertrand muté au Havre demandait un adjoint. Le ministre Helleputte
appuyait la candidature de Thans mais malgré cet
appui, la demande de mutation de Thans fut encore une
fois refusée avec le même motif : « indispensable ». A Leizele, se trouvait un hôpital qui demandait un
brancardier qui accepterait des responsabilités d’aumônier, surtout durant les
nuits. Même réponse de la hiérarchie. En Suisse,
on demandait un aumônier pour les enfants belges. Mgr Marinis,
l’aumônier en chef intervint en sa défaveur prétextant qu’il était volontaire
de guerre et qu’il devait d’abord donner sa démission avant de pouvoir se
rendre dans un pays neutre, ce qui n’était pas possible ! Fin 1917,
Cabourg s’agrandissait et il était évident que bientôt l’aumônier aurait besoin
d’un adjoint. Malheureusement au printemps 18, devant les menaces d’un assaut
ennemi, on commença à démanteler certains pavillons et on ne parla plus à
Cabourg d’un futur aumônier adjoint. D’Angleterre,
le Père Christophe De Keyser qui s’occupait des réfugiés belges, signala à Thans que la duchesse de Vendôme pourrait l’employer comme
chapelain. Après un certain temps on ne parla plus de cette demande, Thans restait toujours indispensable. Un jour, l’Etat-Major décida d’envoyer des brancardiers d’hôpitaux
vers le front. On réalisa un examen médical. Le médecin-major qui examina Thans lui demanda pourquoi il n’était pas sur le front. Thans lui répondit « Justement, je vous demande de m’y
envoyer ! » Le toubib lui répondit: « Farceur, retourne à
ton travail ! » Un
après-midi, un aumônier de bataillon lui demanda s’il était prêt à rejoindre
son bataillon comme adjoint. Thans répondit par un
oui enthousiaste mais ne revit plus jamais l’aumônier. Plus tard
encore, un prêtre-brancardier fut demandé dans un poste à l’avant. Thans saisit cette nouvelle chance mais plus jamais, on ne
lui donna des nouvelles du poste qu’il convoitait. Toutes ces
déceptions n’étaient pas pour Thans des malheurs. Il
avait en effet la confiance des médecins de Cabourg, des infirmières. Les
nouveaux brancardiers et nouvelles infirmières venaient, maintenant qu’il avait
beaucoup d’ancienneté à Cabourg, solliciter très souvent ses conseils. De plus
aucune remarque des « eerste Piet » ne
pouvait l’atteindre. Ainsi, Thans avait laissé jouer
aux cartes six convalescents après l’heure du coucher. Un « eerste Piet », surnommé « de baard »,
surprit les joueurs et cria à Thans qu’il devrait
passer au rapport chez le lieutenant pour ce manquement. Quand Thans se présenta le lendemain au rapport, le lieutenant Bidel lui demanda ce qu’il venait faire parce qu’il n’avait
pas été convoqué ! Un autre
jour, Thans désobéit aux ordres et au lieu de faire
la file devant la cuisine pour recevoir le lait destiné à ses officiers
malades, décida de rentrer lui-même dans la cuisine pour y faire remplir ses
bidons sous peine de mécontenter ses malades qui étaient des officiers
impatients. Il savait que sauter la file pouvait lui valoir 3 jours d’arrêt. Il
fut surprit par Bidel qui en le voyant commença sa
phrase : « trois jours d’… »
mais ne l’acheva pas en reconnaissant subitement le
visage du fautif. Oscar était
un brancardier qui s’apprêtait à partit en permission spéciale pour se marier
et Thans avait même rédigé pour lui des poèmes qu’il avait envoyé à sa promise. Peu avant sa
permission, il fut surpris au chevet d’un diphtérique sans sa blouse. Thans ne put y faire, sa permission fut supprimée. Un peu
plus tard, le colonel Nolf trouva Thans
sans tablier auprès d’un autre diphtérique. Thans
s’expliqua en disant que le malade l’avait appelé alors qu’il n’avait pas
encore eu le temps de revêtir sa blouse. Le colon lui répondit :
« vous mentez ». Et…il laissa l’infraction sans autre
conséquence ! Thans se sentait vraiment « protégé ». Un jour
qu’il fumait dans le pavillon, ce qui était interdit, il fut surpris par Nolf qui lui dit « Thans, tu fumes ! » et cela aussi resta sans suite alors que
c’était considéré comme une faute grave. Thans reconnaissait que finalement il aimait Cabourg mais
que, quelques fois, il se sentait comme un prisonnier derrière des barreaux. Cabourg faisait
partie de sa vie et même, si les conversations avec son copain, devant une
tasse de café, finissaient presque toujours par « Ce sale Cabourg….», Thans savait qu’ils auraient tout deux du mal à le quitter. Petites et grandes tragédies L’hôpital
ressemblait à un monastère. Le colonel en était l’abbé ; Bidel, l’économe ; Madame Drubbel
et Bierbuck en étaient les prieures ; les
officiants étaient les religieux ; les infirmières, les sœurs de chœur et
le reste du personnel en étaient les frères convers. Toute cette communauté
voulait se garder des scandales qui avaient été le fait du Cabourg chirurgical.
Ce tour de force ne réussit pas à tous les coups ! Le Cabourg médical connut lui aussi quelques
faits « scandaleux ». 
Avec Geitchens et Bertrand dans les dunes Thans raconta l’émotion qu’il éprouva en voyant une jeune
infirmière attendre en pleurs à la porte du colonel que celui-ci veille bien la
recevoir et revoir sa décision. Elle avait été surprise se promenant avec un
officier convalescent dans les dunes. Quand le colonel Nolf
à midi sortit de son bureau, la pauvre « Magdalena » tomba à ses
pieds ». On entendit Nolf appeler alors un
caporal à son aide et conclure l’affaire par une phrase : « dans une
heure, vous devez être en train d’embarquer à la gare d’Adinkerke » Une autre
beauté, Madame Bloemzak, était nouvelle arrivante.
« Madame » la prévient gentiment que le colonel était d’une extrême
sévérité mais la belle prétendit qu’elle prendrait dans ses filets le colon
aussi facilement qu’une mouche… Après une semaine, Thans constata n’avoir jamais vu quelqu’un de si
affolé : Elodieke était renvoyée dans ses
pénates ! La
« Madame » de Thans en salle six, était une
femme intelligente mais personne n’est parfait. Elle accorda une préférence
manifeste pour un de ses patients, un jeune officier en convalescence d’une
pneumonie avec pleurésie associée. Ce jeune homme était le plus jeune en âge
dans son grade. Pour ce lieutenant Marcel, son dévouement était sans limite. Il
devait recevoir ventouses, et massage à l’alcool iodé. Un jour, Nolf eut l’idée d’ausculter à nouveau le garçon qui allait
beaucoup mieux. L’infirmière était présente à son chevet et quand le docteur
demanda au lieutenant d’ôter sa veste de pyjama, cette dernière essaya
d’arrêter le déshabillage en
affirmant : « docteur, ses poumons et lui sont tout-à-fait en ordre,
il est seulement encore un peu faible ! » Nolf
réagit : « Tirez la veste ! » La pauvre infirmière fit une
dernière tentative pour arrêter le déshabillage : « Docteur, il fait
très froid sans la chambre ! » Mais rien n’y fit et le lieutenant
dut obtempérer. Nolf découvrit alors le « pot aux
roses ». Le thorax du jeune homme était artistement décoré de petits cœurs
peints au moyen d’alcool iodé !!! Sans faire d’auscultation, Nolf déclara son patient guéri et le même jour il était
évacué vers son unité ! En salle 14,
il y avait une infirmière Madame Tervliet, qui était
veuve et qui avait aidé un aumônier du front à sortir d’une dangereuse
méningite. Elle avait reçu en cadeau un magnifique missel doré et relié avec
une couverture en cuir. Depuis ce jour, elle montrait un empressement à ne pas
manquer une messe, faisant miroiter à tous le précieux cadeau. Des mauvaises
langues, il y en a partout, disaient qu’elle était une femme légère… Un jour
tard dans la nuit, un peu avant l’aube, le « eerste
Piet » surnommé « de baard » surprit Madame Tervliet
à un mètre du sol, pendue à la fenêtre de sa chambre. Elle lui fit signe de se
taire et de venir l’aider. Baard souleva l’infirmière mais immédiatement
l’intéressée retomba accrochée à sa position initiale. Bientôt une
demi-douzaine d’infirmières furent alertées par le bruit et vinrent regarder ce
qui se passait et l’on comprit la situation de Madame Tervliet.
Elle était passée les jambes, les premières, par la fenêtre mais en voulant
ainsi sauter dans le sable sa robe avait accroché le pic d’une fourche qui
était appuyée contre la paroi. Elle ne
souffrit pas de dommage corporel mais la nuit suivante, « mamatje » dormait loin de Cabourg ! Autre
anecdote qui marqua Thans. Il avait un collègue qui
était élève-pharmacien et qui avait un comportement étrange. Il était toujours
sur ses gardes et Thans ne parvenait pas à rentrer en
dialogue avec lui. Son regard était sombre et il paraissait vivre en plein jour
comme un somnambule. Thans eut l’explication quand
Mademoiselle Labise vint le trouver dans son
arrière-cuisine pour lui demander conseil : Quand quelqu’un est dépendant
de la morphine, pensez-vous que ses enfants seront normaux ? ». Thans ne voulut pas répondre et envoya la demoiselle poser
cette question à un docteur… Gustaf, encore un collègue de Thans
lui demanda de lui rendre service en rédigeant un poème destiné à accompagner
un bouquet de fleurs qu’il comptait remettre à sa dulcinée. Ce n’était pas
n’importe quelle jeune femme ! Un après-midi, on ne vit pas
Mademoiselle Labise.
Papa Pinard raconta que c’était parce qu’elle avait des yeux tuméfiés et un nez
empâté. En fait elle se remettait d’une grosse émotion. Gustaf
lui avait transmis son bouquet la veille
elle l’avait refusé. De rage, Gustaf avait pénétré
dans le dortoir des infirmières et s’était caché sous le lit de la belle. Quand l’obscurité fut venue,
il refit surface et voulut marquer son affection par
un baiser. Le baiser fut refusé et un échange de coups s’en suivit. Gustaf fut
rapidement libéré de son poste…. Et pour terminer, Thans se rappelle d’une tragique méprise qui entraîna la
mort d’un patient. Il était de garde la nuit quand arriva une entrée. Le
docteur donna ses instructions à l’infirmière surnommée « La
didactique » parce qu’elle détaillait avec multes
détails les moindres choses sans doute pour cacher son ignorance. Le docteur,
donc la chargea d’injecter un produit toutes les trois heures et un autre
toutes les heures. Mais le matin, le malade décéda. Le docteur fut étonné de
cette mort imprévisible et demanda à voir les ampoules vides administrées. Il
constata que l’infirmière avait inversé les produits. Celui qui ne devait être
injecté que toutes les trois heures avait donc été injecté à chaque heure. Il
en résulta une intoxication aigüe et la mort du patient. Le docteur s’adressa à
l’infirmière « Didactique » puis à Thans. A
« Didactique », il dit « Vous avez tué cet homme ! » A
Thans, il dit seulement : « Motus, aucun
mot sur cette affaire doit sortir d’ici et un mort ne rend personne plus
vivant. » Parfois un concours de
circonstances néfastes causait mort d’homme. Ainsi Thans
se rappela d’une entrée dans son bloc un jeudi à 13h30. C’était un officier
dans un brancard. Il essaya d’en sortir lui-même mais n’y parvint pas. Il avait
de grosses gouttes de transpiration sur son front et 120 de pulsations.
D’emblée, prenant le brancardier pour un médecin, il avertit Thans qu’il souffrait de blennorragie. « Reposez-vous
dit Thans, je ne suis pas le docteur et je vais
appeler l’infirmière. » Thans alla prévenir
l’infirmière de cette nouvelle entrée mais elle était en repos jusqu’à 3 heures
de l’après-midi. A 3h30, elle arriva avec une amie dans le pavillon puis
revint, avec un visage renfrogné, ordonner à Thans d’aller prévenir le docteur. Ce
dernier était au mess et dit à Thans :
« Allez prévenir « Madame » que j’ai la visite un ami et que je
viendrai au pavillon à l’heure habituelle, à 17 h30, faire mon
tour ». Finalement, le docteur vit
le patient à l’heure dite et ressortit rapidement du pavillon pour aller
trouver le colonel. L’intéressé avait une péritonite et il était maintenant
dans un stade trop avancé pour être opéré avec une chance de réussite.
Néanmoins, les médecins décidèrent de tenter l’opération. Après l’opération, le
lieutenant tomba dans une sorte de coma et il n’eut le temps que de recevoir
les Saintes Huiles avant de trépasser le lendemain matin. On décida alors de
commun accord de ne divulguer à personne les circonstances de la mort de ce lieutenant,
une mort entraînée par le retard de diagnostic suite à un triste concours de
circonstances. On apprit alors que le décédé était le fils d’un général et que
celui-ci désirait voir son fils. Quand il arriva à l’hôpital, on le dirigea
vers le pavillon de Thans. C’est ce dernier qui eut
le pénible devoir de lui annoncer la mort de son fils et de lui ouvrir la porte
de la chambre où il reposait. L’infirmière s’était enfuie et c’est Thans qui eut alors le privilège d’encourir les reproches du père désespéré. Encore plus pénible fut pour Thans les soins donnés à un jeune officier qui après son
voyage de noce souffrit d’une subite température. On était en octobre 1918. Il
essaya de reprendre son job au front mais commença à souffrir de symptômes
pulmonaires et dut finalement se faire hospitaliser à Cabourg pour une grippe
très grave. Il avait lui-même marché jusqu’aux lignes arrières avant de trouver
un véhicule. C’est Thans qui le veilla. Bien sûr, on
lui donna de l’oxygène mais malheureusement l’état de santé du malade ne
s’améliora pas. Thans le veilla toute la nuit et fut
étonné de l’extrême gentillesse de l’officier qui ne se plaignait pas et ne
désirait rien. Il était pourtant bien conscient de son état : « je
suis gravement atteint dit-il à Thans mais la mort
ici ou là-bas, cela reste une belle mort. » La nuit, il y eut bombardement
et l’on éteignit les lumières. Quand celles-ci revinrent, Thans
eut quelques mots de consolations mais le lieutenant lui dit :
« Certes, mais une seule chose compte à savoir tout pour Dieu, la bonne
cause, la victoire ! » Un peu plus
tard le lieutenant délira. Il voulait retrouver sa jeune femme et parfois il la
voyait en face de lui. A 6 heures
du matin, Thans entendit des pas sur la passerelle
qui menait à son pavillon. Il vit alors une jeune nurse à l’entrée qui lui
demanda où se trouvait le lieutenant J. Derrière elle, se trouvait sa mère. Les
deux femmes allèrent dans la chambre du mourant et on ne les entendit plus
jusqu’à 8 heures 30 du matin. A ce moment-là tout le pavillon entendit le
dernier appel à l’aide du mourant aussitôt étouffé par deux cris stridents,
ceux des deux femmes. Quand Thans se précipita dans
la chambre, il vit le trépassé, dont le visage marqué par la souffrance faisait
penser à celui du Christ, reposant dans les bras de sa femme et de sa mère.
Juste à ce moment passait devant le pavillon, le vendeur de journaux qui criait :
« Le grand succès de la nuit ! Avance de trois
kilomètres… » Thans
alla dehors et le doigt sur la bouche le pria de se taire ! La grippe Au printemps
18, devant les menaces de l’avancée allemande, l’hôpital de Cabourg fut
partiellement démonté et le personnel devait se tenir prêt à quitter l’hôpital
dans les minutes qui suivraient un ordre. Les brancardiers, les hommes de
corvée en plus de leur service normal durent assumer un travail manuel
considérable. Quand finalement tout se calma, une autre menace vint continuer à
surcharger les activités de l’hôpital. La fameuse grippe surchargea en effet
tous les pavillons. Pour tout le mois d’août, 50 morts mais pour le mois de
septembre, 20 la première semaine, sept par jour pour la deuxième quinzaine et
cela monta jusqu’à 40 morts en 24 heures. En septembre, l’hôpital se prépara à
l’offensive et devait aussi pouvoir opérer à nouveau. Comme l’hôpital était
surchargé de grippés, (il y avait plus de 70 officiers malades à la place de la
douzaine habituellement hospitalisés et ils avaient dû être répartis dans
toutes les baraques !), la plupart des malades furent évacués en France.
Les ambulances transportèrent alors plus
de 80 patients par jour. Toute cette activité épuisa les brancardiers. Dans la nuit
du 27 septembre, l’offensive fut déclenchée et le lendemain à 8 heures, les
premiers blessés firent leur entrée à l’hôpital. Ils avaient souvent avec eux
des trophées pris sur l’ennemi qu’ils voulaient absolument garder sous leur
lit ! L’afflux de blessés nécessita un appel en renfort du personnel se
trouvant à Calais et Bourbourg. Une tente fut même montée au milieu du verger.
Elle était destinée aux prisonniers qui servaient à l’hôpital. Thans souffrit de température. Cela ne l’étonnait pas. Il
avait épuisé dormi dans un lit qui venait d’avoir hébergé un mourant. De plus
un délirant, dans sa dernière heure, l’avait embrassé et expiré son air sur sa
bouche. Il continua néanmoins à travailler. Un soir de
libre, Thans alla chez « les trois sœurs ».
Zulma était en danger de mort, Emilie, malade d’épuisement,
et Alida pleurait qu’elle ne reverrait sans doute plus sa mère tandis que sur
un banc, le gendarme malade et épuisé de sa randonnée en vélo, geignait… La
misère était vraiment partout sur le front. Enfin les adieux Le 14
octobre 1918, à 10 heures du matin, alors qu’il était en train de nettoyer des
plats dans l’arrière-cuisine de son pavillon, le vieux Orban,
un secrétaire du bureau, vint crier sous la fenêtre de Thans
qu’il était nommé aumônier à Calais. La nouvelle était officielle car parue
dans les O.J.A. (ordres journaliers de l’armée). Thans
ne s’attendait plus à cette mutation. La
nouvelle se propagea vite dans tout l’hôpital et ce jour-là Thans
eut fort affaire pour répondre aux félicitations qui émanaient de partout. La
joie de Thans était quelque peu atténuée en pensant à
son collègue « Petit Père » qui devrait se débrouiller sans
lui ! Le lendemain, pas de traces
du remplaçant de Thans mais le surlendemain, il se
présenta. Après avoir présenté son successeur partout, Thans
rencontra le lieutenant sur la passerelle qui lui dit, sans ménagements, qu’il
devait faire ses bagages et se mettre en ordre administrativement en quelques
heures car son train partait le jour même à 16h30. Il n’eut fini ses taches
qu’à 17 h00 et se présenta au lieutenant pour une dernière signature. Ce
dernier le reçut mal : « Vous
terminez mal. Désobéissance manifeste. Comme soldat 2ème classe vous
êtes punissable malgré le fait que vous
êtes nommé aumônier. Mais je laisse tomber cela car vous ne faites plus partie
de Cabourg ! » C’est avec
cet adieu que Thans sortit du bureau du lieutenant Bidel. La soirée se passa chez les « trois sœurs » puis chez Gabriel. Enfin, Thans,
en repassant dans son arrière-cuisine de la salle 6, trouva son infirmière avec
une bouteille de champagne qui l’attendait. A trois heures du matin, Marechal
vint réveiller son copain. Thans alla dire sa messe à
la chapelle. Sœur Thérèse assista à sa dernière messe à Cabourg.
Ensuite Marechal accompagna Thans à la gare où le
train vers calais s’apprêtait à démarrer. 
Avec son casque. Calais Calais fut
atteint vers 10h30. Thans se rendit aux bureaux de la
« base » à la recherche du service d’aumônerie. On l’envoya
finalement dans une petite maison civile où se tenait l’aumônier divisionnaire.
On chercha d’abord à loger Thans qui finalement
bénéficia d’une chambre dans un grenier pour 35 francs par mois. Après cela
vint les présentations au médecin, chef du « British Farmershospital n°2 », nommé
aussi, « l’anglo-belge ». Thans était en effet nommé aumônier de cet hôpital. Peu après Thans
s’aperçut qu’il n’avait pas le droit de rentrer au mess des officiers de
l’hôpital. Malgré sa nomination, il restait un simple soldat. Le divisionnaire
lui apporta cependant secours en lui expliquant que les aumôniers de tout grade
avaient leur propre mess à la « base ». L’aumônier divisionnaire lui
montra aussi le chemin vers l’hôpital 22 et 37 situés
dans la rue des Soupirants et aussi les baraques des prisonniers allemands
situées autour de la « Nouvelle Mairie ». Peu après, il prit son premier repas à la
« base » entouré d’une dizaine de collègues. Il y avait longtemps
qu’il ne s’était plus retrouvé dans une atmosphère si confraternelle ! Une nouvelle
routine, commençait pour lui. Le matin, à 05 heures, il se rendait à l’hôpital
22 où dans la chapelle, il trouvait les hosties consacrées à emporter dans son
« pyxis ». Il rejoignait ensuite l’Anglo-Belge et là, slalomait dans les salles pour donner la
communion, parfois en devant réveiller les malades qui avaient demandé
auparavant le sacrement. Ensuite Thans se rendait à
nouveau dans la rue des Soupirants mais cette fois dans le pensionnat du
Sacré-Cœur. Le pensionnant était vide mais une vielle sœur gardait le bâtiment.
Comme il y avait pléthore de prêtes à calais, on avait permis à Thans de dire sa messe dans la chapelle du pensionnat. Le
servant de la messe était un séminariste qui était brancardier à l’ « Anglo-Belge ».
Après sa messe, Thans allait déjeuner à la
« base » puis se rendait dans les baraques des prisonniers allemands.
Au début de l’après-midi, Thans se rendait à
« l’Anglo-Belge » où il visitait les 300
patients. Ici pour une conversation, là pour une confession, ou encore pour le
sacrement des mourants. Il écrivait des lettres, apportait des commissions et
leur promettait d’intervenir pour un congé de convalescence sur la côte d’Azur.
Par habitude, il servait aussi de brancardier quand l’un des blessés demandait
à boire ou un même un soin. La « Miss » en était parfois surprise et
trouvait cela très « shocking ». Quand c’était le cas, Thans s’excusait en lui expliquant son passé de
brancardier. A 7 heures du soir, Thans avait fini son service et rentrait à la
« base » puis dans sa chambre mansardée. Son petit coin à lui seul lui
paraissait une merveille par rapport à sa chambre de Cabourg. Il pouvait jouir
de moments de solitude comme il n’en n’avait jamais connu derrière l’Yser !
Il recevait très souvent de son copain Marechal des nouvelles de Cabourg.
L’hôpital avait dû être dédoublé à Brugge avec l’avancée belge de l’offensive.
Cela avait valu à « Petit
Père » un job d’aumônier dans le
poste avancé. Un beau matin, Thans eut la joie de
recevoir son ami à Calais. Il avait obtenu une permission et apportait à Thans une caisse pleine de livres à distribuer aux malades. Le samedi
soir donnait à Thans une nouvelle occupation. Il
passait dans les baraques des prisonniers allemands et ceux qui étaient
catholiques (1/4) et voulaient se confesser se mettaient alors en peloton
derrière lui jusque l’endroit du confessionnal improvisé. Thans
devait conduire son peloton en le faisant marcher au pas par des « Links ab !, rechts
ab ! ». Derrière le peloton suivaient deux piottes
avec la baïonnette au canon. Thans n’était pas fait
pour ce genre de cérémonial mais il trouva quand même une satisfaction à
commander ces « sujets du Keizer » en pensant
que, finalement, ce n’était que justice : « à chacun son
tour ! ». Le dimanche Thans disait deux
messes. L’une dans les baraques de prisonniers (qui n’arrêtaient pas le travail
le dimanche) et l’autre messe dans l’hôpital anglo-belge où une infirmière
anglaise, même protestante, assurait l’ordre en n’hésitant pas à faire taire
les hommes qui osaient se dire un mot…. L’armistice Calais était
un immense hôpital. On affirmait à Thans qu’il n’y avait
pas moins de 20.000 hommes dans les hôpitaux. Les blessés étaient bien soignés
à l’exception de ceux qui étaient dans les hôpitaux complémentaires où tout
manquait. Il en était ainsi dans « l’ Oostkamp » qui avait été repris aux anglais ainsi que
dans la rue de la tannerie où gisaient 500 malades au premier étage de la
tannerie avec pour seuls personnels un docteur malade et une infirmière qui
venait seulement quelques heures par semaine. 30 convalescents faisaient office
de brancardiers. Les décès étaient nombreux. 
Trois vétérans : Maréchal, Geitchens, Hilarion A propos de
décès, Thans était chargé d’une partie des
enterrements. Les absoutes étaient dites à la morgue. Puis on chargeait les
cercueils et on les conduisait au cimetière de Calais qu’il avait fallu
agrandir. Les prisonniers allemands creusaient les fosses puis portaient les
cercueils dans la boue. Une prière était dite rapidement et les Allemands
comblaient les fosses. Le 7
novembre, le Thans en allant chercher cinq cercueils
à la Porte de Gravelines entendit le chauffeur du camion lui dire que la guerre
se terminait et que l’armistice serait déclaré dans les jours suivants. Malgré
cette très bonne nouvelle, il y avait encore beaucoup de tristesse dans l’air.
Ainsi, au cimetière Thans considéra avec une immense
pitié une jeune veuve pataugeant derrière eux dans la boue et s’attardant
devant une croix pendant que la lumière tournoyante émise par le phare semblait
faire une danse macabre. Le soir cependant, les rues se remplirent de monde et Anglais, Portugais, Français et
Belges dansèrent et sautèrent de joie. A l’occasion
de l’armistice, les aumôniers reçurent trois jours pour rendre visite à leur
famille. Comme Thans était le dernier arrivé, il
n’eut pas l’occasion de jouir de ce congé et resta sur place pour assurer les
services de l’aumônerie. La misère restait grande au « Trente-sept »,
refuge des « maladies spéciales ». Par contre au numéro 22, se
trouvaient beaucoup de convalescents et mutilés, Belges, Allemands, civils,
militaires ! L’ambiance y était joyeuse. On y jouait aux cartes entre
nations et il arrivait qu’un piot wallon donne des leçons de français à un
officier allemand ou qu’un estropié essaie ses béquilles avec l’aide de deux
« Rhinelanders ». Le 9
décembre, Thans entreprit enfin un retour vers la
Belgique pour quelques jours. Il put rejoindre sa famille puis sa communauté
religieuse de Rekem. Revenu à Calais, il y resta
jusqu’à ce que le dernier hospitalisé de « l’Anglo-Belge »
ait pu être évacué et jusqu’à ce que tous les camps de prisonniers soient
vidés. Après cela, il profita d’une longue permission qu’il consacra à voyager. Il visita le front de l’Yser,
séjourna à Paris puis dans le Calvados,
visita Verdun, Lourdes, la côte d’Azur et prolongea son voyage par un périple
en Italie. Revenu à Calais et toujours sans occupations, il obtint encore une
permission qu’il usa en voyageant en Allemagne et dans les Vosges. A son
retour, il n’y avait toujours pas le papier de démobilisation mais bien celui
d’une mutation à Port-Villez ! En septembre 1919,
il voyagea en Bretagne et termina par le Mont-St Michel. Quelques jours après
cette dernière visite, il put enfin quitter définitivement l’armée pour
rejoindre son couvent. Cette longue période de guerre avait été pour Thans comme un deuxième noviciat ! Il en sera marqué
durant toute sa vie. Dr P. Loodts |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©