 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
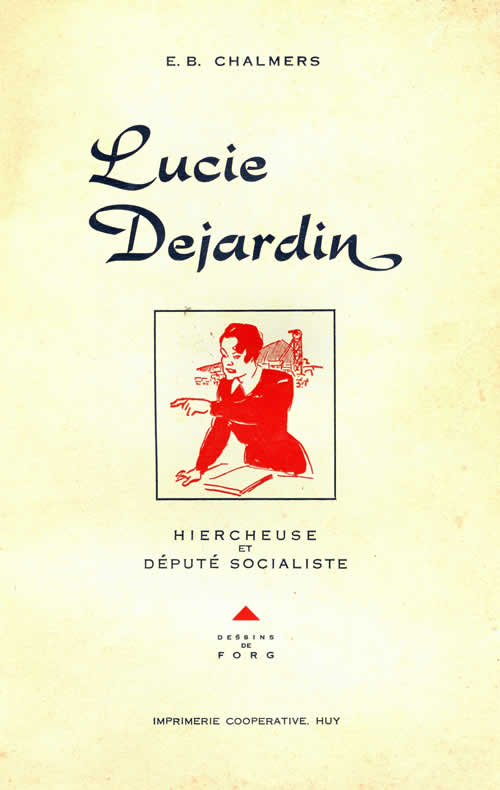
Lucie Dejardin[1] Hiercheuse, première femme Députée Socialiste et
Résistante 
Préface « (Qui sera assez vil pour être esclave? » (Robert BURNS) En m'envoyant le manuscrit, l'auteur me dit: « Voici l'enfant de tant de prières et de larmes » ! Personne ne s'y trompera : c'est l'enfant de la fidélité et de la piété. Ce livre est écrit par une Ecossaise. On en douterait, tant la langue en est fluide et pure. En le parcourant, j'ai cru à une supercherie, puisque l'auteur a poussé l'amour de notre Wallonie ouvrière jusqu'à s'assimiler notre patois, le plus hermétique et le plus coloré de tous ceux de langue d'oïl. Toutefois, en lisant attentivement, on retrouve dans ces pages robustes, les accents de Blake et de Robert Burns, ces poètes compatriotes d'Esther Chalmers, qui ont salué de mâles accents l'aube des affranchissements réparateurs. On y retrouve aussi ce lyrisme anglais si particulier, fait à la fois de hautaine pudeur, d'ardeur passionnée et d'humour attendri. Esther Chalmers est une transfuge de sa
classe. Elle aurait pu rester en Angleterre et y vivre l'existence nonchalante
des classes privilégiées. Mais elle appartient précisément à ce pays qui a
donné des hommes comme Robert Owen, qui ont résolument tourné le dos aux
privilèges dont ils étaient accablés. Avec une silencieuse générosité, elle
s'est vouée tout entière à la classe ouvrière du pays de Liège. Cette Ecossaise
réservée, volontairement effacée - trop effacée au gré de ses fidèle amis - a
le don très rare de dire des choses lourdes de sens en peu de mots. Des mots
humbles et simples qui conviennent à des douleurs anonymes. Elle se défend d'avoir
rédigé une biographie romancée. Elle a fait mieux. Elle a écrit la Vie. La Vie
avec un grand "V». Avec toutes ses cruautés, ses défaites et ses trahisons.
Mais aussi, avec la griserie des combats, l'orgueil des jours de victoire et ses
injustices qui enfantent les fécondes révoltes. En retraçant la vie de Lucie
Dejardin, l'auteur de ce livre pathétique écrit sans pathos. Son texte baigne
dans une subtile sensibilité. Cette sensibilité britannique qui a horreur de la
sensiblerie et où l'humilité et l'orgueil se mélangent d'étrange façon. Avec
une merveilleuse lucidité, elle a saisi le tragique de la condition ouvrière,
avec ses frustrations, ses humiliations, l'anéantissement de la personnalité
par la monotonie des tâches, les tortures de la faim, l'angoissante
interrogation devant la finalité des épreuves docilement acceptées. La vie de Lucie Dejardin,
c'est le réquisitoire contre un régime où les hommes, les femmes et les enfants
ne peuvent choisir leur itinéraire humain. Parce qu'il est déterminé, en dehors
d'eux-mêmes, par des forces monstrueuses et tyranniques qui s'habituent mal
aujourd'hui à être enchaînées par la solidarité ouvrière. Lucie avait une nature
volcanique. Son éloquence était éruptive. Elle était tout le prolétariat à elle
seule. Elle en avait la généreuse indignation devant l'iniquité. Ce Spartacus
féminin faisait écho aux rancœurs séculaires accumulées au cours d'une longue
histoire de vaines rébellions. Ses rocailleuses invectives contre le désordre
social établi jaillissaient de sa bouche comme des blocs de lave d'un cratère.
Elle apportait, dans ses âpres sarcasmes, la certitude d'éclatantes
réparations. Elles sont venues, grâce à des femmes comme elles, s'immolant sans
réserve au service de leur sexe, doublement exploité. Elle portait ses blessures
comme les drapeaux écarlates qu'elle brandissait dans les cortèges où grondait
la colère des déshérités. C'étaient les plaies des générations innombrables
englouties par la misère et les privations. C'est parce que son destin
se confond avec celui de ses compagnes qu'elle les a menées victorieusement
vers leur libération. En même temps, elle leur
apportait sa cruelle expérience des réalités quotidiennes, des servitudes
domestiques, du salariat féminin. Elle en portait les cicatrices sur elle-même.
La destinée, d'une poigne de fer, l'avait conduite durement sur les chemins
ingrats de la misère humaine. J'ai eu le privilège de faire campagne, au
côté de Lucie Dejardin, contre la guerre, cette exécrable absurdité. Puisque ceux
qui la gagnent sont presque sûrs de perdre la paix. Puisqu'elle ne rapporte
iamais rien à personne, sauf à une infime minorité qui en tire des profits
inavouables et déshonorants. Peut-être, avant d'écrire
cette biographie, si magnifiquement réussie, Esther Chalmers avait-elle relu sa
vieille Bible : « La colère des hommes ne
réalise pas la justice de Dieu ». Le frère de Lucie, Joseph Deiardin, député
socialiste comme elle, en même temps qu'elle, fut un chef syndicaliste
exemplaire. Son incomparable sagesse, ses vues profondes sur le rôle historique
des mineurs dans l'évolution sociale, ont fait de lui le plus désintéressé le
plus éminent, le plus éclairé de ceux qui préparèrent la souveraineté du
travail. Lucie est née la même année que Joseph Wauters. Pour moi, ces trois êtres
sont confondus dans le même et tendre respect. En écrivant ce livre, qui
n'avait vraiment pas besoin de préface, Esther Chalmers s'est acquise une'
créance privilégiée à la gratitude de notre classe ouvrière liégeoise. Arthur Wauters. Avant-propos Lucie Dejardin aurait voulu
raconter, aux jeunes d'aujourd'hui, ce qu'était la vie ouvrière à
l'époque où leurs pères ont créé le Parti Ouvrier Belge. Elle trouvait qu'à
côté de l'histoire des faits et
des hommes marquants dans l'essor du
mouvement ouvrier, il y avait place pour une chronique plus modeste: celle des
anonymes, celles des conditions familiales à l'intérieur des logis obscurs d'où
sortaient des hommes pour aller peiner, mais aussi pour prendre conscience peu
à peu de leur force, pour faire
enfin valoir leur droit à une vie meilleure. Le destin ne lui a pas permis de réaliser son projet. C'est pourquoi j'ai tenu à rassembler ces quelques
souvenirs d'enfance et de
jeunesse de cette femme
remarquable, née dans un coron du pays de Liège, qui siégera, un jour, au Palais de la Nation. Avant tout, qu'il me soit permis de m'incliner devant la mémoire de sa mère, symbole du courage et des souffrances des femmes du peuple d'avant notre ère. Que la
sincérité de mon admiration
devant cette Wallonne, qui savait rire et chanter « malgré tout », me fasse pardonner l'indiscrétion de pénétrer dans l'humble demeure où naquit Lucie Dejardin, le 31 juillet 1875, de Marie Rosette, épouse Dejardin, hiercheuse
du fond, et d'André Dejardin,
mineur. E. B. Chalmers. Liège 1952. Les six enfants sont couchés, dans
la mansarde qu'ils partagent avec un précieux restant de pommes de l'automne
dernier. Ils dorment à poings fermés sur leur paillasse bourrée de feuilles
sèches, car peu leur chaut que maman va bientôt mettre au monde son septième
enfant. Le père qui prend volontiers sa petite
goutte a répétition ne veut pas boire cette nuit-ci, puisque Marie en est là,
encore une fois ... Non pas qu'elle se fait plaindre. Cela ne lui viendrait certes
pas à l'idée ... Fille de mineur, travaillant elle-même
au fond de la mine depuis son adolescence, c'est dans la mine qu'André l'a
courtisée. Puis, sortant quelques heures au jour, on s'est marié. Parce que la race doit continuer ? Parce
que c'est la coutume ? Peut-être. - Parce que c'est comme cela
la vie. Et parce que c'est comme cela la vie,
Marie continuera de travailler. «Travailler» s'entend travailler pour un
quelconque patron, naturellement: un ménage se fait en supplément ignoré et
sans valeur. C'est pourquoi Marie, mère et ménagère, n'est pas moins hiercheuse
de fond. Ployée dans l'écrasante chaleur des tailles à longueur de journée, elle
traine, elle pousse ses wagonnets. Mais avant et après ses douze heures dans la
mine elle est libre de faire son ménage. 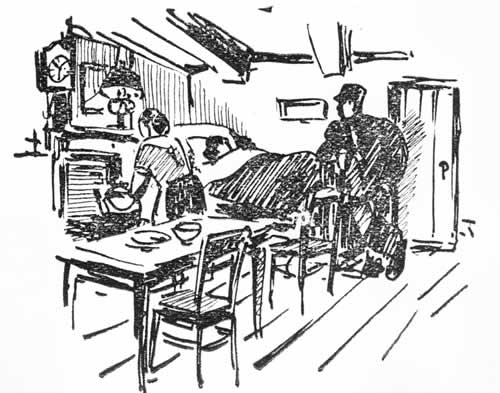
Il lui est déjà arrivé, comme à bien
d'autres femmes de mineurs, de s'accoucher à fond de fosse. Mais aujourd'hui
elle est rentrée à temps, avec la remonte de huit heures du soir. Ainsi elle a
pu lessiver ses hardes de travail et celles de son mari et mettre dormir les
enfants. Avant de se coucher, à son tour, elle a attaché un drap au pied du
grand lit de chêne - ce chêne poli par des bras de femme depuis des siècles. Il fait calme dans l'unique pièce du
rez-de-chaussée qu'éclaire à peine un quinquet posé sur la cheminée. Sur les
deux bougeoirs, le Christ en cuivre, le « Sani » accroché au mur près du poêle,
la flammette danse une étrange sarabande. A part cela rien ne bouge, sinon le
balancier de la pendule, marchandée un dimanche matin sur la Batte et « rafistolée
» par le père. Son tic-tac résonne creux, inexorable, dans la maison étroite et
basse. Dix heures! Marie s'étire, se cramponne à son drap.
Ses yeux, qu'elle a d'un gris-bleu voilé, semblent regarder au loin, cherchant
quelque chose au-delà des quatre murs fraîchement blanchis à la chaux ... En
effet, André a «reblanchi» le mois dernier. Mais ne vous imaginez pas que c'est
par égard pour sa femme. On ne fait pas de pareil frais pour un accouchement,
surtout avec la chaux à 3 cens au kilo. Mais André est conscient de ses devoirs
religieux ; le mois dernier il y a eu la Fête Dieu, et au mois de septembre il
y aura la fête paroissiale. Onze heures. L'enfant se fait plus
pressant. Marie sent qu'il est temps d'aller chercher la sage-femme. Restée seule, son regard se mouille.
Vaguement, elle regarde courir les ombres au plafond, l'esprit vide. Elle a eu
son heure de révolte quand elle s'est sue enceinte encore une fois. Mais maintenant
elle ne songe qu'à une chose: être quitte de ce poids obsédant. La porte s'ouvre. C'est André qui ramène
la sage-femme. Elle s'affaire, active le feu, remplit la bouilloire qui
ronronne sur le poêle. Les draps pour laver l'enfant ? Pour
l'emmailloter ? « Po fahi l'èfant ? » Les voici. La sage-femme fait l'inventaire
des petits langes soigneusement rapiécés, les bandes pour l'enfant, la première
ceinture. Elle connaît bien ces maigres layettes, qu'on prête de famille à
famille au village. Et la bassine ? Ah ! ben oui, la bassine, elle s'est
laissée aller hier. Mais André l'a reclouée. Baquet en lattes, à fond de bois
dur, elle tiendra encore. La sage-femme peut avoir tous ses
apaisements. Il y a de quoi recevoir décemment le nouveau-né; laver, empaqueter
ses petits membres. La bonne femme débite son boniment de
commerce. « Ne te retiens pas de crier! Cela
te soulagera! » Mais Marie ne veut pas crier, trouvant
qu'il faut garder certaines choses pour soi. Les douleurs que l'on sent c'est
pour soi, pas pour les autres, même les plus proches. Les ombres courent toujours au plafond. Sur sa chaise au pied du lit André
soupire. Marie le regarde, le sourire compatissant. Il est plus las qu'elle !
Et à quatre heures déjà il faudra qu'il s'apprête pour aller travailler. La
sage-femme découvre le ventre gonflé; palpe, soupèse du regard. « Ce sera un gros garçon! »
annonce-t-elle avec son assurance professionnelle. En attendant, ce sera une septième
bouche à nourrir, c'est tout. En attendant quoi ? En, attendant la vie. C'est bien simple. Les garçons vont au
travail. Les filles aussi. Mais elles courent davantage de risques. Mieux
vaudrait un garçon encore, quoique la maman aurait bien besoin d'une paire de
bras de fille dans le ménage. Il ne faut pas penser si loin. Qu'on la
délivre seulement de son fardeau ... Ah ! voici du nouveau ! Marie descend
dans un puits sans fond. Un puits où l'on n'est plus qu'une chose qui souffre,
tiraillée, écartelée, transpercée de pointes de feu. On entend miauler derrière la maison.
André laisse entrer le chat, et par la porte entre baillée on voit la
silhouette d'un pommier se profiler un instant sur le ciel clair de cette nuit
de la Saint Jean. Grisette saute sur le lit, pour
s'allonger contre sa maîtresse. André finit par s'assoupir, malgré le
remord confus qui le tiraille, comme chaque fois que Marie en est là. ... Une heure vient de sonner au clocher
de St-Lambert, là-bas dans le fond de Grivegnée. Marie s'étire de nouveau, s'accroche de
nouveau au drap. La sage-femme l'encourage à forcer. Au bout d'un temps Marie s'étonne de voir
flotter une nappe blanche. Ce doit être chez des riches. Il y a de beaux couverts
en argent, du pain blanc sur la table, un superbe rôti de veau. C'est le soir,
quelque part dans un pays chaud, car il y a du beau raisin. De grandes grappes
noires se balancent au-dessus de la nappe. L'air est doux, parfumé, et l'on
voit des taches d'or ci et là dans les arbres ... Cette fois-ci, c'est le sursaut final. La sage-femme se précipite, bousculant
André qui ne sait où se ranger. Encore un effort. La chatte baille, mais elle ne veut pas
se rendormir. Elle sait bien que quelque chose d'insolite se passe dans le
grand lit dont elle vient d'être expulsée. Enfin, ça y est ! La sage-femme pousse un cri de triomphe
! « C'est une belle petite fille, comme je
te l'avais dit » clame-t-elle oubliant que ce devait être un gros garçon. «
Eco onk avou n'hamelète ! » En effet
Joseph, avant Lucie, est né coiffé, indice de succès selon la croyance
populaire. Impressionné, comme toujours, par le
mystère de la création chez sa femme, André ne trouve rien à dire. L'odeur de
sang l'écœure. il ouvre toute grande la porte ; scrute le ciel qui pâlit déjà
de la blancheur de la pré-aube. Le parfum du rosier en espalier autour de la
porte s'éveille, lui caresse les narines. Dans le poulailler près de la maison
une poule gratte son perchoir, se racle sourdement le gosier. Sur le poirier au
fond du jardin un merle s'essaie à siffler puis se décide à se rendormir. L'horloge de Saint-Lambert annonce aux
veilleurs qu'il est deux heures du matin. Précieuse
liberté. Trois ou quatre heures d'un sommeil
fiévreux, et Marie est sur pied. Il faut bien faire à manger pour le mari
n'est-ce pas, et pour les enfants. La femme du mineur tient du reste à jouir
pleinement de sa liberté de travail. C'est pourquoi, trois jours après son
accouchement, on pouvait entendre les sabots de Marie sur le chemin de la bure,
traînants et sourds comme si, au petit jour, elle avait déjà ses douze heures
de travail dans les pieds. En fait, elle s'est levée une grosse
heure avant son mari, comme c'est la coutume. Elle a fait quatre « chemins
d'eau » le joug au cou, pour qu'il y ait de quoi se laver quand on rentre de la
mine. Elle a fait le feu, versé l'eau sur le café - qui est au trois-quarts de
la chicorée - et rempli la petite cafetière. Elle a coupé les tartines de pain
noir pour le « magnâh » de 8 heures, car ni elle ni André n'ont le cœur de
manger à 5 heures du matin. Elle a apprêté les vêtements tout frais lavés, les
sabots décrassés la veille au soir, pour qu'André n'ait qu'à tendre la main
pour s'habiller. Cette jeune femme se rend-elle compte de
son double esclavage : l'esclavage économique et l'esclavage familial? 
Confusément peut-être. Mais elle n'a
guère le temps de se creuser l'esprit. Auriez-vous voulu l'entraîner à la
révolte, elle vous eût répondu que c'était comme cela la vie, et qu'on ne
pouvait rien y changer. En effet Marie est d'un fatalisme absolu, supportant le
fardeau de l'existence sans espoir d'un mieux être même céleste. La plupart de
ses compagnes par contre s'empressent de recueillir des fiches de consolation
auprès de leurs confesseurs : plus elles subiront de malheurs ici-bas sans se
plaindre, et plus elles auront de bonheur dans l'au-delà. Voici donc Marie qui vient de créer une
vie humaine, obligée de s'arracher à son œuvre délicate et mystérieuse pour se
hâter vers le charbonnage[2],
elle sent que la cage attend pour la happer, la descendre à vitesse d'épervier
dans le fond de la Chartreuse, et ses nerfs se crispent déjà à l'idée de ces
milliers de tonnes de pierre et de houille qui vont l'écraser de leur poids. La
mine qui la serre dans un cabanon de chaleur et de soif, qui lui emplit les
poumons de poussière et le cœur de crainte. Mais les enfants, pendant ce temps ? Bah ! la grand-mère, une tante, une voisine
les gardera tant qu'ils seront petits. A 10 ans ils seront libres d'aller
retrouver leurs parents dans la mine. Ils endosseront le harnais à fond de fosse
et, à quatre pattes dans les passages difficiles, ils tireront les bennes. Ces
bennes qui sont si lourdement chargées de la sueur de leur père et du sang de
leur mère. Du reste, ils n'attendront pas toujours
d'avoir l'âge minimum légal. On en trouve de « ces brutes de hiercheurs »
qui ont à peine 8 ans. Et grâce au beau principe de la liberté du travail, la
Belgique présentera, jusqu'à la fin du 19ème siècle, le spectacle, rare alors en Europe, de
la parfaite vie de famille : père, mère et enfants à fond de fosse. Certes, le Parlement belge s'occupera du
travail des femmes et des enfants en 1878 déjà. Mais, la Chambre, ne voudra «
en aucun cas se résoudre à restreindre la liberté du travail quant aux adultes,
cette liberté qui est une des plus importantes et une des plus précieuses parmi
les conquêtes de ce siècle ». Et le Sénat rejettera même la « modeste loi
de police » qu'on lui proposera sur le travail souterrain des enfants[3]. Il est possible que Marie eût souri si
elle avait appris combien ces messieurs de la Haute Assemblée tenaient à ce
qu'elle conservât sa liberté, pour elle et ses enfants. Car s'il lui manquait bien
des choses dans la vie, du moins avait-elle en nue propriété, l'humour. Mais soyons de bon compte. Il y avait
d'étranges préjugés aussi à vaincre « de l'autre côté de la barricade »,
une façon de raisonner à la logique plutôt brutale. La place de la femme n'était-elle
pas aux côtés de son homme ? Dès lors,
puisque la plus grande partie de la vie se consommait sous terre, mieux valait
que mari et femme restassent ensemble. Comme cela pas de surprise possible. C'est dans ces conditions que le
septième enfant Dejardin courut sa chance. Une chance sur deux. Comme les aînés
de sa famille. Comme tous les enfants de sa classe. Car comme le disait Anseele
: pour deux berceaux que l'on prépare dans la classe ouvrière, il faut préparer
un cercueil. Une chance sur deux pour qu'un
nouveau-né passe sa première année ? Vu
sous l'angle sportif ce n'est pas si mal. .. Avant Lucie il y avait eu
Anne-Marie. Anne-Marie est née une avant-veille de Toussaint.
Avec son premier souffle, elle respira l'acre parfum des deux « potêies
» de chrysanthèmes qu'on devait porter le lendemain sur la tombe des
grands-parents. Cette réception funèbre
découragea-t-elle le nouveau-né ? Ou était-ce simplement son héritage, la
bronchite des mineurs, qui l'accablait ? Toujours est-il qu'à peine née
Anne-Marie se mit à tousser. Son père pensait aux chats qui naissent
après la Saint-Jean, et que l'on se dépêche de noyer, parce qu'ils « ne se font
jamais ». Et il se disait : « Elle ne se fera jamais ». Anne-Marie continua de tousser. Par
petits coups secs. Pas moyen de lui faire prendre le sein.
Cela l'étranglait. Le lait qu'on s'efforçait de lui faire avaler lui collait
aux lèvres, dégoulinait de son menton minuscule. De temps en temps le coin de sa bouche,
ridée comme une rose d'automne, se soulevait en un soupir qui était un gémissement.
On aurait dit qu'elle souffrait trop pour pleurer. Ses yeux restaient fermés la
plupart du temps. S'ils s'ouvraient, leur regard voilé semblait fixer un point
au delà de cette terre inhospitalière. Et elle toussa de plus en plus. C'était à se demander où elle trouvait
sa résistance, elle qui n'était nourrie, pour ainsi dire, que de relents de
cuisine et de vapeurs de lessive. Elle trouva moyen même de gagner du
poids pendant les deux premiers mois. Après, les quintes de toux secouant
toujours davantage son pauvre petit corps, elle « ne bougea plus ». Tous maintenant se rendaient compte
qu'elle « ne se ferait pas ». Mais pendant quatre mois encore elle
toussa, et sur sa figure de poupon, la douleur accrocha un masque de vieille femme. Au mois de mars une première bourrasque,
enfonçant porte et fenêtre, cingla l'air lourd de la masure. Il n'en fallut pas
plus pour qu'éclatassent les poumons noyés de ce bébé de misère. Le lendemain on pouvait voir sur la
table de la cuisine un petit cercueil blanc. On aurait dit une boîte à poupée,
la tête un peu surélevée pour mieux faire voir la belle robe de la poupée: sa
robe de baptême et son linceul. Les autres enfants, pieds nus,
entouraient l'étrange St-Nicolas des morts, les yeux rêveurs, le pouce en
bouche. Ce ne fut là qu'un sursit accordé aux
aînés par la destinée. La famille d'André et de Marie Dejardin ne devait guère
faire mentir le dicton d'Anseele. Des onze enfants que Marie mit au monde
cinq seulement ont atteint leur majorité. Encore que sur les cinq André, le
plus doué, le plus beau, le seul à qui l'on soit parvenu à faire donner une
certaine instruction, est mort à vingt-deux ans, crachant ses poumons. Des autres, trois sont morts un an ou
deux après la naissance de Lucie, fauchés par une épidémie de typhus qui
s'abattit sur la région. Ils s'en allèrent à quelques heures d'intervalle, et la
même fosse les accueillit. Leur vie avait été si peu marquante, leur mort si
banale, qu'aucun membre de la famille ne se rappelait de leurs noms. Pas plus
que de celui de l'aînée des filles. Pâle et toujours silencieuse, rongée par
une quelconque maladie sournoise, elle s'est évadée doucement de la vie. La Benjamine de la famille eut une fin
autrement dramatique. Et si, quelques décades plus tard, Lucie
devait réclamer l'installation de buanderies municipales et coopératives avec
une telle émotion, c'est qu'elle avait vécu l'accident type des ménages ouvriers
d'alors, des ménages houilleurs surtout. Parlant des désagréments de la lessive à
domicile elle s'écriait : « N'oublions pas que ces journées de lessive peuvent avoir
des suites dont on ne saurait exagérer la gravité. Pour celles qui ont des
enfants en bas âge, quelle peur continuelle ! Il suffit que la mère ait son
attention détournée une minute pour que l'enfant accoure, tombe dans la cuvelle
d'eau bouillante. Le malheur est entré à la maison pour toujours[4]
». Lucie pensait à l'agonie de sa petite sœur,
morte à trois ans des suites de ses brûlures. Samedi
soir. On a prétendu que Lucie Dejardin avait
eu une enfance malheureuse. Quant
aux circonstances extérieures de sa vie, au côté objectif, c'est exact. Mais il
y avait aussi le côté subjectif, qui, comme chez tous les enfants était couleur
de rose. Ou si l'on veut, elle avait, comme tout enfant, la faculté de rejeter,
dès que cela lui était physiquement possible, toute acceptation de la
souffrance. C'est le malheur de l'adulte de se souvenir qu'hier valait mieux
qu'aujourd'hui, ou de craindre que demain ne soit plus mauvais encore. Chez
l'enfant, au contraire, peines et joies se succèdent, s'oblitèrent les unes les
autres rapides, intenses, comme averses et soleil se disputant un ciel d'avril. Gardons-nous donc de faire de «
l'ouvriérisme ». C'est ainsi que la député Dejardin qualifiait certaine
façon de peindre les conditions de la vie ouvrière avec des tons exclusivement
noirâtres ; ce n'est point ainsi qu'elle se rappelait sa propre enfance. Enfance heureuse alors ? Certes non.
Mais, à cette époque les jours de la semaine avaient, pour les enfants de la
classe ouvrière, leur figure spéciale, bonne ou mauvaise. Des figures bien plus
nettement marquées que de nos jours. Ainsi des samedis ... Il se fait tard et le père ne rentre
pas. Comme tous les samedis de paie la mère attend, essayant de tromper son
impatience. L'homme, c'est tout de même le maître,
se dit-elle. Oui, l'homme c'est surement le maître, puisqu'il ne fait qu'une
journée quand la femme en fait deux. Et qu'il lui faut encore des distractions par
dessus le marché. 
Marie
sait qu'André boit de plus en plus. Mais peut-on lui en vouloir ? Avec
les 3 fr. 40, les 3 fr. 25, - bientôt les 2 fr. ! - que le mineur touche pour sa
journée de 12, 14, 16 heures comment ne pas boire pour se soutenir ? Pour
oublier, surtout. Pour oublier, qu'on doit bien plus qu'on ne touchera de
quinzaine. Evidemment, ce n'est guère logique de
boire les maigres ressources du ménage, parce qu'on n'arrive jamais à se
libérer de sa dette à l'économat. Mais le moyen de faire autrement, puisque c'est
à l'économat qu'on touche sa quinzaine ? Si encore on la recevait en entier,
s'il n'y avait pas ce maudit « truck-system », qui oblige l'ouvrier
à recevoir une partie de son salaire en marchandise[5]. Tout
à l'heure on remettra à André des bons que sa femme pourra échanger à
l'économat du charbonnage, pour autant qu'elle y trouve quelque chose à son
goût. Le choix des marchandises est limité par la rapacité de l'économe, qui a
sa clientèle assurée d'office. Le pis de l'histoire c'est que l'économat
est aussi débit de boisson. Vous n'avez plus d'argent pour vous
payer un verre ? L'économe vous fait volontiers crédit. Il est à l'aise pour se
faire rembourser le jour de la quinzaine puisqu'il n'a qu'à reprendre de la
main gauche ce qu'il a donné de la droite ! Et après l'économat, les cabarets sur le
chemin du retour sont plus nombreux que les stations d'un Chemin de la Croix! Il faudrait une volonté de fer à
l'ouvrier pour résister à ces sollicitations répétées ; au mineur surtout, qui
ne voit jamais le jour en semaine, - si ce n'est à l'aube et à la vesprée de
juin à août. Pour lui la clarté blafarde du café
c'est la lumière et la vie, la poésie de l'heure où il s'échappe du travail et
de ses responsabilités de famille. Or, quand on a commencé de boire on
continue. Une « goûtte » est si vite avalée, puis une autre ! Tout pousse à
boire. L'habitude. La bienséance. Les camarades qui offrent chacun leur
tournée. Qu'on serait mal vu de refuser, et qu'il faut rendre à son tour. André pense-t-il à sa famille ? Puisqu'il lui a volé une part de ce qui
lui revient, il lui faut se rassurer. Pour faire taire les murmures de sa
conscience il boira encore une goûtte. Qu'est-ce qu'elle va encore penser de
lui Marie, quand il rentrera ? Tiens ! pour cela il ne rentrera pas. Il boira
donc « en chapelet ». Ainsi, à chaque quinzaine le cœur
de Marie oscille entre deux craintes! Sa crainte de mère et de ménagère à
l'idée que le père va rentrer, tard dans la nuit, les mains vides, sans rien
lui apporter pour nourrir les enfants. Sa crainte de femme et d'épouse devant
les colères subites, les exigences outrageantes du mari ivre. Elle sait
qu'André n'est pas le même homme quand il a bu, qu'il est capable des pires
brutalités quand il rentre au logis les yeux mauvais, la bave et l'injure à la
bouche! Et sa hache de mineur qui ne le quitte
jamais! A la Sainte-Barbe de l'an dernier n'a-t-il pas démoli le buffet de la
cuisine ? Heureusement, il savait encore ce qu'il faisait. Pour ne pas se jeter
sur les enfants il s'était « revenge " sur le buffet. Parfois Marie prend les devants: elle
envoie les enfants attendre leur père à la sortie de la mine. Elle n'y va
jamais elle-même. Non pas par crainte de la langue des mieux mariées - elles
sont si peu nombreuses au coron celles dont le mari ne boit pas. - Mais par une
convention tacite les wallonnes ne vont pas elles-mêmes « racoler » leurs
maris. Ça ne se fait pas. Pour les enfants ce n'est pas la même chose. On les
plaint, et on fait semblant de ne pas les voir quand ils passent, honteux, en
se coulant le long des murs. C'est pourquoi, le samedi soir, les
enfants osent à peine respirer. Ils guettent le moment où la mère va les
pousser à la porte et les obliger à faire le tour des cabarets jusqu'à ce
qu'ils trouvent leur père. Ils savent que le père, tôt ou tard, finira par se
laisser reconduire titubant, horrible. Ils savent aussi qu'une fois la porte de
la maison refermée, le saoulard recouvrera son équilibre; assez pour défaire sa
ceinture de mineur et les battre, filles et garçons, comme le possédé qu'il
est, pour passer sa rage d'alcoolique. Est-ce étonnant que ces samedis de paie
se soient burinés dans le cœur des enfants, et qu'ils aient fait de Lucie
Dejardin une propagandiste anti-alcoolique à l'éloquence farouche? Entr’acte. Enfance de lutte et de
coups, de mornes samedis de
quinzaine, hantés par la peur. Mais s'ils reçoivent plus de horions que de
caresses, plus de brimades que de tartines, les enfants Dejardin jouissent au
moins d'un privilège authentique : ils habitent une demi-campagne de bois et de
pâturages. En effet, derrière l'interminable
grand'rue de Bois de Breux, avec ses mornes façades, on retrouve des prairies
en fleur, de paisibles troupeaux. Et pour les enfants du coron c'est la liberté,
c'est toute la poésie de la campagne inconnue de ceux de la ville. Bien sûr il faut trimer chacun selon ses
moyens. A peine sait-on marcher qu'il faut
s'occuper des plus petits encore. Mais entre camarades on s'arrange pour porter
le dernier né à tour de rôle « âs crâ vê » quand on part en randonnée dans les
prairies. Et on apprend à connaître les fleurs, comme tout enfant devrait
apprendre à les connaître; en les regardant les yeux dans les yeux, parce que
l'on est encore tout petit. On arrache à pleines mains de grandes gerbes de
St-Joseph, pour la maman, « d'oûy d'and je », de « trimblinne »,
de « p'tit solo ». Puis on pense à autre chose, et ces belles offrandes
se dessèchent, tristement abandonnées. C'est aux enfants à chercher de quoi
renouveler leurs paillasses une fois l'an. Ainsi, à la première éventée de
l'automne, ils s'en vont par bandes dans les bois, se bousculant pour remplir leurs
sacs de feuilles tombées. Journées heureuses où l'on n'a de comptes à rendre à
personne ! On fait durer le plaisir tant qu'on peut. Les gamins en profitent
pour couper des « sawou » pour se faire des sifflets et des « canabûses
», ces cannes à pêche pour têtards. Hélas les fossés auront bientôt disparu du
paysage, avec les derniers vestiges des forêts de Fléron . Moins heureux sont les souvenirs des
courses ménagères. La maman l'envoie-t-elle « à la boutique» que Lucie est sûre
de goûter de la ceinture. Il y a tant de choses passionnantes en cours de
route. - Une colonne de fourmis en pleine migration, portant chacune son
fardeau. - Médusée, Lucie en perdra la notion du temps et des choses. Elle
rapportera, enfin, un kilo de savon alors qu'il faudrait à la maman énervée du
sel pour la soupe. Ou encore, suivant le vol d'un papillon, les sauts d'un
écureuil, elle courra jusqu'à l'oubli complet, comme, à trente ans, elle s'attardera
jusqu'aux petites heures à discuter politique « qu'il vente, qu'il pleuve,
qu'il neige ». Tout
compte fait, c'est sur le terril qu'on se plaît le mieux. Certes on se remplit
le corps de coups bleus à chuter sur les tas de briques et de pierres. Mais
c'est par bravade qu'on se laisse tomber, faisant semblant de glisser sur la
pente pour mieux faire voir comme on est adroit pour se rattraper. Et quand on
a fini sa tâche, rempli son sac, qu'il fait bon galoper tout au dessus du terril.
La montée a été dure, mais ce que la descente est palpitante accroupi sur les
talons, ou sur quelque couvercle de vieille marmite et criant à tue-tête! Et quelle vision magnifique de là-haut!
A la tombée du jour surtout, quand les lumières de Liège ouvrent l'une après l'autre
leurs yeux d'or sur le fond gris de la vallée ! Qu'elle est mystérieuse la
Meuse au crépuscule - on dirait un serpent voilé d'argent. Dimanche matin. André a
la tête dure. Il ne lui faut pas longtemps pour cuver sa cuite
du samedi. Levé de bonne heure il fait son jardin, car c'est un des rares
mineurs d'avant les trois huit à cultiver son lopin de terre. Fait plus rare
encore pour l'époque, ce mineur est passionné des roses. Il faudrait voir sa figure
rude s'adoucir quand il se penche sur quelque greffage réussi. Pour le reste - légumes
courants et fines herbes: sarriette, thym, brèles, pourpier - Marie aura
toujours de quoi faire d'une salade, d'une maigre soupe ou d'une « potêie »
du terroir un plat pour gourmet. 
Son jardin sarclé, André s'habillera
pour fêter le dimanche. Ses vêtements sont de bonne qualité, car avec du mauvais
tissu on paie deux fois la façon. C'est pourquoi sa calotte semble capter les
rayons du soleil, tant la soie noire en est riche. Le long sarreau bleu se
tient debout tout seul tant la toile en est solide. Pourtant le devant en est
finement plissé, grâce à un repassage expert. Marie rogne sur son sommeil pour
que son homme fasse bonne figure à la messe – puisque c'est son idée - et à la
promenade dominicale au village. Mais qu'il arrive une catastrophe
quelconque: maladie, grève, enterrement, la « mousseûre » du chef de
famille suivra les deux bougeoirs au Mont de Piété. Puis ce sera au tour des
deux bagues d'alliance. André a rejoint le groupe d'hommes
devant la Maison Communale. On guette la rentrée des pigeons, supputant le temps
qu'il peut faire là-bas, à Erquelines, à Noyon, à Compiègne, à Vincennes ...
Autant de lieux inconnus mais d'où, sorte d'Eldorados, chaque « colèbeû »
escompte qu'un jour son « colon » lui rapportera la grosse prime. Il fait calme. C'est à peine si quelques
gros nuages blancs traversent lentement le ciel serein, très haut, d'un
bleu-gris clair. Mais, c'est bien du côté de la France qu'ils viennent ces
nuages. Ainsi, le vent est bon, les lâchers auront été faits. Le temps d'écouter un bout de messe devant
la porte de l'église restée ouverte, et les hommes se regroupent devant la Maison
Communale. De la main ils se protègent les yeux contre le soleil de midi. Voilà un petit nuage de rien du tout qui
s'approche, rapide comme l'éclair ! Les voici ! En un souffle de temps la nuée est
rentrée au village, s'éparpillant comme une poignée de grains jetée de la main
du semeur. A peine a-t-on perçu à leur passage l'argenté de leur ventre, le
noir de leur dos, que le premier pigeon a rejoint sa loge. Le grand Hinri jure et veut se cogner la
tête au mur. Cette fois il était si sûr de son affaire ! Jamais il n'a gagné le
« panier d'onèwe ». Mais l'amour du jeu est si profondément ancré en
lui, son optimisme si intarissable, qu'il continuera de miser et d'espérer, de
jurer de dépit et de se saouler pour se consoler, pendant toute sa vie d'homme. C'est fini jusqu'au dimanche suivant. Chacun va dîner de son côté. Et le menu ? De la viande ? Une, deux fois par an tout au plus. Mais la poule au pot, que souhaitait
Henri IV à tous ses sujets ? Oui, de temps en temps il y a un coq à
tuer, car Marie n'est jamais sans quelques poules dans le poulailler contre la maison.
Plus souvent un lapin de garenne braconné qu'elle aura mis cuire la veille.
Bien entendu Marie fait elle-même son pain ; et après la cuisson des grandes
roues de cinq kilos elle enfourne son lapin. Dans la terrine, scellée d'une
languette de pâte, il mijotera sur son lit d'oignons jusqu'au dimanche. Et au
dîner chacun s'en lèchera les doigts, les enfants en croqueront les os. Avant, Marie aura servi une soupe.
Parfois une de ces « vètes sopes » qui respirent le printemps par
chacune de leurs milliers de feuilles, lavées à grand' eau à la fontaine. Et le dessert ? Ah! quand les mineurs gagnaient le
salaire fabuleux de 4 frs par jour, à la fête, aux grands événements: baptême,
première communion, procession, Marie, comme les autres femmes du village,
faisait de la tarte. D'immenses « blankes dorèyes » et des tartes
aux fruits de saison : « as cèlihes, as gruzales, as preunes ».
Mais tout cela c'était en l'an 1873, d'heureuse mémoire, deux ans avant la
naissance de Lucie. Les dimanches cependant Marie fait un
grand effort pour donner quelque douceur aux enfants : un coup de marteau au pain
de sucre et chacun aura son « bokèt d' souke à sucer ». Ou bien une
datte, ou la moitié d'une figue. Marie est friande de fruits exotiques. Dimanche après-midi. André et ses amis sont d’acharnés «
trim'leûs » mais pour Marie les cartes n'ont pas plus de sens que
des jouets d'enfants. Désabusée, elle aurait pu dire avec la « Voix de
l'Ouvrier », premier journal du Parti Socialiste belge : « Le peuple, auquel
depuis un demi-siècle on ne reconnaît pas de droits, ne pense pas, n'a pas
d'opinion... Son éducation politique est encore à faire. Il sait jouer aux
cartes, aux quilles, à la balle, mais ne sait rien des choses politiques. » En hiver on se rapproche du poêle; à la
belle saison on porte la table de cuisine sur le carré de terre battue derrière
la maison. Et en toute saison le baril de pèket fait son apparition. Pour Marie, pas la peine de se désoler,
puisqu'on sait bien ce qui va se passer. Le buveur invétéré conserve sa
lucidité complète même quand il a avalé un demi-litre de genièvre. Pour André
et ses trois amis les cinq litres y passent, parfois les sept, les dix, au
cours de leur partie de cartes. Marie souhaiterait que son homme eût la tête
moins dure. S'il était plus vite saoul il dépenserait moins. Mais ce n'est
encore rien tant qu'il reste à la maison. Tout plutôt que le cabaret. La petite Lucie se glisse sous la table.
On ne pense pas à elle pour les corvées tant qu'on ne la voit pas. C'est le bon
Djosef qui devra bercer le dernier né, veillez à ce que la petite sœur ne
croque pas du charbon. Sans doute aucun des enfants ne mange à sa faim, mais
les aînés ont passé l'âge des illusions comestibles. Lucie a cinq ans. A son poste d'écoute
entre les pieds des joueurs elle en, entend parfois de drôles. Mais,
d'instinct, elle ne s'y arrête pas. Ce qui l'intéresse c'est la mine. Hérédité ? Peut-être. Toujours est-il que dès
l'éveil de la curiosité elle se passionne pour tout ce qu'on raconte sur la
mine. L'attrait de l'inconnu, du danger l'obsède inconsciemment. Tel un enfant de
marins rêvant de naviguer vers des horizons au delà du soleil couchant, Lucie,
enfant de mineurs, rêve d'aller vers le fond de la terre, dans cette cage
mystérieuse qui vous descend si vite qu'elle laisse votre estomac au-dessus
alors que vos pieds sont déjà tout en bas ! Et tel un enfant de marins écoutant,
médusé, des récits de naufrages, Lucie écoute de toutes ses oreilles quand on
parle d'étançonnements mal assis, d'éboulements à craindre, de coups d'eau, et
surtout de l'ennemi numéro un : le grisou. C'est ainsi que le coup de grisou de
Frameries frappera d'épouvante sa jeune imagination[6]. Mais, à côté des récits des mineurs, un
souvenir personnel lui restera au tréfonds de la mémoire. Le souvenir d'un jour
de malaise et de lamentation où la maison était remplie de monde, de hauts cris
d'hommes et de sanglots de femmes. Elle se rappellera surtout sa propre frayeur
d'enfant en voyant pleurer de grandes personnes. Bien longtemps après elle
saura que ce jour-là son père était rescapé, seul, de la noyade au charbonnage de
la Chartreuse, quand l'Ourthe, envahissant la couche dite Poignée d'Or, avait
entraîné dans la mort ses 14 compagnons de taille. A pèlotes. Marie s'est enfin décidée à quitter
la mine. Avec ses neuf enfants, son mari, c'est vraiment trop d'être hors de
son ménage douze heures tous les jours. N'a-t-elle pas ses deux mineurs à
lessiver, à apprêter puisque Nicolas, qui vient d'avoir dix ans, descend
maintenant dans la bure avec son père. Certes, Marie ne pourra pas rester sans
rien faire que son ménage. Le salaire de son homme et de Nicolas suffit à peine
pour le loyer, les pommes de terre, et le pain. Il faut que la mère cherche à
gagner pour aider à nouer les deux bouts. Marie se fera « martchande di pèlotes
», achetant des pelures de pommes de terre aux ménagères liégeoises pour les
revendre aux voisins de Bois de Breux qui ont un cochon à l'engraissage. Combien de kilomètres il lui faut faire
avant de gagner un franc? Voyons... Tous les jours elle descend le Thier de
Robermont, un grand panier sur la tête, chargé parfois de mottes de beurre, - enveloppées,
chacune, de sa feuille de rhubarbe, - parfois d'un quarteron d'œufs. Les
fermières de Bois de Breux et de Beyne-Heusay lui confient volontiers leurs
produits. Contre quelques « çanse » de commission elle les remettra
à une vendeuse de la Place St. Denis, puis elle commencera sa tournée « as pèlotes
». Pendant une, deux heures «c'est selon »,
les sabots de Marie feront tinter les pavés de Liège. Elle a ses clientes,
comme toutes ses collègues de ce pauvre métier. Mais elle en voudrait davantage
pour lui raccourcir sa tournée. C'est pourquoi tout le long du chemin son cri
aigu de «as pèlotes !» annoncera son passage en Féronstrée, au Pairay,
Hors-Château, Quai des Pêcheurs, où elle s'engage Outre-Meuse pour la dernière
étape. Il y a des ménagères qui lui remettent leurs épluchures pour rien, y
joignent même un quignon de pain. D'autres réclament une « çanse »
au bout de la semaine. Celles-ci au moins n'exigent pas qu'on s'attarde à « cacayeter ».
Les « bons cœurs » hélas sont aussi prodigues de confidences que
d'épluchures. Et Marie est toujours pressée. Avant de pouvoir finir journée il
y a la montée de Bois de Breux qui l'attend. Et bien entendu il faut que cela
se fasse à pied, puisque le tramway - deux chevaux chair et os - ne circulera
qu'à partir de 1887. 
Les enfants sont enchantés du nouveau
métier de maman. On l'accompagne quand elle va chercher la marchandise, le
soir, dans les grosses fermes du voisinage : parfois on reçoit un fruit, une
tartine. Comme cela on sait où s'adresser pour avoir sa part quand les
fermières distribuent des gâteaux, le Jour des Rois, aux enfants qui sont à
leur goût. Mais c'est Liège que Lucie voudrait voir
de près. Liège aux yeux de feu, Liège où disparaît tous les jours la maman.
Rien à faire. Maman ne veut pas qu'on l'accompagne : c'est trop loin. Et puis
les toilettes de Lucie ne sont pas précisément à la hauteur d'une promenade
citadine. Pour la dégoûter, le vieil oncle lui
raconte que si elle veut aller à Liège il lui faudra « bahi l'cou dèl veye
feûme ». Les grandes personnes sont bien
contrariantes mais Lucie ne s'en tient pas là. Un beau matin elle se glisse
hors de la maison et suit la maman tout doucement. Quelle veine ! Maman marche toujours
sans tourner la tête, le regard fixe sous son « tchètet ». Et tout à son
idée la petite trottine courageusement. - Ainsi en sera-t-il de Lucie toute sa
vie durant. Jamais elle ne sentira la fatigue qu'au bout de la route qu'elle se
sera tracée. - Mais au pied du Thier de Robermont voici qu'une « cotîresse »
vient au-devant de Marie. Binamé Bondieu ! serait-ce la « veye
feûme » dont l'a menacée le « mononk » Mathieu ? Et Lucie de se
précipiter dans les jupes de la maman qui la reçoit à coups de claque,
évidemment, d'autant plus qu'elle a mis à la petite la plus vilaine de ses deux
robes justement ce jour-là! Comment faire? Remonter avec l'enfant,
il ne faut pas y songer. On perdrait sa journée. La chasser, la laisser
remonter seule ? Ce n'est guère possible non plus. Il faut bien se résigner. Et c'est ainsi que le passant pouvait
voir l'entrée triomphale de la future
député de Liège dans la grande cité
d'eau et de lumière, son unique vêtement une robe faite de pièces cousues les
unes aux autres. Mais qu'importe ! Lucie a gagné sa
première victoire. Elle ne pense pas à sa robe, pas plus qu'elle ne pense à ses
pieds, meurtris par leur longue course en sabots. Suçant d'enthousiasme son
pouce elle n'aura pas assez de ses deux yeux pour regarder passer sous ses
ponts la Meuse enchanteresse. «Meuse la tant belle» qui toujours ; lui semblera
un parterre de tulipes en promenade. Ecolière. A six ans on entre à l'école. Non
pas qu'il y ait la moindre obligation scolaire. Il se passera plus de trente
ans encore avant que le Parlement belge n'accepte de généraliser l'instruction,
même primaire. Mais Marie a ses idées. Elle ne veut pas que ses enfants
connaissent, comme elle, le désespoir d'une intelligence condamnée à ne jamais
s'éclore : il faut qu'ils apprennent à lire. Il y a peu d'écoles dans le pays à cette
époque. N'est-ce pas pour cela d'ailleurs que ce bon monsieur Sainctelette a
voté contre le projet de loi Vleminckx sur le travail des enfants dans les
charbonnages ? A quoi bon interdire aux enfants le fond de la mine ? Ils ne feraient quand même que courir les rues
puisque « dans les communes industrielles les écoles ne sont pas en nombre
suffisant pour satisfaire aux besoins de la population. » Mais, dans la commune de Beyne Heusay il
se fait qu'il y a une école primaire. Lucie ira donc à l'école. Elle n'aura pas
loin à aller, puisqu'on habite maintenant à Beyne. Promue au grade d'écolière,
la maman lui donnera de temps en temps un quart d'œuf pour déjeuner, avec sa
tartine. Lucie trouvera moyen de s'en coller tout autour de la bouche. C'est
pour prouver aux amies de classe qu'on est riche chez elle, puisqu'on mange si
bien. Hélas ! l'école sent trop la prison pour
lui plaire. Rester assise toute la matinée ! Et devoir se taire, surtout, quelle misère ! Aussi, avec quelle sympathie émue devra-t-elle
commenter, un jour, les sentiments des gosses à l'approche des grandes vacances
: « Etre lâchés de l'école, si attrayante
soit-elle - et elle l'est bien peu pour beaucoup d'écoliers! - n'avoir plus à écrire ni à calculer, n'avoir
plus à étudier cette maudite grammaire, quel bonheur ! Quant à l'histoire,
passe encore, la géographie également, surtout lorsqu'il s'agit d'étudier la
géographie locale, de se faire quelques notions de botanique et d'histoire
naturelle en se promenant. Le mouvement, la liberté de regarder autour de soi,
de bavarder, de gesticuler sans être rappelé à l'ordre, sont autant de choses
chères au cœur de l'enfant.» Il faut bien ajouter que même pendant
les quatre précieuses années de scolarité, de six à dix ans, on ne va pas tous les
jours en classe. Loin s'en faut. Au moment de la plantation ou de
l'arrachage des pommes de terre, de l'ensemencement ou du repiquage des
légumes, les fermiers embrigadent les gosses, heureux de cet appoint de travailleurs
à bon marché. Ils les emploient à arracher les chardons, les chiendents, à
cueillir les pissenlits, à abattre les orties. Leur jeune âge n'inspire aucune
pitié quant aux heures de travail ; leurs journées se prolongent jusqu'à
épuisement. « Une seule chose nous rendait la vie
supportable » écrira Lucie. « Au moins mangions-nous à notre faim :
du bon pain gris, des pommes de terre au lard. Et au bout de la semaine nous
rapportions fièrement nos 2 frs 50 à la maman. » Sans doute serait-ce beau d'écrire que
la première femme député de Belgique ait été une élève modèle. Mais ceci n'est pas
une biographie romancée ; c'est la chronique aussi véridique que possible de
faits vécus. Il faut donc avouer que Lucie était la plus turbulente des gosses,
toujours la première à faire des « niches », à tourmenter l'institutrice. La mode était alors aux « tournures » ;
ces perchoirs irrésistibles. Quelle tentation pour les gosses d'y accrocher
toutes sortes de trophées! Et à cette tentation Lucie n'essaya guère de
résister. Des spécimens de faune et de flore subrepticement déposés sur le «
fau cou » de la « 'moizelle » faisaient la joie des élèves, « retournaient le
sang » de l'institutrice. Bien entendu cela finissait par la découverte du coupable.
Lucie se voyait infliger pensum sur pensum, séjour à la cave, retenue en
classe. Mais de ces escapades journellement renouvelées, les punitions n'empêchaient
rien. Punie à l'école, re-punie par sa mère à la maison, punie une troisième
fois par la ceinture du père quand il s'agissait de faits graves, rien n'y
faisait ! Douée d'une mémoire excellente, d'une intelligence vive, elle
apprendra tout ce qu'on voudra bien lui présenter. A l'exception de « cette
maudite grammaire » avec laquelle elle restera toujours en brouille. Mais de
discipline, de conformisme n'en parlons pas. Quand ce n'était pas sa propre
liberté qu'elle défendait au prix de coups et de taloches, c'était la liberté
de ses condisciples de classe, voire même la liberté des plus humbles encore.
Il y avait par exemple les « gattes ».... Il faut dire que « nosse Lucèye » a fait sa première communion. C'est
le père qui l'a voulu. Puisqu'il ne manquait jamais sa messe entre deux « goûttes »
au café vis-à-vis de l'église. Or, voici, qu'en préparation au grand
jour, Lucie se trouvait au catéchisme. Il faisait chaud, en cet après-midi de
la mi-avril. Le soleil s'amusait à peindre des losanges roses et bleus sur les dalles
de l'église. Et les losanges pour remercier le soleil se mettaient à danser. La porte de la sacristie, ouverte sur le
jardin de M. le curé, laissait entrer des odeurs délicieuses de sève d'herbe,
de pommiers en fleur, de narcisses et de muraillers. Et tous ces parfums
printaniers contrastaient, à vous fendre l'âme, avec le moisi ecclésiastique :
ce mélange de fonds d'encensoirs, de suif de chandelles, et de fleurs fanées
qui pourrissent dans leurs eaux mordorées. Au début tout alla bien, car Lucie
savait son catéchisme à merveille. Mais hélas! les choses se gâtèrent quand une
autre fillette, à court de réponse, fondit en larmes, et que le curé la
houspilla quelque peu. C'est alors que, tête baissée, Lucie fonça à la défense
de l'opprimée! Malheureusement, monsieur le curé en
avait vu bien d'autres. En un tournemain Lucie se trouva à la
sacristie, avec ordre de méditer sur la politesse due aux grandes personnes en général,
aux curés en particulier. Mais faut-il dire que de la sacristie-même l'arôme
des muraillers, des herbes s'épanouissant sous les caresses du soleil, se
faisait plus tentateur, plus énervant encore? Le petit cœur de Lucie se gonfle, tant
elle aspire à la liberté, pour elle et pour les autres! Mais comment donc
mettre en pratique ce noble sentiment ? Tiens ! voici par bonheur des malheureux
! Et par la faute de monsieur le curé encore ! Trois pauvres « gattes»
barbues qui n'ont plus rien à brouter, et qui tournent, tournent, au bout
de leurs chaînes, dans la petite prairie tout contre la sacristie. 
Une fois le curé parti, congédiant les
enfants sages, mais laissant à ses méditations cette diablesse-en-herbe de
Lucie, la libération ne devait guère se faire attendre. La suite non plus
d'ailleurs. En trois épisodes ..... Joyeuse entrée des gattes à
l'église. Rageuse entrée du curé chez
les Dejardin. Sortie justicière de la ceinture
paternelle. Mais qu'elle avait été douce l'œuvre de
libération ! Et Lucie de conclure que tout plaisir se paie, et de fredonner : «
Lès scolîs, lès barbotîs, on l'zés prind po lès deûs pîds, on les foute disqu'à
plantehî, on lès hène foû po l'fignèsse ». Quelque chose bouge. Un temps très court, un an ou deux avant
la série de grèves qui allaient alourdir l'atmosphère - lourde déjà de misère -
vider les armoires, blanchir les cheveux des parents, un instant la famille
Dejardin a connu un bien-être relatif. Non pas qu'il soit entré davantage
d'argent à la maison. Mais on a déménagé « sur les Faweux » tout au bout du
village ... La maison est spacieuse par rapport à
celle de Bois de Breux. Il y a une mansarde pour la paillasse des garçons, une autre
pour celle des filles. La cuisine est grande, pas trop encombrée par le lit des
parents. On circule aisément autour de la table, entre les bancs des enfants et
le mur. André parle même d'acheter une chaise ou deux aux plus grands, quand il
aura quelque argent mis de côté. Marie ne passe pas son temps à décourager l'optimisme.
En attendant, le jardin est grand. André y cultive ses roses à l'aise. Marie
jouit d'un bon réduit pour faire ses lessives. Et, comble de richesse ! il y a
une source dans le jardin : finis les longs chemins d'eau. Pour les enfants c'est la toute grande
campagne, le bout du monde; surtout quand l'oncle Mathieu les amène à la limite
de la commune. C'est qu'il aime à leur faire entendre les grandes orgues qui
doivent se trouver quelque part vers l'horizon bleu de la frontière
hollandaise. Vibrations quelconques que le vieillard
capte, l'ouïe aiguisée par cinquante ans au fond de la mine, à guetter le
moindre craquement anormal des boisages, le clapotis d'eau insolite? Souvenirs remontés du sous-conscient? Qui le dira ? Mais, des enfants qui
écoutent, l'un ou l'autre finira toujours par « entendre » le murmure d'une
musique solennelle, venue d'on ne sait où, on ne sait comment. Si bien que par
la loi de la suggestion, si facilement acceptée des enfants, tous finissent par
« entendre » le miracle des grandes orgues . Mais Lucie a dix ans. Elle ne pourra
plus écouter des orgues miraculeuses. Il lui faudra même faire ses adieux à la demoiselle
dite Hoche-quau. Car à dix ans on n'est plus un enfant. On gagne sa croûte, on
aide à gagner celle des plus jeunes. Et ainsi la petite Lucie, toute fière,
ira se faire gagne-pain, avec sa frimousse de dix ans, sa mèche toujours en
bataille, serrée dans un lacet à souliers. Sa mère lui a trouvé une place de
serveuse dans un café. Ah ! à son corps défendant, elle qui a en horreur
les cafés. Mais le choix des occupations ? Au charbonnage ? A la ferme ?
C'est encore au café que le travail paraît le moins dur. Sitôt arrivée le matin on fait le
mastic. Essuyer les glaces, c'est une gymnastique effarante ! En tirant la
langue on y arrive tant bien que mal, en espalier. L'emploi de serveuse ne fera pas long
feu. La chute d'un plateau lourdement chargé... Un fracas écœurant de verres
brisés Cette fois-ci Lucie n'osera pas rentrer
au domicile paternel. A la nuit tombante Joseph finira par la
retrouver, sanglotant de ce chagrin sans réserve des enfants pour qui l'espoir d'un
lendemain meilleur n’existe jamais. La mère réfléchit. Mieux vaudrait se
serrer encore la ceinture et que la gamine reste à la maison. Elle n'est
vraiment pas forte. Et Dieu sait s'il y a de quoi l'occuper dans le ménage, avec
les trois mineurs à lessiver. En effet Joseph, qui a 12 ans, travaille
depuis deux ans déjà, près de son père, avec Nicolas l'aîné. Malgré cela la
misère noire s'est installée chez les Dejardin, comme dans toutes les familles
ouvrières. De 4 francs par jour qu'il était en 1873, le salaire des mineurs est
maintenant tombé à 2 francs. Et avec cela le coût de la vie ne cesse
d'augmenter. Mais il ne s'agit pas de la Belgique
seulement. Par toute l'Europe la crise se fait de plus en plus aiguë et les
ouvriers en ont plein le dos de leurs 12, 14, 16 heures de travail. Dans les verreries,
chez les tisserands, aux charbonnages, le mécontentement gronde sourdement. Les
mineurs, surtout, en ont assez de leur nuit perpétuelle. Ne voir le soleil que
le dimanche et encore ! Quand il ne faut pas faire double journée pour le franc
de plus qu'on gagne ! Ceux qui ont femmes et enfants sont les
plus aigris. Rentrer chez soi après le travail c'est rentrer dans une
atmosphère de larmes et de vaines colères de femmes à bout de nerfs. C'est pourquoi de plus en plus les
hommes boivent. Qu'elle
est belle la vie de famille! A St. Quentin des cabaretiers
compatissants construisent devant leurs cafés quelques hangars où les femmes
stationnent cependant que la moitié, les trois-quarts des quinzaines se
volatilisent, alcoolisés. Au moins ces malheureuses ont-elles « un abri pour
attendre et pour pleurer ». Chez les tisserands du Yorkshire la
misère a atteint le tréfonds de l'esprit de famille, sapant le désir naturel de
voir continuer la race : les parents refusent d'assister au mariage de leurs
fils et de leurs filles. Les enfants ne sont que des bouches à
nourrir. Des bouches qui geignent sans cesse de faim ! Les plus jeunes tombent comme
des mouches quand passe l'aile noire du typhus ou du choléra. Les jeunes gens,
les jeunes filles vous fichent de la phtisie, crachent leurs poumons aux
ateliers, dans la mine, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus debout. Condamnés à
mourir, ils n'ont d'autre recours que de rester chez eux, à contaminer les autres.
Comment en serait-il autrement, quand la moitié des familles ouvrières dispose
d'une pièce unique pour tout logement? Mais si la rage gronde dans le cœur des
hommes, leur patience demeure légendaire. Morne fatalisme de l'habitude, de la religion,
qui prêche toujours la résignation, l'acceptation béate de la souffrance dans
ce monde ! Qu'ils croient encore ou non à un mieux être mystique peu importe;
l'empreinte est là. L'empreinte séculaire, l'empreinte profonde dans leur
sous-conscient. De temps en temps cependant quelque
chose bouge. D'étranges nouvelles du dehors commencent à filtrer jusqu'aux corons
du plateau de Herve, flottant dans la poussière des terrils, suintant au fond
des puits. Mordant et taciturne Nicolas lit son «
Echo du Peuple ». Le père n'ose lui défendre d'acheter ce nouvel hebdomadaire.
Ni même la mère, malgré les 2 centimes qu'il coûte. De temps en temps il lit
tout haut quelque écho de l'étranger : ce que réalisent des ouvriers suisses,
anglais, allemands. Mais André n'en veut rien savoir. Ce qui peut convenir à de
quelconques étrangers ne peut convenir aux Belges! Mais voici des échos de phénomènes
nouveaux au cœur même de cette Belgique qu'il veut croire stationnaire. A Bruxelles des ouvriers se seraient mis
à fabriquer en commun le pain de leur quartier, il y a quelque quatre ans déjà.
Leur coopérative primitive - un four à pain dans la cour d'un café, une
charrette à chien - a remporté un tel succès qu'ils viennent de se lancer en
grand ! Dans une synagogue désaffectée, ils ont installé un magasin de tissus,
un café, une salle de réunion même. Ce sera, disent-ils, leur maison, la maison
du Peuple! Dans le Hainaut, à Jolimont, des
ouvriers mineurs, des métallurgistes abandonnent le travail et, pendant une
quinzaine entière, risquant le renvoi pour absence non motivée, se mettent à
creuser les fondations de ce qu'ils appellent, eux aussi, leur maison du
Peuple, amenant leurs outils, leurs pelles, leurs brouettes à pied de l'œuvre
commune. « C'est contre-nature tout cela »,
déclare André, secouant la tête, « ça finira mal ». Mais dans l'âme sensible et subtile de
la mère une lueur d'espoir s'allume. Ce que ceux-là ont fait, on le ferait bien
ici! Pendant que les uns se groupent pour
essayer d'améliorer les conditions de vie de leur classe, d'autres déclarent ne
vouloir connaître ni trêve ni repos avant d'obtenir le droit de vote à tous les
degrés, et la liberté syndicale pour toutes les catégories de travailleurs.
Profitant du congé du 15 et 16 Août, ils viennent de se réunir à Anvers : 119
hommes, typos, verriers, mandatés par 68 organisations ouvrières. Mais André
s'impatiente. Qu'est-ce que cela peut leur faire, ces histoires d'un nouveau
parti politique ? On n'arrivera tout de même à rien. Parti socialiste ? Qu'est-ce
que c'est que cette histoire ? Des gens
qui veulent tout mettre en commun pour tout partager ? C'est de la foutaise tout
ça ! 
Imperturbable, Nicolas continue sa lecture. Ce mot de « socialiste » fait peur à d'autres
qu'à André. En effet, à la fin de la deuxième journée du Congrès d'Anvers, l'un
de ceux qui s'étaient montrés le plus actif dans les débats : Jean Volders,
propose pour « ne pas effrayer les masses ouvrières » de prendre le nom de
Parti Ouvrier, au lieu de Parti Socialiste Belge. « Peut-être aimeras-tu mieux cela ? »
dit Nicolas le sourire amer. Acclamant d'enthousiasme la proposition
de Volders, le congrès décide que le nouveau parti aura son siège permanent à Bruxelles. 15 août 1885 le Parti Ouvrier Belge
est né. 1886. Le premier acte du P. O. B. sera de
décider une manifestation en faveur du Suffrage Universel pour l'année
suivante, à la Pentecôte. On veut la manifestation grandiose, capable
d'impressionner les pouvoirs publics par son nombre, sa dignité et sa force
disciplinée. Mais la misère des masses ouvrières,
générateur d'incendies sociologiques, n'attendra pas le mot d'ordre du nouveau
parti ; ce Parti Ouvrier, dont la plupart ignorent l'existence. La rage sourde
des travailleurs, le désespoir des chômeurs feront déborder le trop-plein de
cette misère, en une manifestation spontanée, prétexte à de sanglantes
représailles. Joseph va avoir ses treize ans. Certes,
ce n'est pas dans la famille Dejardin qu'on pense à apprêter le gâteau aux
treize bougies et à inviter les petits amis. Mais comptons. Puisque Joseph va
avoir treize ans, c'est que nous sommes au mois de mars 1886. Comme tous les jours, André et ses deux
aînés sont partis au travail. Au charbonnage, tout paraît calme. Les
hommes, blaguant comme à l'ordinaire, s'apprêtent à descendre. Mais voici qu'un
bruit court de groupe en groupe: la dynamite a été retirée de la mine ! Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'ils
craignent, les patrons ? Ainsi qu'un ciel d'été s'assombrissant de nuages,
l'atmosphère, subitement, devient menaçante. L'orage gronde. Puisque
maintenant on a peur des « tchèsses di hoye », on verra ce
qu'on verra. Pendant ce temps, Marie est descendue à
Liège faire sa récolte d'épluchures, comme tous les jours. Sa tournée faite, elle veut remonter à
Beyne. Mais au moment de s'engager Outre Meuse, elle sent qu'il y a quelque chose
d'étrange dans l'air'. « On dirait une ruche quand les wasses vont
essaimer ». Chaussée des Prés : petits groupes
d'hommes, des chômeurs sans doute, puisqu'il n'est pas encore midi? Des boutiquiers
sur le pas de leurs portes, écoutent ce qu'ils disent. Récollets et Roture ont
débordé rue Puits-en-Sock : des hommes qui ne payent pas de mine, des femmes
débraillées, plus gueulardes encore que les hommes. Inquiète, Marie presse le pas tant
qu'elle peut. Mais en haut du Thier de Robermont, il lui faut bien s'arrêter un
instant pour souffler avant d'entamer les derniers kilomètres. Tiens ! pourquoi la clef n'est-elle pas
sous le paillasson ? Eh ! Mon Dieu ! Pourquoi ses trois hommes sont-ils déjà là ? Remontés avant l'heure ? La grève ? Le cœur de Marie chavire. André est là qui jure à jet continu,
martelant la table à coups de poing, menaçant ses fils de la ceinture. Et
Nicolas, plus blême qu'à l'ordinaire. Voilà qu'il desserre les dents pour
marmotter qu'il fera ce qui lui plaît. Et Joseph, taiseux comme toujours, mâchonnant
sa brindille d'ardispène. Que se passe-t-il ? Marie ne comprend
rien à cette discussion. Ça ne paraît pas être une affaire de grève. Alors ? C'est la gamine qui va l'éclairer. Lucie ne parle pas le français, mais
elle a appris à le lire. Les yeux brillants, elle s'absorbe à déchiffrer un
bout de papier que Joseph lui a passé, derrière le dos du père. C'est un
imprimé qui invite « les victimes de l'exploitation capitaliste, les meurt-de-faim,
tous ceux que le chômage a jetés sur le pavé pendant ce rigoureux hiver » à se
réunir le 18 mars pour commémorer l'anniversaire de la Commune et pour
protester contre « la crise terrible et lamentable qui grandit de jour en jour!
» « A Londres, à New-York, à Amsterdam, partout enfin, les travailleurs font entendre
leur voix aux oreilles de la bourgeoisie égoïste. Resterons- nous dans une
coupable apathie ? » Se souciant peu des menaces paternelles,
Lucie s'échine à expliquer à la maman ce qu'elle a compris du Manifeste des Anarchistes
Liégeois. Et ce carré de papier, mal composé, mal imprimé, embrasera
d'enthousiasme son imagination adolescente, marquera, en fait, le départ de sa vie
de lutte et de propagande. Les garçons racontent qu'au charbonnage
de la Concorde, à Jemeppe, les ouvriers sont en grève depuis la veille. Seigneur ! A quoi bon la grève ! Ils vont tous crever de faim ! Mais Nicolas, haussant les épaules: « Crever
pour crever » ... « Mangeons toujours la soupe », dit
Marie. C'est une manière de leur clore le bec à tous : puisqu'on ne parle pas
en mangeant. Mais quand ils ont fini, les fils
réclament de l'eau pour se laver. Ils ne vont jamais « à l'eau » eux-mêmes,
bien entendu. Ne sont-ils pas des hommes? Mais cette fois-ci Lucie ne sentira guère
le « harkè », lourd de ses deux grands seaux d'eau, car elle
a compris. Malgré le père, ses frères vont descendre à Liège. Silencieuse - une
fois n'est pas coutume - elle les regarde s'apprêter, et s'en aller, évitant de
regarder leurs parents. Le père a cessé de jurer. Quelque chose
lui a soufflé son autorité. Il n'a pas osé se mesurer avec Nicolas, qui
commence à avoir de ces colères. Et avec cela de la poigne. Lucie retrouve la parole pour annoncer
qu'elle va couper de l'herbe pour les lapins. Advienne que pourra, pense Marie.
Et à André, qui demande longtemps après, où est passée la gamine, elle répondra
que Lucie est chez sa marraine. Pendant ce temps, Lucie suit ses frères
sur la Grand-Route, à une distance respectueuse. S'il n'y avait que Joseph.
Mais Nicolas « c'es-st-on mâva ». Vers six heures elle arrive Place St-Lambert, où
pour la première fois se tiendra une manifestation ouvrière. Jamais encore Lucie
n'a vu tant d'hommes rassemblés. La plupart sont bien jeunes, mais ils sont
déjà marqués par la mine : épaules tombantes, genoux légèrement pliés, des « bleûs
côps » aux mains et à la figure. Sociable, Lucie se faufile parmi les
groupes, interroge. Deux drapeaux rouges ! Que c'est beau ! Ce sont des houilleurs de Seraing et
d'Ougrée qui les ont apportés. Ce sont eux qui vont prendre la tête du cortège. Les manifestants font un bout de promenade;
déambulant paisiblement devant la Cathédrale, les riches étalages du Vinâve d'Ile,
de la rue des Dominicains. Ils chantent, comme à la fête au village; leurs
chants n'ont aucun sens politique. Malgré leurs deux drapeaux rouges, on les
dirait moins révolutionnaires que des pensionnaires, un jeudi de sortie. Au
fait, ils en ont le même âge. Car la plupart des manifestants de cette journée
fatidique sont des gamins de 12 à 18 ans. Vers sept heures, Lucie se retrouve
Place St-Lambert, avec la tête du cortège. On écoute un, deux discours. Puis
les manifestants se remettent en marche vers la Place Delcour, où doit avoir lieu
un meeting avant la dislocation. Mais voici que rue Léopold, une vitrine
d'épicerie vole en éclats ! Sans doute
ne s'agit-il que du geste spontané d'un gamin qui a faim. N'empêche que le
remous de cette pierre, lancée au hasard, ira en des cercles s'élargissant
jusqu'à submerger, dans quelques jours, quasi toute la Belgique. Pour l'instant, elle fera effet de
signal. Le cortège change subitement de direction, s'engage rue Neuvice. Mais,
à l'arrivée de ces jeunes loqueteux, les marchands prennent peur et ferment leurs
volets d'un même geste. L'histoire leur donnera raison, car, rue du Pont, les
magasins restés ouverts sont saccagés, une boulangerie délestée de ses pains ; les bris de carreaux se renouvellent. Coupant court par la rue Capitaine,
Lucie voit déboucher le cortège de la rue Surlet. Les premiers arrivés
s'entassent, avec les orateurs, au Café National. Le gros des manifestants
piétine sur la place Delcour. Enervés, ils reprennent cahin-caha leur marche.
Mais bientôt, une folie grégaire s'empare de cette jeunesse, qui brise glaces
et vitrines, saccage des étalages. Pendant ce temps, Lucie, curieuse comme
une pie, s'est glissée jusqu'à l'entrée du café. Bien des années plus tard,
elle apprendra qu'au début du meeting, un certain Warnotte avait parlé de la
raison, de la liberté, du respect de soi, de l'amour-propre ouvrier. Mais pour
l'instant, elle n'entend que les effets oratoires de l'anarchiste Wagener, dont
elle reconnaît la voix pour l'avoir entendue une heure plus tôt Place
St-Lambert. 
« Les propriétaires, nom de D... c'est
avec de la dynamite qu'il faut les traiter ! Une bête vous saute au nez pour défendre ses jeunes
et vous autres vous êtes assez c... pour ne pas donner à manger à vos enfants !
» Le meeting fini, Lucie manque de se
faire écraser dans la bousculade de la sortie. Mais plus emballée que jamais, elle
hurle avec les manifestants une Marseillaise enthousiaste. Elle s'époumone à
crier des « Vive la République ! Vive l'Ouvrier
! » Les frères remontent vers Fléron,
obligeant leur bouillonnante jeune sœur à les suivre. Toute à l'émotion du
moment, elle se serait volontiers jetée devant les chevaux de la gendarmerie qui,
maintenant, barrent la rue de Pitteurs. Le lendemain, par bribes et morceaux, on
apprendra ce qui s'est passé. Les manifestants, repoussés vers la place
Delcour, ont gagné le cœur de la ville avant que la gendarmerie ait pu « se
retourner ». Volées de pierres dans les vitres des cafés, dans les pieds des
chevaux, huées de la part des badauds - la gendarmerie n'est sympathique à
personne - puis les sommations d'usage. Faut-il ajouter que les pouvoirs
publics, parfaitement au courant des difficultés de la vie ouvrière,
s'attendaient à une révolte ? Les
dispositions habituelles avaient été prises pour la réprimer. Quarante-sept
manifestants sont arrêtés, dont Wagener, et des houilleurs de la Concorde. A 11
heures du soir, tout est fini. Tout est fini. Mais non, tout commence. Le lendemain les houilleurs se mettent
en grève à Seraing, à Ougrée, à Jemeppe, à Tilleur; eux aussi se mettent à
crier : « Vive la République ! » et avec eux les houilleurs de Montegnée, d'Ans,
de Beaujonc. En fait de République, que trouvent-ils
en remontant au jour ? La garde civique est mobilisée, la
garnison de Liège est renforcée par des régiments venus de Béverloo, d'Anvers
même, de Bruxelles et de Namur. Partout, c'est l'état de siège. Il est défendu
de regarder par les fenêtres, de se réunir à plus que trois personnes sur la
voie publique. Des sentinelles gardent les ponts sur la Meuse, chemins des
charbonnages, châteaux des propriétaires de mines, maisons communales. Et malgré tout cela - à cause de tout
cela - la grève s'étend ! Si les bons bourgeois de Liège se sont
effrayés de la bande de gamins, de la poignée d'anarchistes du 18 mars, que
devaient-ils penser à la vue de ces milliers de mineurs, la hache à la ceinture
? Après ceux du bassin de Seraing, voici
ceux du plateau de Herve, les houilleurs du Hasard en tête. Spontanés dans
l'action de grève, ils sont solidaires dans leurs revendications. Ils s'élèvent,
surtout, contre le régime de la remonte, ce despotisme qui condamne les hommes
de la première équipe à attendre, dans les eaux glacées du fond, que ceux de la
dernière aient fini. Après les houilleurs, d'autres corps de
métier s'en mêlent : les verriers de Chênée, du Val St-Lambert. Puis se sont
les carriers de la vallée de l'Ourthe qui veulent se montrer solidaires de leurs
frères des corons et des cités. Tous les jours, Marie descend à Liège.
Le beurre qu'elle transporte est payé au prix fort, car les marchandises se
font rares. Les acheteurs se précipitent au marché de bonne heure, font leurs
affaires sous la protection des soldats, et s'en retournent dans leurs maisons
fermant vivement volets et portes. Souvent, Marie a le chemin barré par des
manifestants. Un matin, voici des carriers, le marteau
à l'épaule. Mais Marie n'a d'yeux que pour leur chef. Monté sur un cheval, il avance,
solennel, à la tête de ses « troupes » qui l'acclament au cri de « Vive le roi
Pahaut ! » C'est la note comique, mais la force est
là. Les carriers sont aussi décidés que les houilleurs. Mars 1886
! Printemps en fleur ? Printemps rouge d'incendies. Rouge de
sang brutalement répandu. A Tilleur, un gamin pris dans la
fusillade du pont, meurt de ses blessures. Jacobs, simple agent d'affaires est
abattu pour avoir osé regarder par la fenêtre. Aux funérailles, par crainte de
représailles, le cimetière est gardé par trois escadrons de lanciers et 400
fantassins. Pendant une semaine, la grève va
s'étendre de tous côtés, poussée par le vent du mécontentement et de la colère,
gagnant le Centre, le Borinage, le pays de Charleroi, où les désordres se feront
plus violents, la répression plus cruelle. De tout cela pouvait-on escompter un
résultat immédiat ? C’eut été demander l'impossible. Ces
manifestations spontanées, même aussi justement motivées, ne pouvaient avoir
gain de cause. Sans fonds de grève, les hommes étaient désarmés. Ceux qui
avaient femme et enfants étaient les premiers à reprendre le travail, la rage
au cœur. Mais comment faire ? Le cabaretier, qui versait à l'ouvrier le « pékèt
» à la tasse par les beaux; samedis de paie, refusait au gréviste une poignée
de farine pout ses enfants. Avant la mi-avril, tout est rentré dans
le calme, le calme du désespoir, à travers quasi tout le pays. Cependant, les journées de mars ne
seront pas complètement sans lendemain. En effet, à la première réunion de la
Chambre, après les vacances de Pâques, le gouvernement annoncera un programme
de travaux publics pour 100 millions. Palliatif certes, mais qui témoigne d'un
certain changement d'attitude envers le capital humain. Changement aussi dans
l'orientation de la pensée politique: pour la première fois, en haut lieu, on
semble craindre que la seule « liberté » des théoriciens ne suffise pas pour
assurer le bien-être et le bonheur à la nation, car, par la bouche du roi, le
gouvernement annonce, avec un certain regret qui perce: « on a peut-être trop
compté sur l'effet des principes, d'ailleurs si féconds, de liberté ». Et
encore : « Il est juste que la loi entoure d'une protection plus spéciale les
faibles et les malheureux ». On peut se demander combien de temps
encore il aurait fallu - n'eut été ce débordement de la rancœur des ouvriers - avant
que le gouvernement n'acceptât, en principe, de protéger les malheureux et les
faibles. Faibles, parce que sans instruction aucune, sans droit politique
aucun, n'ayant comme arme de défense que le droit de se réunir. Et
encore en 1886, ose-t-on parler à haute voix ? Discuter des conditions de travail ? Faire
connaître librement ses revendications ? Certes, la loi de 1886 abolissant le
délit de coalition avait conféré ces droits, en principe, comme elle conférait,
tacitement, le droit de grève. Mais dans la pratique ? - Jugez-en. De temps en temps, Nicolas revient à
l'aube, un lapin dissimulé sous son sarrau. Marie s'inquiète. Son fils n'a
jamais eu des goûts de braconnier. Du reste, avec quoi prend-il ses lapins ? On
ne le voit jamais bricoler aucun piège. Que se passe-t-il ? Un soir, Marie, habituée comme toute
mère de famille, à ne dormir que d'une oreille, perçoit le grincement d'une
porte. D'un saut, elle est hors du lit, Dans la mansarde des garçons, il y a une
place vide. – Nicolas ! Que peut-il faire ? Marie se
glisse dans la rue. Nuit d'encre. D'instinct, elle monte vers Fléron, se
dissimulant à l'ombre de la haute haie d'aubépine en bordure de la grand'route.
Par ces derniers froids de l'avant printemps, chaque bruit résonne sec, net,
comme le tintement d'une cloche. Les yeux s'habituant à l'obscurité, Marie distingue
d'autres ombres qui se glissent le long des haies. A main gauche, le Thier de
Jupille baille subitement dans la nuit. Faut-il s'y enfoncer, ou continuer sur
la grand'route ? Un instant, elle hésite. Mais voici, venant en sens contraire,
des pieds ! Le coeur de Marie fait un bond. Elle se cache la figure dans le « mouchoir
» qu'elle s'est jeté sur les épaules au saut du lit. « Mon Dieu! Ils ont bougé leurs sabots
pour ne pas faire du bruit. Ils se sont noirci la figure, mais ils n'ont pas
pensé à leurs pieds ». S'enfonçant le plus qu'elle peut dans la
haie, Marie regarde passer des pieds, et encore des pieds se suivant doucement,
seules taches claires dans la nuit. Elle a assez vu, elle a compris.
Rapidement, elle rentre. Mais jusqu'à l'aube, ses yeux resteront obstinément ouverts
à suivre cet étrange défilé. Le lendemain, André, sorti faire son
tour du village, elle confessera son aîné. Puisque la mère en sait déjà tant,
mieux vaudrait lui raconter ce qui se passe. Voilà, on se réunit dans le bois au pied
du Thier de Jupille. Il y fait si noir qu'on ne se reconnaît même pas entre
camarades. C'est fait exprès. Il y a des hommes qui prennent la parole. Ils viennent
de loin. Leur parler n'est pas de Liège, ni des environs. Cette nuit, il y en
avait un qui, sûrement, risquait gros. Il a fallu lui préparer un tonneau. Ah !
non ! pas comme tribune ! Mais pour qu'il s'y cachât. Pour qu'on ne puisse pas
le reconnaître, et pour lui changer la voix. Cependant, Marie a dans l'idée que les
ouvriers ont le droit de se réunir ? Nicolas hausse les épaules. C'est vrai qu'ils
en ont le droit. On le leur a encore répété cette nuit. Il y a vingt ans déjà
que ce n'est plus un crime. On ne peut pas les mettre en prison pour la cause.
Ils sont libres aussi de partir en grève. Mais voilà ! les patrons, eux, sont
libres de renvoyer sans recours tout homme qui use de ces droits. 
C'est pour cela qu'on se réunit en cachette,
la nuit, dans les bois; car si un homme se laisse prendre sur le fait, il est
sûr de son renvoi. C'est pour cela qu'il faut avoir son lapin en poche. Mieux
vaut être pris pour délit de braconnage que pour délit de complot. Marie ne dira rien au père. Elle
n'essayera même pas de retenir son fils. Mais pendant Un mois, deux mois, ses
nuits ne seront que cauchemars où elle étouffe sous le poids des berlines, basculant
sur le terril, au lieu de scories, des pieds nus ensanglantés. Grèves. Ainsi, dans presque tout le pays, les
grévistes se soumettront pour la mi-avril. Pas dans la région liégeoise,
cependant. Dans ce pays de frondeurs on n'accepte pas facilement la défaite. On
le verra bien en d'autres occasions. Pendant un an encore c'est l'émeute
perlée! Il y aura des actes de sabotage, des commencements d'incendies, des
coups à la dynamite, - gestes spontanés, nés de la misère qui n'écoute pas
toujours les conseils de la résignation. Le hasard d'un déménagement ramène les
Dejardin de Fléron à Beyne-Heusay juste à temps pour aider à recevoir la gendarmerie. En effet, les autorités ayant eu vent
d'une manifestation ouvrière, la gendarmerie a reçu l'ordre de « protéger » le
charbonnage du Homvent. C'en est assez pour décider les houilleurs à ne pas
laisser pénétrer les « pandores » dans leur commune. Des barricades s'improvisent où des
tables de cuisine sont maintenues par des sacs remplis de terre. Elles
voisinent avec des charrues et des tonneaux, « empruntés » aux fermiers et aux cabaretiers,
avant qu'ils aient eu le temps de fermer leurs portes. Pour les enfants c'est du sport tout
trouvé. Les garçons ramassent des pierres, font le guet. De loin on entend
sonner les sabots des chevaux sur la route fatidique de Liège à
Aix-la-Chapelle. Lucie ne se laisse pas devancer par ses
frères. Maman n'a qu'à s'arranger pour « regarder » aux plus petits. Elle se
précipite dans la rue, car il lui faut être aux côtés de ceux qui se battent.
Elle n'est point faite « de sucreries et de gentillesses » ; elle jettera des
pierres avec une satisfaction absolue : pan ! et pan ! et attrape que veux-tu
en voilà. Des femmes se mettent de la partie et parviennent à désarçonner un
gendarme, à lui arracher son sabre. Le lieutenant commandant la troupe décide de
retirer ses hommes. Victoire ! Les enfants jubilent, mais les hommes renforcent
leurs barricades. Dès le lendemain les pandores, trois
fois plus nombreux, reviennent pour « rétablir l'ordre ». Tout se paie. Bientôt
c'est le tribunal pour une dizaine d'hommes arrêtés à titre d'exemple. A
l'échelle de Lucie et des autres enfants arrêtés pour faits de grève, le
tribunal sera le garde champêtre. Et les accusés en seront quittes pour une
semonce ... magistrale de la part de ce représentant de la loi. Mais Marie n'est pas au bout de ses
peines. Après les «meetings noirs» de Nicolas, les escapades de Lucie, c'est la
santé de Joseph qui va l'inquiéter. A la suite d'une maladie grave, dont
Lucie comme les autres enfants ignorera le nom, Joseph ira travailler « au
maçon ». La mère ne veut pas qu'il redescende, de suite, dans ce fond qu'elle
craint par-dessus toute chose. Un jour on reçoit la visite d'un
étranger. Escorté de l'inévitable bande de gosses, il frappe à la porte des
Dejardin, à Beyne « podri lès rouwales ». C'est un Bruxellois, propagandiste du
syndicat des maçons. Il a entendu parler de Joseph par d'autres Bruxellois. Des
maçons travaillant à Liège, qui retournent chez eux le samedi chercher leur
linge propre, leurs provisions de la semaine. Le Bruxellois voudrait affilier
Joseph à son syndicat. Peine perdue. Il se heurte à l'obscurantisme
du père, qui en est encore à croire à la liberté individuelle du travailleur,
et ne veut rien savoir du syndicalisme ; au refus net de Joseph, qui compte
rentrer le plus tôt possible près des gueules noires. De fait, il y est si bien rentré qu'à
partir de seize ans il prendra part à la série de grèves qui vont se succéder aux
charbonnages du plateau de Herve de 1890 à 1900 : part, que l'histoire
syndicaliste dira même prépondérante. Mais l'histoire syndicaliste, comme
l'histoire tout court, ne s'intéressera qu'au rôle actif de l'homme, sans
égards pour la répercussion des actes du jeune syndicaliste sur sa mère, sur
ses frères et sœurs. Cependant, pour toutes les mères de famille ouvrières, les
années des premières luttes syndicales furent des années effroyablement noires.
Des années où la mort frappa à leurs portes, leur ravissant leurs enfants. Des
années où la faim vint les narguer, leur chuchoter des conseils de défaitisme. Tenez... C'est un matin de décembre.
Tout est silencieux. grave, ramassé. On dirait que gens et choses attendent un
coup dur. Le ciel est déjà lourd de neige qui ne tombera qu'avec la nuit. Personne sur les terrils. Pas la peine
d'y monter, puisqu'on les a retournés, raclés, grattés, tant qu'il y avait un
fragment de houille à ramasser. Personne
sur la grand-route. Chacun reste chez soi à se chauffer comme il peut : au
souvenir des temps meilleurs quand on gagnait 4 francs et qu'il fallait moins
pour vivre. L'heure passe et les enfants vont
rentrer à l'école. Qu'est-ce que Marie va pouvoir leur donner à manger ? Ses
armoires sont vidées, nettoyées. Vidé aussi son jardin : la terre retournée et
encore retournée pour dénicher les derniers rejets de pommes de terre. Marie a
fait de la soupe avec tout ce qui pouvait se cuire, épinards montés, trognons
de choux, déchets que l'on donnait aux cochons en des temps plus heureux. Tant
qu'il y avait une racine, une herbe au jardin, elle s'est arrangée pour tromper
la faim des enfants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. La terre entre dans
son sommeil d'hiver, et pour la première fois, Marie s'en prend à vouloir en
faire autant. Que faire pour ne pas voir les yeux des
enfants quand ils sauront que cette fois-ci la mère n'a rien à leur donner,
rien, mais absolument rien! Marie se secoue. Elle ira essayer de se
faire donner quelques pommes de terre à crédit dans l'une des grosses fermes. Sans
doute qu'on ne lui refusera pas cela. Les fermières la connaissent bien. Mais si qu'on le lui refusera,
parfaitement! Trop de mères de famille l'ont devancée, trop de femmes moins
fières qu'elle. Marie payera son indépendance le prix d'un premier, d'un second
refus. Mais maintenant la rage s'empare d'elle. Elle ne rentrera pas les mains
vides s'il lui faut aller jusqu'en Hollande! Elle marche courbée sous le vent
froid, humide, qui la déshabille, la fouaille jusqu'à la moelle. D'où lui
viendra le secours pour que ses enfants n'aient pas à geindre de faim?
Certainement pas des quelques hommes qu'elle croise sur les chemins des charbonnages.
Ce sont des piquets de grève. Ils risquent gros puisqu’à tout moment ils
peuvent se faire ramasser par la gendarmerie. N'importe. Ils font leur service,
les joues creusées, le dos courbé par la faim. Les enfants sont sortis de l'école,
criant leur joie, comme d'habitude, ou moment où ils retrouvent la liberté.
Mais depuis quelques jours déjà le silence aussitôt les happe. Ils ne courent plus,
ils traînent le long des haies, que leurs yeux avides fouillent de branche en
branche. Ce n'est point par jeu, mais par instinct de conservation qu'ils
disputent aux oiseaux les dernières baies des églantines et des aubépines. Et maintenant que les voilà rentrés, ils
ne savent que penser. Pas de maman ? Dans l'esprit de l'enfant la maman c'est «
la femme qui fait à manger ». Où est-elle donc ? Pas de casserole qui ronronne,
pas même du feu. Joseph se doute que si la mère est
sortie c'est qu'il y a catastrophe. Et pourtant il faudrait que les enfants
mangent. S'il n'y avait que les grands on se serrerait encore la ceinture. Mais
il faut faire quelque chose pour cette Jeannette qui, selon son habitude, hurle
plutôt qu'elle ne pleure, pour le petit André qui fait peine à voir. Plus blanc
que la mort un sanglot étouffé le secoue, sorte de hoquet qui fait peur. Joseph
compte. C'est l'avant dernier dimanche qu'on a eu des pommes de terre aux
crêtons. Depuis, on a eu de la soupe à midi, avec un morceau de pain gros comme
deux doigts. Il y a donc neuf jours qu'on mange comme cela. Une idée géniale le projette hors de la
cuisine. Oui ! il ne s'est pas trompé. Dans le
«carihou» derrière la maison il déniche un restant de farine grise qu'on
mélangeait aux « pèlotes » quand il y avait encore un cochon à
l'engraissage. Triomphalement il revient, une poignée de brindilles d'une main,
une tasse de « farine » de l'autre. Avec de l'eau, voilà de quoi faire une
«bouquette » ! A cela près qu'il n'y a pas une miette
de graisse dans la maison. La pauvre « bouquette » va dégénérer en une affreuse
bouillie. Mais les enfants pourront rentrer à l'école réconfortés. Au moins ne
se sentent-ils pas abandonnés de tous. 
Gagne-pain. Grèves, lock-outs, manifestations
de houilleurs, démonstrations des forces dites de l'ordre, faim à l'état
endémique : toile de fond de l'enfance ouvrière. C'est dans ces conditions que Lucie
s'essayera de nouveau comme gagne-pain. Entre deux grèves elle se fera embaucher
au charbonnage du Homvent. Mais il ne lui sera pas donné de voir cette chose mystérieuse,
l'aimant de son enfance : le fond de la mine. Non pas qu'aucune loi lui en
défendit l'accès[7];
c'est la mère qui ne veut pas qu'elle descende. Elle sait trop bien à quoi
s'exposent les jeunes filles qui acceptent le travail du fond. A treize
ans Lucie sera donc hiercheuse de la surface. Comme les autres gamines de son âge elle
apprendra à pousser, douze heures durant, sa berlaine remplie de scories et de
pierres. Elle apprendra à s'arc-bouter, hissant de son corps le pivot à
basculer la charge sur le terril. Parfois, les muscles se refusent à la manœuvre.
Il faut bien appeler le chef porion à la rescousse. On n'aime pas cela. Il a
une façon de vous inviter à descendre visiter les tailles ... Le pis de
l'histoire c'est qu'on voudrait bien y aller ! Non pas, certes, pour le chef
porion, mais pour voir une bonne fois toutes ces choses qu'on a entendu
raconter depuis qu'on se cachait sous la table, le dimanche, entre les pieds
des mineurs. Avec d'autres gamines, des gamins aussi,
Lucie apprendra le lavage et le triage du charbon. On pourrait supposer qu'à ce
travail les muscles connaîtraient une certaine trêve, que les reins du moins
jouiraient d'une détente. Il n'en est rien. Car la ceinture roulante qui amène
le charbon est placée trop bas pour que les trieuses puissent se tenir
carrément debout. On dirait un fait exprès, pour qu'elles soient obligées de
courber le dos au travail. Il n'y a qu'au point d'amenage du charbon qu'on échappe
à ce surcroît de fatigue, la ceinture étant, à ce seul endroit à hauteur
d'homme. On ne se dispute guère la place cependant. Car il faut se garer des
jets d'eau qui giclent subitement, vous inondant de boue. Et sans cesse l'eau
noire déborde, dégoulinant dans les sabots, les jupes des trieuses. Le soir
Marie, comme toute femme de mineur, devra savonner le dos de son homme, de ses
enfants, quand ils rentrent avec la poussière du charbon qui, soudée par la
transpiration, leur colle à la peau. Et après le lavage des corps, il faudra
lessiver les vêtements de travail. La direction des mines, en effet, exige
que les houilleurs se présentent au travail les vêtements frais lavés tous les
jours. Et les femmes acceptent sans broncher cette corvée quotidienne. Faut-il
plus admirer leur courage au travail ou déplorer leur résignation ? Songez au cas de Marie Dejardin, et
comptez les « chemins d'eau » qu'il lui faudra faire, elle et ses filles
tous les jours. En plus d'André, Marie a son frère et
deux petits parents à ses charges. Avec les trois enfants, cela lui fait six « jeux
» de vêtements à laver : six séries de chemises, de pantalons, de mouchoirs pour
le cou et pour la tête, sous le chapeau de cuir bouilli, sans compter les
effets de la gamine. Lucie aidera sa mère, naturellement :
loi universelle du cumul pour les femmes. Que la femme ait travaillé toute la journée
à leurs côtés, cela n'impressionne guère les hommes. Une fois la journée finie,
elle recommence - pour les femmes. Les hommes, seuls, ont droit au repos. Ils
fréquentent les réunions des syndicats qui se développent malgré les mises à
pied, les lock-outs. Ils peuvent lire le journal, « regarder aux pigeons » pour
le concours du dimanche. Quelques-uns coupent du bois pour le feu du lendemain.
Mais en principe tout ce qui se fait dans un ménage c'est du travail de femme,
et la dignité de l'homme n'a cure de la fatigue de la femme. Jamais ils ne « feraient
» leurs chaussures par exemple. Ainsi dans le ménage Dejardin six paires
de sabots et de bottes d'homme attendent tous les soirs qu'une main de femme vienne
les décrasser. Lucie commence à se révolter contre l'égoïsme masculin : un beau
jour elle fera grève sur le tas! Mais les frères ont la main leste.
Sabots et bottes volent à travers la cour, pleuvent sur le jardin où elle s'est
réfugiée. La maman donnera raison aux garçons,
naturellement. Pour avoir la paix, d'abord. Mais surtout parce qu'elle est
respectueuse de ce qui s'est toujours fait - parce que cela s'est toujours fait
- comme la plupart des femmes. Il
faut bien s'incliner, en apparence du moins. Mais dès ce moment Lucie commencera à se
révolter contre la vie où elle découvre injustice sur injustice. Elle
s'esquivera de la maison paternelle aussi souvent qu'elle le pourra, et se mettra
à musarder par les chemins de cette campagne vallonnée, à en scruter le profil
avec l'intensité de son regard d'adolescente. C'est pourquoi, cinquante ans
plus tard, en exil, elle aura toujours la nostalgie du plateau de Herve avec
ses terrils : Croix-Rouge, Homvent, Quatre-Jean, Hasard, la Minerie. Et le plus
bel horizon lui semblera manquer de vie si elle n'y découvre une de ces
pyramides noires si chères à ses yeux. Pendant ce temps Joseph continue sa
propagande syndicale. Bientôt il est noté dans tous les charbonnages aux
alentours. Bien noté, ou mal noté, c'est selon votre point de vue. Les patrons
se le signalent comme un homme trop indépendant; comme un meneur qu'il ne fait
pas bon avoir parmi ses ouvriers. Partout où il passe, en effet, il s'efforce d'organiser
ses camarades de travail, tout jeune qu'il est. Les grilles des charbonnages se
ferment devant lui, les unes après les antres, et il devra se résigner à n'être
plus mineur. Le métier, cependant, il l'avait dans le sang. Et jusqu'à sa mort
les mineurs et leurs problèmes seront sa préoccupation constante. Le jour viendra où Joseph sera invité,
non seulement par les ouvriers mais aussi par les patrons houilleurs, à
arbitrer un conflit de travail. Beau témoignage de probité et d'objectivité ! Mais nous sommes loin de l'arbitrage de
1920. Nous sommes en 1889 et il faut vivre. Joseph se fera porteur de journaux.
Voyageant dans les corons le sac sur l'épaule, il distribue « le Populaire » -
premier journal socialiste de la région et qui se vend 2 centimes. Il va de
charbonnage en charbonnage, guettant les hommes à la relève, faisant sa
propagande syndicaliste sous le couvert de son commerce de journaux jusqu'au
jour où, fatalement, il se fait arrêter comme fomenteur de troubles. Lucie
est au travail sur le carré de la mine quand on vient lui dire que son frère
est emmené par les gendarmes. Sautant sur un tas de houille elle explose en un
maiden speech torrentiel. Les paroles qui se précipitent de sa bouche fine mais
décidée n'ont rien de parlementaire ; leur franc wallon est émaillé d'expressions
qu'il est d'usage de représenter par ... ! Et les grèves de se poursuivre. Les familles font leur bilan. Où en est-on chez les Dejardin ? Quant à toi Joseph, inutile de te
présenter à nouveau. Pour toi c'est bien fini le travail de mineur ! Toi André, le père, tu peux rentrer.
Avec ta santé minée par les années de labeur au fond de la mine, minée une
deuxième fois par l'alcool qu'on te pousse, les jours de paie ou à crédit. Toi,
on veut bien accepter que tu finisses ta vie dans la bure. Toi Nicolas tu peux rentrer aussi. Fort,
et fier de ta force, tu es toujours prêt à faire la double pause du dimanche,
travaillant tes 18 heures d'affilée. Toi tu ne boiras pas. L'exemple du père te
suffit. La mine t'a pris tout espoir de fonder une famille. Car avec ta joue brûlée
par un coup de grisou, tu n'oseras jamais regarder aucune jeune fille. Et alors « noss Lucèye »,
que va-t-elle faire? Blanche comme de la cire, maigre comme
la lame d'un couteau elle ira travailler à la ferme. Elle sait que là elle pourra
du moins manger à sa faim. De la « trûlêye », du pain gris et de la
« frisse makêye » à volonté, de la salade aux « crêtons ».
Et quand on tue un cochon la « drèssèye » circulera : l'immense assiette
où, selon l'usage, toutes les variétés de boudin alternent avec de la tête
pressée, les pieds, les oreilles, la queue ! Quand on l'envoie seule dans les
prairies étendre, à la grande fourche, de la bouse de vache Lucie retrouve ses
huit ans. Elle s'attarde à écouter les premiers chants des oiseaux, à sentir
fumer la terre sous le soleil du renouveau. De temps en temps Joseph passe avec son
paquet de journaux, et Lucie de se précipiter à la barrière pour savoir les
nouvelles. Elle court chercher ses deux cens, et à la soirée elle lira « le
Populaire » au fermier ahuri. Les nuages courent sur les blés
mûrissants, et voici le mois d'août. Il fait chaud. Les paysans sont aux champs,
en plein travail. Les récoltes ne sont pas trop mauvaises, mais rien ne fera
dire au fermier qu'elles sont bonnes. Neuf heures sonnent à l'église de Romsée.
Au faîte du clocher un point lumineux scintille : le coq de bronze, doré par
les rayons du soleil. C'est l'heure du casse-croûte; la fermière s'amène, le
joug aux épaules. A droite pend un grand panier de tartines beurrées et de
fruits, à gauche une cruche d'eau. Ainsi elle a les mains libres pour porter la
grande « coquemare » de café au lait. Dans son bras gauche, elle
serre un jeu de bols. Elle appelle son monde autour d'elle. On n'est pas fâché
de se reposer un brin; de boire un bon coup d'eau surtout. Tous boivent au même
verre : les vieux d'abord, les jeunes après. 
Un an, deux ans Lucie restera à la
ferme. Le temps de se refaire la santé. Puis le rythme lent du travail paysan
commence à l'énerver. Esprit vif et sociable il lui faut le coude-à-coude du carré
de la mine, le tic-au-tac de l'atelier. Les pluies de novembre finissent de la
dégoûter de la campagne. On demande des ouvrières à Chénée,
chez Amiable et Baiwir. Les quelques mois que Lucie vivra le
drame d'une verrerie lui seront singulièrement éducatifs. Elle y apprendra que
de l'effort des hommes peut naître de la beauté. Elle est en admiration devant
le travail patient, adroit, des guillocheurs, l'art mystérieux du souffleur qui
tire d'une bouillie en ébullition des formes aussi diverses. Admirables ces
chevaux aux pelages bariolés, ces presse-papiers à la Napoléon ou aux algues
marines, ces coqs wallons belliqueux, ces fleurets fragiles, ces scènes de rue en
miniature : la charrette à légumes avec ses carottes roses, le livreur de
brasserie avec sa voiture à quatre chevaux, haut chargée de barillots. Il y a
de quoi émerveiller ses quinze ans ! Mais le revers de la médaille ne lui
échappe pas. Son admiration pour l'habileté des souffleurs se double
d'indignation devant la misère de leurs apprentis qu'ils brutalisent. Comme si la
chaleur d'enfer à laquelle sont exposés ces enfants ne suffisait pas à leur
peine. Le travail des ouvrières - l'examen des
verres pour défauts éventuels - ne demande qu'une certaine rapidité de
manipulation, de précision visuelle. Et réviser des verres à bourgogne en série
n'est guère plus passionnant que de trier du charbon, ou de ramasser des pommes
de terre. Lucie cherchera dans la lecture un palliatif à son ennui. Au repos de
midi elle dévore les premières brochures « Germinal » que Joseph distribue avec
ses journaux, et, s'aidant de force gestes, les « explique » à ses camarades
d'atelier. Le dimanche, comme tout Beynois qui se
respecte, elle descend en ville avec ses frères, faire le tour traditionnel de
la Batte. Après, aux jours de grande opulence, on se paie un pied de mouton -
on en a trois pour cinq centimes - qu'on mange, debout, s'abritant contre le
volet de l'échoppe, non loin de la vieille halle. Mais, ce qui les attire, surtout, sur la
Batte, elle et Joseph, ce sont les étalages de bouquins crasseux, de partitions
démodées. Ils y dénichent des trésors : des fragments des romans-fleuves d'Alexandre
Dumas; la légende des Quatre Fils Aymon qui les initie au folklore du terroir.
Sous les espèces d'une brochure écornée flairant le tabac français, l'évangile
de fraternité internationale des St. Simoniens leur est révélé. Ils en vibrent
d'enthousiasme. Non pas qu'ils redoutent la guerre. Une telle éventualité
n'effleure pas l'imagination des jeunes gens de 1890. Mais, si tous les
ouvriers pouvaient se donner la main par-dessus les frontières! Cela changerait
bien des choses !... Le soir, quand la mère les croit
endormis, les frères sont dans la mansarde de Lucie, couvant la bougie qu'ils
ont achetée en se cotisant. A sa flamme vacillante ils déchiffrent les
trouvailles de la Batte, produit de quelques cens qu'ils ont subtilisés de leur
paie. Ah ! si la mère s'en doutait, il y aurait line belle « margaye » ! Lucie se souviendra toujours d'un
certain petit volume relié cuir, aux coins fatigués, qu'elle marchanda,
victorieusement un dimanche de fraîche giboulée : « Les Aventures de Télémaque ».
Ça doit être quelque chose dans le genre des « Trois Mousquetaires ». Pour rien
au monde elle n'avouera sa déconvenue à ses frères. Elle lira jusqu'au bout les
péripéties de Télémaque et de Mentor, et finira par ne pas regretter ses 60
centimes. Source imprévue d'inspiration socialiste
que le chef d'œuvre de l'évêque de Meaux! Mais Fénelon, n'était-il pas
internationaliste et démocrate à sa façon, lui qui « voyait le genre humain
comme un tout indivisible » ; qui avait sa vision d'une société « où tout le
monde travaille et personne ne songe à s'enrichir » ; où on construit des
maisons « propres, riantes et commodes pour une famille nombreuse » ? Lucie ne gardera pas ses lectures
pour elle. Propagandiste née, quelque chose la pousse à partager chaque
miette de connaissance qu'elle acquiert. D'instinct elle voudrait éveiller chez
les ouvrières de la verrerie le même esprit de révolte qui la travaille. Elle y
parviendra suffisamment pour attirer l'attention de la direction, pas assez
pour bénéficier d'un sursaut de solidarité de la part de ses collègues femmes
ou hommes. Elle réussit à se faire réembaucher au
Homvent, y reste quelques années, juste assez pour que la bronchite des mineurs
devienne l'hôte attendu de ses futurs hivers. Pas plus au charbonnage qu'à la verrerie
elle ne saura se taire. On ne la renvoie pas ouvertement, mais devant les
menaces, le silence qu'on veut lui imposer comme prix de son emploi, elle préfère
prendre la porte. Elle trouve à s'engager dans une
blanchisserie de Grivegnée, au pied du Thier de Vette Houmeresse. Mais
le métier de lessiveuse, au temps où tout se lave à la main, va franchement la
répugner. Elle se fait traiter de « grandiveûze » par ses camarades de
travail parce qu'elle évite de toucher le linge sale et préfère le harponner
avec « un bois ». Le repassage par contre, l'attire, par sa propreté
absolue, le soigné du travail. Et, chose paradoxale, au lieu de l'énerver, son
tempérament fougueux se calme au vernissage des faux-cols et des plastrons, au
plissage des dentelles. Lucie a enfin trouvé le métier qui lui
convient. Elle sera repasseuse de fin. C'est à ce moment que commencera son
développement intellectuel par la voie de «la dramatique ». Enfant,
adolescente, elle avait joué de temps en temps dans quelques saynètes wallonnes
montées par un régisseur improvisé de Beyne ou de Fléron. Jeune ouvrière
penchée sur ses fers à repasser, les premiers cercles dramatiques vont
l'enthousiasmer; elle prêtera volontiers son concours au fur et à mesure qu'ils
se développeront. Le temps d'apprendre ses rôles ? Mais, en chemin. Ah ! pas le matin, par
exemple ! Pour Lucie il est toujours trop tôt pour se mettre en route. Mais le soir,
en remontant le Thier de Vette Houmeresse elle lira la pièce à l'étude, la
relira dans sa mansarde une fois les corvées ménagères finies. Et dans le calme
relatif de la petite salle de repassage elle répétera, répétera, repassant ses
rôles en même temps que son linge. Enfin, à la plus grande joie de ses
collègues et de sa patronne, elle fera entendre, à travers la buée du linge
fumant sous les fers, les accents pathétiques de « Marie-Jeanne, ou la
Femme du Peuple », de la « Porteuse
de Pain » ou de « Fantine ». 
A cette époque elle ne sait pas
s'exprimer en français, quoique le lisant, le déclamant. Sur les conseils
avisés de Donat Wagener, son premier régisseur au Cercle Germinal à Ougrée, elle
abandonne complètement le wallon et ne jouera plus qu'en français. C'est encore
Donat Vagener qui lui apprendra à se tenir, à se mouvoir en scène. Pour ses
débuts il lui apprendra le rôle de Lucrèce Borgia ! Sa faculté de
concentration, l'instinct qui la pousse à se donner de façon absolue à
l'activité du moment, le sens inné de la valeur émotive à donner à ses rôles
lui en assureront le succès. Ainsi, grâce à sa passion pour le
théâtre les 20 années de « ristindèdge » lui paraîtront moins monotones.
Vivant la vie de ses personnages son horizon mental dépassera singulièrement son
horizon matériel. Bien entendu la «dramatique» ne suffira
pas à meubler les loisirs de Lucie. Comme tous ceux qui ont « percé » dans la classe
ouvrière, ses soirées se prolongeront en de multiples activités, et aucun
groupement du jeune Parti Ouvrier ne lui sera étranger. Elle est membre ardent
des cercles de gymnastique comme de ceux de l'Education et de la Libre Pensée. Amie joyeuse des enfants, c'est vers eux
que se portera sa sollicitude. Pour soustraire ceux de sa commune à l'emprise cléricale
des patronages, elle les groupe en « Cercle des Enfants du Peuple » de Beyne,
s'improvise maître de ballet, régisseur, adaptant des chansons, écrivant de
naïves piécettes à leur intention. A la Noël, à la Mi-carême, à
l'Assomption, elle « produira » ses enfants, et les bénéfices de ces « concerts
» lui permettront de conduire les petits Beynois à Liège, où ils fraterniseront
avec les enfants des autres communes aux fêtes rationalistes qu'organise « Mayanne
» pour remplacer le banquet de première communion. « Mayanne » ? Encore une pionnière des temps héroïques
du socialisme liégeois. Venue de la région de Verviers au moment de la création
de « La Populaire », au Potay, Marianne Wasson est une des premières
coopératrices liégeoises. Membre enthousiaste des cercles dramatiques, elle
joue, comme Lucie, dans ces pièces à thèse sociale qui maudissent la misère et
clament la révolte. D'une voix claire et vibrante elle chante avec ferveur ces
chants révolutionnaires qui scandaient la marche des premiers grands cortèges
socialistes. Elle était de toutes les manifestations, comme l'était le groupe
de femmes de Beyne-Heusay « La Plébéienne », arborant fièrement leur fanion,
avec les porte-drapeaux de Seraing, de St. Gilles, de St. Nicolas, toutes
habillées de rouge. La « tenue » de ces femmes laissait-elle
à désirer ? Les manifestantes étaient-elles quelque peu débraillées, violentes ? Mais comment auraient-elles pu être
autrement que leurs frères de misère ? Et à l'adolescente qu'était Lucie elles
semblaient belles et nobles, ces femmes qui ne reculaient pas devant les
dangers que courait alors quiconque osait réclamer plus de justice, plus de
liberté ! Si les premières manifestations
ouvrières pour le Suffrage Universel ont embrasé l'imagination de Lucie
adolescente, le Congrès de Quaregnon, avec sa promesse tacite d'émancipation de
la femme liera, en un élan de foi et d'espoir, l'enthousiasme de ses vingt ans
aux destinées du P. O. B. Cependant il se passera bien des années
encore avant que Lucie n'ose tenter d'organiser les femmes. Enfin, après avoir entendu
les pionnières de l'éducation de la femme telles Gatty de Gammont, Brismée,
Alice Bron, elle créera, en 1910, la première Ligue de Femmes Socialistes de
Liège. Avec « Mayanne » elles sont huit membres au début, mais leur
enthousiasme est contagieux; dans les communes environnantes d'autres Ligues se
créent. Chez les hommes, dans les conciliabules du Parti, on commence à
discuter l'organisation des femmes. Faut-il une Fédération Nationale Féminine,
ou bien les femmes doivent-elles faire partie des Ligues Ouvrières aux côtés
des hommes ? Enfin, événement marqué d'une pierre
blanche, en 1912, le Conseil Général invite les femmes à envoyer leurs
déléguées à Bruxelles. Elles tiennent deux réunions à la Maison du Peuple, sous
la présidence de Vandermissen, secrétaire du Conseil Général : les citoyennes
Pirson-Lothier, Alice Heyman, Maria Tillemans; Lucie Dejardin et Marianne
Wasson pour Liège, d'autres encore. Il en résulte que les femmes sont admises à
être membres du Parti en payant le quart de la cotisation des hommes - ceux-ci
payaient alors 2 francs par an ! « Nous étions heureuses » dira Lucie, «
nous allions pouvoir travailler, créer nos fédérations. A Liège, le comité
fédéral était prêt à nous aider. François Van Belle étudiait les bases de notre
organisation. Puis vint 1914 et ce fut l'arrêt net, brutal de tout développement
social. » La Dame Blanche. Quelques années avant d'entrer comme
vendeuse au premier magasin coopératif de Liège, où la guerre viendra la surprendre
en 1914, Lucie se décide à abandonner son métier de repasseuse pour celui de
voyageur de commerce. Adversaire acharnée de l'alcool, c'est
cependant une maison de tabacs et liqueurs qu'elle représentera. Ses
adversaires politiques ne manqueront pas de le rappeler et d'en faire des
gorges chaudes en 1932 quant, à la Chambre, elle criera son horreur de
l'alcool. - Pourquoi cette contradiction
illogique? C'est bien simple. L'emploi de voyageur
lui permettra de multiplier les quelques gâteries par lesquelles elle trompe sa
tristesse de voir s'en aller son frère cadet, atteint de tuberculose. Circulant avec ses échantillons de Liège
à Oupeye, de Seraing à Visé, en vélo ou en vicinal, elle apprendra à connaître à
fond les environs de Liège. Ses tournées la conduiront dans le Namurois, dans
le Limbourg jusqu'à la frontière hollandaise. Ce sera une préparation admirable
pour ce que l'avenir lui réserve. En effet, dès le début de la première
guerre mondiale Lucie Dejardin est prise dans l'engrenage d'un service de
renseignements, entraînée par la fatalité, comme la plupart de ceux qui prennent
du service, sans avoir jamais pensé à faire un acte de patriotisme. Pour elle la fatalité se présente sous
les espèces de Joseph, alors bourgmestre ff. de Beyne-Heusay, qui, au lendemain
de l'invasion lui demande de passer certain document en Hollande. Il lui semble
qu'une femme a plus de chance de réussir qu'un homme. Alors quoi de plus
naturel que de venir trouver sa sœur ? Le document de Joseph est du genre de
ceux qui condamnent leur porteur à mort s'il se laisse prendre. Lucie aime
mieux risquer le coup que de décevoir son frère. De ce premier voyage à
Maestricht elle rapportera le goût de l'aventure, et un sentiment de
satisfaction d'avoir fait quelque chose contre le boche. C'est pourquoi elle
n'hésitera pas à s'inscrire dans les cadres du « Mot du Soldat », dont la
mission est d'assurer la liaison entre les soldats au front et leurs parents en
Belgique occupée. Les Allemands tolèrent à moitié cet organisme. S'ils arrêtent
l'un ou l'autre porteur de lettres, la condamnation est anodine, et se limite à
quelques mois de détention. Mais sous le couvert du « Mot du Soldat» il y a «
la Dame Blanche » et ses agents, dont bientôt Lucie, faisant discrètement leur
service. La consigne est évidemment le mutisme le plus complet. Les agents
doivent s'ignorer mutuellement. Malheureusement, il ne se passe pas
longtemps avant que Lucie ne se sente surveillée. Elle se doute qu'elle est
dénoncée par une collègue, mais continue son service, se contentant de changer
de domicile de Liège à Bressoux. Il arrivera ce qui devait arriver. Le 8 juillet 1915 elle est arrêtée à
Vronhoven à la frontière hollandaise et incarcérée à la prison de Tongres. Les
Allemands l'interrogent de jour et de nuit, ayant déjà commencé le système qu'ils
devaient perfectionner au .cours de la dernière guerre. Sa seule distraction
c'est la messe ! qui lui permet de voir ses co-détenus, si même elle ne peut
pas leur parler. Certain petit livre, « Elévations » de M. l'Abbé Vignon, lui
sera d'un précieux réconfort. Non pas à cause des sentiments pieux de l'auteur
mais parce qu'une marge, voire une page blanche lui fournit de quoi écrire. De
temps à autre elle réussit à glisser un message à une voisine sous le couvert
d'un livre de messe. Une semaine après son arrestation elle craint de perdre la
notion du temps. Au verso du chapitre « De Profundis » de l'excellent abbé elle
note jours et dates au moyen d'une épingle. Accusée non seulement d'avoir facilité
l'évasion en Hollande d'un nombre incroyable de jeunes gens et de militaires - 4.000
d'après l'acte d'accusation - mais d'avoir fait de l'espionnage, Lucie sait
qu'elle joue sa tête pendant les trois mois que durera son procès. Faute de
preuves, et aussi parce que Joseph intéressera l'avocat Haas, du parti
socialiste allemand, en sa faveur, elle ne sera condamnée qu'à la détention
perpétuelle. Mais les Allemands pousseront le sadisme jusqu'à lui faire croire
qu'elle est condamnée à mort et l'obligeront à écouter fusiller quatre de ses
compatriotes. Quand elle croit son tour venu, elle est amenée à la
prison-forteresse d'Aix-la-Chapelle. 
Elle va, s'y morfondre, au secret, ne voyant
que sa geôlière et le médecin de la prison, seul allemand en qui Lucie
reconnaît des sentiments humanitaires. De fait, en lui faisant absorber une
drogue irritante, il parvint à lui faire cracher du sang, puis s'empressant de
la déclarer tuberculeuse, il insiste pour qu'elle soit transférée dans un camp. Lucie arrive au camp d'Holzminden en
janvier 1916. Là du moins elle aura de l'air, et sa nature expansive n'aura
plus à souffrir de l'affreuse solitude d'Aix-la-Chapelle. Si les camps de la première Guerre
Mondiale étaient des sanas par rapport à ceux de la deuxième, il faut croire
qu'ils présentaient néanmoins certains inconvénients. Surtout quand on y
débarquait avec la mention « dangereuse pour l'armée allemande » comme ce fut
le cas pour Lucie. Sans cela pourquoi cette épidémie d'évasion parmi les
prisonniers dès le printemps ? Après d'autres, dont elle facilitera
l'évasion, Lucie tentera l'aventure mais se fait prendre à la frontière même.
Assommée à coups de crosse, elle est ramenée au camp et envoyée au cachot, puis
transférée dans une baraque où il n'y a que des Alsaciennes de langue
allemande, afin de l'isoler de ses amis. A trois reprises elle passera en
Conseil de Guerre. Les Allemands veulent l'obliger à dénoncer ceux qui lui ont
fourni le matériel d'évasion : l'argent allemand, les vêtements de civils, le
plan de la frontière germano-hollandaise. Les Allemands ne pourront pas la faire
parler, pas plus qu'ils ne pourront la faire travailler. De fait elle est l'âme de la résistance
des 23 femmes belges qui s'obstinent dans leur attitude de non-coopération :
travailler pour les boches ce serait travailler contre son pays. Elles connaissent les souffrances de la
faim, car les colis de la Croix-Rouge sont supprimés ; du froid, car
couvertures et vêtements chauds sont confisqués, et elles sont obligées de
stationner dans la neige, au garde à vous, pendant l'appel qu'on fera traîner
parfois plus de deux heures. Un jour, l'officier de service oblige
Lucie à marcher devant lui à travers tout le camp. C'est elle qui est
responsable de la résistance des femmes belges, et des représailles dont elles sont
victimes. Il veut la faire maudire des autres prisonnières. Lucie en profite
pour les exhorter à tenir bon et s'étonne de ce que, sur son passage, les
femmes pleurent, se tordent les mains dans le geste traditionnel de la pitié. Rentrée
dans sa baraque elle sent quelque chose de chaud qui lui coule dans le dos.
Alors, seulement, elle comprend la pitié des femmes. L'officier marchant
derrière elle lui avait littéralement lardé le dos avec la pointe de son épée.
Tout à son discours de résistance elle n'a rien senti au moment même. Si les plaies se ferment grâce aux soins
de ses compagnes d'infortune, grâce surtout à son extraordinaire vitalité, les
cicatrices en demeureront toujours témoins de cet acte de brutalité. Pendant le
restant de sa vie, il suffira que Lucie éprouve une grande fatigue pour que les
21 cicatrices se dessinent sur sa peau meurtrie, tels des stigmates. Fin décembre 1917, bénéficiant d'un
échange de prisonniers, elle est libre, et ramenée en France, sa santé
gravement minée par deux ans et demi de captivité. A Paris il est question de
lui faire obtenir une pension. Elle n'en veut rien savoir : qu'on lui donne le
moyen de travailler auprès des enfants et sa santé se remettra, déclare-t-elle.
Et la voici dans une colonie pour enfants belges à Conflans-Sainte-Honorine en
février 1918, puis à Ecouen où elle sera la maman de 58 garçonnets de Liège et
de Charleroi, envoyés en France pour y chercher un peu de santé. C'est là que l'Armistice
la trouvera. Quand
elle rentre à Liège, au mois de mars 1919, Lucie jouit de la popularité d'une
prisonnière politique qui a été très crâne en face de l'ennemi, mais la plupart
de ses compatriotes ignoreront toujours la vraie nature de ses activités[8]. En
effet, le plus communicatif des êtres, d'une franchise frisant l'indiscrétion en
ce qui concerne ses opinions personnelles, Lucie respectera de façon absolue
son serment d'agent de la Dame Blanche. Deux fois seulement elle
lèvera le voile de cette vie cachée, et encore faudra-t-il que ce soit dans
des moments de fatigue exceptionnelle. La première fois: un soir au coin du
feu, dans notre vieille maison qu'elle aimait tant. Après avoir donné une
conférence dans quelque Hout-si-Plout, elle finissait sa journée de dimanche en
lisant les journaux. Feuilletant une revue d'actualité où il était question de
la mort de Mata Hari, je lui demandais, presque sans penser à ce que je disais,
si elle n'avait jamais vu la célèbre espionne. Et sa voix, me répondant du fond
de ses journaux, l'esprit ailleurs : « Oui, je l'ai vue deux fois en Allemagne
». On aurait sursauté à moins. Comment, en
pleine guerre avait-elle osé pénétrer en Allemagne ? Ou bien à quel moment ces rencontres
avaient-elles eu lieu ? Mais Lucie, se ressaisissant, refusa
d'en dire davantage. La deuxième fois : à Londres, lors de la
seconde Guerre Mondiale. C'était à l'époque où l'D. R. S. S. était encore
l'alliée d’Hitler. Par une nuit de « Paniers Molotov », ces bombes remplies de
fusées vertes, rouges, oranges, blanches, qui glissaient doucement vers le sol
avec un effet d'arbre de Noël renversé et qui serait descendu du ciel toutes
bougies allumées. Les paniers Molotov servaient d'éclaireurs, à la deuxième
vague d'attaque : des milliers de bombes incendiaires que les volontaires de la
Défense Passive, femmes et hommes, s'efforçaient d'éteindre à l'instant de leur
chute. Les deux vagues étaient passées. Tout
était rentré dans le calme. Sauf... sauf en quelque huit points de l'immense arc
de Londres que nous apercevions de notre logement à Hampstead, et qui reposait,
à l'est sur les quartiers des docks, à l'ouest sur le quartier de Kilburn, en
passant par la cité, par le quartier aristocratique, les clubs, le Parlement,
le palais de Buckingham. En ces huit points flambaient d'immenses incendies,
que les efforts de la défense anti-incendiaire n'avaient su maîtriser à temps.
Et nous nous demandions quelles richesses encore se consumaient dans ces nuages
de fumée noirâtre, gris-clair, orange qui montaient dans le ciel rougeoyant. Oui, les avions avaient passé, et sans
doute que cette nuit de beauté et d'épouvante avait remué quelque autre terreur
dans le souvenir de Lucie. Tout à coup elle se mit à raconter comment deux
membres de son groupe, qui avaient « parlé », avaient été condamnés au
châtiment ultime. Une femme, qui avait refusé le bandeau avec lequel on voulait
lui couvrir les yeux, acceptant crânement la mort qu'elle savait méritée. Un
homme qui s'était débattu, pleurant, implorant sa grâce. On ne pouvait pas se
servir de révolvers, évidemment. Les hommes chargés de poignarder les coupables
étaient masqués. La mort était instantanée ; on le voulait ainsi même pour ces
traîtres. « Evidemment, je rompt mon serment en
parlant de tout cela. Mais il y a 25 ans déjà que cela s'est passé. Et nous
sommes à une autre guerre. Cela n'a plus d'importance » 1919. La Dame Blanche ne s'occupe guère de ses
anciens serviteurs. Il faut vivre. Lucie obtient une place d'Inspectrice
du Travail, au mois de mai 1919. Employée, en partie, à relever les prix
permettant d'établir l'Index Number, elle est tous les jours en route, faisant
consciencieusement les enquêtes qui s'imposent. Dans les usines de son rayon
elle a tôt fait de s'acquérir la confiance des ouvriers ; son travail
l'intéresse. Mais devoir dresser des rapports sur l'emploi de son temps
l'ennuie. Elle n'a décidément pas l'âme d'un fonctionnaire, ni le méthodisme.
D'ailleurs, elle ne se sent pas à l'aise, puisqu'il y a incompatibilité entre
le fonctionnarisme et la politique active. En effet, son nom ne pourra pas
figurer aux affiches des meetings où elle parlera pendant les élections
communales de 1919, ses articles devront être signés d'un nom d'emprunt. Cela
.n'empêchera pas ses concitoyens de l'élire au Conseil Communal de Liège, où
elle siégera jusqu'à la fin de ses jours. Aux élections législatives de 1921,
Lucie, en sa qualité de prisonnière politique de la guerre 1914-1918, est parmi
les quelques 9,300 femmes à qui est octroyé le droit de vote. Ce qui est
infiniment plus intéressant c'est que le P. O. B. voulant assurer son
éligibilité à la Chambre, propose une légère modification à l'Article 50 de la
Constitution[9]
: Le rapport des députés Troclet et Brunet à la commission des XXI dit : « ...
la femme peut-elle être appelée à siéger au Parlement ? Le cas ne s'étant
jamais présenté, la question est toujours restée dans le domaine théorique...
En vertu de la souveraineté populaire les électeurs doivent être libres de
choisir leurs représentants parmi les Belges, sans distinction ... un pays doit
pouvoir utiliser les qualités de cœur, d'intelligence et de dévouement à la
chose publique de tous ses enfants sans aucune exception ». La Fédération Liégeoise veut présenter
la candidature de Lucie en ordre utile au Poll. Mais elle n'a rien d'un
arriviste et refuse la place qui lui est offerte, de crainte de faire échec à
la candidature d'un vieux militant du Parti. Pour Lucie « le dévouement à la chose
publique » ne s'arrête pas aux frontières de son pays. Elle est
internationaliste par tempérament, peut-on dire, et pour elle l'idéal
socialiste se confond avec l'idéal de paix. « Je suis pacifiste parce que socialiste
» dira-t-elle volontiers. Pour elle l'ennemi c'est le militarisme où qu'il se
trouve. Elle tendra la main à quiconque partage son idéal de fraternité humaine. Au lendemain de l'Armistice elle
s'inscrira à la L.I.F.P.L.[10] mais
ne se contente pas d'un internationalisme de principe. Elle veut vivre son
idéal. C'est pourquoi, cette femme, qui a souffert dans sa chair de la
brutalité allemande, se préoccupe du sort des enfants dans les pays ex-ennemis,
victimes du blocus infligé par les alliés à l'Allemagne et à l'Autriche, et
prolongé « par raison d'état » deux années après l'Armistice. Avec d'autres Belges, Lucie organisera
une œuvre de secours, à plusieurs reprises elle fera le voyage Liège-Vienne ramenant
des colonnes d'enfants chétifs et rachitiques qui, dans un millier de foyers
liégeois viendront se réchauffer le cœur, se refaire la santé. Les Viennois ne
sont pas des ingrats. C'est pourquoi... mais transportez-vous à Vienne, un soir
de juillet 1921, au moment où la L.I.F.P.L. y tient ses assises sous la
présidence de Jane Addams, seule femme qui s'est vu attribuer le prix Nobel de
la Paix. L'immense
vaisseau de l'Opéra est archicomble. Aux
parterres, des femmes d'une vingtaine de pays, déléguées au Congrès de la
L.I.F.P.L. Des Viennois, venus là par invitation spéciale, remplissent le
restant de la salle, jusqu'à l'amphi. Ce sont des gens de condition modeste :
ouvriers, petits bourgeois, rentiers désargentés, avec leurs femmes et leurs
gosses. En attendant la cérémonie qui les a réunis ils goûtent la musique, la
lumière surtout, car ce soir la salle est éclairée comme elle ne l'avait plus été
depuis avant la guerre. Dans les coulisses en entend rire des
femmes. Dans une loge d'artiste des membres du comité de réception viennois,
une couturière, la bouche pleine d'épingles, s'affairent autour de Lucie. Il
s'agit de lui arranger, en hâte, une tenue de soirée, afin que cette fille de
mineur, prolétaire de naissance et de conviction, et qui n'a pas dans ses
bagages le moindre vestige de toilette bourgeoise, puisse paraître décemment
vêtue pour recevoir l'hommage de Vienne. En effet, Vienne la Rouge est traditionaliste
dans sa manière d'honorer des invités de marque. C'est à l'Opéra, aux côtés du
chef de l'Etat que ceux-ci seront présentés au public. Aussi, quand Lucie fera
son entrée dans la Loge Impériale, aux côtés du Président de la République,
c'est le délire. « Toute la salle se lève », écrira
Mary Kelsey, déléguée américaine « pour ovationner, comme jamais je n'ai vu
ovationner personne, cette femme qui incarne aux yeux des Viennois, qu'ils soient
de droite ou de gauche, le vrai esprit chrétien d'amour et de compassion, la
vraie solidarité humaine qu'aucune frontière n'arrête ». Dans son discours de remerciement aux
Viennois, Lucie, faut-il le dire, se défendra d'avoir rien inventé. Elle n'a
fait que suivre la ligne de son cher Parti, qui depuis qu'il existe a été
internationaliste et anti-militariste. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que
l'anti-militarisme du P. O. B., à ses débuts, consistait à protester contre «
l'infâme privilège du remplacement[11] »,
cette inégalité sociale qui permettait au riche d'esquiver son temps de service
par l'achat d'un remplaçant ; que sa fraternité internationale se limitait aux
congrès internationaux. Il a fallu la guerre de 1914-1918 et l'initiative d'une
femme pour que les principes de base se traduisent par un geste pratique autant
que désintéressé. Elue ce soir-là par acclamation au
Comité exécutif de la L.I.F.P.L., Lucie verra sa tâche de militante socialiste
se doubler de propagandiste de la paix. Entre les deux guerres elle
représentera les femmes socialistes belges à de nombreux congrès internationaux,
à Hambourg, à Marseille, à Paris, à Zurich, à Prague, à Vienne et, pour la première
fois, en décembre 1922, à La Haye, où elle se rend avec Alice Pels, secrétaire
nationale, au Congrès Mondial pour la Paix organisé par la Fédération Syndicale
Internationale. A la veille de ce congrès elle assistait au congrès de la
L.I.F.P.L., qui groupait alors 111 organisations représentant 20 millions de
membres de 20 pays, et parle à un meeting public aux côtés de Buisson et de
Lord Parmoor. 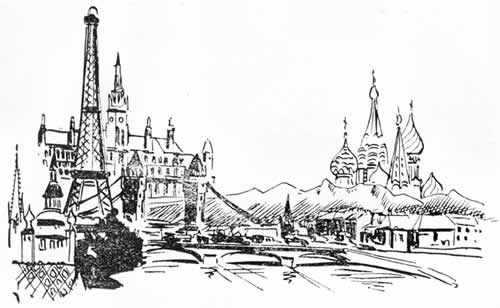
Répondant à l'invitation d'une section
allemande de la L.I.F.P.L. elle se trouve aux prises avec la police et se fait refouler
à la frontière. Elle ne se décourage pas pour si peu, rentre en Allemagne, et
cette fois-ci, grâce à l'appui des jeunesses socialistes, elle parlera aux
métallos de Duisbourg. Puis c'est son admiratrice du Congrès de
Vienne qui vient la trouver à Liège. Femme de cœur, d'intelligence supérieure, américaine
de naissance mais européenne de culture et de sympathie, Mary Kelsey rêve
d'établir un centre où pourront se rencontrer les représentants de nationalités
diverses pour discuter, dans la paix de l'intimité, de ces problèmes
internationaux qui portent la guerre dans leurs flancs. Elle voudrait, à cette
époque de nationalisme exacerbé, trouver des professeurs, dans n'importe quel
pays, sans distinction de tendance politique ou religieuse, mais connus pour
leur valeur combattive de penseurs convaincus de la nécessité d'une
organisation internationale. Comme étudiant elle voudrait attirer des jeunes
gens appelés à exercer une certaine influence dans leur milieu : propagandistes
syndicaux, universitaires montrant quelque velléité à s'occuper de la chose publique. Quiconque veut lutter pour « qu'on ne
remette pas ça » est le bienvenu chez Lucie. Elle accepte de grand cœur de seconder
Mary Kelsey dans son œuvre de rapprochement international, et promet de la rejoindre
l'année suivante pour l'inauguration du centre. Août 1923. Honfleur.
C'est ici que Mary Kelsey a trouvé l'endroit rêvé : une propriété
minuscule, adossée à la côte de Grâce avec ses beaux chênes, ses hêtres, ses lanières
de vigne vierge entortillées en bouquets de folle verdure. Une villa,
construite par une bonne grand-mère de manière à abriter en un minimum d'espace
un maximum de petits enfants, logera les « professeurs ». Un jardin
dégringolant vers la plage, servira de cabine de bain aux « étudiants ». La
terrasse, surplombant la mer, sera notre salle de conférence. Au large, des barques de pêcheurs,
petites taches noires. A nos pieds l'estuaire de la Seine, encore endormi. Sur
les bancs de sable découverts qui nous séparent du Havre quelques mouettes au
cri rauque. Petit à petit le soleil boit la vapeur blanchâtre du matin, et tel
un artiste choisissant des couleurs sur sa palette, va dorer les sables,
argenter les cimes des vagues. Lentement le Havre sort de ses voiles. Par le miracle
de l'atmosphère en cette chaude matinée d'août, ce port industriel aux hautes
façades, aux innombrables grues d'acier, se transforme en cité féerique de
nacre et d'argent sur un fond de brume rosée ... Et c'est la conférence qui
commence. Norman Angell, cet esprit à clarté toute
française, nous parlera de la menace de guerre. Et nous sommes en 1923 et nous nous
croyons en paix ! Il nous dira aussi, dans un aparté étrange : « La vie sans
émotion c'est une tombe vivante. » Et par émotion cet intellectuel logique et
sec a voulu dire : la vie sans amour. C'est Graham Wallas, sociologue, ami de
jeunesse de Bernard Shaw et qui conseilla à l'Irlandais fraîchement débarqué à Londres,
révolté mais ignorant, d'étudier l'économie politique s'il voulait arriver à
réformer le monde. C'est au tour de Lucie, qui se réclame
du métier préféré ne sa jeunesse, - voyageur de commerce, Inspectrice du
Travail, - ni l'un ni l'autre elle ne les considérera comme ayant été sa
véritable profession. Encore moins pense-t-elle à dire qu'elle est député
suppléant, et Conseiller communal de Liège. C'est au seul titre de repasseuse
qu'elle va se présenter à cet auditoire de savants et d'étudiants venus
d'Amérique et d'Angleterre. De quoi nous parle-t-elle ce premier
jour ? De la nécessité de l'entente des peuples, sans doute. Du fléau de la
guerre qu'elle a vécue, mais sans nous dire la part qu'elle y a prise. Car
Lucie joignait à une sorte de fanfaronnade, de franc-parler allant jusqu'à une
apparente vantardise parfois, une modestie personnelle déconcertante. Ainsi, si
elle nous parlait de l'occupation allemande, ce n'était que par bribes que nous
lui arrachions dans la suite son histoire : une partie de ses exploits comme
convoyeuse d'hommes à la frontière hollandaise. Par contre, elle nous dira avec
fierté que ses compatriotes ont été parmi les premiers à faire partie de l'Internationale
des Mineurs, et que la rapidité avec laquelle les mineurs belges sont sortis de
l'état de servitude économique où ils se trouvaient au début du siècle est en
grande partie due à leur compréhension de la nécessité d'une action
internationale. 
Dans la suite Mary Kelsey sollicitera
chaque été le concours de Lucie à la conférence d'Honfleur, qui deviendra en
quelque sorte le microcosme d'une université internationale, fonctionnant -
sous le patronage d'hommes tels que Pierre Hamp, Charles Gide, Jean Longuet
pour la France, Hendrik van Loon, le général John F. O'Ryan pour les Etats-Unis
- de 1923 à 1939. Au cours de ces sessions les professeurs
seront un Sir Norman Angell, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur
l'organisation supranationale, dont « La Grande Illusion ». Un Sir George Paish,
conseiller technique au Ministère des Finances de la Grande-Bretagne. Un Paul Otlet,
précurseur de l'U.N.E.S.C.O., bafoué par ses compatriotes mais dont l'imagination
brillante fera un jour la gloire de la Belgique. Un Chakotin, biologiste russe doublé
d'un théoricien de la propagande politique, inventeur de la campagne
anti-hitlérienne des « Trois Flèches ». Les étudiants seront parmi les « graduâtes »
les plus prometteurs d'Oxford ou de Harvard, de Bryn Mawr ou de Newnham,
Chinois, Japonais, Malgaches. Une Ethel Thornbury, statisticienne à la bourse
de New-York ; une Muriel Joliffe, professeur d'économie politique à
l'Université d'Aberystwith ; un Lord Listowel, ministre des postes dans les deux
gouvernements travailliste: un Kucizinski, le plus jeune docteur en philosophie
de Berlin depuis Goethe ; un Georges Boehm, venu des Etats-Unis en contrebande
pour faire le tour du monde à pied, en pèlerin de la paix. L'esprit qui a présidé à la fondation du
centre a surtout voulu faire œuvre de percement à jour des grandes illusions, de
« décamouflage ». Les professeurs s'efforcent de démontrer combien la
prospérité, la vie même, de chaque pays dépend de la vitalité de l'ensemble des
pays, le nationalisme persistant dans l'esprit traditionaliste des hommes alors
que l'indépendance nationale n'est qu'une illusion. C'est pourquoi le rapport
de la troisième conférence d'Honfleur, en 1925, concluait : « Il faut que les
hommes ensevelissent l'illusion de l'indépendance nationale et fassent preuve
d'une volonté de coopération internationale consciente. » C'est le moment psychologique de la
Conférence du Désarmement. Ce que l'on dit dans l'intimité du centre
international d'Honfleur, les organisations ouvrières le clament en des
manifestations massives. A l'initiative de la F. S.!., le P. O. B. décide de
soutenir l'effort des démocrates siégeant à Genève. Le dimanche 21 septembre de
nombreux cortèges sont organisés à travers la Belgique : à Huy, Namur, Tournai,
Peruwelz, Ostende, Turnhout etc. Vingt mille personnes sont dans les rangs à
Bruxelles, dix mille à Gand. A Liège huit mille manifestants prennent le départ
Place de l'Yser et parcourent la ville sous la drache habituelle. N'importe,
sur tout le parcours une foule compacte les accueille en un silence quasi
religieux. Le groupe des femmes socialistes est précédé de pancartes : « Les
femmes veulent bien donner des fils à l'industrie. Elles n'en donneront plus à
la guerre ». « Mères, cultivez chez vos enfants le sentiment de fraternité et
la guerre disparaîtra ». A la dislocation un meeting aura lieu au Cirque des
Variétés, sous la présidence du député Troclet. Au nom des femmes socia1istes
Lucie se fait ovationner en réclamant pour les femmes des droits qui leur
permettront de faire peser dans la balance internationale leurs sentiments de mères
et d'épouses. Au printemps de 1924 Lucie obtient
quelques semaines de congé et la voilà à bord de l'Orduna, avec une cinquantaine
de déléguées de la L.I.F.P.L. chargées de faire entendre la voix de l'Europe
aux Etats-Unis. A New York, grand meeting public, avant
de partir pour Washington où le congrès bisannuel de la Ligne va durer dix jours.
Le président ff. Calvin Coolidge fait aux congressistes l'honneur de les
recevoir à la White House. Puis en route, dans le Pax Spécial. A Philadelphie,
ville aux traditions libérales grand déjeuner d'honneur. Pittsburgh, avec son
immense industrie sidérurgique, leur offre comme tribune la chaire de seize églises
d'autant de cultes. A Wheeling les choses se gâtent. La
presse a commencé de se méfier de la présence de ces femmes étrangères sur le
sol américain. Le maire viendra s'excuser de l'opposition qui se manifeste dans
le public. A Cincinatti, devant les menaces des officiers du corps de réserve,
les délégués des 54 organisations du comité de réception se désistent. Malgré
l'accueil de Coolidge « ces étrangères ne méritent pas qu'un seul Américain les
reçoives. » Elles tiendront quand même un grand meeting public. Dayton,
changement d'attitude. Le maire tient à les saluer, les emmène visiter la Federal
Aircraft Experiment Station. Et en route vers Indianapolis. Alerte aux Ku Klux
Klan. Les responsables américains font changer les congressistes de train.
Curieuse comme toujours Lucie trouve moyen de rentrer dans le Pax Spécial
et attend ces messieurs de 1a cagoule. Les « masqués » défilent, sans
prêter attention à la dame qui lit sagement son New York Times. Cependant, il faudra abandonner les
meetings prévus, par suite de l'opposition soulevée par l'Association des
Employeurs, et par la «Society of 40 and 8 », organisation des plus étroitement
nationaliste, émue par « la propagande subversive » de ces étrangères qui ont
osé prendre comme thème de conférence « The Substitution of Law for War » et « The
Psychology of Peace. » Il est vrai que la délégation belge (soit Lucie
tout court) s'est déclarée favorable à l'admission de l'Allemagne à la S. D. N.
trouvant que cet organisme ne pouvait être viable sans que tous les peuples y
soient représentés. Elle avait également osé dire, dans ce pays isolationniste,
que la coopération de l'Amérique était indispensable au rétablissement social,
moral et économique de l'Europe. Lucie ne pourra pas profiter de son
voyage pour assister à la quinzaine de discussions des problèmes internationaux
qui aura lieu à Chicago. Le Ministère du Travail ne veut pas prolonger son
congé. Elle reviendra sur le France pour reprendre le collier. Que les efforts de Lucie comme les
efforts de milliers d'autres socialistes, d'intellectuels de tous les partis,
d'hommes d'Etat de premier plan de tous les pays n'aient pas empêché la tragédie
de 1939-1945 c'est évidemment un lieu commun. Ce qu'il importe de se rappeler
c'est le talent d'orateur de cette femme du peuple, qui se fera applaudir dans
tous les milieux, c'est sa vaillance infatigable, c'est le don complet qu'elle
fit de sa forte personnalité à la double cause du socialisme et de la paix. Militante. SI la première année de la Conférence
d'Honfleur devait être marquante dans la vie de Lucie comme propagandiste de
l'esprit internationaliste, 1923 sera non moins marquante dans sa vie de
militante socialiste, car le mouvement socialiste féminin connaîtra cette année
des modifications des plus importantes. En effet c'est le 21 janvier qu'a été
constitué, sous les auspices de l'Office Coopératif, le Comité national de la
Guilde des Coopératrices. Lucie en sera la première présidente et, au Congrès
de Gand en juin 1924 elle présentera un rapport sur « Le rôle de la femme dans
le mouvement coopératif ». Comme moyen d'action elle est heureuse et fière de
pouvoir dire que l'Union Coopérative de Liège a créé une « action de capital
accessoire » qui donnera aux femmes et filles de coopérateurs des droits égaux
« pour une fois » ne peut-elle s'empêcher de dire, dans l'administration et aux
assemblées de l'Union Coopérative, et plus loin : « L'Union Coopérative a fait
à Liège un pas formidable en avant par l'organisation des Guildes de
Coopératrices ». Progrès aussi sur le terrain
politique, car c'est en 1923 que le bureau du Conseil Général constitue
définitivement un secrétariat national féminin ; les dirigeants du Parti ont
compris qu'il est temps de faire l'éducation politique de la femme. Faut-il
dire que Lucie s'en réjouira de tout cœur, comme elle se réjouira d'accueillir,
pour la première fois à Liège, le Congrès National des Femmes Socialistes (27
et 28 octobre 1923) lequel, au cours de ses débats, admet le principe de la
création d'une section féminine par commune. Les décisions prises pendant ce congrès
sont d'une telle importance que je me permets de les citer in extenso. « Il ne peut être créé de groupements
autonomes. Toutefois, les groupes politiques peuvent créer des sections féminines,
au sein desquelles s'étudieraient et seraient préparées toutes les questions
intéressant le bien-être général de la famille. Les sections féminines peuvent
créer à leur tour des sous-sections : a) de mutualité ; b) de la coopération.
Là, où, dans l'intérêt de la propagande, la création ou le maintien d'une section
mutualiste s'impose, celle-ci est obligée de prévoir dans ses statuts la
fixation d'une cotisation spéciale pour l'affiliation au groupe politique de la
localité. » A Liège, par exemple, ce dernier point est à l'examen au cours de
1923, et « des modifications très heureuses ont été réalisées dans le but
d'activer la propagande auprès des femmes ». Ainsi le mouvement féminin socialiste
est définitivement constitué sur la triple base de la mutualité, la
coopération, la politique. Lucie va s'atteler aux trois formes de
propagande. Mais dire qu'elle les affectionnait au même titre serait
méconnaître singulièrement son caractère. Il est probable qu'au début de sa carrière
elle surestimait l'intelligence de la généralité des femmes, ne se rendant pas
compte combien elle-même était au-dessus de la moyenne. Elle avait eu, de tout
temps, un désir si ardent de s'instruire, un goût si marqué pour la discussion
qu'elle croyait pouvoir éveiller chez toutes des sentiments semblables; qu'il
suffirait de parler politique aux femmes pour qu'elles comprennent l'idéal
socialiste et s'affilient au P. O. B. - en attendant le jour où elles auraient
le droit de vote et augmenteraient la puissance réformatrice dans le monde. Or
en fait, du temps où l'idée politique était le mobile principal des groupements
de femmes socialistes, une poignée seulement de femmes y étaient attirées. Mais
oh ! combien elles étaient splendides ces quelques femmes dans leur
enthousiasme, leur foi en une vie meilleure, grâce au triomphe du socialisme
régénérateur, sur le plan national et international. Elles étaient de vrais
apôtres. Mais on ne fait pas une société avec des apôtres – hélas ! C'est pourquoi Lucie accepte l'organisation
féminine à base mutuelliste, en en prévoyant, d'emblée, les résultats à long
terme. « Le recrutement des femmes sur base
mutuelliste sera chose relativement facile, une fois attirées au Parti on fera petit
à petit leur éducation politique afin de les préparer à remplir leurs devoirs
de citoyennes quand elles en auront les droits ». En
attendant, elle n'a qu'un désir, celui de voir se réaliser l'amélioration des
conditions de vie de la classe ouvrière. Du point de vue tangible et immédiat
c'est par la coopération que ce désir semble pouvoir se réaliser le plus
rapidement. Elle suivra avec enthousiasme les progrès de l'Union Coopérative
dès sa création en 1918 et s'adonnera avec joie à la propagande pour la
formation des « Guildes ». Avait-elle à développer un bilan lors d'une
assemblée de coopérateurs, elle commençait sagement, s'efforçant de commenter
les chiffres. Puis graduellement sa pensée s'élargissait, vivant le progrès que
représentait pour chaque famille ouvrière l'achat d'autant de pains, de kilos
de beurre, de saine nourriture, elle qui avait vu pleurer de faim les enfants de
sa propre famille, entrevoyant d'autre part le potentiel d'éducation, de
délassement, de vie collective que représentaient les Maisons du Peuple. C'est
pourquoi sa parole s'échauffait, prenait de l'ampleur, empoignant de plus en
plus ses auditeurs jusqu'à la péroraison, où l'émotion qui se dégageait de sa
personne les aurait entraînés à faire la révolution, si telle avait été sa
volonté. En un temps où le mouvement socialiste
liégeois ne comptait que trois femmes capables de faire des conférences, Lucie était
souvent en route, d'autant plus que ses collègues étaient toutes deux jeunes
mamans, et qu'elle était bien souvent obligée de remplacer l'une ou l'autre,
empêchée à la dernière minute par quelqu'avatar familial. Aussi, ses agendas
témoignent-ils de meetings ou de conférences dans toutes les communes de Liège
et des alentours. L'étendue de son dévouement à la cause socialiste, la
multiplicité de ses efforts resteront cependant inconnus de ses concitoyens,
car la presse de l'époque ne connaît pas « le coin de la Femme Prévoyante » ni
« le coin des Guildeuses ». S'agit-il de former des Guildes, elle ira parler,
en quelques mois, à Comblain-au-Pont, St. Gilles, Beyne, Thier-à-Liège, Fraipont,
Fléron, Romsée, Ans, St-Georges-Stockay, Ampsin, Jupille, Awans, Slins, Heusy,
Ninane. Mais, rebelle, comme toujours à l'idée de rendre compte de ses
activités, elle néglige même les moyens publicitaires à sa disposition et se
fait « ramasser » en conséquence par le regretté Logen, « ... à différentes
reprises vous vous êtes rendue dans certaines régions pour y conférencier sur la
coopération, et à l'occasion de la formation d'une guilde de coopératrices, et
vous n'avez pas daigné envoyer la moindre relation de ce qui a été fait ». Ah !
comme on reconnaît bien là « nosse Lucèye » ! Puis, se faisant l'écho de la
secrétaire de l'embryonnique fédération des Guildes, la lettre de Logen
continue : « Très prochainement notre secrétaire sera tenue à faire rapport sur
la marche des Guildes et se trouvera, naturellement, dans l'impossibilité de
satisfaire au vœu exprimé par nos amis de Bruxelles. » C'est l'éternel tiraillement entre
l'ardeur propagandiste et la conscience administrative. L'une se précipite à la
bataille toutes voiles dehors, l'autre se désole de ne pas recevoir les éléments
nécessaires à la rédaction des rapports, à l'alignement des statistiques. Parfois cependant, il faut bien que
Lucie se plie aux exigences buralistes de son propre emploi de secrétaire
féminin à la Fédération Liégeoise, et s'occupe, elle aussi, de rapports et de statistiques. Ainsi, nous sommes le 31 décembre 1925,
et Lucie veut profiter du « pont » de fin d'année pour dresser le rapport
d'usage sur les activités des Ligues de Femmes Socialistes. Entourée des dossiers
qu'elle a rapportés de la Fédération, elle écrit, ne s'arrêtant que pour
allumer une cigarette et encore une cigarette. Il fait désespérément sombre
aujourd'hui au rez-de-chaussée où elle habite : le gaz restera allumé toute la
journée. Devant nos fenêtres la Meuse roule des
vagues écumantes, charriant bottes de foin, cadavres d'animaux, arbres
déracinés. D'heure en heure les eaux grossissent, alimentées par la fonte subite
des neiges en Ardenne, la pluie qui ne cesse de tomber jusqu'au delà de la frontière
française. Des camions de la Ville se relayent,
déchargent des sacs de terre à l'aide desquels soldats et volontaires civils
s'efforcent d'exhausser les murs riverains. Les quais sont noirs de monde, habitants,
curieux venus du centre de la ville. On se penche, qui avec une canne, qui avec
une ficelle pour mesurer combien de centimètres, de millimètres, « elle » peut
encore monter avant la catastrophe. Le ciel est d'encre, haché de gris
jaunâtre, genre « Porte D’'Enfer » de Gustave Doré. Depuis des semaines ce même
ciel tragique recouvre la vallée de la Meuse, nous ravissant le jour, nous
obscurcissant l'esprit. Est-ce la fin du monde? Une fois seulement Lucie lève le nez de
son travail. C'est pour se précipiter dehors, embaucher un couple de badauds
et, en un clin d'œil, renforcer avec eux, notre barrière de manière à opposer
une sorte de digue aux eaux si elles envahissaient le quai. Puis elle rentre,
se rassied, allume encore une cigarette. Je déménage livres, bibelots, literies
chez les voisins à l'étage. Quant aux meubles il faudra bien qu'ils courent
leur chance ; ces bons vieux buffets liégeois indémontables. « Ça y est Lucie ! » Une nappe d'eau, filtrant des caves,
vient de nous surprendre à l'arrière en traître. Il faut se rendre à
l'évidence. Alors seulement Lucie consentira à monter, avec ses dossiers, chez
les voisins du premier. Le lendemain, dans une de ces barquettes
miraculeuses, hier caisses à margarine, aujourd'hui navires de sauvetage, nous traversons
la place Ste Barbe et gagnons le Pont Maghin. Le hasard d'une rencontre nous vaut
l'hospitalité généreuse de M. Neujean, collègue de Lucie du temps où elle était
Inspectrice du Travail. De la rue Hocheporte Lucie pourra continuer son activité
de militante pendant les deux mois qu'il faudra avant que son rez-de-chaussée
soit de nouveau habitable. « Heureux sont ceux» écrira-t-elle « qui,
comme moi, ont trouvé l'hospitalité, offerte avec cette franche cordialité qui
caractérise les gens de notre patelin mosan, mais combien sont nombreux ceux
qui sont obligés de rentrer dans leur appartement nauséabond, et qui logent au
milieu de leur mobilier brisé, paillasse par terre, père, mère et enfants
cherchant la place la plus sèche ». Les
eaux en se retirant ont déposé une couche de boue dans toute la ville. En
attendant de pouvoir déblayer, le Service de la voirie ne peut qu'en faire des
monticules : aubaine pour les gosses qui se croient à la plage. Ils y pataugent
avec délice, se disputant les paquets de chocolat moisi, de bonbons vomis par les
caves des magasins. Dans ces conditions Lucie, qui s'était penchée sur
la misère des enfants de Vienne, pourra-t-elle rester indifférente devant le
danger que courent ses petits compatriotes des communes mosanes ? Par la voix
de « La Wallonie » elle fera appel à l'entr'aide et annoncera aux familles des
localités inondées que les Femmes Socialistes de l'arrondissement de Liège se
tiennent à leur disposition pour le placement de leurs enfants jusqu'à ce que
toute menace d'épidémie soit écartée. Avec le concours de camarades qui ont
noms Gisèle Paffen, Thérèse Peulen, Elise Muselle, les regrettées Léa Cornet et
Emma Bassleer, un millier d'enfants sont dirigés sur Bruxelles, et répartis
dans les familles, sélectionnées par les soins du Comité National des Femmes
Socialistes, dans le Centre et dans le Brabant. Dublin, Dresde. Lucie est bien de la période
eschatologique du P. O. B. et le mot espoir est constamment sur ses
lèvres, au bout de sa plume. Espoir en une vie meilleure, non pas pour elle, certes,
ni pour ceux de sa génération, mais pour les enfants de ceux à qui elle
s'adresse. Espoir en un temps où les femmes, fortes
de leurs droits civiques acquis, et fortes de leurs qualités traditionnelles,
ne voudront plus admettre ni misère ni gaspillage dans la société. Espoir surtout,
en un temps, où les travailleurs auront compris leur potentiel d'inertie et où
- enfin - ils refuseront de se laisser envoyer à l'abattoir. Naïveté ? Non pas ; elle sait fort bien que ses espoirs
ne se réaliseront pas de si tôt. Mais elle croit fermement à la vertu
cathartidique d'un idéal de bien-être et de paix. Sans idéal, pas d'espoir. Et
sans espoir, pas d'effort de la masse. C'est pourquoi l'espoir, prélude à
l'action collective, sera le leitmotiv de ses articles, comme de ses discours,
qu'elle s'adresse à « deux pèlés et on tondu » dans quelque
commune du Luxembourg réactionnaire, aux mandataires conscients qui emplissent
la Salle des Fêtes d'une des grandes Maisons du Peuple, ou à la foule hétéroclite
sur une place publique quelconque. 
Nous sommes à Dublin, en 1926, au
Congrès bisannuel de la L. 1. F. p. L. La section locale a voulu profiter de la
présence d'étrangères dans sa ville pour organiser un meeting en plein air. Les
oratrices parleront chacune cinq minutes. Comme tribune un break, traîné par
deux chevaux. En cette fin d'après-midi, les tramways
qui circulent autour de Bank Square sont pris d'assaut par les employés. Ce ne sont
pas eux qui vont s'attarder pour écouter ces dames de la L. 1. F. P. L.
Heureusement que quelques dizaines de chômeurs sont là, se chauffant aux
derniers rayons de ce soleil irlandais qui ne sait s'il doit rire ou pleurer;
de rares étudiants, quelques employés. Le meeting commence. Une Américaine
d'abord, pour attirer la foule par son humour d'outre Atlantique. Les chômeurs ne
goûtent qu'à demi les plaisanteries de la brave déléguée. Comme partout, le
peuple se méfie du bourgeois qui essaie de le traiter en enfant. C'est au tour
d'une Tchèque. Sa nationalité prédispose en sa faveur. Ses cinq minutes, elle
va les consacrer à son pays. Elle nous parlera du grand leader Thomas Masaryk, mûrissant
ses plans pour la libération de son pays, pendant son exil dans la lointaine
Amérique. De cette liberté chère au cœur des Tchèques reconquise enfin grâce à
l'effondrement de l'empire autrichien ; de Bènès, right-hand man de Masaryk. On
l'écoute attentivement, on l'applaudit avec bienveillance. Une Hollandaise, une Suissesse, une
Norvégienne nous parleront en un anglais de plus en plus fantaisiste. Elles
disent des choses intéressantes, certes, mais il leur manque la flamme
d'enthousiasme qui tient en éveil un auditoire. Nos chômeurs commencent à s'impatienter,
les rares étudiants, les quelques employés se dispersent. Il n'y aura bientôt plus
que les pavés de Bank Square pour entendre la dernière oratrice à l'affiche. Le temps fraîchit. Les quelques chômeurs
qui flânent encore autour de notre char relèvent le col de leurs vestons usés. Lequel
aura la patience d'écouter, ne fut-ce que cinq minutes, une langue qu'il ne
comprend pas? Voici Lucie, et sans doute vont-ils s'en
aller tous. ... Etrange phénomène. Les chômeurs ne
s'en vont pas. Ce qui est plus bizarre encore, c'est
que leur groupe paraît s'agrandir. J'ai peine à le croire, mais bientôt je dois
me rendre à l'évidence. Des quelques unités qu'ils étaient au début, ils sont à
plus de cent. Et il en arrive de partout. Après
une nuit blanche, en train d'abord, puis sur mer de Holyhead à Dublin, Lucie
doit, logiquement, être exténuée de fatigue. Mais, comme si souvent, c'est le
contraire de la logique qui se produit. Lucie est magnifiquement en forme. Elle
parle avec une fougue splendide, un don complet de sa personne. Lançant sa voix
jusqu'aux quatre coins de l'immense place, elle parle avec ses yeux, avec ses
mains, avec la sincérité absolue qui est sienne et qui est le secret de son
succès d'oratrice. Elle dit de ces mots qui se comprennent partout où il y a
des ouvriers, partout où il y a des gens probes et libres. Elle parle de
l'Internationale qui lui est chère comme les fibres de son cœur, de
syndicalisme et de coopération. Elle dénonce les tares de notre civilisation. Elle
clame sa foi inébranlable en un avenir de paix et de bonheur, à condition, et à
cette seule condition, que les travailleurs prennent conscience de leur force. Attirés par je ne sais quel appel
mystérieux, des hommes, des femmes accourent, toujours plus nombreux, plus
pressés. Lucie a largement dépassé son temps de parole. Et toujours, il arrive du
monde. Et elle parle comme si elle voulait pénétrer directement le cerveau et
le cœur de ces gens surgis d'on ne sait où. Quand enfin elle s'arrête, on voit
que des agents de police s'efforcent de dégager cinq ou six trams immobilisés
par la foule massée jusqu'à la périphérie du square. Au milieu d'un silence impressionnant,
la présidente se lève. Elle a pris quelques notes, nous confie-t-elle. -
Prendre des notes d'un discours de Lucie Dejardin ? Un jour comme aujourd'hui ! Aussi bien essayer de compter les gouttes
d'un torrent de montagne déchaîné. - Elle essayera de traduire un résumé du discours. Mais de partout fusent des cris. Non ! Non ! Nous
n'avons pas besoin de votre traduction ! Nous ne voulons pas vous entendre ! Nous avons compris ! Nous avons tout compris ! Et alors seulement les applaudissements
éclatent. 
Lucie descend du char, croyant pouvoir
s'en aller à pied. Mal lui en prit. Des hommes se battent pour essayer de lui
serrer la main. Des femmes, renouvelant le geste biblique des peuples primitifs
se bousculent pour lui baiser le bord de la jupe. En jouant des coudes,
j'arrive à la faire remonter sur le char et fouette cocher ! On nous fraye un passage entre des centaines
d'hommes à la figure extasiée. Un instant, ils ont eu la vision d'un monde tel que
le voudrait Lucie. Vous penserez probablement, comme je le
pensais, que la communication directe de cœur à cœur n'est possible qu'entre gens
d'un même complexe émotif. Sans doute était-il facile à l'imagination généreuse
de la Wallonne d'entrer en contact direct avec l'âme celte, toujours à l'affut
du miracle, du geste inspiré qui va l'entraîner : ailleurs qu'en Irlande,
pareille scène ne pourrait se produire. Détrompez-vous. Trois ans plus tard, et
dans des circonstances combien différentes, Lucie va renouveler le « miracle de
Dublin » au « Kristallpalast » de Dresde, devant un auditoire allemand qui, pas
plus que les chômeurs de Dublin, ne comprend le français. C'est un numéro du «
Volkszeitung » trouvé dans les vieux papiers de Lucie qui m'apprit ce qui
s'était passé certain soir de janvier 1929. « Lucie Dejardin parle librement, sans
note. Elle parle en français, mais c'est comme si nous comprenions chaque
parole. Dès la première phrase, c'est comme si un pont était jeté entre la
scène et le reste de la salle, quelque chose qui lie nos cœurs l'un à l'autre
... Avec les yeux, nous vivons le discours de l'oratrice qui met tout son être
dans chaque phrase. En regardant parler cette femme, on pense à un tableau de
Steinlen ou de Millet, une statue de Meunier. Dans la salle, pas le moindre
bruit. Chaque visage est un miroir reflétant les paroles de l'oratrice.
L'espoir, la volonté, la foi tour à tour se peignent sur la figure de ses auditeurs
à mesure qu'elle parle ... Enfin quand Lucie Dejardin nous parle de la mission
de ceux qui pensent en socialistes – tous la comprennent avec leur cœur, ils savent
que c'est de cela qu'elle parle ; cela s'entend à sa voix chaude - et tandis
que le visage de l'oratrice se fait tout jeune et d'une claire beauté, la mine
de ses auditeurs se fait belle... Et à l'instant où cette voix a prononcé sa
dernière parole, l'oratrice est entourée d'un élan de sympathie spontanée. » Si elle est à ses moments, orateur
d'un dynamisme fougueux remarquable, Lucie Dejardin ne ménage jamais son concours
aux réalisations concrètes, au quotidien immédiat. Ainsi, dans le domaine
international, elle ne néglige aucune occasion de témoigner de sa fraternité
agissante. Si elle se rend volontiers à l'étranger,
elle accueille avec empressement quiconque lui arrive d'au delà des frontières :
une Emmy FreundIich, une Lotte FürtmulIer, conseillère municipale de Vienne, en
tournée de conférences dans la région Liégeoise, des étudiants chinois,
anglais, américains, polonais ; des réfugiés anti-hitlériens, allemands ou
tchèques, des enfants de chômeurs victimes du régime capitaliste en Belgique,
ou de la guerre civile en Espagne. Son hospitalité est large et accueillante
comme la porte de sa vieille demeure. Tantôt, c'est la Dürer SchüIe en masse,
75 adolescents avec leurs convoyeurs venus de Dresde pour visiter la Belgique.
Par je ne sais quelle multiplication de l'espace vital, elle les reçoit tous à
dîner dans son rez-de-chaussée. C'est le Comité exécutif de la L. L F. P. L. au
grand complet : elle les initie aux délices de la « boûkète » liégeoise.
C'est un groupe de jeunes chômeurs allemands, mandoline au côté, en route pour la
Sarre où ils espèrent trouver du travail. Ils veulent se reposer à Liège et
demandent, tout uniment, à loger chez la genossin Dejardin. Dans le P. O. B., elle est de tous les
comités, car on la sait de bon conseil dans les détails pratiques de
l'organisation. Tout à son idéal de socialiste et d'internationaliste, elle
donnera son appui aux mouvements les plus divers. Au cours des années, on la
trouve aux côtés d'un Jean Allard recevant une délégation d'étudiants allemands
; d'un Dr. Machelaert créant le Service Sanitaire Ouvrier; d'un Henri Damart
recevant des sportsmen aux olympiades ouvrières ; d'un Jobsès et d'un Delbrouck
à la formation d'un cartel d'Anciens Combattants et de Femmes Socialistes contre
la guerre et le fascisme. Elle assiste aux réunions d'ex-prisonnières politiques
présidées par Mademoiselle Delwaide, militante catholique comme on sait, qui se
plait d'attester « de l'allant de son caractère et de l'élégance de sa parole ». Elle est membre du Comité d'Action pour
la Liberté et la Démocratie, avec un Terfve, un Grognard, qui appartiennent au parti
qu'elle exècre, pour avoir divisé la classe ouvrière au moment psychologique où
le P. O.B. avait l'avenir en mains. Elle n'a jamais été féministe dans
l'acception précise de ce terme, s'étant ralliée par conviction à la thèse
socialiste, syndicaliste surtout, qui exclut la femme de certains métiers
insalubres. Mais elle est membre fidèle de l'Open Door, reconnaissant l'efficacité
de cet organisme comme élément d'éducation sociale de la femme. Au lever de
boucliers contre l'arrêté loi de 1934 contingentant le travail des femmes, elle
est membre du Comité de Vigilance Nationale où elle siège avec une Louise De
Craene, une Germaine Hannevart, présidentes : l'une de l'Open Door, l'autre des
Femmes Universitaires. L'amour qu'elle a pour le P. O. B., le
véritable culte qu'elle lui voue, ne fera pas de Lucie une sectaire, comme on
le voit. Elle est toujours prête à collaborer avec des femmes et des hommes des
partis adverses pour autant que, momentanément, leurs buts coïncident avec ceux
du socialisme. En attendant le règne idéal de celui-ci, avec quelle joie Lucie
salue-t-elle chaque geste qui contribue au mieux-être de la famille, ou à
l'éducation sociale de la femme. La création de Homes de Vacances pour
les enfants devait nécessairement rencontrer son appui enthousiaste, car au
fond du cœur, elle avait conservé la nostalgie de sa première enfance dans les
bois, les prairies de Fléron. Elle se souvenait, qui mieux, combien
l'imagination de l'enfant a besoin de « la forêt mystérieuse avec ses mille
bruissements, le doux et discret renouveau du printemps ». Aussi est-ce avec
joie qu'elle fit partie du Conseil d'Administration du Home de Glons - premier
de la région - de Mont Comblain, des Floricots, sa préoccupation constante
étant d'œuvrer pour l'enfance qu'elle voulait toujours plus heureuse. La Fête du 1er mai a, pour la génération
de Lucie, la valeur d'un symbole : la reconnaissance de la dignité du travail
par le monde capitaliste ; l'affirmation de la force ouvrière au deçà et au
delà des frontières. Pour Lucie, qui garde au fond du cœur son amour de la
nature, la Fête du Travail chante aussi le renouveau. C'est sous ce triple
aspect qu'année après année elle fait appel aux femmes, les invitant à se
joindre au cortège et témoigner ainsi de leur reconnaissance au P. O. B. pour
les réformes dont elles bénéficient. Sa satisfaction sera à son comble quand elle
pourra annoncer, à l'occasion du 1er mai 1926, la parution du premier journal
des femmes socialistes. « C'est la « Voix de la Femme » qui se
fera entendre, réclamant plus de justice sociale, réclamant pour elle le droit
de se défendre, de défendre ses enfants ». Mais la loyauté de Lucie reste acquise
au P. O. B., dont le progrès général lui est plus cher que toute revendication
féministe. « Si les femmes socialistes
belges ont cru nécessaire de créer ce nouvel organe, c'est avec l'idée de
travailler par le socialisme... Nos camarades du Parti n'ignorent pas que toute
l'éducation sociale et socialiste de la femme est à faire et cela encore plus
dans notre pays que partout ailleurs, car la femme a toujours été traitée en
inférieure, tant par l'éducation familiale que sociale. Tout est à faire près
d'elle. » Il a été dit que d'après ses goûts et
l'orientation particulière de sa pensée, Lucie aurait voulu organiser les
femmes sur une base politique pure et simple, mais qu'elle a accepté la thèse «
mutuelliste ». Rien cependant ne l'empêchera d'essayer de faire l'éducation de
la femme comme elle l'entend. Immédiatement après s'être ralliée à la création
de la Femme Prévoyante, elle envoie à « La Wallonie » une série d'articles où
elle s'efforce de démontrer que: « La politique est l'associé invisible de
chaque moment que nous vivons, et malheur à qui ne veut pas comprendre cette vérité
qui saute aux yeux ! » Et s'adressant
aux hommes qui lui objectent que la politique ne regarde pas les femmes - ils
sont nombreux dans le Parti : « Comment, vous vous prenez pour des
êtres conscients et vous trouvez que c'est intelligent de laisser subsister
cette tradition de la politique comme chose occulte et détachée du monde ? Vous
trouvez que c'est intelligent de laisser ignorer aux femmes le système qui
régit en bien ou en mal leur vie quotidienne ? Ne vaudrait-il pas mille fois mieux leur faire
comprendre combien sont étroits les liens qui rattachent leurs foyers, leurs
libertés civiques et domestiques, et jusqu'à leur popote, aux pouvoirs publics,
à l'ensemble des mandataires? » Et enfin, en une déclaration dont le bien
fondé n'apparaîtra, avec toute sa valeur, que dans la période de flottement
d'après guerre, elle concluait: « On a maintes fois répété que ce qui fait la
force de notre P. O. B., c'est son caractère cohésif : mouvements politique,
syndical, mutuelliste et coopératif étant étroitement unis. Que notre
coopérative, délaissée, perde sa puissance d'achat et de fabrication, que nos
mutualités périclitent et que nos syndicats perdent leurs effectifs, le prochain
pas ne tardera pas à se faire. C'est alors que la politique, fonctionnant sans
ses appuis habituels, fonctionnant pour ainsi dire dans le vide, ne
fonctionnera plus du tout. C'est alors que les conquêtes ouvrières -
revendications syndicales sanctionnées par les pouvoirs publics - auront tôt
fait de s'écrouler. Et que d'autres lois nous reprendront nos libertés
acquises. « Et voilà pourquoi je demande aux
femmes non pas d'écarter la politique de leurs discussions, mais, au contraire,
de faire de leur mieux pour comprendre tout ce que la politique comporte d'intérêts
vitaux pour la famille et le foyer. » Une phrase : un programme, une règle de
vie. C'est à la lumière de ces principes clairs, simples, droits que Lucie
vivra sa vie de parfaite coopératrice, syndiquée, mutuelliste, en même temps
que de propagandiste politique d'instinct autant que de profession. Député. La
campagne électorale de mai 1929 se termine dans une atmosphère de fièvre, adoucie
seulement par le parfum des lilas que Lucie rapporte chaque soir de
l'une ou l'autre commune où elle a été invitée à prendre la parole. Le
26 mai elle s'en va à son bureau à la Populaire comme à l'ordinaire. C'est
par un reporter du « Soir » arrivé en hâte à la maison pour l'interviewer
que j'apprends la nouvelle. Le P. O. B. perd 8 sièges pour
l'ensemble du pays, mais l'arrondissement de Liège en gagne un. Lucie Deiardin
est entrée dans l'histoire comme la première femme élue au Parlement belge par
voix de suffrage direct. Bouquets de félicitations de nombreux
amis belges. Vincent Volckaert. « Je suis heureux de constater que la première femme
qui entre à la Chambre des Députés est une vraie prolétaire et socialiste de
vieille roche, qui a consacré toute sa vie à la défense de nos chères idées et
à l'organisation des travailleurs belges ». Lombard, « C'est la preuve que la
classe ouvrière n'est pas toujours si ingrate que certaines gens voudraient
nous le faire croire, celle-ci sait reconnaître ceux qui lui consacrent leur vie
et vous êtes de ceux-là ». De l'étranger : de Paris, de Prague, d'Athènes, de
Philadelphie, d'Edimbourg, de Londres : «congratulations to first socialist
woman nepllty from British Labour women » ; de F. Adler au nom du secrétariat
de l'I.O.S. « C'est de bon augure pour la conquête finale du suffrage universel
et égalitaire en Belgique qu'une femme ait réussi à s'acquérir la confiance des
électeurs ouvriers dans les circonstances difficiles qui ont accompagné la
lutte électorale du Parti ». Fête à la Populaire. Puis le rythme de la vie de
s'accélérer. Chacun voudrait entendre ce phénomène nouveau : une « femme député
» ! Du reste, d'après les demandes de conférences qu'elle reçoit, on dirait que
là où elle a parlé pendant la campagne électorale on voudrait la revoir - et
tout de suite : pour s'assurer qu'elle n'a pas changé de visage. Non, Lucie n'a pas changé de visage.
Elle n'a même pas changé grand-chose à ses habitudes, sauf à accepter le
surcroît de besogne qui fatalement lui échoit avec son mandat de député. Mais
elle ne se croit pas dispensée, pour la cause, des corvées de militante sans
grade. Si elle accepte d'aller conférencier à Ottignies, à Aubange, à
Leuze-Longchamps ou à Wautier-Braine, à Spy ou à Goutroux elle ne néglige pas
Liège ni la banlieue. Elle parle à Huy, retour de la Chambre, pour le Comité
local de l'Union Coopérative, fait une conférence au «Franklin» de la Populaire
en faveur de la « Noël Rouge » des Enfants du Peuple ; parle de «
L'organisation féminine » à Ans. L'année de son élection verra l'inauguration
de la journée annuelle de la Femme, les 26 et 27 octobre, à Liège. Elle
s'occupe de la publicité, et note avec satisfaction que la salle des Fêtes de
la Populaire est trop restreinte pour le public qui s'y presse pour entendre
les exposés de la citoyenne Spaak, d'Hélène Evrard-Daxhelet, de Jeanne- Emile
Vandervelde. L'enthousiasme est à son comble quand le « Patron » lui-même vient
exposer aux femmes la plateforme du Parti. La collaboration qu'elle avait accordée
jadis au Comité Régional d'Education Ouvrière de Liège, Lucie la continuera
comme si de rien n'était. Pendant un seul trimestre elle fait pour le compte de
cet organisme quatre conférences, parlant à Tilff de l'Enseignement
Professionnel ; à Méry du Droit des Femmes ; à Bois de Breux du Rôle
social de la Femme ; à Moulin sous Fléron de La Coopération et la Femme.
On l'entend au Val St. Lambert ou à Hamoir pour la Guilde des Coopératrices. A
Couillet, elle fait une conférence pour la Libre Pensée « La Persévérance » ; à
Nessonveaux elle parle de « La Libre Pensée et la Religion » etc., etc. Lucie
n'abandonne pas, non plus, ses activités d'internationaliste :
fidèle à la conférence annuelle d'Honfleur ; représentant les Femmes
Socialistes au congrès de l'LO.S. à Paris, à Zurich, à Vienne ; avec le
comité de la L.I.F.P.L. à Prague ou à Grenoble ; prenant part, sous le
signe du désarmement, à une tournée de conférences dans les Vosges. Ses multiples activités ne l'empêchent
pas de faire honnêtement et scrupuleusement son « boulot » de député, assistant
avec une régularité exemplaire aux séances de la Chambre, à celles des
commissions où elle est désignée par le Groupe Socialiste, intervenant dans les
débats lorsqu'un budget en discussion touche plus particulièrement aux intérêts
des femmes et des enfants. Son « Maiden Speech », elle le
prononcera à l'occasion de la discussion du Budget de l'industrie, du travail
et de la prévoyance sociale (le 21 février 1930) et, d'emblée faisant connaître
sa préoccupation constante, demandera au ministre responsable (M. Heyman) de « se
montrer un peu plus généreux dans l'attribution des subsides aux mutualités en
général et surtout à celles organisées pour les femmes ménagères ». Puis elle
dévoilera son côté eschatologique. « Vous aiderez de cette façon les femmes à
s'éduquer, à se consacrer beaucoup mieux à leurs maris qu'elles accueilleront
avec bonne humeur à leur retour du travail et avec une plus large vue de la vie
sociale... Elles donneront au travail des êtres forts, sains et gais, qui iront
vers les temps meilleurs avec assurance, avec une tolérante bonté pour leurs semblables
quels qu'ils soient. .. » D'emblée aussi elle clamera ses aspirations
de militante ; « En attendant, Messieurs, que vous vous décidiez à la
révision du Code civil, que vous vous décidiez à donner à la femme mariée le
droit de se sentir une personnalité dans le monde – et surtout une place digne
d'elle au foyer familial où elle est traitée en mineure autant que les enfants
auxquels elle a donné le jour - et vous y viendrez. Messieurs, à la révision du
Code civil, de même que vous vous trouverez obligés d'étendre les droits
politiques. Mais en attendant je me bornerai à vous parler de la place que,
utilement, les femmes devraient trouver dans le projet d'assurances sociales
que vous nous présentez ». Coïncidence touchante : le jour du
maiden speech de Lucie son frère Joseph interpellait, lui aussi, le ministre
Heyman « au point de vue charbonnier ». Lucie n'était pas peu impressionnée
quand elle devait prononcer un discours à la Chambre. L'idée que le temps de
parole était strictement limité lui enlevait d'avance une partie de ses moyens.
Une fois cependant le président lui accorda « un temps de parole un peu plus
long que celui » (un quart d'heure) «qui a été, décidé par la Chambre »,
s'excuse-t-il, et on applaudit sur tous les bancs. C'est à l'occasion de la
discussion d'un projet de loi dite « de protection contre l'alcoolisme » et
qui tendait à restaurer la vente de l'alcool au nom de la liberté. Faut-il dire
que Lucie puisa dans les souvenirs de son enfance de quoi flétrir « Le commerce
de l'alcool » qui « ne peut être comparé qu'au commerce des narcotiques et des
stupéfiants, car nul autre article de consommation ne produit semblables
dégénérescences physiques et mentales ». Au nom des femmes Lucie jette
l'anathème sur cette liberté-là. 
« Nous, femmes, qui songeons avant tout
à l'enfance et à l'adolescence, nous ne voulons pas qu'on rétablisse la liberté
de boire; nous sommes irréductiblement adversaires de la liberté en cette
matière, parce que la liberté finit là où elle devient nuisible à nos
semblables, à l'humanité ». Et encore : « ... si le contribuable est obligé de
subventionner pendant le restant de ses jours des anormaux et des criminels
alcooliques ... qui peuplent les asiles, les prisons, dans des proportions de
plus de 50 %, n'est-ce pas en quelque
sorte porter atteinte à la liberté de la collectivité en faveur d'une section
peu intéressante, encore moins méritante, de la population ? » Cent mille cafetiers ayant voté une
résolution réclamant cette fameuse liberté, Lucie s'écriera : « Cent mille cafetiers ! C'est
impressionnant ! Quand 300.000 coopératrices et 168.000 femmes socialistes,
125.000 femmes de l'Union des mutualités socialistes, quand 165.000 membres des
ligues féminines chrétiennes demandent le maintien de la loi de 1919, c'est
hélas, beaucoup moins impressionnant, et pour cause ». Que l'attitude de Lucie pendant ce que
l'on pourrait appeler la campagne alcoolique ait été les plus dignes, on peut
en juger par la violence des attaques dont elle était l'objet de la part de la
presse adverse qui la traite de Vierge Rouge, d'Erynnée vengeresse, Lucie de
l'amer mot etc ... Que c'est spirituel ! Mais derrière la façade du travail
parlementaire il y a évidemment le travail silencieux, occulte. Affaires,
relations, influences pour les uns : pour Lucie démarches, correspondances sans
fin en faveur de la catégorie la plus déshéritée : les vieillards qui attendent
leur pension. En effet, lorsque Lucie est entrée à la Chambre, la position des
vieilla.rds était tragique et pouvait faire dire au député Rubbens : «J'ai
signalé le cas exceptionnel à M. le Ministre de deux vieillards qui sont morts
il y a trois jours, de misère et presque de faim, alors qu'ils attendaient
depuis quelques mois l'octroi de leur pension de vieillesse et, qu'habitant une
toute petite commune rurale, ils ne disposaient d'autre ressource. Sans vouloir
faire une plaisanterie on peut dire que la législation de la pension de
vieillesse raccourcit parfois la vie des vieillards de quelques années à cause
de l'anxiété qu'ils ressentent en attendant chaque matin le facteur, qui ne
vient jamais ». 
Deux fois par semaine Lucie reçoit
quiconque a besoin de ses services et pendant toute l'après midi c'est un
défilé de vieux et de vieilles qui ne touchent pas encore leur pension de
vieillesse. Avec une patience remarquable chez cette femme vive autant que
décidée, Lucie constitue ses dossiers - par intuition plutôt que par
précisions, car la plupart des intéressés sont incapables de lui en fournir -
et en général arrive à avoir gain de cause chez le Ministre de la Prévoyance
Sociale. Puis elle fait à sa façon la propagande en faveur de l'Union
Coopérative. En attendant de toucher leur pension, elle établit aux noms des
vieux des bordereaux de commande qu'elle solde en fin de semaine. De plus, chaque
fois qu'elle reçoit, il faut lui préparer une série de billets de 20 francs, ce
qui finit par se chiffrer dans son budget. Ses électeurs ne lui en ont fait
aucune publicité, et pour cause. Or, si Joseph Dejardin est connu comme le
député des mineurs, c'est comme le député des pensionnés que Lucie mérite d'être
connue. Au mois d'octobre 1932 elle a l'immense
douleur de perdre le compagnon de ses luttes politiques comme de sa dure
jeunesse. Joseph, son frère aîné. Les contingences de la vie ne lui laisseront
guère le temps de le pleurer. La campagne électorale l'arrachera à ses
souvenirs et à ses regrets pour la lancer dans la bataille. Le 27 novembre elle est réélue à la
Chambre, preuve que les antialcooliques font majorité parmi les électeurs. Et
la vie de reprendre son train normal tant à l'intérieur qu'à l'étranger. 1936. Aux élections de 1936 un phénomène
regrettable se produisit. Le « climat » de cette période trouble
favorise la montée des jeunes. La violence casse-tout de leur langage pendant
la campagne électorale a manifestement fait recette. Et le Poll du Parti,
malgré les années de service de Lucie, lui attribue la septième place sur la
liste des huit candidats à présenter à la Chambre pour l'arrondissement de
Liège. Ainsi c'est à la place d'honneur qu'elle aura à combattre, car, d'après l'atmosphère
politique du moment, on craint que le huitième siège ne soit perdu d'avance ;
le septième est donc le point névralgique. Le plus ennuyé en l'occurrence c'est
sans doute le citoyen Gruselin qui se trouve placé avant Lucie. Et Lucie c'est
la sœur préférée de Joseph Dejardin à qui il doit tout, puisque, comme on sait
c'est par l'influence de Joseph qu'il a été tiré de la mine et que le Syndicat
des mineurs a accepté de lui faire faire des études universitaires. Il y a deux
ans à peine que la Fédération liégeoise - y compris Lucie au nom des Femmes
Socialistes – le félicitait d'avoir « brillamment conquis son grade de Docteur
en droit ». Mais la politique a de ces situations cruelles. Ce que le hasard du
Poll a décrété, le citoyen Gruselin ne peut l'annuler. Dans la glissade qui fait perdre 3
sièges au Parti Ouvrier Belge pour l'ensemble du pays liégeois, Lucie perd
évidemment le sien. Qu'on n'oublie pas que les femmes n'avaient pas encore le
droit de vote aux élections législatives. Et le fait brutal est là. Lucie
militante depuis plus de vingt ans, propagandiste inlassable, se trouve en état
de chômage, sans ressources, sans fortune aucune, ayant comme seule garantie la
vieille maison qu'une étrangère a acquise pour lui assurer un toit. Elle voit
venir avec angoisse le moment de la pension de vieillesse. Elle qui s'est tant
démenée pour faire obtenir la pension à d'autres, va-t-elle être obligée de la
solliciter à son tour ? Veillées d'amertume, où elle lit jusqu'à
quatre, cinq heures du matin. Amertume de ne plus pouvoir aider ses pauvres
vieux, ni matériellement ni en usant de son influence au Ministère du Travail,
ou au Ministère de la Défense Nationale en faveur des mères qui viennent
implorer un sursis pour leur fils. Amertume de devoir fermer son cœur quand on
la sollicite, elle pour qui « l'entr'aide est le seul vrai bonheur sur la terre
», qui a l'habitude d'ouvrir si généreusement son portefeuille à chaque appel d'un
groupement quelconque du Parti. Sur une lettre de Paul Peeters, président du
groupement organisateur d'une fête au profit de la J.G.S. et qui lui demande un
don, elle note : « Pas cette fois-ci. Je ne touche rien moi-même. Quand j'aurai
du travail revenez. C'est la chose la plus dure pour moi cette réponse. » Et, sur une lettre du secrétaire de la
Fédération Liégoise lui demandant sa note de frais pour la campagne électorale
: « Je ne veux pas qu'on me paie des frais. Je ne veux que du travail pour
gagner ma vie ». Qu'une telle âme ait été mise dans
l'impossibilité d'exercer sa passion de générosité c'est un crime du sort, et
certes pas la moindre des souffrances de sa carrière. Il faut bien boire le calice jusqu'à la
lie. Elle se voit obligée de demander sa réadmission à la Fédération Liégeoise
en qualité de secrétaire propagandiste auprès des femmes. A soixante ans elle
devra s'astreindre à la discipline des heures de bureau avec, en plus, des
réunions de comité qui se sont multipliées par suite de son mandat, et qui
continuent malgré qu'elle ne siège plus à la Chambre. Quels que puissent être ses sentiments
intimes, elle n'a rien perdu de sa combattivité. A peine les élections finies
qu'avec Jean Rey et Terfve elle pénètre en Allemagne pour essayer d'intervenir en
faveur d'Edgar André[12]
inculpé de haute trahison contre l'Etat allemand. Elle force la consigne en en
imposant par on ne sait quel sortilège aux S.S. qui veulent lui interdire
l'accès du tribunal, et parvient même à échanger quelques paroles avec le prisonnier.
C'est le hasard d'un voyage en U.R.S.S. qui m'apprend le rôle remarquable joué
par Lucie à cette occasion. Son attitude a été commentée en termes élogieux
dans la Pravda, et quand nos interprètes réalisent que la citoyenne belge,
présente en chair et en os, est bien l'héroïne de l'article en question, ils se
confondent en admiration respectueuse En U.R.S.S. on est connaisseur en procès
politique. En Belgique elle n'en ménage pas moins
son concours, participant avec son énergie habituelle aux activités du Parti,
suivant le calendrier des fêtes ouvrières comme si de rien n'était. Elle
assiste comme chaque année à la tournée d'inspection de l'Union Coopérative, à
l'occasion de la Fête Internationale de la Coopération, et comme chaque année
dresse un rapport au nom du Comité local de Liège, distribuant louanges,
conseils, observations avec le tact, la bonhomie qui la caractérisent. Membre du comité liégeois du RUP
(Rassemblement Universel pour la Paix) elle tend la main à Julien Lahaut, autre
adversaire politique, mais avec qui elle veut œuvrer dans la tolérance au nom
de leur haine commune de la guerre. Elle n'a rien renié de ses convictions
politiques pour la cause, et après une conférence à Mariembourg, un des
auditeurs, en témoignage d'admiration lui écrit : « On vous a qualifiée de
socialiste acharnée, ce qualificatif représentant ici le summum des qualités
socialistes ». Août 1939. Lucie prend part à la 17e
Conférence d'Honfleur, et se plaint de ce que ses collègues vieillissent. «
Elles tricotent et font des réussites. Je m'ennuie. Viens me chercher », m'écrit-elle.
Elle n'aura pas longtemps à s'ennuyer. A Concarneau, je lis l'affiche de
mobilisation générale et me mets aussitôt en route. Les trains sont bondés :
dernières recrues, réservistes avec leurs familles qui les accompagnent au
dépôt. « Cette fois-ci on les aura. Il le faut
». Jamais les Français n'ont été aussi décidés, admirables de calme courage.
Crise d'hystérie cependant chez un tout jeune. « Je ne veux pas y aller ! Je ne veux
pas qu'on me tue ! » On le calme. Ce ne sera rien. Dans
quelques mois on sera de retour. De Concarneau à Honfleur deux jours de
voyage à la manière d'Echternach, pendant que trains de soldats, convois de munitions
passent en direction frontière. A Paris par contre tout est étonnamment
calme. Nous rentrons à Liège pour entendre la voix de Chamberlain. Les lumières
s'éteignent en Europe. C'est la drôle de guerre. Par arrangement de Lucie avec des amis
de la firme Offermans, notre maison deviendra un centre de distribution de lait
aux femmes de mobilisés. Les visiteurs trouvent notre hall d'entrée encombré de
bidons, de bouteilles et sont obligés de se faufiler entre les femmes qui
attendent leur tour. Nos greniers, qui de tout temps reçoivent les colis que
Lucie récolte pour ses malheureux, sont pleins de vêtements d'hommes. Lucie n'a
pas terminé sa tâche auprès des rescapés de la Brigade Internationale, comme
trésorière du comité d'Accueil aux Volontaires d'Espagne, que déjà des
chômeurs, premières victimes de la guerre frappent à sa porte. Samedi 11 Novembre. Alerte à l'invasion.
Au Consulat britannique branle-bas général. Nous expédions nos archives à l'Ambassade
à Bruxelles. Et lundi on recommence, travaillant de mémoire, les classeurs
vides. J'expose la situation de Lucie au
Consul. En raison de son attitude pendant la guerre de 1914-18, le Consul veut
bien accepter de l'assimiler au personnel britannique en cas d'invasion. Lucie
accepte l'offre qui lui est faite. Dimanche 25 janvier. Deuxième alerte. Il
paraît que les Allemands vont traverser la frontière à midi. Toutefois le
Consul estime la nouvelle prématurée. Je décide de continuer mon repos du
dimanche, d'autant plus que Lucie est partie de bonne heure faire une
conférence. Vendredi 10 mai. Voici le moment de
partir. Lucie ne veut pas s'en aller. J'ai toutes les peines du monde à la
décider de s'apprêter; elle ne veut pas quitter son Liège. Enfin, nous
attendons toute la journée au Consulat. L'auto retenue depuis des mois pour
évacuer le personnel féminin est déjà partie vers la France A 5 heures, coup de
téléphone. « Ils » sont déjà à Dolhain. Lucie veut rentrer chez elle, pas la
peine de se laisser cueillir au Consulat. Un des vice-consuls se décide de nous
conduire jusqu'à Louvain dans sa voiture, après nous devrons tirer notre plan.
La voiture est une quatre-places, de dimensions fortes modestes. Et nous sommes
six. Comme bagage, ce qui peut tenir sur nos genoux. Lucie a tenu à emporter la
caisse de la « Femme Prévoyante » pour qu'elle ne tombe pas aux mains des
Allemands. Ma serviette en est remplie de grosses pièces de cinq francs. A cause
de ce fardeau je suis obligée d'abandonner le petit colis qui contient ce que
je possède de plus précieux. Ce que je maudis « La Femme Prévoyante ! » Louvain. En attendant le
vicinal pour Bruxelles nous entrons dans un café. Une demi-heure après notre
départ le café sera rasé. Bruxelles. Nous y restons
deux, trois jours. Lucie ne veut pas aller plus loin sans avoir vu quelqu'un du
gouvernement. Les Bruxellois s'en vont, matelas attachés sur le toit de leur
voiture. Les régiments anglais arrivent, en route pour le front belge. Canons
et camions sont fleuris de lilas. De magnifiques voitures sont alignées sur les
boulevards, à vendre pour deux fois rien. Personne n'en veut. L'essence est
introuvable. Enfin Lucie réussit à avoir un entretien avec un responsable au Ministère
de la Santé et obtient le « papier » qu'elle convoite. Toutes deux nous sommes
accréditées, oh ! combien régulièrement auprès du gouvernement belge avec
mission de nous occuper des réfugiés belges en France. Par extraordinaire on
nous offre 10 litres d'essence, fond de garage d'un automobiliste qui part à
l'instant. Grâce à cette aubaine nous allons pouvoir trouver une voiture et, le
mercredi de la Pentecôte, en route pour la frontière française, direction
Tournai. A la sortie de Bruxelles nous
sommes bloqués par la file des évacués, plus vraie que nature : camions,
charrettes, animaux domestiques. Une vieille femme, blanche comme si la mort l'avait
déjà épousée, son lit hissé sur une charrette à foin, serre entre les bras un
immense crucifix. La file traîne à pas de vieillard et encore. A chaque
carrefour c'est le même enchevêtrement indescriptible. Les évacués veulent
aller toujours plus au sud, à l'ouest ; les armées françaises arrivent à
contresens. Il fait un temps splendide ;
on en arrive à oublier où l'on est, ce que l'on fait. Notre chauffeur, ancien
ténor à la Monnaie, bavarde à qui mieux-mieux avec Lucie, sauf quand il lâche le
volant pour se lancer à grands gestes dans un air d'opéra. « Monsieur ! Monsieur !
N'oubliez pas que vous conduisez ! » « Ah ! c'est vrai ! » Un homme vêtu de cuir
verdâtre, s'enfuit à toutes jambes à travers un champ de jeune blé. Un parachutiste
sans doute. Nous n'y pouvons rien. Nivelles. Au lieu d'y entrer
directement, nous nous arrêtons sur la hauteur pour prendre un café. Soudain
des avions piquent sur la ville. Des nuages montent de la vallée et le ciel
s'en assombrit. 
Nous contournons Nivelles et
continuons notre route. Tournai enfin! Nous avons
mis neuf heures et demie pour faire 52 kilomètres. Tous les hôtels sont
archi-remplis. Des centaines d'automobilistes s'apprêtent à camper à la belle
étoile. Une amie nous emmène loger à l'école d'Infirmières. « Et vous ? Ne partez-vous
pas? » « Si, quand toute la famille
sera rassemblée. La maison est déjà remplie mais nous attendons encore un frère
avec sa famille ». Pour avoir attendu trop
longtemps, notre amie s'en ira à Ravensbruck. Elle n'en reviendra pas. Lille. Notre chauffeur-ténor
nous quitte pour rentrer à Bruxelles chercher sa femme et ses enfants. L'aviation allemande
bombarde Lille avec ordre et méthode. A dix heures du soir, à une heure et à
six heures du matin. Le maire a décidé de faire évacuer la ville. A moins
d'être porteur d'une carte d'identité française on ne peut même pas s'approcher
de la gare. Il n'y a plus une voiture à Lille. Et on dit « qu'ils » sont déjà
dans la banlieue. Alors ? Par hasard, je rencontre le consul britannique de
Liège. « Que faites-vous ici ? J'ai
une place dans ma voiture. Venez avec moi ». « S'il y a place pour deux,
je veux bien ». Douce après-midi. Nous
roulons en pleine campagne sur une route déserte. Oublié l'exode de Bruxelles,
la cohue de Tournai, les bombardements de Lille. On entend chanter les
alouettes. « A propos, où allons-nous ? » « Mais, à Dunkerque ». « Dunkerque! Pourquoi faire ?
». « Parce qu'il y a un bateau
pour emmener les réfugié en Angleterre ». « Mais nous voulons aller en
France ! » « Bien, quand vous serez à
Dunkerque vous pourrez trouver un autre moyen de locomotion. En attendant, je
crois que nous y entrons dedans en plein ». En effet, Ce ne sont pas des
alouettes qui piquent vers le sol, là-bas au nord, puis se redressent comme
allégées d'un poids. A Dunkerque comme à Lille,
pas moyen de s'approcher de la gare si l'on n'est pas citoyen français. Et la
dernière auto est partie depuis avant-hier. Lucie s'accroche au sol français. Qu'irait-elle
faire en Angleterre ? Elle ne connaît pas la langue. Je n'ai qu'à l'abandonner.
Ah ! ça ! non ! Pas la peine d'être arrivée jusqu'ici !... Pour la contenter,
je fais encore une fois le tour des garages. Nous arrivons avec une heure de
retard au rendez-vous fixé par mon consul aux 600 réfugiés britanniques qui se
sont amenés à Dunkerque. La barrière des docks est
évidemment refermée. Il faut attendre qu'un officier vienne examiner la carte
d'identité de Lucie qui, sur ordre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne
rencontré à Dunkerque, porte la mention qui l'autorise à m'accompagner en
Angleterre. Douvres ! Nous arrivons à 4
heures de l'après-midi. Après quatre nuits de bombardements, - deux selon
l'horaire lillois, deux à Dunkerque à peu près sans arrêt - je me réjouis
d'être à Londres dans deux heures. Dame! l'Angleterre est en
guerre. Je n'y avais pas pensé. La visite des pièces d'identité des réfugiés
n'en finit pas. Enfin, puisque Lucie est retenue parmi les étrangers, j'obtiens
l'autorisation de rester auprès d'elle. Départ de Douvres vers 11
heures du soir, pour arriver dans une gare inconnue à 1 heure du matin. Entouré
par de solides gaillards de la M. P. notre pitoyable groupe de femmes et
d'enfants, de vieux pensionnés et de religieuses subit un nouvel interrogatoire
qui durera jusqu'à l'aube. Puis, en autobus nous traversons une ville immense -
ce ne peut être que Londres - pour arriver dans je ne sais quelle cité-jardin. On nous dirige vers une
sorte de hangar gigantesque où mille lits de soldat sont dressés. Un nous offre
de la soupe aux tomates - à 5 heures du matin - des tartines de margarine. Que
ne donnerions-nous pas pour une bonne tasse de café ! On pourra enfin se
reposer une heure ou deux. Le « lendemain » je veux aller téléphoner. Une infirmière de la
Croix Rouge se précipite. « Vous n'êtes pas autorisée à communiquer avec
quelqu'un de l'extérieur ! » Ainsi, nous apprenons
l'existence de la cinquième colonne, et que nous sommes des suspects, jusqu'à
preuve du contraire. Dans quel guet-apens ai-je donc entraîné cette pauvre
Lucie, moi qui croyais pouvoir l'accueillir en Grande-Bretagne comme je l'ai
fait, si souvent, en temps de Paix ! Heureusement Lucie est «
dépannée » en un temps record, grâce à l'intelligence d'une jeune fille de la
Criminal Investigation Department, qui veut bien me croire quand j'atteste de
la parfaite honorabilité de cette patriote de l'autre guerre, et réussit à
plaider sa cause auprès du Ministre de l'Intérieur. Nous voici libre de gagner Londres. Nous sommes en effet dans la
banlieue. Notre hangar géant est le stadium de Wembley, bien connu des fervents
du tennis. Exil. Oisiveté de la vie d'exil
! Quel supplice. Comme distraction : la lecture des journaux qui annoncent
de jour en jour de plus mauvaises nouvelles. Reddition de la Belgique. Reddition
de la France. Lucie ne tient plus en place, que faire, où aller dans ce
Londres, la Mecque des touristes ? A quoi s'intéresser quand tout l'esprit est
tendu vers le Continent où s'étend toujours plus l'affreuse moisissure
vert-de-gris. Dunkerque. Les Anglais
retrouvent leur tradition de peuple marin ; qui en yacht, qui en barque de
pêche, qui en remorqueur, en chaland, en tout ce qui peut flotter sur mer - un
lac par la grâce d'un été sans nuage - ont ramené le gros de leurs effectifs laissant
canons, munitions, tanks dans les sables rougis de la France. N'ayant pas réussi à
anéantir l'armée britannique, l'aviation allemande s'attaque aux civils pour en
ébranler le moral. Prélude à l'invasion ? C'est probable. Des avions isolés
viennent à toute heure de la journée lancer leurs bombes sur Londres. A toute
heure des trains spéciaux emmènent les enfants vers les régions classées comme
« évacuation areas ». Certains expédient leurs gosses au Canada, en Amérique,
en Australie. Petit à petit les réfugiés
prennent l'habitude de faire un tour à la gare de Waterloo. On échange quelques
mots entre étrangers. On voit parfois arriver des Français. Le premier échelon de
l'armée de de Gaulle est annoncé. Mon Dieu ! C'est ça qui reste de la France ?
Cette poignée d'adolescents chétifs ? Allons prendre l'air à
Hampstead Heath. A peine arrivées, voilà des
promeneurs qui se précipitent au faîte d'une colline, les têtes tournées vers
le même point de l'horizon. Nous faisons' comme eux. De ce haut-point de
Hampstead Heath on découvre tout Londres. Les tours jumelles de Westminster
Abbey, le dôme de St-Paul, l'enchevêtrement des docks, les sinuosités argentées
de la Tamise se perdant là-bas à l'est dans les brumes de mer qui se marient
aux fumées des usines. ... Ah ! c'est cela ... Coup sur coup cette nappe
grise de brouillard est déchirée par la chute en vrille d'un nuage de feu. Un
autre, encore un autre. Sont-ce des Spitfires, sont-ce des Messerschmitts qui piquent
ainsi vers la Tamise? Et voici d'affreux champignons de fumée qui montent
par-ci par-là. « Ils » bombardent les docks, là-bas, à l'est de la cité. Au cœur
des champignons des taches orange : ce sont des dépôts de marchandises, des
usines qui flamberont encore au petit jour. Un instant, et voici au-dessus de
nos têtes une trentaine d'avions en pleine bataille ! Mais si haut, si haut qu'ils
paraissent plus petits que des moucherons. C'est plus passionnant que la boxe
ou le football. Le flegme britannique explose en vociférations, en gestes
ring-side. Une, deux de ces descentes en vrille, - éclair et nuage. Les autres
moucherons vident le ciel. Nous venons d'assister à la
première scène du drame de Londres. « Ils» viendront cette nuit.
Et la nuit suivante, et celle d'après et ainsi de suite pendant plus de six
mois; arrivant, avec leur régularité de boche, tous les soirs à 7,15 heures
sonnantes pour nous bombarder, tout à leur aise jusqu'à 5 h. 30, voire 7 heures
du matin. Pendant les quatre premières nuits, la D. C. A. reste complètement
muette : les avions ennemis rasent les toits des maisons, lâchant leurs bombes
avec indifférence. Après, quelques gros canons, empruntés à la marine de
guerre, donneront la réplique. Justement il y en a un à côté de notre pension de
réfugiés. Cela nous vaut des émotions, quand nous sortons de la maison dortoir
pour aller souper à la maison centrale, et que des éclats de shrapnell pleuvent
sur la chaussée. Non, décidément Londres
n'est pas le lieu de repos que je rêve pour Lucie. Si encore j'avais à y
travailler. Mais les Anglais se méfient de moi comme d'une étrangère. « Vous
êtes restée trop longtemps sur le Continent. Vous ne connaissez plus les usages
du pays ». Alors ? Alors, plutôt que de
continuer à servir de cible, allons en Ecosse, où ma famille est suffisamment
connue pour me permettre d'établir ma respectabilité. 
La patience n'est pas la qualité
dominante de Lucie. En Ecosse il lui faudra cultiver cette vertu pendant huit
longs mois avant de trouver de l'occupation au Ministère du travail belge qui,
dans l'entretemps, a été établi à Londres. Elle rentre d'Ecosse et du coup
renaît, enchantée de se trouver dans un milieu belge, de pouvoir s'exprimer
dans sa langue, de se sentir utile à quelque chose dans ce Londres qui n'a pas
de place pour l'oisif. De fait Lucie aura pour mission de dépister les femmes
belges valides, et de les persuader à prendre part à l'effort de guerre. Les
femmes britanniques sont astreintes au service militaire jusqu'à 45 ans, au
service civil dans les usines jusqu'à l'âge de 51 ans. L'Angleterre n'a pas cru
devoir appliquer semblable mesure aux étrangères. Les fonctions de Lucie vont
l'entraîner à des déplacements invraisemblables dans toutes les banlieues du
grand Londres. Ce n'est pas un des aspects les moins remarquables de « nosse
Lucèye » que de réussir à trouver son chemin, elle dont l'anglais est des plus
rudimentaire, dans le dédale effarant de ces quartiers immenses comme des
villes, d'une uniformité désespérante. Lucie aime son travail, car
elle ne fait pas que « la chasse au matériel de guerre ", comme elle le
dit. Elle a dans ses attributions à s'occuper des plus malheureux parmi les
réfugiés, à leur apporter un peu de réconfort moral et matériel. Elle se «
débrouille » auprès des patrons anglais quand il y a un malentendu à
régler entre ceux-ci et leur personnel belge. Elle reçoit la visite de
marins, de militaires belges en permission. Toute proportion gardée, c'est la
Lucie de Liège qui renaît à Londres. C'est aussi, en, modèle réduit, Lucie
l'internationaliste. Car, quand enfin je peux me libérer de mon service en
Ecosse, je m'aperçois que Lucie est devenue la confidente, « le leader » de la pension de famille où le hasard nous a
conduites en arrivant, pension tenue par des Russo-Arméniens, jadis étudiants à
Liège, et qui abritent des spécimens de 7 nationalités. Janvier 1943 : c'est le
troisième acte: the little blitz. Les avions nous rendent visite à nouveau
presque tous les soirs. La plupart des habitants descendent au rez-de-chaussée
quand il y a alerte. Pas Lucie. Elle est d'un flegme plus que britannique. 1943-44 : quatrième acte :
période des VI. Puis enfin la libération. Par la force du destin Lucie
est redevenue député. Elle rentre en Belgique à bord d'un des avions qui
ramènent le gouvernement. Au départ, à Airways Rouse, au moment où nous nous quittons,
elle est déjà en Belgique, l'esprit tendu, la figure illuminée, paraissant 20 ans
de moins que son âge. Envoi. L'émotion du retour au
pays, les difficultés de la vie après
la libération, et auxquelles ses années d'exil ne l'avaient nullement préparée, ont fortement ébranlé Lucie. Elle
réussit à tenir le coup
quelques mois cependant, assistant comme autrefois à toutes les activités du Parti, faisant le
trajet Liège-BruxelIes, par les
froids intenses de 1944-45, pour
suivre les séances de la
Chambre. Après les
bombardements de Londres, elle
vivra ceux de Liège, et connaîtra le confort d'un appartement sans
feu et sans carreaux. Le hasard d'un coup de vent,
alors qu'elle s'est assoupie de fatigue
dans son fauteuil, va la terrasser. Un de ses neveux, venu lui
faire visite, la trouve sans connaissance. Le médecin, appelé d'urgence,
prononce son épitaphe qui, pour ne pas être fort élégante, est explicite: « C'est fini. Elle ne se relèvera
pas. C'est comme un bon cheval
qui va jusqu'au bout de la
route et tombe pour ne plus se relever. » Magnifique de ténacité, elle s'est quand même relevée,
trompant le médecin pendant quatre mois. Mais cela ne pouvait pas durer. Depuis
bien des années, Lucie est atteinte
au cœur. Elle n'a jamais voulu qu'on le sache hors de son entourage immédiat. Le 25" anniversaire du jour où, si allègrement, elle recevait le Congrès des
Femmes Socialistes pour la première fois à Liège, elle s'en est allée au petit matin, l'esprit préoccupé de la chose publique. « Il
ne faut pas qu'il revienne. » « On
ne le laissera pas revenir, Lucie, tu peux être tranquille.» « Mais c'est qu'il essaie
de revenir, et IL NE FAUT PAS qu'il revienne. » Dors en paix. Il n'est pas
revenu. «De tels êtres ne
meurent pas. On ne les perd qu'à
sa propre mort. Jusqu'alors
réjouissons-nous de leur vie » Georges Bernard
SHAW. [1] E. B. Chalmers – Lucie Dejardin, hiercheuse et député socialiste. Dessins de Forg. Imprimerie coopérative, Huy. [2]
La mise en congé de toute femme
travailleuse pendant six semaines avant et six semaine" après ses couches,
selon la convention Internationale votée par la S. D. N., en 1927, ne
fut ratifiée par la Belgique qu'en 1944. [3] Le projet de loi déposé, en 1872, par le député Vleminckx tendait à fixer l'âge minimum de la descente à 14 ans, pour les deux sexes. La prise en considération n'eut lieu qu'en 1878. L’amendement Jottrand demandant la suppression de tout travail féminin souterrain fut balayé par 86 voix contre 5 et 1 abstention. Le projet Vleminckx, modifié dans le sens de 12 ans pour les gamins et 13 ans pour les filles fut adopté par la Chambre par 52 voix contre 23, mais rejetée au Sénat par 23 voix contre 10. [4] Au Congrès Coopératif des Guildes de Coopératrices, à Verviers, au mois de juin 1926. [5] En 1859 déjà, les tisserands de Gand faisaient grève pour protester contre les économats des usines et des mines, contre le truck~system surtout. Mais il a fallu attendre 1887 pour en obtenir la suppression et le vote d'une loi imposant aux patrons l'obligation de payer leur personnel dans un local réservé à cette fin. Entre voter une loi et la faire respecter, il y a de la marge. A la fin du XIXme Siècle, les ouvriers étaient toujours victimes d'un système qu'à juste titre, ils jugeaient malhonnête. A preuve l'expression ({truc~système»: traduction populaire et péjorative du vocable anglais. [6] La catastrophe de Frameries, qui emporta 123 houilleurs sur les 250 qui se trouvaient dans la mine, le 17 avril 1879, coïncida douloureusement avec la fondation du Parti Socialiste Belge dont les statuts avaient été adoptés l'avant-veille même. [7] Ce
n'est qu'en 1899 que fut votée la loi interdisant aux femmes le travail
souterrain. Toutefois, jusqu'en 1920, certaines femmes travaillaient à fond de
fosse aux côtés de leurs maris. [8] La Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec rayure d’or lui est décernée. [9]
Pour éviter toute objection à la
candidature éventuelle d'une femme, l'article 50 alinéa 3. « Etre âgé de
vingt-cinq ans accomplis » devient
« AVOIR ATTEINT L'AGE style='mso-bidi-font-weight:normal'>DE
VINGT·CINQ ANS ACCOMPLIS » ; alinéa 4 « Etre domicilié en Belgique »
devient « style='mso-bidi-font-weight:
normal'>AVOIR SON DOMICILE EN BELGIQUE » [10]
LA LIGUE INTERNATIONALE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA LIBERTE. - En mai
1915, les style='mso-bidi-font-weight:normal'>femmes de douze pays, dont sept en guerre, prirent
l'initiative de se réunir à La
Haye pour chercher dans l'aspiration commune des peuples la base d'une paix magnanime et honorable. Puis, sous
l'impulsion de Jane Addams, les femmes de quarante pays protestèrent contre les horreurs de la
guerre. Elles formulèrent une Charte de la Paix incorporant les
résolutions votées à leur premier Congrès, qu'elles soumettent aux gouvernements belligérants. A la conférence de la
Paix à Versailles, le Président
Wilson reconnut s'en être inspiré en rédigeant ses 14 points. [11] J. Destrée. [12] Edgard André, de nationalité allemande, fit ses études en Belgique, de 1910 à 1914, a été membre du P. O. B. Rentré en Allemagne, il lutta d'abord comme socialiste puis comme communiste. Il fut arrêté par les nazis en 1933. L'instruction n'ayant rien retenu, il fut, en 1935, inculpé de haute trahison, sous prétexte qu'il avait essayé de changer la constitution de l'Etat allemand. Or, la Constitution en question, celle de Weimar, avait été abolie par les nazis eux-mêmes. L'absurdité de l'accusation n'empêcha pas les nazis de décapiter André. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©