 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Le commandant Léon Motte, un modèle d’officier ! Motte fut le prototype du, commandant de
compagnie en campagne (Colonel Wambersy). Quelle âme magnifique de soldat et de chrétien! Quel
entraineur d'hommes ! (Général Baron Baltia). C’était le plus pur
exemple du devoir et du dévouement à la patrie (Général Tilkens). Ses états de service sont les plus élogieux que l’on puisse trouver dans les annales de la grande guerre (Colonel Pellaert). Nous l'appelions
notre petit Mangin [Lieutenant-Général Collyns). 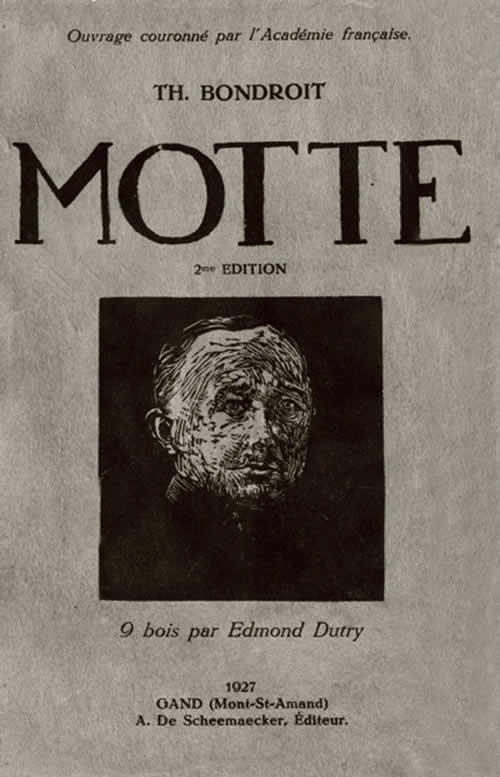
Avertissement
Cet article est rédigé avec comme source principale le livre de Th. Bondroit qui fut professeur de Léon Botrel durant ses
années d’études au collège Notre-Dame de Bonsecours à Binche. Le fait mérite
d’être signalé : il est en effet assez rare qu’un professeur écrive un
livre sur… un de ses élèves. Dr Loodts P. Un petit gars casse-cou puis un étudiant brillant Un garçon idéaliste, né à Leernes en Hainaut le 13 décembre 1887, marqué par la mort de
son ami George décédé à l’âge de 15 ans, par un oncle aimé, le gai luron Livin, qui lui
apprend l’art de la chasse sur les coteaux de la Sambre, par une première peur
à 11 ans dans la cave de sa maison quand, chargé d’y ramener de la bière, une
pétarade le fait fuir, celle due à une grosse bouteille de bière qui venait de
sauter…Bref un garçon choyé par sa famille, heureux et passionné par la lecture
d’un livre racontant l’histoire d’un lieutenant de vaisseau mort à 27 ans et
qu’il relit sans cesse : « Une âme de fer et un cœur d’or ». 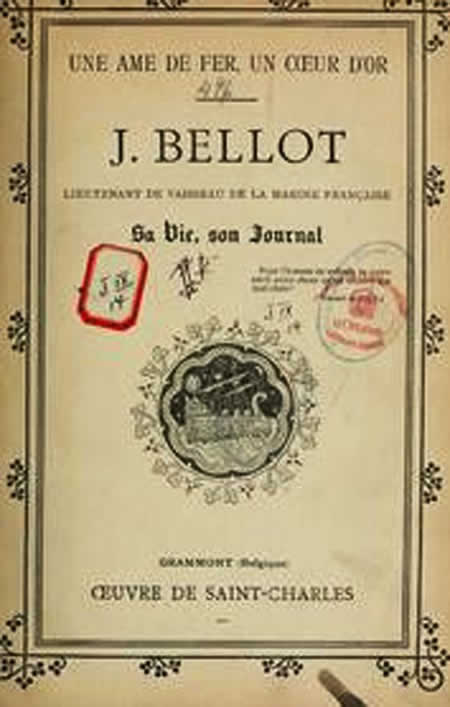
Plus tard il avouera connaître ce livre par cœur tant il voulait ressembler à ce héros. Octobre 1890, le voilà demi-pensionnaire au
collège Saint-Joseph à La Louvière. Dans le train où il prenait place matin et
soir, le petit de sixième joue au rhétoricien et lisait les journaux. Bagarreur
et chahuteur, il répond à tous les défis et notamment à celui de sauter d’un
train en marche. Le train arrivant en gare de Haine-St-Pierre, le voilà qui
saute, tombe et roule sous le marchepied. Le train passé, on se précipite. Pas
une contusion ! Mais une engueulade du chef de gare puis de son père… En
1901, le collège brûle et le fiston est envoyé au collège Notre-Dame de
Bonsecours à Binche. Il s’agit alors d’une période de travail mais aussi de
bonheur de se trouver avec des condisciples qui devinrent des amis qu’il garda
d’ailleurs toute sa vie. Ses professeurs lui font aimer le latin et le grecque
qui lui permet de suivre les grandes épopées classiques. Il se passionne pour les grands guerriers tel
Hannibal et répètera souvent le sonnet de Heredia d’une voix qu’il faisait
grondante : « Annibal écoutait pensif et
triomphant le piétinement sourd des légions en marche »
Passionné, il peut se mettre à la place de ses héros. Qu’il s’agisse de
prononcer quelque harangue de Galgacus ou du paysan
du Danube ou d’évoquer le spectre de la Déroute d’après Victor Hugo, il oublie
où il est quand il monte sur l’estrade. Descendu à son banc, il lui faut une
minute pour reprendre contact avec la classe.
En poésie, il est déjà décidé à devenir officier mais son père veut
l’envoyer en faculté de médecine mais il arrive à faire fléchir son père. Alors
il fit le choix d’une devise : « Marcher, toujours marcher, pour le
bien, le juste, le beau, sans m’inquiéter des difficultés, suivant en tout le
Christ. » Lorsqu’au mois d’août 1905, Léon termine sa
rhéto, il emporte 12 prix, sans compter celui de
« la bonne humeur », prix précieux pour celui qui selon le mot de
Bossuet veut « conquérir » d’abord les cœurs de ses soldats, pour les
conquérir ensuite à la Patrie.
Emouvant, dans son cahier de dissertation, son professeur de rhéto a écrit en bas de son dernier travail un adieu
pathétique à son élève : Léon,
je puis te dire que j’ai toujours lu avec émotion tes travaux. Tout ce qui te
concernant m’intéressait. S’il m’est arrivé de te faire de la peine, ce fut à
regret ; je t’en demande pardon. Je ne t’oublierai jamais. Tu peux compter
sur moi quoi qu’il arrive… Ce sera une consolation de te revoir, de revoir (…).
Bon vent donc ! Bonnes voiles ! a la garde de dieu… Tu seras toujours
notre honneur ! Sa formation militaire En octobre 1905, Léon s’engage comme
volontaire de carrière et rejoint l’Ecole Régimentaire de Dinant afin de se
préparer à l’Ecole Militaire. Le 18 novembre 1907, devenu sergent, après être
passé par le dixième de Ligne, il entre à l’Ecole Militaire. Fier de son état
d’élève-officier, durant les premiers jours de ses vacances, il rendait visite
à son ancien collège où il avait donné rendez-vous à ses anciens camarades. Il
arrivait au galop de son cheval d’emprunt. Un vrai canasson, qui fonça même
dans la vitrine d’une épicerie. Il narrait les brimades de son Ecole et
revisitait les classes. Le soir tombant, il se rendait à la chapelle,
s’agenouillait à sa place d’autrefois puis prenait congé.
Fier de sa promotion, « des Purs » disait-il et dans ses pensées,
cela voulait dire, des officiers qui savaient supporter les contingences les
plus difficiles pour leur Patrie. Il termina ses études après deux ans et
fut nommé le 26 mars 1910 sous-lieutenant. Envoyé à Charleroi, il forme les
recrues et acquis une rapide renommée pour ses causeries et son patriotisme.
Les soldats employaient d’ailleurs son patriotisme pour l’amadouer. Ainsi, un
matin, ne sachant pas les leçons qu’ils devaient connaître, les soldats
décidèrent d’amadouer leur lieutenant en chantant la Brabançonne à vive voix
lorsqu’il pénétra dans la classe. Le visage du lieutenant s’éclaire alors d’un
immense sourire et le voilà dissertant sur la Brabançonne durant toute l’heure
de cours.
En 1913, lors des grandes manœuvres, à Fosses, il est invité par un
collègue dans son logement d’étape à participer au dîner familial de son
logeur. Il fait connaissance d’une jeune
fille, Jeanne Dehogne, qui deviendra sa femme après
la guerre. La guerre éclate, le lieutenant Motte est blessé une première fois
Quand la guerre éclate, Léon vient d’être détaché au 1er
Régiment d’infanterie. Il brûle de se jeter dans la mêlée. Il se distingue le
27 septembre 1914 en montrant sa bravoure dans ses fonctions d’éclaireur autour
d’Anvers. Le 19 octobre, il vient de
parvenir derrière l’Yser avec son régiment quand on signale une mitrailleuse
allemande installée dans une maison qu’on lui demande de détruire. Il s’offre
alors d’amener une pièce à bras d’hommes puis court à 100 mètres seulement de
la mitrailleuse pour observer les tirs. Après deux corrections, le tir détruit
sa cible. C’est un exploit « du pur Motte » comme le dira son major.
Le lendemain il est blessé en amenant une pièce d’artillerie au niveau de la
ligne des tirailleurs. Grâce à elle, l’adversaire ne réussit pas à avancer mais
atteint par des shrapnells à la poitrine et aux mains, il doit être opéré. On
le confesse avant de l’endormir et à l’aumônier lui demandant s’il avait des
péchés à confesser, il répond : « je ne crois pas mais pour plus
de sûreté oui… en tout cas, je demande pardon de tout. » Les médecins lui coupent deux doigts qui ne
tenaient plus que par des lambeaux et Léon est envoyé dans un hôpital à Calais
puis en convalescence en Angleterre où il conquit les cœurs de la famille
anglaise qui l’hébergea. Chaque année, la jeune miss du lieu lui adressera
d’ailleurs quelques paires de gants cousus spécialement pour sa main amochée où
manquaient deux doigts !! Début 1915, sur le navire qui le ramène sur le
continent il écrit à ses parents :
On m’a offert une place dans un bureau bien chauffé ; j'ai fait à
cette proposition la seule réponse qu'elle mérite: Merci, Vous êtes bien bon !
Mais cela, jamais. Alors tant de bras défendent nos couleurs, je me
chaufferais les pieds et je fumerais tranquillement ma pipe fermant peu à peu
ma conscience, à force de me répéter : " Tu as fait ta part, repose-toi !
" Non ! Mille fois non ! Tout le monde a fait sa part ! Et l'éducation
supérieure, je dis supérieure surtout du point de vue moral, que j'ai reçue à la maison
d'abord, à Binche et à Bruxelles ensuite, me
fait un devoir impérieux d'être à la hauteur de ce que réclame mon pays. En
1870, le général Pau eut le poignet arraché. Peu de temps après l'amputation,
on le vit revenir sur le champ de bataille, Je ferai comme lui. Je lui
ressemble déjà un peu, avec ma main ... Je tâcherai d'activer la ressemblance. Le Général commandant la première
division m'a offert le commandement d'une compagnie de chasseurs, certain,
écrit-il, que je la conduirai, en toutes circonstances, dans le chemin de
l’honneur. C'est en effet ce chemin-là que je veux prendre tous les jours, et
non pas le chemin du Bureau. Je vais donc me mettre à la tête de mes
hommes. En avant !
L'extrait du matricule de l'armée porte à la date du 9 mars 1915 :
Réintégré sur sa demande, dans l'infanterie et désigné pour le 1er
Chasseurs à pied. Le 1er Chasseurs occupait, à cette époque, alternativement les
secteurs d'Oudstuyvekenskerke, et de Vicogne, pour des périodes de quinze à vingt jours,
séparées par de courts repos à la Panne. II n'y fut pas longtemps. A la date du
15, il était d'ores et déjà passé au 4ème chasseurs.
Nommé commandant de la deuxième compagnie. Son comportement décrit par
son biographe, est exemplaire :
Partout où il y a de ses hommes Motte est là. Doivent-ils passer aux
endroits dangereux, il leur jette un trait d'esprit, qui fait oublier le
sifflement de l'obus. A-t-il aperçu des éclopés, qui, le jour de relève, ont
été autorisés à devancer les camarades, pour rentrer au cantonnement, il
accourt, s'informe auprès d'eux de leur santé et des événements survenus aux
premières lignes. On le
voit examinant minutieusement l'état des venelles par où se faufileront ses
hommes tout à l'heure. La nuit, il va de poste en poste, dit un bon mot à
l'oreille de la vigie collée au parapet, ranime, d'un geste d'amitié, celui-ci
que le froid déprime, cet autre à qui la pluie donne le cafard. Aux
intellectuels de sa troupe qu’il sait exaspérés par une guerre qui n'en finit pas, il fait part d'un incident
heureux sur quelque partie du front. De temps en temps, il donne l'ordre de
lancer une fusée éclairante, de tirer quelques coups de fusil, secouant de la
sorte la rouille des corps, la rouille aussi des
âmes. Durant l'hiver, s'il perçoit, dans la nuit noire et mouillée, qu'un de
ses hommes de garde est en proie à quelque accès de toux, il s'en va, sur la
pointe des pieds, lui réchauffer, à l'abri des regards boches, un bol de café ;
ou encore, arrachant un morceau de sac-à-terre, il râpe dessus un peu de bougie
afin de préparer, à cette mèche improvisée, le breuvage du bon samaritain. Le
matin, lorsqu'après un nuit particulièrement dure revient la troupe, il accoste
ces hommes, dont la tête s'enfonce dans le collet relevé de la capote ou dans
l'écharpe blanche d'aigail, dont tes mains roide s'enfoncent dans les poches,
dont s'enfoncent les pieds dans la paille de sabots à la mode flamande, dont
s'enfoncent les sabots en pleine gadoue. D'un mot du cœur, il ramène un sourire
furtif sur leurs faces méconnaissables et rallume leurs âmes au feu toujours
incandescent de la sienne.
Léon Motte était né pour l’action et pour tromper son attente, il
organisa maintes patrouilles dans le no
man’s land.
Mi-novembre, le voilà nommé capitaine au 14ème de ligne. Réunissant
ses hommes, il leur dit adieu : « Vous avez comme commandant un ami à
moi. Je vous demande à tous de servir avec lui comme avec moi… »
Il lui fut impossible de continuer et en pleurant il serra la main de chacun de
ses hommes. Heureusement son absence auprès de ses soldats bien-aimés ne fut
pas longue ! Après un mois, sans doute suite à son insistance, on le renvoya
au 4ème Chasseurs. Son premier souci fut à nouveau le bien-être de
ses soldats. Aux premiers froids, il prit un jour l’auto mise à sa disposition
par le colonel pour aller quérir à l’arrière des lainages, chaussettes,
caleçons. Sa moisson fut fructueuse pour la plus grande joie de ses hommes.
Du 10 janvier au 3 février 16, le
régiment occupait le secteur du boyau de la mort puis après un cantonnement à Oudstuyvekenskerke,
le régiment, en mai 1916, fut de garde dans le secteur de Dixmude. Durant l’été, il lui fut accordé un congé pour La
Panne qu’il mit à profit pour chasser avec un ami médecin et faire ample
moisson de canards et de lièvres. Au cantonnement, ce chasseur invétéré
n’hésitait pas à braconner et fut à plusieurs reprises poursuivi par les
gendarmes. Un jour, au moment où il se voyait presque rattrapé, il eut la
chance de rencontrer un de ses hommes. Il revêtit la veste et le bonnet de
police du soldat. Les gendarmes arrivés sur place furent étonnés de ne plus apercevoir
l’officier braconnier qu’ils poursuivaient mais un simple soldat qui les envoya
dans une fausse direction.
Au cours de l’hiver 16-17, dans le secteur de Dixmude, l’ennemi ne se
privait pas d’une attaque de temps en temps. Le soir du 1er février
1917, nombreux avaient été les blessés. Motte se préparait à nouveau à relever
le poste avancé mais en plus voulait tendre une embuscade aux Allemands qui
oseraient encore lancer une attaque nocturne. Avec un 1er sergent,
il traverse l’Yser puis se glissa jusqu’au pied du parapet ennemi. Ils attendirent toute la nuit mais personne
ne sortit des tranchées ennemies. Ils s’en retournent donc vers 5 heures du matin mais une balle vient tout à coup le
blesser à la cuisse gauche. Le 1er sergent parvint heureusement à
transporter son chef jusqu’au radeau puis à traverser l’Yser. Le
lieutenant Edmond Dutry,
commandant en second de la compagnie, organise alors un raid pour venger son
capitaine mais l’aventure tourne mal : une sentinelle allemande est tuée
et l’alerte est donnée. Edmond, blessé à la fesse, parvient cependant à ramener
tous ses hommes dans ses tranchées mais doit aussi être hospitalisé à l’Océan. Hospitalisé à l’hôpital l’Océan Motte hospitalisé à l’Océan pour une fracture du fémur (heureusement sans déplacement des fragments) est stupéfait de voir arriver son ami Edmond quelques heures après lui. Ils se retrouvent tous deux dans une chambre avec des blessés de leur trempe : il s’agit du Père de Groote et du lieutenant de vaisseau Marrast appartenant aux fusiliers marins de l’amiral Ronarch. Tous ces hommes valeureux se promettent l’un l’autre de ne jamais se plaindre. Leur chambre résonne de leurs rires mais il y a aussi des conversations plus sérieuses quand Motte parle des vrais soldats qu’il admire et qu’il nomme à sa façon « les Purs ». Parmi eux Leman, Castelneau, Grossetti. Le lieutenant de vaisseau Marrast était lui-même considéré comme un « Pur » par Motte. Menacé de perdre un œil, soigné depuis deux mois il s’impatientait de rejoindre sa compagnie. On répondait de sa guérison mais à la condition de rester encore à l’hôpital or, après deux mois d’absence au front, on remplaçait le chef. « Docteur dit Marrast, on voit bien que vous n’avez jamais commandé une compagnie. Entre la perte de mon œil et la perte de ma compagnie, je n’hésite pas ! » Motte ne s’était pas trompé sur l’héroïque Marrast. Ce dernier mourut en héros lors de la bataille du moulin de Laffaux le 14 septembre 1918. Il est enterré non dans un cimetière militaire mais à proximité du lieu où il combattit, en pleine campagne, à côté de son ami l’Enseigne de vaisseau Dubois). 
A l’aube du 14 Septembre, à l’extrême pointe de notre avancée, l’Enseigne de vaisseau DUBOIS tombait frappé d’une balle en plein front, et à quelques minutes d’intervalle son commandant de Cie le Lieutenant de vaisseau MARRAST était tué lui aussi d’une balle au front, au moment même où un courrier lui annonçait la mort de son fidèle lieutenant. Leurs tombes jumelées, pieusement édifiées par leurs familles, constituent le symbole émouvant de leur destin commun de lutte et de glorieux sacrifices. Tous deux avaient été affectés à la même compagnie lors de la dissolution de la Brigade en 1915. Fraternellement unis pendant 35 mois de combats, ils devaient rester unis dans la mort et après la mort. Témoignage du Commandant de vaisseau Feuillade. « L’avant-veille de l’attaque, je vis le Lieutenant de vaisseau MARRAST (de retour de permission depuis 4 jours). Il me montra d’un large geste les lignes de tranchées ennemies s’estompant devant nous et me dit : « Bah, le bataillon a de quoi mourir en beauté » Le jour même, il écrivait à sa sœur : « nous partons demain pour la grande attaque de l’Armée MANGIN, si je dois y rester, mon seul regret sera de te quitter, car, en un pareil moment, avec d’aussi belles espérances de victoire, et avec des hommes comme les miens, il n’y a pas de bonheur plus plein que de donner sa vie pour la France avec un cœur calme et une conscience tranquille » Photo, explications et témoignage proviennent de : La chambre des « Purs » était souvent visitée. Le général Jacques en personne s’y rendit mais aussi de très nombreux soldats de la compagnie Motte. Après deux mois d’absence, Motte reprit à son grand soulagement le service à la tête de sa compagnie. Été et automne 1917 : six mois de coups durs et
de déceptions En juin 1917, Léon est averti du décès de sa grand-maman et de sa maman. Il éprouve un grand chagrin. Après deux années de guerre, ce me fit un rude coup. Aujourd’hui encore, je me console qu’en priant et en faisant prier pour elles… écrit-il à un ami. En souvenir de sa maman, il fit célébrer un office à Kruysabele sous une tente. Malgré le caractère privé qu’il voulait donner à cette cérémonie, il se fit que pas un homme de sa compagnie ne manqua d’y assister. A cette tristesse vint s’ajouter une importante déception professionnelle. Le premier juillet, l’ennemi déclencha une attaque sur son secteur d’Oudstuyvekenskerke. Surprises en pleine relève les postes avancés se défendirent héroïquement (le sergent Lagneau ayant défendu son poste à coups de grenade fut cité par le colonel allemand d’en face comme un exemple) mais cette affaire coûta au régiment cinq tués, 22 disparus et douze blessés. Il fallut trouver un responsable ou plutôt une victime et ce fut Motte qui fut désavoué par certains de ses chefs. C’est le général Jacques lui-même qui mit fin à l’affaire en ne voulant pas la moindre mesure à l’encontre de l’officier. L’affaire fut classée mais la blessure infligée à Léon resta longtemps à vif. Enfin, pour terminer cette époque malchanceuse, il y eut un de ses meilleurs amis et collaborateurs, son lieutenant, celui-là même qui fut hospitalisé en même temps que lui à l’hôpital l’Océan qui, quelques jours après avoir rejoint le front, fut atteint d’une balle à la tête. Appelé à son chevet, Motte le voit déjà mort et pleure devant son frère d’arme. Mais les jours passent et miracle, son ami se rétablit peu à peu. La vilaine époque se termina le 23 octobre quand le colonel Wambersy le proposa en haut lieu pour suivre les cours au Centre d’Instruction d’Etat-Major. On lui laissa le choix d’accepter ou de refuser. Motte préféra rester auprès de ses soldats, mais cette proposition l’honorait et mettait fin définitivement à la cabale menée contre lui en juillet. Un officier, idole de ses hommes Voici le témoignage de son ami le lieutenant Edmond Dutry[1] au réveillon de Noël à Vinckem : 
La représentation se donnait dans
le baraquement où logeait la deuxième compagnie, au beau milieu d'une prairie.
On y accédait en mettant le pied, à chaque enjambée, dans une ancienne
empreinte, devenue si profonde par l'usage qu'elle vous raccourcissait de toute
la hauteur du mollet ; puis le pied posé, il fallait le retirer, et il ne
sortait qu'avec des coassements de boue. Or, pour faire honneur à Motte, on
mettait ses bonnes chaussures. Ce brin de toilette nous avait mis un peu en
retard. Déjà toute la baraque était devenue ce que j'appellerais volontiers un Grandgosier. Les cuivres ne s'entendaient même
plus. On chantait Tipperary. Le
spectacle avait commencé. Je dois dire que ce baraquement
convenait admirablement. Au long des parois, comme dans les auberges du Far West, du moins d'après le cinéma,
courait un balcon chargé d'hommes couchés en gargouilles pour voir la scène. La
scène ? C'était le fond du baraquement, déblayé de toute la paille qui servait
de couche aux hommes, et drapé de couvertures. L'orchestre ? Six des plus
bruyants instrumentistes de la fanfare régimentaire, sous la direction d'un
piston. Je les vois encore, alignés d'une manière imposante, le long du mur. Au premier rang, sur des escabeaux, les
officiers. Au milieu d'eux trônait Motte ne se possédant plus de joie après le
premier morceau, l'Ouverture, comme
il disait. A ses pieds, allongé en flèche, le museau sur le bout des pattes, je
vois encore Duc, grognant
quelquefois, mais, en général, indifférent. Derrière nous, la salle comble ! Une
soirée de Première ! J'allais
oublier le grand échanson là-bas, au fond de la salle, préposé à la
garde du robinet, distribuant de la bière, de la bonne bière. Chaque homme
avait reçu deux cigares à fumer, et les fumait. Bonne précaution ! Le tabac est
un excellent désinfectant pour un dortoir. Le programme ? Oh ! Très chargé ! Etrange
parfois ! Emouvant toujours. Un jass entre en scène. Très gêné devant nous, il
salue avec une gaucherie charmante et retrousse ses manches avec la même
gaucherie charmante. Puis, sur la table, là, en face, il retourne deux jattes
toutes blanches. Sous l'une d'elles il place une boule rouge, et sous
l'autre... rien. Alors il nous regarde sérieusement. Toute la salle est en
arrêt devant les deux jattes... Il les retourne... Eh bien ! la boule rouge,
nom d'un chien, avait changé de jatte... On applaudit. Il salua, toujours avec
sa gaucherie charmante. Sa bonne figure devint rouge. Sans dire un mot, il
continua un tas d'expériences d'un aussi fort calibre, et finit par nous
montrer l'impossible ! De ma vie, je ne verrai prestidigitateur plus sympathique.
Et Motte n'était plus de ce monde ci ! Comme il donnait le signal des
applaudissements... Voici maintenant un tableau de Frans Hals : un
accordéoniste assis sur une chaise usée, oreille collée au soufflet. Quel régal
! Des airs du terroir, des bribes d'Opéra que toute la salle connaissait et accompagnait, prise vraiment aux
entrailles. J'étais ému, comme de juste. Venait enfin une Comédie d'un ridicule achevé, avec un
homme déguisé en femme. Il n'avait pas dix mots à dire, mais il mit en
incroyable liesse toute l'assistance. Cocasse ! Emouvant ! Et Motte plus
émouvant encore ! Avec une gravité étonnante, de la part d'un roublard tel que
lui, chaque fois qu'il n'était pas sûr du succès d'un entrant en scène, de peur que son jass ne fût pas suffisamment
applaudi, il nous renseignait sur ses qualités guerrières ; et si, franchement,
l'acteur était tout à fait nul, Motte renchérissait sur sa valeur, non pas
assurément de comédien, mais de soldat. De vrai, c'était touchant. J'ai vu là
des acteurs stupides, hilarants au possible. Braves gens ! Heureux de rire !
Mais surtout heureux, je crois, de rire ensemble. Ils étaient trop souvent
malheureux ensemble, ensemble avec Motte ! Car il était visible qu'ils ne
faisaient qu'un avec lui. La fête se termina trop vite. La Brabançonne éclata. Toutes les gargouilles se
dressèrent et nous avions les larmes aux yeux à les regarder debout, immobiles,
les muscles tendus. Motte ici décrit son ami Jacques Dedoncker, mort au front le 1/11/18 à Landegem. Mais à travers ce texte, on perçoit sa propre personnalité.
Sa grande préoccupation, dit-il,
était le sort de ses soldats. Quel souci ne prenait-il pas de leur
installation, de leur logement, de leur nourriture ? Il entrait dans les plus
petits détails pour trouver un adoucissement à leur vie de fatigues. Il ne comptait
ni peines ni argent, lorsqu'il s'agissait d'atteindre ce but. C'est qu'il les aimait comme des enfants. Et
quel culte pour eux ! Que de fois ne m'a-t-il pas dit : « Les hommes sont
franchement admirables de supporter, comme ils le font, tant de travaux, de
dangers, d'inconfort. Malgré
tous nos efforts, nous ne pourrions faire assez pour eux. » Et là-dessus,
il me proposait l'une ou l'autre chose, de nature à les distraire et à les
réconforter. Souvent je le surprenais s'entretenant familièrement avec eux,
s'inquiétant du sort de leurs familles, leur parlant de nos gloires, leur
disant nos motifs d'espérer, leur affirmant sa foi dans la victoire. Il les
connaissait tous individuellement. Il savait les malheurs de celui-ci, les
joies de celui-là ... « Je ne vis plus que pour eux », me disait-il. Aussi
l'aimait-on et combien ! Quelle confiance sans limites ses hommes n'avaient-ils
pas en lui ! Quand ils apprirent sa mort, quel abattement ! Ils disaient
« Ce sont toujours les meilleurs. » Toujours à propos de Jacques Dedoncker, Léon Motte nous décrit ce que doit être pour lui un officier :
Je me souviens avoir lu quelque
part qu'un officier doit être avant tout un homme, de cœur. Manifestement la guerre a prouvé la
vérité de cette parole. Elle a montré à suffisance ce que l'on peut attendre,
en dépit du danger et de la lassitude, de ceux qui ont du cœur. Avoir du cœur, c'est aimer sa troupe.
C’est sans faiblesse être bon pour elle, comprendre ses souffrances et les
partager, s'unir intimement à ses misères comme à ses joies. Avoir du cœur, c'est souffrir gaiement
et sans se plaindre, supportant le froid, la chaleur, la fatigue, avec une âme toujours égale. Avoir du cœur enfin, c'est ne désespérer
jamais. C'est se rendre compte qu'à la guerre rien n'est jamais perdu tant que
l'on garde la foi dans la victoire, une ardeur toujours égale dans l'action :
et, aux heures les plus noires, c'est montrer un visage serein, trouver le mot
qu'il faut afin de dissiper de trop hâtives alarmes. Motte tout en étant un meneur d’hommes était un officier très sensible. Ainsi le 21 juillet 1917, un maladroit de sa compagnie en manipulant des grenades a fait sauter tout le stock de son poste. Un soldat témoigna par écrit qu’à la vue d’un des blessés qui avait la gorge ouverte et le visage noirci, Motte sanglota alors comme une femme ! Son amour pour ses hommes se manifestait aussi par des gestes de générosité. Son ordonnance, le fidèle Selvais aimait à raconter comment son chef donnait volontiers de sa poche aux soldats nécessiteux. Cependant il était intransigeant sur la discipline et l’équipement. Ses hommes devaient être d’une propreté parfaite et gare à celui qui n’avait pas dans son paquetage les 120 cartouches et son lot de biscuits et de rata. 
L’esprit du 1er bataillon du 4ème
Chasseurs à pieds
Dans la compagnie et le bataillon de Motte règne un esprit bon enfant
mais héroïque. Léon Motte côtoie au quotidien nombre d’officiers et soldats
d’un courage exceptionnel. Il y avait l’ingénieur Marius, toujours prêt à
rejoindre Motte dans ses incursions dans le no man’s land. Un jour en
expédition avec Motte, il se relève pour mieux apercevoir la minoterie de
Dixmude tenue par l’ennemi. Il s’en fallut de peu pour sa vie car une balle
siffla à deux doigts de son visage. Les deux amis continuent leur ronde puis en
repassant sur le chemin de retour par le même endroit, Marius refait le même
geste devant la minoterie. Il se relève mais cette fois une balle le tue en lui
perçant le crâne. Motte est narré d’autant plus qu’il doit défendre la
réputation de son ami tué qui est taxé d’imprudent par des officiers. Motte
leur répliqua : « Marius a été
surpris par la mort au moment où il s’exerçait à la mépriser. A la guerre, et
chez les héros, il est impossible que le mépris de la mort ne devienne pas un
mépris sans mesure, un mépris implacable. Le signe du courage héroïque, c’est
qu’on ne lui refuse rien, à cet ogre qui vous dévore à la fin, et qui s’appelle
courage militaire. (…) Bref, il nous semble à nous qu’une telle mort est le
triomphe le plus péremptoire de l’âme sur les sens » D’après son biographe Th. Bontrel, le bataillon était le repaire de nombreux hommes exceptionnels imprégné du même esprit que Léon Motte. Je retranscris ici la description qu’il donne de quelques-uns des compagnons d’armes du commandant Motte :
Pour ne parler que des morts, Thioux n'avait-il pas cet esprit, lui qui, malgré sa foulure au
pied, refuse de se laisser évacuer, parce que quelqu'un, croyant lui faire plaisir,
vient de lui dire à l'oreille : « Ainsi, Thioux tu échapperas à l'attaque ? » Or, Thieux engagé volontaire de 56 ans, avait
deux fils sur le champ de bataille, où l'un a laissé une jambe et l'autre sa
santé. Thieux que l'on surnommait « l’optimiste
béat » était la joie même, la jeunesse même,
et, si l'on peut ainsi parler, la « paternité » pour ses hommes. Ah ! disait-on, comme le vieux sioux, il n'y en a pas deux sur terre !
Est-ce que Lerat au nez fin, surmonté de lunettes d'or, Lerat auquel on avait donné le sobriquet de « petit bonze » dont l'organisme
était celui d'un enfant, mais dont les gestes révélaient l'énergie la plus
troublante, est-ce que Lerat n'était
pas imprégné de l'esprit de
Motte ? Il aimait à faire sauter le bouchon, mais quel mal si terrible y
voyez-vous ? Dans la zone des armées, tous les bouchons boches pouvaient sauter, cela lui était égal ; et
jamais un de ses hommes n'aurait seulement cillé, quand il était là, à côté d'eux. Avec une admiration,
qu'il était loin de dissimuler, Motte nous rapportait ses dernières paroles : « Quelle belle bataille ! » s'écria-t-il
en expirant ! Thioux et Lerat sont tombés le même jour, le 3 octobre 1918. Et Francotte volontaire de guerre, père de
plusieurs enfants, n'était-il pas imprégné du même esprit ! Le commandant l'appelait un dur à cuire. « Celui-là, disait-il, il ne faut jamais le
mettre en tirailleur, le matin. Il se lave en plein air, le torse nu, malgré
tous les froids, ne voulant jamais qu'une seule couverture pour dormir. » Cet homme, ajoute le lieutenant E. D, au
milieu des bombardements les plus fulminants, fumait sa pipe avec le même
rythme paisible. « Il tomba, lui aussi, en 1918, en même temps que Cambron. Firmin Cambron, un
bibliophile et un chimiste. » Sérieux comme un pape, écrit le lieutenant E.
D., Cambron s'occupait de ses
hommes avec l'intérêt passionné qu'il mettait à une recherche scientifique,
avec la même ténacité. » Et
tout naturellement revient ici le nom de Jacques Dedoncker, le grand Jacques, le joyeux Jacques, que Motte faisait si
volontiers « fumer ». Il semble bien que ces figures de Motte et de Dedoncker, si proches l'une de l'autre par
tant de traits, ne puissent jamais être évoquées l'une sans l'autre. Comme son
ami, Jacques fut un patrouilleur hors de pair. A la 2ème compagnie,
il promenait son mètre nonante partout,
mais de préférence aux endroits
sensibles. L’esprit de Jacques, admirez comment avec quel brio le dépeint son alter ego : « Qui donc a jamais entendu notre Jacques se
plaindre ? Et cependant comme il a souffert ! Qu'il rentrât de
patrouille, transi, percé, gelé, après avoir rampé dans les herbes, durant de
longues heures, ou s'être posté à l'affût, dans un trou d'obus ; qu'il eût
passé aux avant-postes toute une nuit d'hiver à faire les cent pas, au milieu
des balles, sur les passerelles glissantes, pour s'étendre ensuite, le jour
levé, dans un abri ouvert à tous les vents ; qu'il revînt d'une de ces longues
marches, par une pluie battante, et par des chemins où l'on s'enfonçait
jusqu'aux genoux, il était toujours le même, gai, d'une gaieté presque
paradoxale, sans jamais le moindre murmure ! » C'était tellement sa joie
et sa gloire à lui – il nous le disait souvent – d'appartenir à l'infanterie,
qu'en échange de ce bonheur, il admettait la souffrance, sous quelque forme
qu'elle se présentât, qu'il l'aimait presque, et qu'il ne comprenait son métier
qu'accompagné de cette austère, mais combien salutaire amie. » Nous ne pouvons oublier non plus ni Kremer, dont le rêve était également de
rendre l'âme dans le feu d'une belle bataille, ni Maurice Putzeys, qui avouait
candidement sa peur en plein bombardement, mais dirigeait sa troupe avec le
calme d'un maitre de gymnastique dans une cour d'école, conduisant ses hommes jusqu'aux moindres défilements, ne reculant
jamais d'un pas par crainte de s'exposer. Telle était la famille spirituelle de Motte. Motte : un soldat mis un intellectuel aussi. Sa chambre était celle d’un intellectuel. Sa table jonchée de livres et de cahiers de note. Dans un de ses cahiers on découvrit les pages qu’il avait recopiées du « Prix de la vie » de Léon Ollé-Laprune :
« On n'est pas un homme si on
ne sait pas mourir. Toute grande action entraîne un labeur qui est un
commencement de mort, puisque c'est une usure, une dépense de force vitale.
Cela est vrai dans tous les ordres. Et si l'on n'est pas prêt à mourir quand il
le faut, quelle vie mène-t-on ? Quelle entreprise hardie osera-t-on aborder ?
Pour vivre grandement, noblement, généreusement, il faut embrasser la mort.
L'héroïsme ne paraît si admirable qu'à cause du peu de cas qu'il fait de la
vie. Il ne la ménage pas, il la prodigue et il accomplit des merveilles. Le
dévouement semble le dernier mot de la vertu. C'est qu'il achève ce que le
désintéressement commence : le dépouillement de soi, l'oubli de soi, le don de
soi, la perte de soi. » Léon Motte nourrissait son courage de ce genre de lecture ! Sa chambre n’était pourtant pas qu’une salle d’étude. Elle était aussi le lieu de rendez-vous des officiers et des inférieurs qui aimaient se grouper autour de lui car il était un boute-en-train, allumant des discussions, faisant fumer ses camarades, organisant des farces. Ainsi un jour, visant un corbeau, il le blesse et l’aile brisée il tombe et est ramassé puis placé dans le bas du lit d’un de ses amis lieutenant. Celui-ci en se couchant se fit mordre au gros orteil, cria, jura et déclencha l’hilarité parmi les officiers qui s’étaient réunis en dessous de la fenêtre … Un croyant très pratiquant 
Au front il assistait tous les jours à la première messe et y communiait. Sa foi était celle d’un intellectuel qui devait être constamment alimentée par la lecture et la réflexion. Léon trouvait beaucoup d’inspiration dans Bossuet. Pas étonnant qu’il devint l’ami d’un autre héros, le Père de Groote, toujours debout à 4 heures du matin pour pouvoir dire sa messe de très bonne heure. Le lieutenant Edmond Dutry a le souvenir d’une de ces messes :
C'était à Caeskerke,
dans la seule chambre qui, à cet endroit du front, eût gardé un coin de plafond.
Dans le village, toutes les tuiles avaient été éparpillées au vent, comme des
confettis, depuis longtemps ! Le capitaine Lekeux
avait fait une chapelle sous ces vestiges de plafond, lorsqu'il était venu, à
deux pas de là, installer son observatoire, après avoir quitté Oudstuyvekenskerke. Or Lekeux, à l'instar
de son patron saint François d’Assise, était un bâtisseur d'églises ou plutôt
de crèches. Une haute table surmontée d'un petit
tabernacle en bois. Au-dessus, un dais composé d'un bout de bâche. Précaution
sage. Des bâches aussi aux fenêtres. En ce lieu de bombardement, les carreaux
avaient disparu, depuis belle lurette. Le jour venait par les trous du plafond
et par la porte ouverte. Le camarade B… , notre aumônier, m'avait prévenu qu'il
dirait la messe à la chapelle de Caeskerke. J'y fus
donc. Motte y était déjà. Deux brancardiers du poste de secours s’y trouvaient
avec lui, ainsi que le commandant L. qui servit la messe. Celle-ci était à
peine commencée que l'artillerie ennemie se mit à battre l'ancienne gare, sise
à une cinquantaine de mètres de la chapelle. Si elle avait allongé d'un rien
son feu, elle nous eût englobés dans la
fourche de son tir. Feu terrible ! Et c'était ainsi chaque fois que l'artillerie pilonnait ce carrefour. En effet,
progressivement l'artillerie allongea son tir vers l'observatoire du capitaine Lekeux. Dans les silences d'une mortelle anxiété, entre les
explosions de plus en plus rapprochées, les paroles de la messe se suivaient
lentes et douces. L'envie me prit, un
moment, de fuir vers l'abri bétonné du poste de secours. Mais Motte ne bougeait
pas, feignant de ne rien entendre, indifférent à la mort qui nous cherchait.
Aux ébranlements du sol provoqués par chaque explosion succédait, sur le bout
de plafond, une grêle de pierres, d'éclats, de terre, tandis qu'une âcre fumée
nous prenait à la gorge. A un éclatement plus proche, la petite porte de la chapelle
frappa violemment, presque arrachée. Le tir insistait toujours. Avec une pieuse
lenteur l'aumônier acheva sa messe. Puis furent récités les trois Ave tour à tour perdus ou plus nets
selon qu'éclataient des obus ou que d'effrayants silences attendaient les
suivants ... Lorsque l'aumônier eut rangé dans sa
petite valise les ornements et les objets liturgiques, nous sortîmes pour nous
réfugier au poste. Le pavé était éventré çà et là et recouvert de terre
fraîche. A quatre pas de la chapelle, je comptai trois trous d'obus. Le calme
de Motte m'impressionnait. Il avait communié !... C'était son habitude chaque
fois qu'il pouvait assister à la messe. Même en voyage, pendant ses congés, il ne manquait jamais ni la messe ni la
communion. La communion était la grande préoccupation de Motte. A
l'hôpital, raconte le P. de Groote, comme on m'avait lié le bras sur une
planche afin de l'immobiliser, je dus demander à l'aumônier de m'apporter la
sainte Communion. Aussitôt Motte en profita, et, après seize jours, lorsque je
pus me lever, j'eus le bonheur d'apporter, à mon tour, à ce grand chrétien, si
fier, sans aucune ostentation de sa foi, la communion de tous les jours. Souvent,
ajoute le révérend Père, dans les cantonnements, il profitait de ma présence
pour se confesser. Je sais qu'il disait son chapelet chaque jour, et qu'il n'y
eût pas manqué pour un empire. Il tirait son chapelet de sa poche, nous rapporte
Edmond Dutry, aussi naturellement qu'il prenait son
mouchoir. Le connaissant encore que de vue, c'est à ce geste que je m'aperçus
qu'il était quelqu'un. Le
fidèle Servais nous apprend qu'outre son scapulaire, Motte portait suspendues à
son cou par une chaînette d'argent, une petite croix et quelques médailles. Dans
la poche de sa tunique ajoute l'ordonnance, j'avais l'ordre de placer, tous les
matins, son livre de prières et son chapelet. Capitaine-commandant Nommé le 26 décembre 1917, il resta l’homme des avant-postes afin de s’assurer de la solidité de ceux-ci et de la sécurité des hommes qui y sont. Le 5 juin 1918, on ne lui donne plus le choix, ou bien il accepte une mutation au Q.G de sa Division, ou bien il est muté à l’école d’état-major, le C.I.E.M établi à Furnes. Léon opte finalement pour être adjoint à l’E.M. de la 9ème division d’infanterie. Son ami, le lieutenant Edmond Dutry est lui aussi forcé de quitter sa compagnie et rejoint Saint-Lô pour devenir instructeur de l’école des sous-officiers. Léon lui écrit sa tristesse de devoir quitter ses hommes. Mon cher E., Oserai-je
t'écrire ?... Ai-je bien fait ?... Ai-je mal fait ?... Mon Dieu, quelle crise
je traverse ! Passera-t-elle jamais ? Ecoute : une place étant devenue vacante
au Q. G. de notre D.I, je fus appelé le soir, et l'on me demanda si je ne
désirais pas y aller. On ajouta : « De toute façon, vous devrez bientôt
quitter vos hommes, vous irez sans doute au C. I. E. M. » Je répondis : « Dans
ces conditions, soit. » Et le
lendemain, je suis parti. Atroce a été la séparation. Ah ! En regardant toutes
ces bonnes figures de soldats qui vivaient avec moi depuis trois ans, je
m'attendais que mon cœur faiblirait. Il m'a été impossible de prononcer un mot.
J'ai pleuré en serrant rapidement des tas de bonnes grosses mains. Une chose
pourtant me console, c'est que je les revois encore, tous les jours, que je
demeure tout de même avec eux, et que j'irai leur dire souvent bonjour. Malgré
les charmants camarades qui entourent à l'E. M., je ne me remets pas de ce
départ. Tu peux être certain que je continuerai à rester l'ami et le défenseur de la troupe avec
laquelle j'aurai le plus de contact possible. Qu'en
penses-tu, mon cher ami ? Ai-je bien fait ? Dis-moi franchement ton opinion. Thioux et Landrin vont sans doute
reprendre mon unité. Lerat va rentrer dans quelques
jours. Bien
à toi. Motte En congé, Motte ira voir son ami à Saint-Lô emmenant avec lui leur ami commun Jacques Dedoncker. De là ils visiteront le mont Saint-Michel et Saint-Malo. Ce fut le dernier congé avant la grande offensive. Par tous les moyens, il essaie de quitter l’E.M. L’offensive est déclenchée le 28 septembre. Le 1er, Motte est blessé par un éclat d’obus à Oostnieuwkerke alors qu’il effectue une reconnaissance pour son E.M. Il est forcé de rejoindre une nouvelle fois l’hôpital l’Océan. Le 4 octobre, son régiment est mis au repos à La Panne pour se refaire une santé. Le régiment souffre de nombreuses pertes : Crémer, Lerat, Thioux sont tombés au champ d’honneur, son ami Edmond est hospitalisé à Vinckem, blessé gravement. De 17 officiers de son bataillon, seuls cinq reviennent indemnes à La Panne. Léon court revoir les « anciens » et leur promet de reprendre sa place parmi eux. Il y parvient le 10 octobre tout simplement parce qu’il y a eu cette hécatombe dans les rangs de son bataillon. Le 14 octobre, le bras en écharpe, il est acclamé par la 2ème compagnie rassemblée sur deux rangs. Le 18, ils sont à Thourout. Le 31, la compagnie reçoit l’ordre d’attaquer Landegem. Son ami le lieutenant Jacques Dedoncker est blessé d’une balle dans la poitrine en sortant de son abri. Il succombera le lendemain, le 10 novembre, le bataillon est devant l’Escaut. Ce sont des patrouilleurs du régiment qui sont chargés de franchir les premiers le fleuve. Motte participe à leur action. Le 11, la guerre est finie. Après quelques jours de repos à Leernes, Motte rejoint à nouveau son bataillon pour l’accompagner en Allemagne à Reydt puis à Dusseldorf. A la fin du mois de février 19, il s’en va suivre à Bruxelles les cours de l’Ecole de Guerre. Son moral est entaché, il lui manque l’action et la vie du bataillon. Dans une lettre à son ami Edmond, il décrit sa morosité :
Nous avons sauvé le pays, mais,
dans notre pays, nous ne sommes déjà plus rien. Nous sommes mangés par les nouveaux
riches, et par des tas de pékins qui
furent trop lâches pour s'aligner avec nous devant l'Yser. Lorsque je me
promène dans la rue, je pense aux demi-soldes. Je me voyais autrement glorieux et
considéré dans une ruelle d'Alveringhem. Nous
servions à quelque chose au moins à Alveringhem ! Avec cela, la veulerie et les
compromissions des conférenciers de la paix, de ce club de négociants présidé par deux brasseurs d'affaires :
Lloyd, Georges et Wilson ! L’'histoire
dira quelle lourde faute fut l'armistice. Il aurait fallu continuer à taper sur
le bandit tant qu'on le tenait court et pousser jusqu'à l'Elbe. Te souviens-tu du vieil Africain, disant,
après la bataille de Cannes, à Annibal :
« Vincere scis, victoria uti nescis ». Léon se marie en avril dans la simplicité car il y a trop de deuils
dans les cœurs. Il termine ses cours tout en se distinguant : un officier
note qu’il était la figure la plus marquante de sa division d’Ecole. Esprit
très personnel, enthousiaste, au jugement sur, d’un rare bon sens, il était ennemi,
et résolument, de toute solution tactique trop fignolée, trop élégante, où les
spéculations tenaient trop de place. Il aimait l’idée lucide et claire.
Le voilà adjoint d’E.M. à la 5ème D.I. à Charleroi. Motte regrette la façon dont la Belgique
traite son armée en réformant en 1920 le temps de service. « Je pleure, écrit-il. Pauvres
chers morts, que pensez-vous de tout cela ? Ah ! Mon Dieu, comme elle est bête,
cette paix, avec ses marchandages, son manque d'idéal, sa négation de la
confraternité d'armes... Depuis un mois, je suis d'une mélancolie ! L'avenir de
notre chère armée, l'avenir de mon pays, tout cela entre les mains des
politiciens !.. » Fallait-il faire souffrir et faire mourir tant de
braves, pour arriver à une armée moins solide encore qu'en I9I4 ? Je suis
dégoûté. Je m'en irais volontiers ! Mais l'armée souffre et je dois l'aimer
surtout lorsqu'elle souffre. Ah ! Si j'avais voix au Chapitre ! » Mort de sa blessure de
guerre en 1921 
Le matin du dernier dimanche de janvier
21, le commandant Motte remarque sur sa poitrine que sa cicatrice de sa
première blessure suinte. Un éclat de shrapnell, ayant échappé à
l’investigation des chirurgiens en 1914, avait provoqué une fistule au sternum.
A l’hôpital militaire on radiographia sa blessure. Le shrapnell en fait s’était
logé dangereusement derrière le sternum contre le cœur. Une semaine après, on
l’opère mais l’éclat battait avec les pulsations cardiaques. Malheureusement,
le cœur cicatrise mal et deux jours après l’intervention Motte décède
brutalement. Il était allé retrouver les « tués », ceux qu’il voulait
venger, le grand Jacques et tant d’autres, sa mère aussi, sa mère qui, selon sa
propre expression « le regardait du haut du ciel ». Le lendemain, le général baron Jacques, qui
avait deviné dans ce jeune officier une des gloires futures de l’armée, voulut
revoir « le brave des braves ». Le colonel Wambersy
se souvint du testament qu’il avait rédigé sur le front en un moment critique
et qui reflétait si bien l’officier qu’il avait été. « Je n’ai jamais abaissé mon
idéal, jamais je ne le diminuerai. Si je meurs au cours de cette horrible
guerre, je mourrai heureux de 28 années de bonheur sans mélange, et fier
d’avoir versé mon sang pour mon pays et pour l’honneur de mon nom. Je n’ai à me
reprocher aucune faute grave, aucune lâcheté. Je suis de l’infanterie ;
j’ai servi l’artillerie de campagne pendant la première partie de la guerre et
j’y ai été blessé. Je suis revenu à l’infanterie à cause de ma blessure, et
aussi parce que l’on y souffre davantage et que l’exemple y est plus efficace
et plus nécessaire » Les obsèques eurent lieu à Fosse le 17
février. Prirent la parole le lieutenant-général Collyns,
de la 5ème D.I., le lieutenant-colonel Cresens,
chef de l'E. M.. de cette division, le colonel Billemont
du 4ème Chasseurs, le capitaine-commandant d'artillerie Vanbuylaere, ce dernier au nom des camarades de l'Ecole de
Guerre et le bourgmestre de Fosses. Parmi la multitude de participants aux
funérailles, outre sa tendre épouse et son papa, il y avait un petit garçon, son
fils Jacques, dénommé ainsi en hommage à son ami Jacques Dedoncker.
Se trouvait aussi plus de cinquante officiers, son ami le père de Groote et son
fidèle ordonnance, le brave Selvais chargé de porter
son sabre et ses décorations. Puisse le souvenir du commandant Motte
renaître dans le cœur des Belges en ce centenaire de la Grande Guerre. Dr Loodts P.
[1] Edmond Dutry, compagnon d’armes de Léon Motte
est né à Kalken le 30 août 1897. Il décéda le 8
février 1959 après une longue carrière d’artiste et de mécène consacré à la
ville de Gand. Il s’engagea comme volontaire
à l’âge de 17 ans. C’est lui qui illustra la biographie consacrée à son
ami Léon et rédigée par Th. Bondroit. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©