 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Jean Lassaux, l’invalide de guerre qui voulait retourner
au front ! Mes remerciements
à Madame Detilleux-Jacquemin de la commission d’Histoire locale de Jupille 
1) Jean Lassaux décrit par Steenebruggen Ch. Saluons tout d'abord en Lassaux Jean-Joseph,
employé, né à Jupille, le 23 mai 1876, un des plus purs héros de la grande
guerre. Engagé volontaire à l'âge de 38 ans, Jean Lassaux fut de toutes les
batailles depuis Liège jusqu' à La grande offensive libératrice. Fait Chevalier
de l'Ordre de Léopold sur l'Yser, assumant de gaieté de cœur les missions les
plus périlleuses, laissant dans l'accomplissement de chacune d'elles un lambeau
de sa chair, Jean Lassaux revint à l’Armistice porteur de neuf décorations de
guerre, officier de l'Ordre de Léopold et cependant fantassin de 2ème
classe comme il était parti. D'une modestie sans égale, grand invalide de
guerre, Jean Lassaux, dès son retour, n'eut plus qu'un but aider ses camarades
invalides de son dévouement et de son cœur. Auteur d’une cinquantaine d’œuvres
lyriques, Jean Lassaux est connu pour sa chanson Lès p' ti ts sabots que
Walthère Brasseur chante avec une philosophie finement souriante. Une autre de
ses œuvres ayant pour titre Li tate di confiture fait le succès de Donat
Wagener qui l'interprète avec un talent si tendrement délicat. Comme auteur
dramatique Jean Lassaux signa cinq ouvrages Dèstinèye (2 actes), Lès deûs
vôyes (3 actes), On tchèt d'vins on sètch' (1 acte), Li dame dè djeû (1 acte)
et Li dreût d' l’èfant créé sur la scène du Théâtre Wallon du Trianon. En
1919, Jean Lassaux publia un recueil de poèmes et en 1924 un grand roman
intitulé A L’assaut du Rêve qui, pour une œuvre belge d'expression
française, connut un succès de librairie étourdissant. Jean Lassaux est mort à Liège, le 23 avril 1933. (Extrait
du Livre d'Or de L'Association royale des Auteurs dramatiques, Chansonniers et
Compositeurs wallons de Belgique, de STEENEBRUGGEN Ch.) 2) Résumé du livre de Jean Lassaux « A
l’assaut du rêve ». Son parcours de combattant y est décrit 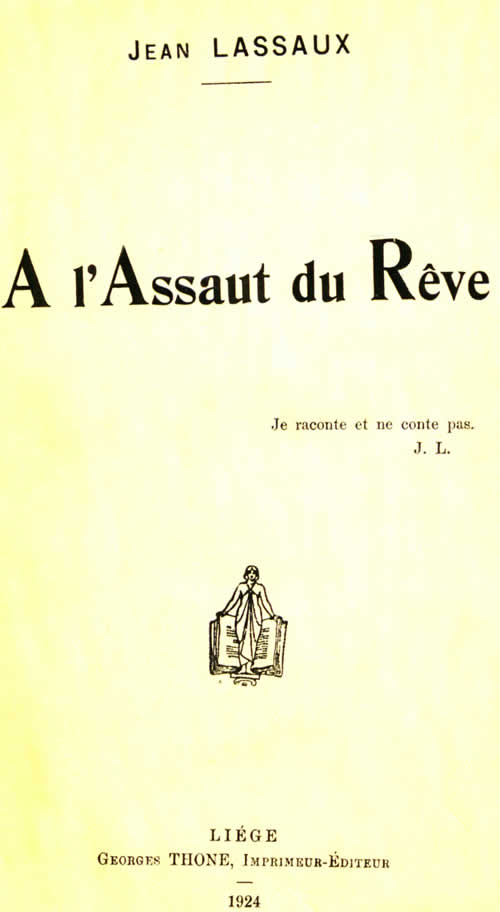
Avertissement Le texte ci-dessous n’est pas une reproduction du livre de Jean Lassaux, mais simplement un résumé de sa deuxième partie (pages 79 à 268)
dans laquelle l’auteur raconte sa vie de soldat durant la Grande Guerre. Résumé du
témoignage de Jean Lassaux rédigé par le Dr P. Loodts) Dès les premiers jours de la
guerre, Jean s’engagea comme volontaire au bureau de recrutement de Ste-Foy
puis rejoignit la Citadelle où, immédiatement, les recrues furent envoyées à
Malines. Ce fut le temps des premières amitiés entre soldats, l’époque où Jean
rencontra François Deschamps qui deviendra un de ses grands amis. Le voyage en
train vers Malines fut long car il se déroula en transitant par Anvers où les
recrues passèrent leur première nuit sur les bancs de la gare. A 4 heures du
matin, les hommes remontèrent dans des wagons qui les emmenèrent enfin à
destination. Dans la caserne malinoise, les Liégeois usèrent de ruse pour se
retrouver ensemble dans la même chambrée, une chambrée fort spartiate car elle
ne comptait que quelques lits et était démunie de la paille nécessaire aux
couchages. Un camion dut être envoyé rapidement pour en réquisitionner. Cet
arrivage permit un minimum de confort. C’est à Malines que Jean fit
connaissance d’un autre volontaire liégeois. Il s’appelait Fromenteau Joseph
mais ses compagnons l’appelèrent « Poteau » en vertu de sa grande
taille. « Poteau » allait compter beaucoup pour Jean et devenir un
fidèle frère d’armes avec qui il entretiendra des liens tout au long de sa vie.
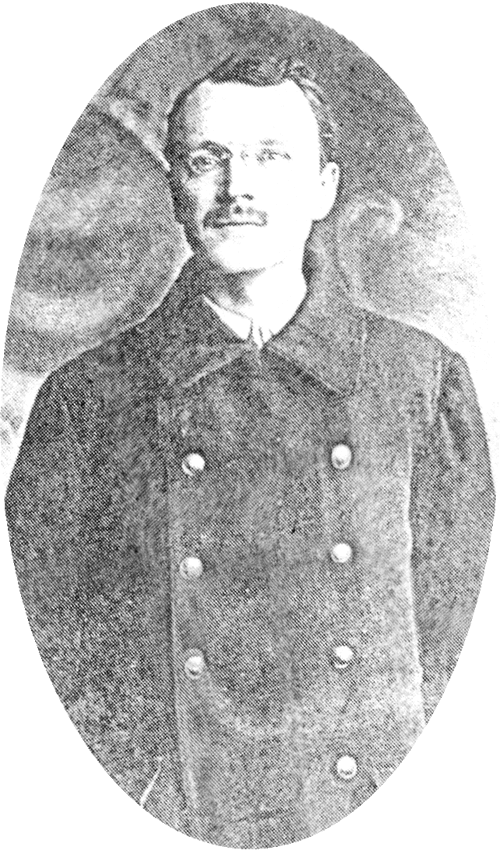
Joseph
Hector Fromenteau, dit « Poteau » est né à Liège le 28 septembre
1887. Il fut dessinateur. A 26 ans, il eut un fils Carl Victor Alphonse né le
18 novembre 1913. Il quitta son épouse et son bébé pour s’engager en août 1914[1] C’est à
Malines qu’on équipa les jeunes recrues d’uniformes dépareillés provenant des
fonds du magasin militaire et, c’est aussi à cet endroit, qu’ils reçurent leur
initiation au drill et les inévitables leçons de théorie sur les grades. Cette
période d’instructions fut rapidement interrompue. Un soir, le clairon retentit
dans le centre-ville pour avertir la troupe qui se distrayait en ville qu’elle
devait rejoindre illico la caserne pour se préparer à un départ imminent. Le
lendemain, les volontaires rejoignirent la gare et s’entassèrent dans un train
spécial qui s’ébranla au milieu… des acclamations des Malinois venus pour leur
dire adieu ! Leur destination fut Termonde où le problème rencontré à
Malines, celui d’une literie insuffisante, se renouvela dans leurs dortoirs ! Cette fois, les jeunes volontaires durent
eux-mêmes trouver une solution. Ils allèrent tout simplement descendre en ville
et réquisitionner le stock d’un commerçant matelassier !! Le soir, la
malice des Liégeois se manifesta encore une fois. Il s’agissait de pouvoir
profiter de l’hospitalité des cabaretiers du centre-ville. Une ruse fut bien
vite trouvée pour quitter la caserne : Jean et ses amis se munirent d’un
baquet, ou d’un seau ou encore d’un récipient quelconque puis, en peloton, ils
défilèrent en bon ordre devant le factionnaire qui crut à une corvée
« eau ». Le lendemain
des gardes furent organisées pour surveiller les abords de la caserne et
repérer d’éventuels espions. Jean expérimenta la difficulté d’admonester un
suspect sans connaître la langue de Vondel ! Ce fut en
tout cas sans déplaisir que la troupe quitta Termonde pour Saint-Nicolas-Waes.
Elle put alors cantonner dans une ferme-château qui lui offrit des omelettes
appétissantes à un prix modique. Ce furent, en cet endroit, quelques jours
calmes coupés seulement par une marche d’entraînement, une parade sur la grand’
place et une sélection d’hommes pour constituer une avant-garde. Cette dernière
devait inclure les meilleurs tireurs de la troupe or les recrues n’avaient
encore jamais tiré ! Le lieutenant chargé du tri n’eut pas d’autres
recours que de choisir les hommes sur
base en les questionnant ! - Avez-vous déjà tiré et avec quoi ? 
Jean Lassaux Jean
répondit qu’il avait déjà tiré à la foire et qu’il cassait toutes les pipes
tandis que Descamps avoua avoir déjà tiré… des portraits car il était un photographe patenté. En usant de persuasion, les Liégeois
réussirent tous à faire partie des élus ! Un train amena alors
l’avant-garde à pied d’œuvre dans les environs de Wetteren, près de Gand, pour
y monter la garde le long de l’Escaut. Jean signale un bel exploit de femmes à
cet endroit : deux jeunes mariés réussirent à signaler à leurs épouses leur
position et celles-ci parvinrent à rejoindre leurs maris pour quelques heures
de retrouvaille ! Après ce
temps de garde, nos jeunes gens s’en allèrent à Gand
pour être cantonnés à la caserne Saint-Pierre. Nos vaillants Wallons s’étaient
mis en tête de faire connaissance de la belle cité de Van Artevelde. Une astuce
fut encore être trouvée. Le lieutenant qui commandait leur peloton avait
délivré à Jean un ordre de mission pour aller quérir en ville un de ses bagages
d’officier arrivé en ville. Le Liégeois vit de suite l’avantage qu’il pouvait
trouver dans cette mission. Grâce à celle-ci, notre volontaire pouvait se
permettre une visite de la cité mais il pouvait aussi faire profiter ses
camarades de cette escapade. Revenu avec le bagage, il passa en effet l’ordre
de mission à « Poteau » et après bon usage, ce dernier refila le
précieux sésame à un autre de ses compagnons. Le stratagème fut utilisé maintes
fois jusqu’au moment où le départ fut sifflé, cette fois pour le village de
Malle où les soldats s’installèrent dans les dépendances d’un hospice tenu par
des religieuses. C’est dans
ce village qu’ils creusèrent leurs premières tranchées et qu’ils virent leurs
premiers ennemis. Un matin, un groupe de cyclistes allemands s’approcha de
leurs lignes. Sans attendre un commandement, une salve jaillit des tranchées et
le combat s’engagea. Les cyclistes tombèrent mais les volontaires Batta et
Leunis payèrent de leurs vies cette victoire.
Peu après ce combat, Jean aperçut trois nouveaux Prussiens qui s’avançaient
en éclaireurs et visa l’un deux qui s’effondra aussitôt. Enhardi par son
succès, Jean quitta la tranchée en rampant afin de constater de près la
réussite de son coup de feu. Cet acte intrépide effectué, il rejoignit sa
tranchée où, avec anxiété, trois de ses amis avaient résolu de l’attendre
malgré la désertion des lieux par toute
leur compagnie. Les quatre
Liégeois, désemparés de ne pas retrouver leurs frères d’armes n’eurent comme
recours que de retourner dans l’hospice de Malle. Les
généreuses religieuses eurent la gentillesse de distribuer aux attardés des
tartines bien beurrées et de grands bols de lait. « Un vrai régal »
écrivit Jean dans son livre. L’ennemi cependant approchait et risquait de
pénétrer dans le couvent d’une minute à l’autre. Les soldats égarés décidèrent
alors de se déguiser en civils pour ne pas impliquer les religieuses ; ils
dissimulèrent leurs uniformes dans un hangar et puis gagnèrent les maisons de
Gand par un chemin détourné. En ville, on les informa que leur unité de
carabiniers se dirigeait vers Bruges. Les égarés purent monter dans un train et
ce fut finalement au pied du beffroi de Bruges qu’ils retrouvèrent leur unité.
Le capitaine ne leur fit aucuns reproches et au contraire,
se montra très fier de la débrouillardise de ses volontaires qu’il n’espérait
plus revoir. « Poteau » et Jean bénéficièrent alors d’un logement
chez un bourgeois aux environs du Lac d’Amour et, ce dernier très généreux, les
invita par deux fois à souper avec sa famille. Le séjour à Bruges permit aussi
de rééquiper les attardés en uniforme et en matériel. L’étape suivante fut à
nouveau Gand. Dans un village de la périphérie, les quatre amis trouvèrent un
logis très digne, en fait un presbytère tenu par la gentille nièce du curé nommée
Gabrielle. Ce furent là encore quelques journées de calme. Le matin, vite
débarbouillés, les deux gaillards couraient chercher leurs rations journalières
chez le fourrier puis s’en allaient déjeuner chez le curé. La cuisinière leur
mijotait un peu plus tard des dîners délicieux et la soirée était égayée par
des parties de cartes. Ces journées d’insouciance se terminèrent et quand la
compagnie s’éloigna du village, Jean vit, au bord de la cure, le brave curé se
moucher en compagnie de deux femmes qui pleuraient ouvertement la perte de
leurs pensionnaires. Lierre fut
atteint et il fallait défendre Anvers. On mêla alors les recrues peu formées
dans des nouvelles compagnies qui comprenaient déjà des soldats plus âgés ayant
bénéficié d’une instruction complète. Nouveau tour de passe-passe : Jean
parvint à rester avec ses amis dans la même compagnie pour participer, à ce
qu’on nomma plus tard, la dernière sortie d’Anvers de notre armée. Au cours de
celle-ci, les Liégeois engagèrent un assaut à une maison tenue par l’ennemi.
Par bonheur, ils n’eurent pas beaucoup de mal car une mitrailleuse provoqua la
fuite de l’ennemi. Boissier fut cependant atteint d’une balle et fut évacué
vers les ambulances. Il laissait un grand vide parmi ses compagnons. Les Carabiniers
rejoignirent ensuite Anvers qu’ils quittèrent rapidement dans le plus grand
secret pour effectuer une retraite vers la mer via Gand. Avec une certaine
émotion, ils virent alors les Gantois les accueillirent avec moulte friandises,
chocolat et un énorme morceau de « Kip Kap » (Le Kip Kap est une
charcuterie faite à partir d'un mélange de viande de porc comprenant tête,
pieds, couenne et autres abats, coupée très fin et désossée, cuite à l'eau ou à
la bière et mise en terrine). Les réjouissances eurent rapidement une fin et la
marche reprit cette fois en direction de Dixmude et de Loo. Plusieurs villages en
« Kerke » ou en « Choote » passés, ce fut finalement à
Nordschoote qu’ils arrivèrent. Là, les attendaient les fameux dragons français
dans leurs uniformes flamboyants occupés de creuser des tranchées… Les Belges ne restèrent pas longtemps à fraterniser avec
leurs alliés dont ils admiraient la magnifique prestance. Ils les quittèrent
pour se rendre à Pervijze où ils expérimentèrent, pour la première fois, une
nuit complètement à découvert dans un champ et sous une pluie qui les assaillit
en fin de nuit[2]. La journée
suivant se passa sur le qui-vive au bord de l’Yser mais des rapports montraient
que l’ennemi avait franchi en deux endroits le petit fleuve et qu’il fallait
donc évacuer les unités belges qui stationnaient entre ces deux endroits
derrière la digue. Des hommes furent demandés pour une reconnaissance vers la
digue. Jean fut du nombre et constata que celle-ci était libre d’ennemis. Il
envoya son ami Deleuze avertir le capitaine que la retraite vers la digue
pouvait se faire. Néanmoins, il avait constaté qu’un peu plus au sud, les
Allemands passaient l’Yser à hauteur des tanks à pétrole. Un furieux combat
d’ailleurs s’y déroulait entre l’envahisseur et les Français. Jean et un de ses
compagnons décidèrent d’aller en reconnaissance vers ce champ de bataille. Ils
ne tardèrent pas à découvrir un fusiller marin blessé et étendu sur le sol. Ils
le transportèrent jusqu’à une cabane tenue par ses compatriotes. Mais, sur la route du retour, un des leurs,
Huard, fut assailli par un Allemand qui était à ses trousses. Jean, par
bonheur, se précipita à son secours et avec son seul poignard (il s’était
allégé de sa carabine pour la reconnaissance) parvint à mettre hors de combat
l’Allemand. Revenus sur la digue occupée par la Major Lahire, et réfugiés dans
une cabane, les hommes virent alors une troupe ennemie s’approcher d’eux. Deux
coups de fusils et deux ennemis furent abattus… Depuis deux jours, les hommes
étaient sur pied sans sommeil et sans nourriture. Ils étaient maintenant, pour
la plupart, affaissés dans les fossés. Ce fut avec un grand soulagement qu’ils
accueillirent la relève et qu’ils rejoignirent Pervijze. C’est à cet endroit
que Jean apprit que son ami « Poteau », une jambe brisée par une
balle, avait dû être évacué[3]. Cantonnant
maintenant dans une ferme, au sortir de l’enfer, les hommes expérimentaient
après l’enfer … le paradis. Le repos
fut cependant de courte durée et lui succéda la garde aux tranchées devant
Dixmude. Il pleuvait continuellement, les fourriers amenaient la nourriture
pendant la nuit. Un matin Jean se glissa dans les ruines d’une villa bâtie
contre le talus de la digue. De cet endroit, il put
apercevoir un soldat ennemi posté dans la minoterie de Dixmude. Il fit feu et
l’abattit. Le
cantonnement de repos fut Alveringhem où, pendant quatre jours, les hommes
pouvaient souffler quelque peu et reconstituer leurs sacs avec leurs propres
achats avant le retour à Dixmude. Les relèves allaient ainsi se succéder aux
séjours dans les tranchées dans lesquels les soldats se muaient la plupart du
temps en terrassiers. Et puis enfin un repos d’un mois par division fut
accordé. Le havre de paix fut pour Jean et ses amis Deleuze et Deschamps, une
chambre d’une maison de pécheurs à Bray-Dunes. Deschamps
faisait la cuisine et invitait souvent à manger la pauvre femme du pécheur et
ses deux bambins. La vie à Bray-Dunes aurait pu être confortable s’il n’y avait
pas eu l’obligation d’exécuter chaque jour des exercices dans les dunes et d’y
monter la garde. Les soldats, avec humour, s’attribuaient le sobriquet de « défenseurs du front de mer ». Mais enfin, les hommes se satisfaisaient du peu car, au moins, ils pouvaient se laver chaque jour
et entretenir leurs uniformes. Bientôt, les
carabiniers s’apprêtèrent à rejoindre un nouveau secteur. L’on distribua des
boites de « plata » comme vivres de réserve. Beaucoup cependant
décidèrent de ne pas alourdir leur sac avec cette nourriture jugée insipide et
prirent l’option de les jeter sans même les ouvrir. Dans le
nouveau secteur, Jean fut désigné pour l’occupation d’un poste avancé face à
l’Yser et c’est dans ce poste qu’il fut atteint à l’œil par une balle ennemie.
L’obscurité permit de l’emporter vers le poste de secours puis vers l’hôpital
l’Océan où, la Reine en personne, vint lui remettre une fleur. Ce fut le seul
souvenir qu’il garda de cet hôpital tellement la douleur qui le tenaillait
était intolérable. L’amnésie semblait complète. Au bout de quelques jours, on
évacua Jean à Calais puis à Cherbourg. C’est seulement à cet endroit qu’il
découvrit que derrière son bandeau, on lui avait enlevé l’œil blessé. Après
Cherbourg, ce fut le centre de triage de Querqueville puis son évacuation au
dépôt de Saint-Pair avant d’arriver au dépôt des invalides à Sainte-Adresse.
C’est là seulement qu’il reprit goût à la vie en acceptant de donner cours aux
invalides illettrés. Jean fut ensuite envoyé à l’Hospice Général français du Havre
pour recevoir une prothèse oculaire. Il y fut choyé notamment par deux femmes.
D’abord la religieuse, mère supérieure, lui offrit quelques sous pour se faire
raser. Ensuite, une visiteuse fut émue par Jean qui venait d’offrir sa pipe à un voisin de lit plus malheureux que
lui. Cette dame, peu après, lui fit la
surprise d’une toute nouvelle pipe ! En
réfléchissant à son avenir, Jean prit peur de finir la guerre dans un bureau.
Il prit alors une décision courageuse : celle de demander son retour dans
son unité de carabiniers. Sa demande fut d’abord jugée folle mais, avec une
belle obstination, il parvint à obtenir satisfaction et pu rejoindre le dépôt de sa division à Bourbourg. C’est là
qu’il retrouva un de ses compagnons surnommé « Prince » qui avait été
soigné au camp du Ruchard et qui, guéri, retournait aussi vers sa
compagnie. « Prince « aida
Jean à se rééquiper puis après quatre jours d’attente, les deux compagnons
reçurent enfin leur ordre de départ. Le train les amena jusqu’à Adinkerke et,
de là, ils rejoignirent leur bataillon qui cantonnait à Alveringhem. On imagine
aisément les retrouvailles de Jean avec les gars de sa compagnie. Elles furent
émouvantes et joyeuses. Jean fut étonné de voir les progrès dans l’équipement
des soldats avec notamment ce casque métallique qu’il n’avait pas connu
auparavant. La reprise de la vie de soldat ne fut cependant pas facile pour
l’invalide qui gardait des douleurs et une faiblesse aggravée par des troubles de l’équilibre. Jean revécut
cependant la dure vie des tranchées souvent sous les bombes ennemies. Il vit
aussi des compagnons succomber… C’était l’hiver et bientôt un nouveau repos
d’un mois s’annonçait à Bray-dunes. C’est alors que Jean eut la joie de voir
« Poteau » revenir dans sa compagnie. « Poteau » après
quelques jours d’ambulance avait été transféré » en Angleterre où sa
blessure se cicatrisa guérie, mais où une grave affection cardiaque lui avait
été ensuite reconnue. Sa pathologie améliorée mais non guérie, comme son ami
Jean, il avait demandé à retourner au font. Hélas, la reprise de sa vie
militaire fut abrégée car elle s’accompagna d’une aggravation de son état.
« Poteau » dut à nouveau être évacué. Peu après, ce fut Jean qui
faiblit et devint incapable de supporter les fatigues du front. A Dinard où
il fut transféré son état s’améliora. Il récupéra un pas plus ferme et la
douleur orbitale s’atténua peu à peu. Bientôt il s’entendit dire qu’il pouvait
rejoindre le camp d’Auvours qui comprenait de grands baraquements abritant les blessés
susceptibles de rejoindre le front ou d’autres unités de l’arrière. Mais là,
avec un certain désappointement, il fut désigné pour le camp du Ruchard, un
camp de convalescents ayant une triste réputation. Les corvées étaient
exécutées sans tenir compte de la santé des soldats et des sanctions sévères
réprimaient tout manquement. Les seules distractions consistaient en promenades
menées, sous la conduite de gradés, en rang par quatre et en séances de cinéma
dans un local sommaire situé à l’une des entrées du camp. Jean se plaignit au commandant du dépôt de
Ste-Adresse qui lui fut favorable et il obtint son retour au Havre au dépôt des
invalides. Sa vie
devint alors plus agréable. Les promenades étaient permises individuellement,
la correspondance avec ses amis l’occupait et il trouvait là nombreuses
occasions de revoir des connaissances. Ce fut le cas de Decleyre, Harvey et du
grand « Poteau » qui, d’abord occupé en Angleterre comme invalide,
avait trouvé un meilleur emploi en France. Jean eut même la surprise un jour de
rencontrer son cher commandant de compagnie (A. Simons), qui appuyé sur deux
cannes, s’avançait vers l’institut de mécanothérapie. Les deux hommes
s’embrassèrent… Jean
terminait toutes ses lettres par cette exclamation : « On les
aura » mais un jour, il s’attira cette réponse d’un ami : - Tu dis toujours qu’on les aura, mais voilà bien longtemps qu’on les
a ! Le tout c’est de s’en débarrasser maintenant ! Finalement détaché dans un bureau
ministériel, Jean eut la joie de connaitre l’annonce de l’armistice. Vint alors
son retour au pays avec une étape à Bruges puis à Bruxelles. Après deux jours
d’attente à Bruxelles où il dormit sur un canapé dans un hôtel de troisième
ordre, il put enfin prendre le train qui le ramena au foyer ! Quelle joie
pour lui d’apercevoir le paysage quitté quatre ans auparavant ! Le train
roula, dépassa Louvain, on voyait Tirlemont, Waremme, puis apparaissait Momalle ! puis Fexhe !
Ans ! Liège ! Des semaines
plus tard, Jean, déçu du peu de changement de la société après la guerre,
rencontra son ancien commandant. La description de cette rencontre servit de
conclusion et de titre à son livre. -
L'homme
doit toujours être le soldat de quelque idée, et, ce n'est que par la lutte
pour l’accomplissement de ses aspirations qu'il se rend digne de dominer la
nature, lui dit l’officier. -
Mais à quoi a abouti la lutte que nous avons menée pendant
quatre ans répondit Jean. Où est l'état
idéal dont nous rêvions dans les tranchées ? L'humanité s'est-elle épurée par la souffrance ? La paix a-t-elle calmé
les esprits ? Le bonheur a-t-il échauffé les âmes ? -
Homme ! Rêveur ! prononça l'officier. Un rêve d’amour a
blessé votre cœur, un rêve de gloire a déçu votre esprit, et cependant sur vos
lèvres, naissent encore ces mots, humanité, paix, bonheur, idéal ! La
prescience du bien a donc survécu aux désillusions les plus cruelles et,
irrésistiblement, vos regards se tournent toujours vers le beau. Eh bien, Jean,
le bonheur est là ! En avant ! A l’assaut ! 
Portrait de Jean dessiné par son professeur de dessin, Henri Quittelier à l’institut de revalidation du Havre en juin 1917. (Collection d’Ida Detilleux) 
Jean Lassaux est décédé le 23 avril 1933. Il allait sur ses 57 ans. (4) Poème écrit par
Joseph Hector Fromenteau lors de son hospitalisation en Angleterre : 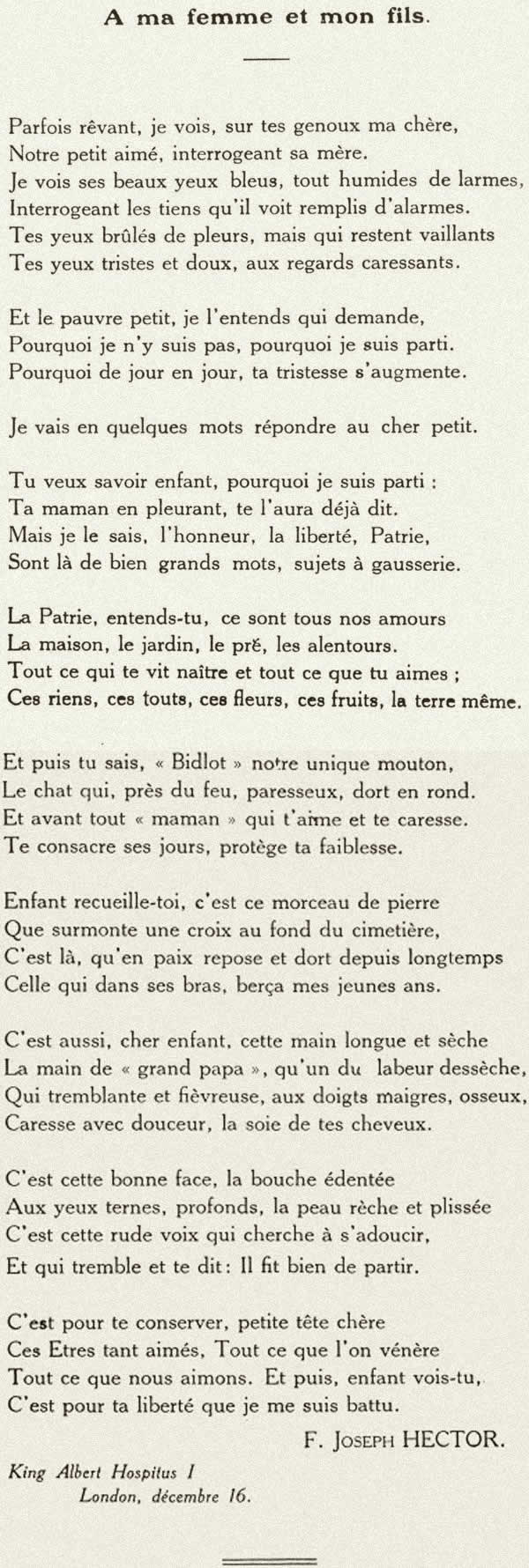
(Texte tiré de « Quelques
poèmes et impressions de guerre » par Jean Lassaux et Joseph Hector Fromenteau,
livret paru dans les années vingt et réédité en 1994 par la commission
d’histoire locale de Jupille) [1] « Pour quand mon fils sera grand » : Voici le très beau texte écrit
par Joseph Hector Fromenteau dit « Poteau » et traduisant
merveilleusement le sacrifice d’un jeune père devant se séparer de son enfant
pour accomplir son devoir. « P'tit coq » n'est pas un volatile
dont la crête naissante, mais déjà fièrement portée, indique le futur pacha
d'un sérail de poulettes aux gloussements amoureux. Non, « P'tit coq », est
celui qui, à peine né, a su conquérir sur tout son entourage, une autorité
incontestable et d'ailleurs incontestée. « P'tit coq» est le dispensateur des
joies et des peines; c'est auprès de lui qu'hier encore, je venais, après une
journée de labeur, priser dans son sourire et ses grands yeux pétillants de malice, l'oubli de mes ennuis et la
force de lutter pour la conquête d’un peu plus de bien-être. « P'tit coq » est mon seigneur, mon
maître, mon Dieu, mon Tout. « P'tit coq» est mon fils. Dédaignant les paroles inutiles,
et pour cause! « P'tit coq » est âgé de huit mois, d'un geste délicieusement
câlin, de ses petites menottes roses et grassouillettes, il sait commander, se
faire comprendre et nous amener à ses pieds, repentants si nous avons méconnus
ses volontés, et prêts à satisfaire ses moindres caprices, pour un sourire, un
petit pied à baiser. Confortablement assis sur son trône, le giron de maman, «
P'tit coq » domine son peuple émerveillé et fier d'être à lui. Et le soir,
après avoir longuement tirer la moustache de grand papa, son courtisan favori,
parce que plus docile, monsieur mon fils, la bouche pleine d'un sein bien fourni,
s’endort heureux, sous nos regards attendris. Hélas, ces beaux jours de
quiétude et de paix, entrent dans le passé et la journée qui s'écoule, m'amène
vers l'inconnu, peut-être vers le néant. Et je ne puis m'empêcher de songer à
toi, cher petit être, tout fait de mes caresses. Je songe à toi que j'abandonne
en mon foyer en pleurs, pour courir aux frontières. Et je songe que plus tard,
quand je ne serais plus, peut-être emporté par la tourmente qui se déchaîne, tu
demanderas « pourquoi n'ai-je plus de père ?» et tristement tu chemineras par
la vie, sans soutien, sans autre appui que l'amour de ta mère. Lorsque le calme
sera revenu, la page d'histoire qui commence achevée et tournée, d'aucuns
peut-être, estimeront devant ta solitude, que j'ai failli à mon devoir de père,
en offrant au pays, ma vie qui t'appartient. Nombreux, hélas ! seront ceux qui,
pour apaiser leur conscience, masqueront leur manque de courage, en invoquant
leur affection paternelle, leurs devoirs de famille. Pensent-ils donc, qu'il y a
plus d'honneur à vivre paisible, au milieu des siens, qu'à courir au-devant de
l'ennemi, pour défendre son foyer les armes à la main ? Puissent-ils, ces
égarés, comprendre que notre sang à nous, qu'une loi injuste a exempté du
service, soit par le tirage au sort, soit par l'achat d'un homme, n'est pas
plus précieux que celui du père de famille que la loi appelle sous les armes.
Ne comprenant pas cela, puissent-ils au moins conserver un peu de respect pour
ceux qui l'ont compris, et laisser à nos fils, un souvenir de ceux qui sont
partis et que peut-être ils ne verront plus. Suivant les routes de Flandre,
marchant vers l'inconnu, je songe à toi enfant, et la tête haute, fièrement je
vais. Je vais de l'avant, conscient de mon devoir, car c’est là qu'est l'honneur,
et devant lui vois-tu, tout s'efface. Août 14. Joseph Hector Fromenteau. (Texte tiré de « Quelques poèmes et
impressions de guerre » par Jean Lassaux Joseph Hector Fromenteau, livret paru
dans les années vingt et réédité en 1994) par la commission d’histoire locale
de Jupille) [2] Cette nuit à découvert sur un champ fut aussi décrite par
« Poteau » : Repos,
sacs à terre. Enfin l'on s'arrête. Chacun se débarrasse de son fardeau, les
faisceaux se forment et nous lorgnons avec espoir la magnifique ferme qui,
là-bas, au milieu de la plaine, nous apparaît riche, et intacte encore de toute
destruction. Nos yeux connaisseurs, évaluent déjà la contenance en hommes, de la grange, attenant à la ferme, et
qui nous paraît immense, semblant regorger de bonne paille, fraiche et
odorante. Voici quelques jours déjà que nous attendons une nuit entière de repos sur la paille bien douce à nos membres
fatigués, et cet abri couvert et clôturé, nous semble le « nec plus ultra » du
confort espéré. Qu'il doit faire bon s'y blottir dans un coin, fraternellement
couché côte à côte. Mes amis et moi, échangeons nos espoirs, nous escomptons
nos chances pendant que là-bas, attendant les ordres, nos officiers se groupent
autour du major. A quelle compagnie reviendra ce bon logement ? Volontaires de
guerre, peu habitués à cette vie en commun, une sympathie instinctive nous a
réunis, mes compagnons et moi, formant un groupe au milieu de la masse. Les
services que nous nous sommes rendus mutuellement pendant ces deux premiers
mois de guerre, la mort affrontée côte à côte et notre compréhension commune
des devoirs et de la mission qui nous incombent, ont fait de nous des frères
unis à jamais. Les instructions transmises de section à section, nous arrivent
: L'on couche en plein air. La cuisine seule logera à la ferme, ainsi que nos
officiers. Un peu de désappointement se manifeste dans les rangs, quelques
jurons étouffés s’entendent de-ci de-là, puis philosophiquement chacun se
dirige vers la grange où la distribution de paille commence immédiatement. Nous
avons la chance de n'être désignés pour aucune corvée, et ma foi j'en suis bien
aise. Ayant abusé quelque peu, les derniers jours, de la nourriture prise au
hasard de la route, (navets, betteraves, etc.) et la fatigue aidant, je me sens
l'estomac plutôt malade. Néanmoins, c'est gaiement que nous procédons à notre
installation, hélas sommaire. Notre ami François, « le Vatel » de la bande,
n'ayant plus, depuis plusieurs jours déjà, d’extra à nous servir, nous devons
nous contenter du maigre ordinaire de la troupe. Après un brin de causette
amicale et quelques pipes, fumées béatement, la paille bien étendue sur l'herbe
et le sac pour oreiller, je m'étends frileusement, bien serré, entre mes bons
amis Jean et Henri. Ah ! qu'il fait bon dormir ainsi, si près de deux braves
cœurs qui battent fraternellement à mes côtés. La fraîcheur du matin m’éveille,
et dans la pénombre, je distingue la plupart de mes compagnons déjà debout. Une
pluie fine tombe doucement, un poids inusité me couvre et, surpris de ne pas
trouver mes bons amis près de moi, je regarde. Je regarde et je comprends. Ils
sont là, tous deux, en veste et faisant les cent pas tout en fumant. Eveillés
par la pluie et me sachant quelque peu malade, ils se sont débarrassés de leur
capote et se dépouillant pour moi, comme des frères ainés, ils m'ont chaudement
couvert pour me protéger. Profondément ému devant ce geste si simple et si
noble, les yeux humides de reconnaissance, je vais vers eux et leur pressant
les mains je ne puis que leur dire merci. Merci frères. Septembre 14. Joseph Hector Fromenteau (Texte tiré de « Quelques poèmes et
impressions de guerre » par Jean Lassaux et F. Joseph Hector, livret paru
dans les années vingt et réédité en 1994) [3] Joseph Hector Fromenteau dit « Poteau » décrit
ci-dessous les circonstances de sa blessure ainsi que la mort de son compagnon
Crève-cœur La fatigue nous rendant inconscients du
danger, marchant ainsi que dans un rêve, nous sommes venus par la nuit noire,
rendue plus noire encore par ces visions de ruine et de mort. Jamais je n'aurai
cru pouvoir supporter la vue de tant d'horreur. Cadavres émergeants à moitié de
ruines fumantes, corps boueux enchâssés dans la terre et que l'on enjambe pour
passer, murs calcinés et branlants, nous avons traversé tout cela enveloppé de
nuit. Nous arrivons au château de « la Vicogne » objectif de notre reconnaissance.
Masqué par de grands arbres, celui-ci se dessine confusément dans le jour qui
se lève et prudemment nous prenons position dans un fossé boueux, séparant des
terres labourées. Cà y est, une balle me traverse le
tibia droit, fracture celui-ci et fiche le camp je ne sais où. Me voici étendu
de mon long sur cette terre détrempée et froide. Quatre de mes amis qui m'ont
vu choir, spontanément, sans songer au danger, se précipitent à mon secours. Sans perdre du temps en condoléances
inutiles, Benoit, Hurson, Herrion et Crève-cœur, m'enlèvent et se disposent à
me mettre à l'abri. Une fusillade, soudain, crépite à nos oreilles et lâchant
leur fardeau, mes amis se précipitent d'un bond vers l'abri. Tous sont
indemnes. Surpris, Crève-cœur, se tâte : une balle traversant sa gamelle et son
sac est venue effleurer son épaule sans qu'il en résulte aucun dommage. De
nouveau étendu sur cette terre boueuse, isolé si près de mes compagnons, je
m'efforce en rampant de me rapprocher d'eux. La tâche est douloureuse, mais j'y
parviens enfin. Me voici, étendu sur le bord arrière du fossé transformé en
tranchée de fortune, et protégé quelque peu par le semblant de parapet,
construit en hâte. Le calme est revenu. En attendant le moment ou je pourrai
être transporté vers le poste de secours le plus proche, je cause avec mes
compagnons qui m’encouragent et me promettent que bientôt je serai hors d'atteinte.
Leurs bonnes paroles affermissent la confiance que j'ai en leur dévouement et
c'est sans inquiétude que j'attends. L'ennemi ne donnant plus signe de vie,
avec l’assentiment du lieutenant, mes quatre braves, sortent de nouveau de leur
cachette et rn enlèvent d'un commun effort. Hélas ils ne font pas trois pas,
que l’un d'eux, blessé à mort, m’entraine dans sa chute, et les yeux pleins
d'épouvante, j'assiste à la fin de mon pauvre ami Crève-cœur. La mort s'acharnant contre lui, ne l'a
pas manqué cette fois. Une balle en plein cœur vient de l'abattre à mon côté.
Courbé sur les genoux, je le vois qui s'effondre et dans un dernier geste,
portant à la poitrine une main qui tâtonne et déjà se raidit je l'entends
murmurer « Je suis tué ». Et c'est tout. Son corps, maintenant près de moi, gît
inerte à jamais. Sur la terre humide des Flandres,
combien de héros obscurs sont morts ainsi ? Non pas dans l’acharnement de la
lutte où l'homme n’est plus lui-même, mais simplement en secourant un ami en
détresse. Joseph Hector Fromenteau. Souvenir du 25-10-14. (Texte tiré de « Quelques poèmes et
impressions de guerre » par Jean Lassaux et Joseph Hector Fromentaux, livret
paru dans les années vingt et réédité en 1994 par la commission d’histoire
locale de Jupille) |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©