 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Chez Mademoiselle Rose… pendant la guerre[1] Par Jules Blasse 
Avant-Propos. Hiver 1931-1932. Remarque est rentré dans l’ombre après fortune faite. A l’Ouest, rien de nouveau avait remis les livres de guerre à la mode. La mode est comme les jours, elle passe vite ; les livres de guerre, on n’en veut plus. Ne soyez pas effrayés par le titre de cet opuscule. Chez Mademoiselle Rose, pendant la guerre, ne signifie pas que j’aie l’intention de vous ressasser des histoires de tranchées, je sens que « vous en avez marre », et moi aussi d’ailleurs. On vous en a raconté de vraies, de fausses, vous les avez crues toutes. Mais il est un sujet que l’on n’a guère exploité : « le marrainage ». Pourquoi ? Sans doute parce que la fiancée ou l’épouse du combattant fronçait les sourcils quand on parlait de marraine de guerre. Et, pour cette raison, peut-être, a-t-on bien fait de jeter sue ces histoires, le manteau du silence, car c’eût été vilain d’énerver les femmes. Depuis lors quinze ans ont passé. La méfiance féminine, légitime parfois, déplacée bien souvent, s’est un peu endormie. Je pense que l’on peut fourrager dans ses souvenirs, sans craindre le crêpage de chignons – les femmes n’en ont d’ailleurs plus – la séparation de corps ou simplement l’éclosion du doute lancinant. Je voudrais, avant que le Président des combattants en fonctions à l’époque, ne murmurât des paroles… trop flatteuses sur le bord de ma tombe, le jour où j’irai rejoindre ceux de l’Yser dans l’au-delà, je voudrais, dis-je, essayer de réparer une injustice. On a mis toutes les marraines de guerre dans le même sac ; on a réprimé des sourires pleins de sous-entendus en parlant d’elles ; on a oublié d’établir la distinction nécessaire. Si nous en connûmes pour qui le marrainage était une sorte de bureau de placement, si certaines d’entr’elles profitèrent habilement de cette invention nouvelle pour exploiter leurs charmes avec intérêts composés, il y en a beaucoup d’autres. C’est de celles-là que je voudrais vous entretenir. Je vous parlerai, non pas de la mienne, mais de la nôtre, car je n’étais qu’une simple unité parmi les dix-neuf filleuls qu’elle avait adoptés. La mienne, ou plutôt la nôtre, c’était Mademoiselle Rose Honorez, Parisienne d’adoption, Douroise d’origine, revenue définitivement au village natal dès la fin des hostilités. Un tournant
dangereux. On avait douze mois de mobilisation à son actif. Le printemps de 1915 d’abord, l’été ensuite, avaient été plein de déception. Les Allemands, qui devaient théoriquement rentrer chez eux, affamés, à cause du blocus, battus à plate couture, à cause des Russes, continuaient à rendre la vie dure aux occupants du front belge. Les nouvelles provenant du pays envahi devenaient plis rares et étaient de plus en plus alarmantes. On supportait les rigueurs de son existence nouvelle avec résignation parce que l’homme a tôt fait, quoi qu’on en dise, de s’habituer à vivre comme vivaient les Nerviens. Mais l’isolement devenait insupportable. Nos voisins les Français, ceux du Nord excepté, correspondaient régulièrement avec leurs familles. Les Anglais aussi. La famille du Belge, famille de guerre bien entendu, c’était ordinairement un indigène de la région non envahie, chez qui il passait quelques journées par mois. Le haut commandement comprit qu’il fallait contrebattre un découragement général, qui pouvait être gros de conséquences. Il inventa les permissions. Quand je dis il inventa, c’est une façon de parler, on invente rien à l’armée. Il rétablit simplement un usage ancien qui voulait que le milicien passât dans son foyer les vacances de Noël ou de Pâques. La nouvelle se répandit comme un gaz asphyxiant et nous en fûmes suffoqués. S »en aller en congé n’importe où ! Cirer ses bottes comme les officiers d’Etat-Major, le vaguemestre ou les chauffeurs d’auto ! Quitter cette zone gluante sentant le chlorure de chaux, le sang desséché et la paille échauffée ! On dansait comme de grands enfants que l’on était devenus. C’était à qui partirait le premier. Ceux qui n’avaient jamais été exemptés de service par le médecin réclamaient la priorité pour plus longue présence au front. D’autres invoquaient, pour revendiquer un tour de faveur, l’état de feuillet matricule et de punition, resté vierge malgré la gravité des événements auxquels on avait été mêlés. Et au milieu de ces discussions, dominant les accents fiévreux des candidats partants, quelqu’un cria : « Mais N. d. D., vous êtes fous ? Pour aller en permission, il faut de la galette ! » On se regarda, médusés. De l’argent, on n’en avait guère et l’on n’y avait même pas pensé. Et c’est en raison de cette impécuniosité générale que le marrainage naquit… 
Les marraines
lointaines et inconnues. En vérité, le marrainage était né beaucoup plus tôt : il avait vu le jour au lendemain de la bataille de l’Yser.
Vers
Les civils de l’arrière et les embusqués de tout crin et de tout poil en profitaient pour démontrer qu’ils étaient infiniment plus malheureux que nous. C’était une façon comme une autre de se faire pardonner bien des choses. Mais les femmes, plus fines, dotées d’un cœur généralement plus sensible et, faut-il le dire, connaissant mieux la résistance des effets, fussent-ils militaires, se doutaient bien, malgré les communiqués à l’eau de rose, de ce que notre tenue, neuve au mois d’août, commençait à s’user. Elles fondèrent des ouvroirs : chemises, chandails, chaussettes, etc… sortaient de leurs mains comme par enchantement. L’armée innombrable, avait des besoins que l’on ne pourrait évaluer. Mais les Françaises veillaient. Grandes dames, ouvrières d’atelier, petites filles des écoles, tout le monde s’attela à cette besogne gigantesque : doter chaque soldat du front d’un cadeau de Noël. Ils nous parvinrent, ces cadeaux, à la date voulue malgré le désarroi des moyens de communication.
Tenez, en écrivant, je revois cette grange, là-bas quelque part dans le
secteur de Loo. Je revois le fourrier distribuant les paquets et je ressens
encore l’émotion qui m’étreignit en déballant la paire de chaussettes qui
m’était attribuée. Il y avait, épinglé sur la laine, un tout petit billet,
écrit par une main malhabile : « Sois
fort et courageux, vaillant soldat belge, 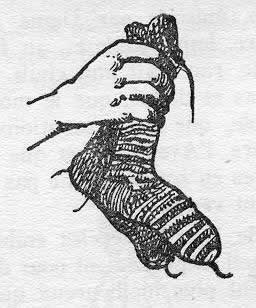
Depuis lors, j’en ai vu un peu de toutes les couleurs dans la vie.
J’ai défilé, à Houthem, devant le Président du Portugal ; à Je ne fus jamais aussi ému que je l’étais en lisant le billet de la petite Française.
Quand on a connu l’après-guerre, quand on a constaté combien de gestes
philanthropiques sont déflorés par le fait que leurs auteurs recherchent avant
tout la gloire, quand ce n’est pas l’intérêt, on revoit, en pensée, toutes ces
femmes anonymes travaillant sans relâche pour que le défenseur du pays
« reste vaillant et fort ». Alors, on compare les époques et l’on
regrette un tantinet le temps où l’on passait 
Un cas de conscience. Je devais entrer en relations épistolaires avec Mademoiselle Rose Honorez, quelques mois plus tard. Pour être précis, cet événement se produisit en février 1915. Et ce fut un événement. Pensez donc, écrire à une femme inconnue, alors que la mobilisation est venue interrompre votre lune de miel ! Mais n’anticipons pas. L’existence de Mademoiselle Honorez me fut révélée de façon bizarre et grâce à une petite indiscrétion. 
Et d’abord, laissez-moi vous dire que le service postal, en temps de guerre, ne peut avoir, par comparaison, aucun point de contact avec l’organisation postale du temps de paix. Cela est très compréhensible. Les régiments se déplacent perpétuellement et, au sein même des unités, les mutations imposées par les besoins du service, les évacuations des blessés et des malades vers l’arrière, amènent un confusion dont le diable lui-même ne s’est jamais fait une idée. Il en résulte que les correspondances n’atteignent que très difficilement leurs destinataires.
A mes moments perdus, et vous pensez si on en avait quand Un jour, dans le fatras des correspondances, couvertes, pour la plupart, de renseignements embrouillés, griffonnés par le vaguemestre, au moyen d’un mauvais crayon-aniline, je découvris une écriture connue. Le destinataire nous avait quittés depuis belle lurette, pour une région mal définie. L’expéditeur était Henri Limelette, ancien de la compagnie, réformé pour maladie et attaché à une banque de Paris. Que la déesse Posta me pardonne, je lus la carte d’Henri. Il y a des moments dans la vie où le secret des correspondances vous paraît moins inviolable, et puis, je voulais voir ce qu’était devenu mon ami. Il terminait sa carte par cette phrase : « Tu m’obligerais en envoyant des cartes-vues du front à ma cousine Mademoiselle Rose Honorez, 184, avenue Victor Hugo, à Paris ». J’ai noté l’adresse de la cousine. Vous souriez, je le sens. Et pourtant, vous n’y êtes pas. Je me disais que la carte ne parviendrait sans doute jamais au monsieur désigné pour envoyer des cartes du front et que c’était là, en somme, une besogne dont je pouvais parfaitement me charger. Je courus les magasins pour trouver des cartes. Je fouillai vainement tout Bray-Dunes. Alors, l’idée me vint d’écrire à la cousine d’Henri. Voilà que vous souriez encore… Et c’est ici que le drame commence, drame de conscience, bien entendu. Mettez-vous à ma place. J’ai vingt-quatre ans, quinze mois de mariage, un bébé qui a dû naître en ces derniers temps, du moins je le suppose. J’ai abandonné là-bas un bonheur inattaqué et inattaquable et je vais écrire à une femme. C’est la première fois que je vais écrire à une femme, depuis le jour où j’ai juré une fidélité Eternelle, avec un E majuscule. Et ce qui est pis, cette femme est une Parisienne. Pour un Belge de 24 ans, en 1915, tout au moins, une Parisienne, c’est un être vaporeux, lettré, qui fleure la violette ou le Pompéia ; qui aime recevoir les compliments et les rendre sans en penser un mot. Je me demandais, comment, diable, Henri Limelette, né natif de Dour, pouvait avoir une cousine à Paris. Il est vrai que les militaires ont des cousines un peu partout, me disais-je. Après tout, c’est peut-être sa fiancée, ou sa maîtresse, ou bien les deux. Il me reprochera probablement d’avoir écrit. Tant pis, je me mis à rédiger. Et voyez un peu de quoi est capable un homme de vingt-quatre ans, qui a quinze mois de mariage et qui entend terminer une guerre sans aventure inutile : je commençai par dire dans ma lettre que j’étais marié. Puis, je parlai de tout, en châtiant mon style, comme il convient de le faire quand on écrit à une femme qui est censée fleurer la violette ou le Pompéia. Paris, tout le monde descend. Cette première incursion dans le monde extérieur eut un résultat inattendu. Le sergent de garde vint m’inviter, un jour, à retirer au poste de police, un paquet parvenu à mon adresse.
J’avais fait tant de blagues à mes copains que j’eus l’impression que
mon tour était venu d’être mystifié. En effet, qui aurait pu m’envoyer un
colis ? Je ne connaissais personne à l’arrière et Et pourtant, le colis venait d’elle. J’en fus vexé. Le ton de ma lettre aurait dû lui faire comprendre que je n’entendais pas que l’on me prit en pitié. Mon amour-propre exagéré me fit manquer de psychologie. J’oubliais que pour cette étrangère, j’étais avant tout un poilu… délabré et qu’elle s’accrochait à une occasion de faire le bien en m’envoyant mille gâteries. Mais nous avions été élevés à une époque où, l’argent n’étant pas un dieu, on avait, de la dignité, une conception qui s’est transformée depuis et je ne parvenais pas à surmonter mes scrupules. Je fus sur le point de renvoyer le colis avec une lettre de remerciements et d’excuses. Ce sentiment-là, à l’heure qu’il est, ne manque pas de faire sourire… et pourtant… Durant les mois qui suivirent, je fis comprendre à ma correspondante que j’accepterais volontiers ses lettres parce qu’elles me réconfortaient, mais que je ne voulais, à aucun prix, voir renouveler le geste qui m’avait tant chiffonné. Elle le promit et tint parole. Ses lettres ? Elles me parlaient du bon Dieu, de Saint-Christophe, de la bienheureuse Bernadette et de tout l’Etat Major spirituel. Je me disais : c’est bien ma veine, Limelette était un coco de mon espèce et sa cousine est une zélatrice de Saint Vincent-de-Paul. Ce qui ne nous empêcha d’ailleurs jamais de nous entendre à merveille. J’avais, dans ma première lettre, fait allusion à mon état-civil ; je fis par la suite allusion à mon état d’esprit. Il n’y eut de ce fait aucun nuage entre nous. Au contraire, Mademoiselle Rose multipliait ses sermons sur la montagne et elle m’annonça un beau jour, qu’elle m’avait placé sous la protection de Saint-Christophe. J’objectai que Saint-Christophe préservait ses clients des accidents et qu’au front, l’accident était plutôt exceptionnel. Rien n’y fit. Et je tiens à ouvrir ici une parenthèse. Pour qu’une réflexion, involontairement maladroite, ne puisse faire supposer que je ris de la croyance d’autrui, je tiens à souligner le f ait suivant. Pour être sacré filleul de Mademoiselle Rose Honorez, il fallait être au front, les autres mobilisés n’étant pour elle que des hospitalisés de troisième zone. Or, sur les dix-neuf filleuls de Rose, placés sous la protection de Saint-Christophe, aucun ne fut tué ni blessé. J’ai souvent raconté cela depuis que la guerre est finie. Les croyants ont levé vers le ciel un regard chargé de reconnaissance. Les autres m’ont fait remarquer que les monuments élevés aux morts de la guerre eussent été inutiles, si Saint-Christophe avait pris tout le monde sous sa protection. Je me suis chaque fois gardé de donner mon avis. Chat échaudé craint l’eau froide. En effet, j’ai publié mon journal de campagne en 1925. J’y blaguais les aumôniers militaires, sans la moindre méchanceté d’ailleurs. Quelques sectaires assermentés ont classé mon livre parmi les ouvrages peu recommandables. Si j’insiste donc aujourd’hui sur ce chapitre délicat, c’est pour bien montrer qu’en pleine guerre, une grande chrétienne adoptait un filleul mécréant sans arrière pensée et qu’un soldat, beaucoup moins catholique que le Pape, savait parfaitement digérer les histoires de Saint-Raphaël ou de Saint-Jean-Baptiste par souci de respecter la croyance d’autrui. Il ne faut d’ailleurs pas vous figurer que Mademoiselle Rose Honorez était une de ces bigotes ratatinées qui écoutent le « Gloria in Excelcis » avec des frissons à fleur de peau. Non, Mademoiselle Rose était tout simplement une militante à poigne, clamant son amour pour Dieu, sa haine pour les Boches, et qui faisait marcher les hommes à la baguette. Il est vrai que c’était une vieille fille. A ce moment là toutefois, j’ignorais ce détail. Rien dans ses lettres ne me permettait d’être fixé sur le fait de savoir si ma marraine sortait de l’adolescence, si elle s’épanouissait au soleil de la trentaine ou si elle avait dépassé l’âge où on se fait des illusions. Il va sans dire que je n’aurais pas osé me permettre de le lui demander. On m’avait vaguement appris que l’on ne peut jamais poser semblable question à une dame et je n’aurais pas voulu laisser supposer que cela m’intéressait. Je continuai donc à lui envoyer des renseignements sur notre genre de vie, en tenant compte des exigences de la censure. Un jour, elle réclama ma photo. J’étais parmi les plus anciens de ses filleuls et elle ne connaissait pas ma « bobine ». Je demandai la sienne en échange et cela me mit à l’aise : Mademoiselle Rose avait 42 ans. A l’heure où j’écris ces lignes, c’est moi qui les ai, ou presque. Les dames de mon âge, qui me liront, ne verront, je l’espère, rien de déplaisant dans le paragraphe précédent. Je les considère comme étant encore capables de faire tourner la tête à plus d’un homme soi-disant fort, à condition toutefois qu’il n’ai plus 25 ans. Et comme si l’échange de photos eut été un signal, on accorda des permissions. Rose fut mise au courant de la chose et elle m’écrivit : « Venez ». Oui ? Aller ? C’était chic de sa part de m’inviter ainsi tout de suite, mais je vivais au jour le jour, moi. On peut en penser ce que l’on voudra, mais un soldat, en temps de guerre, fume la pipe même s’il n’a jamais fumé. Il boit des pintes, même s’il a toujours été sobre comme un chameau. J’avoue en me voilant la face, que je faisais les deux.
Ce n’est pas le prix du coupon qui me faisait hésiter. On avait le
transport gratuit jusqu’à Calais (en 1915, les trains de permissionnaires n’existant
pas encore, on payait 6 fr. 55, en seconde, de Calais à Paris). Mais je ne me
dissimulais pas qu’arrive dans Je fis mon bilan. Ce fut très simple. Je finis par me dire que trois jours d’absence ne seraient pas à la ruine et je décidai d’aller voir ma marraine. Je vous fais grâce des péripéties du voyage à l’aller. Plus tard, quand le chemin de fer aura trépassé, assassiné par la concurrence automobile, peut-être me viendra-t-il à l’idée d’écrire une série d’articles sur « La voie ferrée à travers les âges ». Je vous montrerai alors de quelle façon on effectuait, en 1915, un trajet qui dure normalement trois heures en rapide et qui, en temps de guerre, en prenait vingt-quatre, parfois d’avantage. 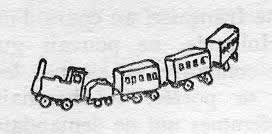
184, Avenue Victor Hugo Le voyageur qui débarque pour la première fois à Paris, par la gare du Nord, est déçu. Il a vu la capitale de France en rêve, il l’a grandie comme à plaisir, et il trouve que le boulevard Magenta ressemble aux boulevards de toutes les grandes villes. Je vous laisse à penser ce que ce débarquement sur l’asphalte parisien pouvait représenter en pleine guerre, sur le coup de dix heures du soir. Et quand je vous aurai dit que les gendarmes belges, de faction sous le hall, m’avaient énervé avec leurs petites manières de faiseurs d’embarras, vous comprendrez qu’en sortant de la gare, il faisait aussi noir dans mon âme qu’à l’entrée de la ville, ce qui n’est pas peu dire. La « civile » avec qui j’entrai en conversation ne devait pas contribuer à faire passer cette première impression désagréable. En l’occurrence, c’était la patronne d’un bistrot dans lequel j’avais pénétré avec l’illusion qu’il suffisait de demander une consommation pour l’obtenir. J’étais à cent lieues de supposer qu’à Paris, un militaire ne pouvait plus avoir soif après neuf heures du soir, alors que le civil pouvait s’en donner à cœur joie, sans que personne songeât à l’en empêcher. Vous avouerai-je qu’en faisant cette constatation, j’eus le pressentiment que le mobilisé était une poire. Les années qui passèrent me donnèrent mille fois l’occasion de comprendre qu’il ne pouvait en être autrement. Quand le monde est bouleversé, les malins en profitent pour tirer la couverture autant qu’ils le peuvent ; quant aux autres… ma foi, les autres… Toujours est-il que, parti du front plein d’allégresse, je sortis de ce bistrot tout décontenancé. A quoi peut tenir la joie en ce bas monde ? Je crois que je serais regrimpé dans le train, si Rose ne m’avait attendu. Mais je lui avais écrit et il ne s’agissait pas d’être impoli. Je m’engouffrai dans le métro. J’étais à peine installé dans le bolide souterrain qu’un poilu français m’interpellait. Il revenait de l’Argonne. Il me parla de crapouillots, de gaz asphyxiants et d’attaque avortée. J’avais quitté le front avec l’espoir de ne plus entendre parler de la guerre pendant trois jours et ça s’annonçait bien. Cependant, deux postiers qui se rencontrent se scient mutuellement les côtes en parlant de la poste ; deux instituteurs, parlent de leur devoir de conférence ; deux députés, de l’interpellation du jour et deux ménagères, de la cherté de la vie. Il est assez logique que deux poilus s’entretinssent de ce qu’ils venaient de quitter. Ils n’avaient d’ailleurs plus, après un an de campagne, d’autres sujets de conversation.
Je sortis du souterrain à Il s’agissait de repérer l’avenue Victor Hugo. Si c’est là un jeu d’enfant en temps ordinaire, c’était plutôt compliqué dans l’obscurité.
D’autant plus que Mais un poilu est comme un chat, il y voit la nuit et le n° 184 me fit pousser ouf ! d’abord, et un oh ! ensuite. Ouf ! parce que j’étais enfin arrivé ; oh ! parce que l’immeuble dans lequel j’allais pénétrer n’avait rien de comparable aux casemates du pont de Dixmude. Résolument, je tirai la sonnette. La porte cochère me livra passage et se referma. Je me trouvais dans un hall puissamment éclairé. Je n’avais plus supporté pareille lumière depuis l’incendie de l’église de Oud-Stuyvekenskerke et je clignais des yeux comme une poule éveillée en pleine nuit. Cinq minutes se passèrent. Je ne voyais personne. Je me souvins alors de l’aventure survenue à ce Borain, arrivé par le premier train, à Bruxelles-Midi le jour des funérailles du Roi Léopold II et qui se demandait anxieusement où il pourrait s’adresser pour satisfaire un petit besoin particulièrement urgent. Notre gaillard sonne à la porte cochère d’une maison de maître, la porte s’entr’ouvre et la servante passe dans l’entrebâillement, un bras armé d’un poêlon. C’était l’heure du passage du laitier. Enfin, une dame passant dans la cour m’aperçut. Elle devina tout de suite que le concierge, croyant avoir à faire à un locataire, s’était remis sur le côté gauche, après avoir tiré le cordon. Elle vint à mon secours. - Vous venez pour Mademoiselle Rose, sans doute, monsieur ? Quelle veine, me dis-je, voilà quelqu’un de la famille. - Ils sont déjà plusieurs là-haut. - Là-haut ? - Mais oui, chez Mademoiselle Rose, je vais vous conduire. Et s’emparant d’un bougeoir, elle me précéda dans l’escalier. J’étais entraîné aux longues marches, mais, au front, il n’y avait plus d’escalier. Au troisième étage, j’aurais volontiers crié halte, comme le faisaient les soldats, la nuit, au retour des tranchées, lorsque le sac commençait à limer les épaules et que le commandant oubliait la halte réglementaire. Rose était au sixième. Je n’osais rien demander à mon guide. La bougie montait, montait, et je la suivais, terrassé par le poids de mes vêtements d’hiver, que j’étais bien forcé de porter en été. Enfin, nous y fûmes. Une porte s’ouvrit. Une dame parut sur le seuil. - Bonsoir, Rose. - Bonsoir, Jules. On était aussi à l’aise tous les deux que si l’on s’était quittés la veille. Entre-temps, ma cicérone avait disparu dans le corridor, sans que j’aie pu la remercier. Dans l’appartement plusieurs soldats se levèrent dès mon entrée. Je n’en connaissais aucun. Rose fit les présentations nécessaires et nous nous mimes à parler tous en même temps. Il vous est certainement arrivé de faire un voyage en tram ou en chemin de fer, en compagnie de militaires rentrant à la caserne. Vous avez pu constater que les soldats en groupe sont comme les jeunes filles de pensionnat : ils ont la langue bien pendue. Je vous laisse à penser ce que devait être chez Rose, cette première entrevue de poilus de différentes divisions. Un vrai rassemblement d’officiers d’Etat-major à la fin d’une manœuvre. On encerclait la tête de pont ; on allait à l’assaut du redan ; on interrogeait les prisonniers.
Les yeux de la marraine brillaient. Elle posait des questions, elle
voulait savoir. On triquait à la victoire finale, à l’extermination des Boches.
On défilait dans les rues de Mons, musique en tête. Le Borinage était descendu.
Les mineurs criaient de toutes leurs forces : « Vive l’armée, vivent
les soudards ! » Grands enfants que nous étions ! Mais quelqu’un
troubla la fête : un pou à bec d’acier escaladait lentement ma jambe. J’en
avais laissé des milliers et des milliers dans l’étuve du bain militaire, à Paris dort et je l’envie. Depuis deux heures, les autres m’ont quitté et je n’ai pu fermer l’œil. Ce lit si blanc, si moelleux, ne convient pas à mes muscles durcis. 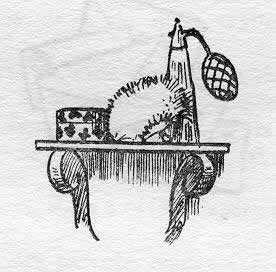
J’ai éteint la lumière et je fume force cigarettes près de la croisée entr’ouverte. Paris dort. On se croirait en pleine campagne. Le vent frais fait frissonner les feuilles des arbres du boulevard, c’est là le seul bruit qui parvienne jusqu’à moi. De temps en temps, une auto passe, phares voilés, roulant silencieusement. Où donc est le Paris bruyant de 1914 ? Le Paris des fêtards ! Le Montmartre universellement connu, où, à pareille heure, on commençait à souper ? Les fêtards sont partis, les uns aux armées, les autres, vers le sud, lors de la fuite éperdue de septembre 1914, lorsque les mauvaises nouvelles parvenaient ici, ravageuses comme le choléra. Il reste, à Paris, la gente besogneuse, les restaurateurs et les portiers de cinéma. L’armée a drainé le plus gros, les femmes ont remplacé les hommes dans les banques, au métro et sur les tramways. Paris, berceau des révolutions, est vide… Paris en flânant Comme c’est autoritaire une marraine de guerre ! Rose nous a tracé un itinéraire pour toute la journée. On déjeune, on dîne à telle heure, pas d’excuse pour le retard éventuel, en avant marche ! C’est un adjudant que cette femme ! Un adjudant gentil, qui donne des ordres en souriant, mais qui néanmoins, les donne et je pressens qu’il ne s’agirait pas de désobéir. Loin de moi l’idée de m’en plaindre. N’a-t-elle d’ailleurs pas le droit de nous traiter en grands gosses ? On est sorti en ville tous ensemble, comme des collégiens. Rose tient le milieu du groupe. Le Roi Albert, en défilant, à Bruxelles, à la tête de ses troupes, lors de la rentrée au pays, ne cambrait pas davantage le torse. Naturellement, Rose a offert l’apéro chez le bistrot du coin. - Ce sont des parents, madame ? - Des filleuls, monsieur, ils sont tous au front. Il n’est pas nécessaire d’ailleurs, que marraine Rose donne ce détail. Le Parisien se doute bien en regardant nos capotes que nous ne sortant pas d’un bureau d’état-major. Pour ma part, je porte une tenue qui pourrait aussi bien être celle d’un prisonnier russe ou d’un tirailleur en convalescence. Les clous qui garnissent mes chaussures ont à peu près la taille des vis à glace dont on orne les pieds des chevaux, en période de gelée ; les manches de ma veste sont couvertes de taches de bougie et mon képi…, mais à vrai dire, est-ce un képi ? Il n’empêche que je fais mon petit effet en rue. Mes compagnons sont en tenue kaki, les premières distribuées au front belge, et on les prend pour des Anglais. Des midinettes à la mine tricolore, bleu dans le coin des yeux, rouge aux lèvres et blanc sur le reste, nous interpellent « Good bye, sir ». Mais j’oublie de dire que ceci se passe l’après-midi et que Rose n’est plus avec nous. Il ne manquerait plus que cela ; non, Rose a voulu nous laisser libres de flâner à notre aise dans ce Paris que j’ai plaisir à montrer à mes compagnons. Ils n’ont guère eu l’occasion de visiter les grandes villes, ces braves gars, et ils roulent des yeux… 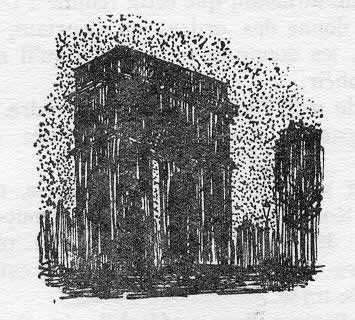
Cependant, Paris n’est guère intéressant en ce moment. On y sent peser lourdement les deuils causés par une année de guerre. On n’y connaît pas encore la restriction, cela viendra plus tard, au fur et à mesure que cette infernale aventure se prolongera, mais pour le moment, çà va. Et puis, on y jouit d’une tranquillité relative depuis que le front s’est stabilisé. Certes, l’alerte a été chaude et les vieux, particulièrement ceux qui ont vécu 1870, reparlent de septembre 1914 avec des regards épouvantés. Les Uhlans sont venus jusqu’à la lisière du Bois de Boulogne. Mais il ne s’agit pas de rentrer en retard, Rose a dit « sept heures ». Elle avait d’ailleurs de bonnes raisons pour insister sur l’heure de rentrée. Un souper princier nous attendait. Et lorsque deux jours plus tard, sur le quai de la gare, au moment de repartir, nous nous efforcerons de faire comprendre à la marraine combien nous sommes touchés de l’accueil qu’elle a bien voulu nous réserver, elle dira simplement : « Ce n’est rien, mes enfants, entrez-leur dans le chou, à ces sales Boches et revenez nous bien vite, indemnes et victorieux ». La plus jeune Marraine de France On était au printemps de 1916. L’espoir renaissait Verdun était sauvée. Les communiqués redevenaient soporifiques. On délaissait les journaux quotidiens pour les revues. Parmi celles-ci, la « Vie Parisienne » connaissait la grande vogue. C’était une revue illustrée qui existe d’ailleurs toujours et dont le transport par la poste est interdit en Belgique, sous prétexte que cette publication est trop décolletée. Vous pensez si ce genre d’illustré devait avoir du succès auprès d’hommes jeunes qui étaient tout heureux de pouvoir de temps en temps admirer autre chose que le Mauser, modèle 1889, le canon de 75, ou le masque anti-gaz.
On lui fit la chasse, bien entendu. Il y avait parmi les officiers, pas
mal de puritains et de petits folichons se disant puritains parce que cela
faisait plaisir à l’aumônier. Bref, on essaya de mettre « C’était le meilleur moyen de la propager. Le Belge est ainsi fait. Que certaine presse critique tel spectacle parce que trop leste, c’est la vogue assurée et le théâtre ne désemplit plus. C’est ce qui arriva au front. Mais le directeur de la revue n’était pas manchot et il en profita pour exploiter une véritable mine : le marrainage. Ce fut le premier coup d’épée donné à cette institution. Le marrainage, si respectable, dégénéra en marivaudage plus ou moins louche, ainsi que je l’exposerai plus loin. Ce fut néanmoins grâce à la « Vie Parisienne » que le jeune sous-lieutenant X (nous l’appellerons Robert, afin qu’il ne m’envoie pas du papier timbré, si le présent récit lui tombe sous les yeux), que le sous-lieutenant Robert des Chasseurs à pied, découvrit sa marraine. Robert s’ennuyait au front, à en devenir malade. Pensez donc, il avait rêvé de participer à des assauts, et il était venu échouer à mon régiment, dans le secteur inondé de Ramscapelle. Lettré, soigné de sa personne, il souffrait plus que tout autre d’être forcé de salir son bel uniforme en rampant dans les abris enfumés du chemin de fer de Nieuport et de subir, des soirées durant, la conversation insipide des troglodytes de tranchée. Il voulait une marraine. Mais il était très difficile sur le choix. La « Vie Parisienne » vint le tirer d’affaire. Il y trouva un jour cette annonce : « Jeune marraine, douce, jolie, cherche filleul élégant, distingué, pour correspondre. Ecrire X.Y.Z., à Saint-Étienne (Loire). » On entendit, la nuit suivante, un soldat qui grognait en s’agrippant à la passerelle. C’était l’ordonnance du lieutenant Robert, qui revenait du cantonnement, porteur d’une boite de papier à lettre super chic. Le lendemain, le cuistot emportait vers l’arrière une missive délicieusement parfumée qui devait porter à la jeune marraine, douce et jolie, les pensées du filleul élégant et distingué. Le sous-lieutenant Robert était fier de sa découverte, mais
Il ne croyait pas dans sa candeur
naïve Que l’amour innocent qui
germait dans son cœur Put se changer un jour en une
ardeur plus vive Et troubler à jamais ses rêves
de bonheur. C’est ce qui arriva cependant. Il exhiba fièrement la réponse reçue, puis vint la lire au bureau de la compagnie. Pour une belle lettre, c’était une belle lettre, écrite avec un porte-plume manche de brosse, comme en emploient les comtesses, marquises et femmes du monde en général. Mon lieutenant riait aux anges. Des semaines passèrent. Il était visible que le porte-plume manche de brosse fonctionnait, le filleul était transfiguré.
Puis, son tour vint de partir en permission. Il acheta à prix d’or, à J’attendais son retour avec impatience. Il vint nous rejoindre dans les baraquements de Wulpen. Il était tard. J’allumai une bougie supplémentaire pour voir mieux sa face. Il riait en découvrant ses dents blanches. Eh bien, demandai-je, et la marraine ? -Délicieuse, mon vieux, délicieuse. - Raconte. - Eh bien, voici. Je te jure que jamais, dans mes lettres, je n’avais parlé d’amour. Cette femme inconnue m’inspirait un respect inimaginable. Mais je me disais, en pensant à notre entrevue : fine comme elle est, elle comprendra bien que je suis bouleversé. Bref, je me mis en route. Ce train n’avançait pas. Je fis la traversée de Paris, non pas à la nage, mais à du trente, dans un tacot. Et j’arrivai à Saint-Étienne. En sortant de la gare, je m’oriente, on m’indique la maison où je vais peut-être changer le cours de ma vie et je sonne, le cœur battant à se rompre. Une vieille servante vient m’ouvrir. Elle m’introduit dans un salon doré et va annoncer mon arrivée. Une personne d’âge mûr, aux cheveux blanchis, vient me rejoindre, s’avance vers moi, les mains tendues, me questionne avec un doux sourire et puis, devinant sans doute combien grande est mon impatience me dit : « Vous désirez voir votre marraine, n’est-ce pas ? Venez ». Je la suis en comprimant les battements de mon cœur. La vieille dame m’introduit dans une pièce somptueuse, découvre un berceau et me dit simplement avec un sourire malicieux : - La voici, monsieur le lieutenant. Ma marraine avait six mois… 
Peut-être est-ce son nom Ou le fameux tendon, Toujours est-il qu’il sait
plaire A toutes les jeunes moukères. Ainsi finissait la chanson que j’avais composée, en 1916, pour silhouetter Achille, mon ordonnance, qui tenait un rôle dans la revue « Tout 2/I y passera ». Mon ordonnance ? Titre pompeux pour désigner un groom de sergent-major ? Achille était mieux que cela. C’était un frère. Souffrez que je le dépeigne. Milicien en 1911, Achille, originaire d’Iseghem, avait fait son service au 2e Chasseurs à pied, en garnison à Mons. Son séjour dans la ville du Doudou ne l’avait pas dégrossi. Achille, comme tant d’autres miliciens, originaires de la région Courtrai-Roulers, ne connaissait pas un traître mot de français. Lorsque le clairon de garde annonçait que les soldats, non de service, pouvaient sortir en ville, Achille se rendait au réfectoire, mangeait son kilo de patates, puis allait digérer dans un café-concert des environs où, à défaut de comprendre ce que l’on disait, il pouvait néanmoins saisir la signification des gestes. Le plus souvent, la maigre solde étant épuisée, il passait sa soirée à raccommoder des chaussettes ou à préparer le lit du voisin, moyennant un quart de pain et un peu de confiture. Mon Achille était donc rentré au village natal, le service terminé, aussi balourd qu’il était venu. A la mobilisation, il fut désigné pour ma section. Je l’avais repéré tout de suite. Ce garçon avait un air ahuri qui m’amusait. Grâce à un interprète, je lui proposai de devenir mon ordonnance, contre rétribution de un franc par semaine. Il accepta spontanément. Je dois dire qu’il encaissa pas mal de francs avant qu’il fût question de l’installer dans ses nouvelles fonctions. Pendant les premiers mois de guerre, on couchait dans les champs de luzerne ou de betteraves. On ne pensait guère à faire cirer ses bottines et l’on éprouvait pas le besoin de nettoyer ses armes, les inspections du fusil démonté n’étant plus à la mode et les Allemands étant encore loin. Je conservais néanmoins Achille qui me paraissait doux comme un agneau et muet comme une carpe. Plus tard, j’avais pris du galon, ma solde s’en ressentait et mon ordonnance commençait à zézayer les quelques mots de français que je m’évertuais à lui apprendre. Il parvint à s’exprimer en si peu de temps que je n’en revenais pas. Je pensai à Robinson Crusoé et à son fidèle Vendredi. Je confesse que j’étais loin de faire, dans sa langue, les progrès qu’il faisait dans la mienne. Nous étions toujours ensemble en 1916, lorsque Achille, qui usait mes vieux bâtons de cosmétique, résolut de chercher une marraine comme tout le monde. Nous fîmes un pacte. Je tâcherais de dénicher la marraine, je lui écrirais au nom d’Achille et, le moment venu, c’est lui qui irait la voir. Il y avait là-dessous la charpente d’un vaudeville et cela m’amusait prodigieusement. En cherchant la marraine en question, j’en découvris trois. Deux sœurs, habitant ensemble au quai de Valmy, à Paris, deux modèles vivants pour antiquaire, et une charmante jeune fille dans le fond du Calvados. On échangea les premières correspondances. Le quai de Valmy prodiguait ses conseils « pot au feu », le Calvados voguait dans l’irréel. Je lisais les lettres à mon Achille qui écoutait en ouvrant la bouche toute grande. Il me marqua immédiatement ses préférences pour le quai de Valmy. D’abord le style était plus à sa portée et puis il pouvait dire, en parlant de ses deux marraines : « Elles habitent Paris ». En pleine guerre, c’était un titre. Quand à l’autre, je ne sais quel oiseau ce devait être puisque je ne l’ai jamais vue, mais elle me faisait l’effet d’une femme qui avait été élevée dans un milieu révolutionnaire. Je contrecarrais ses idées pour avoir le plaisir de lire la riposte et j’avoue que, bien souvent, j’avais nettement le dessous. C’était une des rares Françaises lettrées, dont je lisais la correspondance, qui ne faisait pas de fautes d’orthographe. Ceci dit entre parenthèses, ainsi que le major Louis Tasnier l’a écrit quelque part un jour, j’étais devenu une sorte d’agent épistolaire à la compagnie. Cela me permit bien souvent de sonder le cœur féminin et d’y découvrir des trésors insoupçonnés de douceur et de sensibilité. Il est entendu que mes fonctions d’intermédiaire prenaient fin à partir du jour où mes poilus étaient allés rendre visite à leur marraine. Ne vous figurez donc pas que le principal sujet que j’avais à traiter pour eux était l’amourette possible. Ce n’eut d’ailleurs pas été intéressant. Quand on n’a jamais vu une femme, on peut lui faire croire qu’on l’aime, mais cela doit manquer de conviction. Si j’insiste sur ces détails, c’est parce que trop de poilus véritables et surtout trop de soi-disant poilus ayant passé la guerre loin des lignes, sont venus prendre des airs de conquérant en parlant de toutes les marraines en général. J’aurai le regret, pour que mon histoire de marrainage soit à peu près complète, d’être obligé d’aborder plus loin la narration de certains exploits mis sur le compte du marrainage. Mais je proteste lorsque j’entends prétendre que la femme s’offrant à devenir la marraine d’un soldat qu’elle ne verrait peut-être jamais, avait, avant tout, une idée derrière la tête. S’il en eut été ainsi, les deux sœurs du quai de Valmy ne seraient jamais devenues les marraines de mon ordonnance. C’est chez elles évidemment qu’Achille décida de se rendre d’abord. Il me conta, au retour, qu’elles n’avaient pas eu l’air trop étonnées en le voyant. Il leur avait expliqué d’emblée qu’il ne savait pas écrire et « que le serzant-mazor c’était une sique type qui faisait son lettre ». Les deux bonnes vielles filles en avaient été émues et mon Achille avait passé, chez elles, quelques jours « qu’il n’oublierait zamais ». Mais six mois plus yard, il s’en alla dans le Calvados et là, ce fut une autre histoire. La marraine révolutionnaire qui s’attendait à voir arriver un bonhomme avec qui elle pourrait discuter de la nécessité de la continuation de la guerre, prit la farce du mauvais côté. On fut certes gentil chez elle, pour ce malheureux qui s’exprimait en petit nègre, mais Achille eut l’impression qu’il gênait et il alla finir ses vacances au quai de Valmy, près de ses deux antiquaires au cœur d’or. 
Les Marraines anglaises J’espère que cette réflexion ne fera de peine à personne : je n’ai jamais pu supporter les Anglais. Et ce qui est bête, au fond, c’est que je n’ai jamais pu m’expliquer pourquoi. Au front, lorsque je me trouvais dans un secteur, en liaison avec l’armée britannique, je souhaitais d’être relevé. Au cantonnement, lorsque je me trouvais dans un café, il suffisait qu’un tommy fasse son apparition pour que je disparusse. Inutile de vous dire que je n’ai jamais consenti à devenir le filleul d’une Anglaise. Pourtant, il y avait moyen. A certains moments, on en offrait à tout le monde. C’est peut-être la raison pour laquelle je n’en aurais pas voulu.
On nous en offrait parce que, si extraordinaire que cela puisse paraître
en 1932, nous, les Belges avons eu au-delà de C’était à l’époque où le pacifisme bêlant n’étant pas encore à la mode, on se souvenait de l’attitude de notre petit pays, au moment où avait éclaté l’orage de 1914. Les soldats belges qui débarquèrent en Angleterre, au lendemain des premiers combats, furent portés en triomphe. Les Anglaises étaient emballées à ce point qu’elles mettaient dans le même sac les soldats, ceux qui auraient dû l’être et qui se bornaient à fuir l’invasion, et les pauvres civils réfugiés, dont quelques-uns se crurent intéressant au point de devenir bientôt insupportables. Puis, quelques mois plus tard, le plus tard possible, dans bien des cas, les soldats hospitalisés « in England » vinrent nous rejoindre au front lequel, entre temps, s’était stabilisé. Evidemment, les Flamands qui revenaient de là-bas connaissaient l’anglais. Quand on livre ses pensées au public, il faut avoir le courage de reconnaître ce qui est. Il s’établit donc entre le front belge, la vieille Angleterre et les jeunes Anglaises, un échange de correspondances, duquel devait résulter le marrainage. Quoi que l’on ait pu en penser, en Angleterre comme n’importe où, cette belle institution du marrainage dégénéra, en fin de guerre, en une sorte de flirt pour ne pas dire plus. Cette réflexion me remet en mémoire une conversation, tenue chez des amis, vers l’année 1922, et qui me prouva combien était grande l’erreur commise à ce sujet par le public, en général, et par les femmes mariées, en particulier.
Mon ami avait fait la guerre et avait eu pour marraine une Espagnole
habitant Dans un hôtel de Londres, voisin de la gare de Victoria Cross, on n’admettait les voyageurs… accompagnés que pour autant qu’ils fussent porteurs de valises. Or, dans un petit magasin voisin de l’hôtel, on louait des valises à la journée, à l’heure ou à la demi-heure, suivant le temps dont disposait le client. C’est ainsi qu’un jour, un Belge, qui s’était mis en civil pendant son congé de convalescence, se présenta à l’hôtel, porteur d’une valise de location. Le portier avait un sourire énigmatique. Intrigué, notre Belge questionne. - C’est au moins la dixième fois que je revois cette valise ici, cette semaine, déclara le portier… Mon aversion inexpliquée pour l’élément britannique ne m’a pas aveuglé, bien entendu, au point de vue de ne pas savoir reconnaître que certains Anglais firent, pour certains Belges, de grandes choses. En tous cas, l’Anglaise dont je vais vous conter l’histoire avait un cœur peut-être assez singulier, mais un cœur tout de même. Je vous demanderai la permission de ne point citer le nom du héros de l’affaire. Il appartient encore à l’armée à l’heure qu’il est, a su y conquérir un grade enviable, à force de culot et a, par sa manière de servir, fait oublier une folie de jeunesse. Notre gaillard donc avait été très légèrement blessé sous Anvers – une blessure de six cents francs, comme disait le commandant Dupuis. Pendant la fameuse retraite sur l’Yser, on l’embarqua sur un bateau charbonnier qui le déposa à Folkestone. Sa barbe était devenue imposante. Il s’exprimait assez facilement en anglais. - Votre profession ? - Impresario. Il n’en fallait pas plus pour qu’on l’installât dans une limousine qui l’emmena dans un château. Je dois dire qu’en fait d’impresario, notre homme avait surtout connu des petits succès personnels dans les cabarets chantants, remplis de fumée où, perché sur une table, à côté d’un pianiste aveugle, il dégoisait des drôleries bien faites pour enthousiasmer les pensionnaires de l’établissement, sommairement vêtues, comme il convient quand il fait chaud. Il avait acquis dans cette profession un peu spéciale, un aplomb tel qu’à première vue, il éblouissait. Pas vilain garçon d’ailleurs. Il s’en rendait compte. Au château où il était hospitalisé, il racontait, par le menu, ses randonnées à travers le monde. Organisateur de telle tournée, il avait coudoyé les plus grands artistes du globe et il fallait bien le croire puisque ce n’était pas le moment de contrôler. En un rien de temps, il conquit le cœur de fille du châtelain et on les maria. Il revint au front. Les Capitaines quartiers maîtres, bien que n’ayant vu les batailles que de loin, avaient perdu leur comptabilité. On ne savait plus au juste à qui on avait affaire et l’on était bien forcé, pour reconstituer les feuillets matricules, de s’en référer aux déclarations des intéressés. Notre jeune homme déclara donc qu’il s’était marié en Angleterre, mais il oublia complètement de dire qu’il était déjà marié en Belgique avant la déclaration de guerre. 
Pour ceux qui pourraient croire que cette histoire a germé dans mon imagination, je dois dire que, faute de pièces administratives probantes, les cas de bigamie furent si pas nombreux, du moins assez fréquents à un moment donné. Pour en revenir à nos moutons, notre jeune marié menait, au front, une existence princière. « Il a des bagues à ses artoiles », disait en parlant de lui un wallon un peu envieux qui l’avait connu à la caserne. Je n’ai pas vérifié la chose, mais j’ai de mes propres yeux vu les mandats poste que lui faisait parvenir son Anglaise. Qui vendit la mèche ? Je ne l’ai jamais su. Toujours est-il qu’un beau jour on fit une enquête et que le Colonel de régiment fut amené à remettre les choses au point. La famille anglaise demanda le divorce. Elle l’obtint pour 250 francs, les torts étant du côté de la femme, disait l’acte. Si la procédure de séparation marchait aussi carrément en Belgique, ce serait à vous dégoûter de devenir avocat. Mais c’est ici que la singularité du caractère de cette femme divorcée apparaît. « Nous ne pouvons rester mariés, parce que nos conditions ne sont pas les mêmes, dit-elle à son ex-mari, dans une lettre dont on ma montré la traduction, mais vous êtes avant tout un soldat et je continuerai à vous envoyer de l’argent et des confitures. » Et elle tint parole. Le dortoir de Pendant les deux premiers congés que je passai à Paris, je profitai bien volontiers de l’hospitalité de marraine Rose. Certes, j’invoquai toutes sortes de prétextes pour prendre, autant que possible, mes repas en ville. J’emmenais les autres « pensionnaires » à Versailles, à Saint-Cloud, etc. Autant de motifs pour dîner au restaurant. Il était visible que Rose nous recevait de bon cœur, mais il ne fallait tout de même pas abuser. D’autant plus que les autres, ou du moins la plupart d’entre eux, avaient déjà l’air de considérer ces réceptions comme un droit acquis. Ces pauvres diables avaient certes une excuse. Rose les mettait à l’aise et ils n’avaient pas tous suffisamment de flair pour discerner à partir de quel moment ils abusaient. Rose, bien entendu, ne s’en plaignait pas. Au contraire, elle m’annonçait constamment dans ses lettres l’adoption de nouveaux filleuls. Et elle les acceptait sans distinction de grade ni d’origine. A certain moment, dans l’escadron Marie-Henriette, ainsi que j’avais baptisé les filleuls de Rose, on trouvait un capitaine, deux sergents-majors, un sergent et, parmi les soldats de deuxième classe, des universitaires et de braves mineurs du pays de Dour et de la région de Charleroi. Mais le cousin Henri Limelette qui, la banque sitôt fermée, de rendait chez Rose, se demandait si pareille situation pouvait s’éterniser. Il se demandait surtout, connaissant les disponibilités de sa cousine en fait de logement, comment elle s’arrangeait pour héberger tant de monde à la fois, et il m’en parla. Nous décidâmes de profiter de ma prochaine permission pour faire, à ce sujet, une petite enquête discrète. Nous fûmes bientôt fixés. En rentrant du théâtre un soir, Henri et moi, nous apprîmes, par le concierge, que deux soldats belges étaient arrivés au cours de la soirée à l’improviste. La « garnison » étant déjà bien fournie, nous nous demandâmes comment Rose avait pu s’y prendre pour caser ces nouveaux venus. On nous dit à l’étage que Rose leur avait cédé sa chambre. C’était fort bien, mais elle, à qui avait-elle été forcée de demander l’hospitalité ? Henri, qui avait un cœur d’or, s’énervait. Je veux éclaircir ce mystère, me répétait-il constamment avant de s’endormir. Le lendemain matin, dès l’aube, il fut sur pied. Prétextant une indisposition subite, il descendit à la cuisine. Rose y avait passé la nuit sur des caisses à sucre. Je m’en voudrais d’ajouter un mot pour qualifier pareille attitude, je vous en laisse le soin. 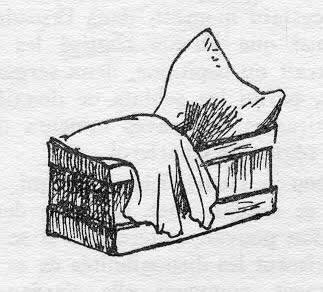
Ah c’te gueule…ah c’te binette !!! Il va de soi qu’après avoir fait semblable découverte, nous décidâmes de louer une chambre à l’hôtel. Il nous fallait un prétexte pour ne pas attirer l’attention des autres « locataires », car Rose ne nous l’aurait jamais pardonné. Elle déclara d’ailleurs lorsque nous la mîmes au courant de nos intentions, qu’elle en avait bien l’habitude, qu’elle nous défendait strictement de nous en aller et il fallut conjuguer nos efforts pour lui faire entendre raison. Restait le prétexte à invoquer auprès de nos compagnons. Je le trouvai au cours du repas du soir. - Nous ne pourrons pas rentrer aujourd’hui, dis-je tout à coup, Henri et moi avons donné rendez-vous à des copains à Montmartre et nous reviendrons trop tard. Le concierge ne serait pas content. Cela n’avait pas l’air d’enchanter la marraine. Craignait-elle pour notre vertu ? Ces vieilles filles, vis-à-vis de qui, en ce temps là, on évitait de parler des boites de nuit, se les représentaient comme un enfer d’où l’on ne revenait plus.
Une heure plus tard, nous étions, Henri et moi, attablés à Ce cabaret, sis en plein boulevard des Italiens, était le lieu de rendez-vous des Belges passant ou séjournant à Paris. Les gens de l’arrière venaient y prendre langue auprès de ceux du front, afin de pouvoir épater la marraine en racontant des exploits… accomplis par les autres. Quant à ceux du front, ils allaient au Pousset parce que c’était le café à la mode et que cela leur permettait, dès leur retour aux tranchées, de prendre des airs avantageux. Henri eut tôt fait d’y retrouver des amis. Pendant qu’ils échangeaient tous ensemble les banalités que l’on échange en pareille circonstance, j’inspectais les « têtes ». La grande majorité des clients était Belge. On savait repérer à distance, les sous-officiers d’avant guerre, devenus officiers auxiliaires, les officiers de métier et les anciens étudiants à qui on avait donné une étoile parce que l’on ne pouvait tout de même pas en donner une à mon ordonnance. Les premiers étaient passés au ripolin. Ils avaient cette façon spéciale de porter l’uniforme que nul d’entre nous n’aurait pu acquérir. Les seconds avaient cet air dépaysé qu’ont habituellement, dans les conseils communaux, les édiles nobles voisinant avec la roture. Quant aux universitaires, ils affectaient dans leur tenue un tel laisser-aller que les anciens premiers sergents-majors en étaient offusqués. C’est dans ce clan là, faut-il le dire, qu’Henri me présenta. Je m’y sentais évidemment plus à l’aise. Et d’ailleurs, on décida de ne pas moisir au Pousset. Il y avait, dans le coin, un officier médecin français, accompagné d’une poule, qui n’avait pas l’air de priser beaucoup les fantaisies de notre jeunesse turbulente.
Quelqu’un proposa d’aller chez Aristide Bruant et nous disparûmes dans
le Métro. Nous étions cinq. En route, on examina la possibilité de faire, à
Montmartre une entrée sensationnelle et nous échangeâmes nos capotes et nos
képis. Henri pouvait mesurer
Nous voici sur le seuil du cabaret Aristide. On pousse la porte.
« Ah ! c’te gueule, ah ! c’te binette ». Nous avons crié
cela tous les cinq ensemble et Aristide s’est avancé au milieu de la salle,
majestueux comme un dignitaire de 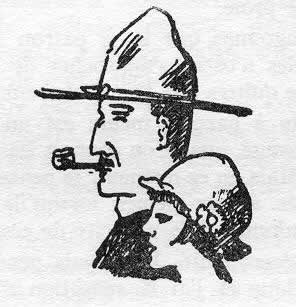
On sent tout de suite que l’irruption de soldats belges a secoué une torpeur qui menaçait de devenir dommageable pour l’établissement. Aristide Bruant est bien tel que je me l’étais figuré au cours de mes lectures. En savates, une large ceinture rouge au corps, il prend ce petit air à la fois protecteur et débonnaire spécial aux patrons de caboulots. Au fait, son établissement en est-il un ? Il ne l’a peut-être pas toujours été, mais je pressens qu’il l’est devenu : les temps sont durs et il faut vivre. Gentiment, comme un patron de café qui se respecte, Aristide a accepté une consommation. Il nous conte ses ennuis. La mobilisation a privé sa boite de ses meilleurs éléments et aussi de sa clientèle fidèle ; les affaires ne vont plus. On s’en aperçoit d’ailleurs en écoutant le ténor malingre qui s’est installé sur l’estrade. Le malheureux a une voix capable de fendre une bordure de trottoir. Puis, c’est le tour d’un poète chevelu, qui essaie de regonfler son porte-monnaie pendant ses jours de permission. Aristide recommence à se lamenter. Dans le cabaret, d’affreuses commères attendent vainement une proie. Aussi longtemps que le « patron » nous tient compagnie, elles n’osent s’approcher de nous, mais il nous a à peine quittés que l’encerclement commence. Tenir tête à pareille meute est un jeu d’enfant quand on a voyagé, quand on connaît les dessous d’une grande ville. Mais en ce moment, je pense à nos braves paysans, livrés à eux-mêmes, lorsqu’ils viennent en congé et abandonnés à la voracité de ces rats d’égout. Je suis désenchanté. Je croyais pénétrer dans un cabaret artistique et j’ai la sensation d’avoir échoué dans un bouge. De temps en temps, Aristide prend possession de l’estrade. Il nous a fait entendre plusieurs morceaux de sa composition notamment « A Ménilmontant » et « A Montrouge », chansons âpres, argotiques et non dépourvues de sel. On oublie un peu l’offensive de tout à l’heure. Mais voilà que des types à mines patibulaires sont entrés, à pas feutrés, dans l’établissement. Ils interrogent du regard la grosse « vertu défunte » qui semblait tantôt jouer un rôle de premier plan dans la manœuvre d’encerclement.
« Purée », dit-elle à voix basse, mais j’ai compris. Dans les
autres cabarets « artistiques » de C’est donc çà, le Montmartre de blague et de rêve, de poésie et de gaminerie tel qu’on nous l’avait dépeint ? C’est donc çà, le « Chat Noir », le « Mirliton », le « Caveau », etc… Comme il y a loin de ceci au « Ruisseau », de Pierre Wolf, au « Montmartre » de Pierre Frondaie. Encore une illusion qui s’en va. Je suis retourné à Montmartre près de deux ans plus tard. Je m’étais contenté, dans l’intervalle, lorsque je revenais à Paris, d’aller voir Montmartre sue une scène de music-hall. Là, Polaire exécutait le pas des rouflaquettes ou la danse du foulard, en compagnie d’un quelconque danseur que l’on avait éloigné du front pour épargner soi-disant l’art français et cela suffisait à satisfaire ma curiosité. Mais, au début de 1918, les Américains étaient devenus les « hommes du jour ». Ils tenaient, à Paris, le haut du pavé. Nous avions eu notre tour. Cela avait duré pendant quelques semaines, peut-être pendant des mois, puis les Britanniques nous avaient détrônés. Les Anglais avaient transformé maint bistro parisien en « Old Taverne », empoisonnant cette belle langue française au point que, depuis ce temps là, le sport aidant, l’emploi abusif d’expressions anglaises est devenu une véritable plaie. Ils étaient riches, un peu rogues, et se disaient tous ingénieurs. Les Américains eux, avaient beaucoup d’ingénieurs dans leurs rangs, mais ne savaient pas le dire. D’ailleurs, au point de vue peuple, ce qui les auréolait, c’était le fait de représenter en France le cow-boy de la prairie, que le cinéma et les romans au kilo avaient popularisé. Ces représentants des cow-boy avaient en tous cas ce qu’il nous manquait : de l’argent à dépenser et c’était le moment ou jamais de dire que l’argent est le nerf de la guerre. On m’avait conté qu’ils avaient colonisé Montmartre. Je suis donc allé voir. On n’avait rien exagéré. Montmartre était devenu banal comme la rue Lafayette ou le boulevard Haussman.
D’ailleurs, Y est-il retourné depuis ? Je ne crois pas. On a essayé, mais en vain, d’y faire ressusciter le passé. Là où les Anglo-Saxons ont séjourné, c’est plutôt difficile. 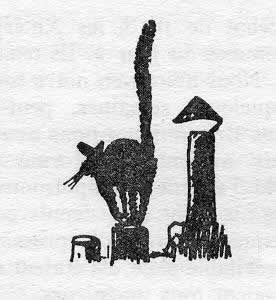
A Saint-Honoré d’Eylau Au cours de la randonnée nocturne dans les établissements montmartrois, nous nous souvînmes tout à coup, Henri et moi, de ce que nous étions au seuil du dimanche et que Rose comptait sur nous pour faire ce jour là, la petite « excursion » à laquelle elle tenait tant. A l’heure dite, nous étions au poste. Il s’agissait d’aller entendre la messe à Saint-Honoré d’Eylau. Saint-Honoré d’Eylau est le nom de l’église, sise dans le quartier de marraine Rose, où l’on rencontrait le « gratin » de Paris, les vieilles rombières ainsi que le crémier du coin ou la fruitière de l’avenue parce que le commerce a ses exigences. C’est là que Rose emmenait ses pensionnaires. Aucun n’aurait voulu se soustraire à cette sortie dominicale, Rose y tenait d’ailleurs comme à la prunelle de ses yeux. Elle pénétrait dans l’église, à la tête de son bataillon, fière, heureuse, et nous, nous avions l’air un peu gauches. Je revois encore l’intérieur de cette église cossue, où l’on trouvait, sur chaque chaise, un livre de messe de dimensions respectables, mis gracieusement à la disposition des fidèles. Je feuilletais machinalement celui qui m’était provisoirement destiné, pendant que les autres poilus inspectaient, avec de grands yeux étonnés, les détails d’ornementation de ce temple de Dieu. Henri, qui connaissait Rose mieux que nous, semblait absorbé par sa lecture, au point d’en oublier le reste du monde. L’office terminé, comme je demandais à Rose si elle était satisfaite de la docilité dont nous avions fait preuve, elle me répondit : « Tu ne dois pas te vanter, toi, tu n’as lu que les cantiques. » A la vérité, j’avais fait autre chose, j’avais observé tout ce monde pendant toute la durée de la messe et j’avais été frappé par cet air de grande piété qui se lisait sur tous les visages. Il y avait du malheur dans l’air, et l’on devinait que tous ces fidèles imploraient le Seigneur pour qu’il mette un terme aux souffrances du pays. Quelle différence entre ces croyants, tout à leur dévotion, et les habitués de nos messes villageoises, au cours desquelles les jeunes filles échangent leurs impressions sur le chapeau dernier modèle, les jeunes gens, sur les résultats probables des matches de l’après-midi et les agriculteurs, sur le palmarès du dernier concours d’étalons ! Et quel curé, bon sang ! Homme d’âge mur, il m’avait paru exercer sur ses paroissiens une influence considérable. Je l’entends encore : « Je vous avais demandé tel et tel objet pour mes poilus ; tels autres pour les hôpitaux ; j’avais tout reçu dès mercredi. Merci. » J’ai encore besoin… Et mon gaillard commençait une énumération qui n’en finissait plus. Brave Français que ce prêtre ! Ayant dépassé l’âge où l’on pouvait rendre des services au front ou à l’arrière, il rendait service à son pays, à sa façon. J’ai la manie de blaguer les curés quand ils exagèrent. Cela ne m’empêchera peut-être pas d’aller en paradis, comme tout le monde, mais les vieilles filles, qui vont au salut tous les soirs me révolvérisent du regard en me rencontrant. Si elles savaient cependant que depuis l’armistice, j’ai pensé bien souvent à ce brave curé de Saint-Honoré d’Eylau ! A l’heure actuelle, il doit attendre là-haut les innombrables poilus qui profitèrent autrefois des douceurs qu’il leur fit parvenir, grâce à l’ascendant qu’il exerçait sur les riches paroissiens du quartier de l’Etoile. A force d’amener chaque dimanche de nouveaux « pèlerins », Rose avait fini par attirer l’attention des habitués de l’office. A la sortie, on l’entourait. Et Rose donnait le pedigree de chacun en insistant sur le fait qu’il était dans tel secteur. On retournait alors tous ensemble au 184 de l’avenue Victor Hugo où un apéro accueillant nous tendait les bras. Je dois dire que de temps en temps Rose était inquiète. - Çà ne te fait rien, bien sûr, de nous accompagner à la messe ? Alors, pour la taquiner, je répondais en riant : - Mais non, Rose, ça ne dure qu’une heure et puis, ça n’arrive qu’une fois à chaque permission… 
Les Marraines insupportables. Quand je pense à ces femmes pédantes, genre « Précieuses Ridicules », qui nous mitraillaient à bout portant avec leurs mots à soixante-quinze, je me demande ce qu’il adviendrait dans l’état actuel des mœurs, si la guerre recommençait. Il est vrai que le pédantisme s’équilibrerait, car nos jeunes gens ne ressemblent que de loin au poilu de 1914. Aujourd’hui, en effet, le snobisme est roi. Et la génération qui pousse ne comprendra peut-être pas pourquoi les femmes pédantes de 14 à 18 nous donnaient sur les nerfs. Pourtant, Dieu sait si, pour ma part, je les avais prises en grippe. Pensez donc ? Nous vivions simplement, à tous les points de vue, et ces montreuses d’ours venaient nous révéler qu’il y avait encore sur terre des êtres humains pour qui l’existence n’était, somme toute, qu’une occasion de poireauter. Se figuraient-elles donc être sorties de la lignée de la marquise de Rambouillet ou de celle de Mme de Bouchavannes ? On aurait pu les croire. Parmi les soldats auprès de qui je jouais le rôle de secrétaire bénévole, deux étaient affligés de marraines de l’espèce et, n’était le sentiment de curiosité qui me poussait à vouloir mesurer jusqu’où irait leur bêtise, je les aurais envoyées se promener dès réception de la troisième lettre. Le style, c’est l’homme a dit Buffon. C’est la femme aussi. J’avais senti tout de suite à qui j’avais à faire et il ne me déplaisait pas trop, après tout, de jouer le rôle de Mascarille, par simple passe-temps. Nous étions quelques-uns seulement à la compagnie à même de nous gausser de ces écrits rocambolesques, les destinataires eux, n’y voyaient que du feu. Un colis, parvenant de l’arrière, à l’occasion, faisait beaucoup mieux leur affaire. Quant à aller en permission chez ce genre de femmes, il n’y fallait pas compter. Elles considéraient le poilu, soi-disant filleul, comme étant une victime désignée pour subir parallèlement au bombardement de l’artillerie, un marmitage littéraire, d’un genre spécial. Se demandaient-elles seulement si elles étaient comprises ? Elles commettaient somme toute, l’erreur de certains collaborateurs de journaux quotidiens, qui se figurent n’être lus que par des professeurs d’Université. Il suffisait ordinairement d’une offensive ou, simplement d’un grand déménagement de Division pour être débarrassés de ces femmes savantes. On avait alors d’autres chats à fouetter et puis, on en était quitte pour rechercher une marraine ailleurs. Il vint un moment où cela était plutôt malaisé. La guerre durait, durait, et les emballements du début avaient reçu une fameuse douche. D’autre part, les bénéficiaires du marrainage étaient des militaires. Or, chacun sait que ce mot est synonyme de carottier. La plupart des combattants ne se contentaient plus d’une marraine, ils en voulaient plusieurs. C’est ainsi qu’au commencement de 1917, le beau marrainage, tel qu’il avait été compris d’abord, avait reçu un fameux coup dans l’aile. Les uns en faisaient un jeu ; les autres, et ils étaient nombreux hélas ! Ne voyaient plus, dans cette institution qu’une occasion de se faire prendre en pitié et de tendre la main à tout propos et même hors propos.
Défaut d’éducation, commun bien entendu, à toutes les armées. La masse
est ainsi faite. Tendez lui le doigt, elle veut la main, puis le bras y passe.
Quand on décida de remplacer, au bain militaire de Pour le marrainage ce fut pareil. Des jass n’hésitèrent pas à écrire simultanément à toutes les œuvres de l’arrière s’occupant de fournir des marraines aux déshérités. Ils étaient parvenus à améliorer ainsi considérablement leur ordinaire, au détriment du voisin parfois. Et le malheur, c’est que ces sortes de filous, que l’on appellerait aujourd’hui des « resquilleurs », se recrutaient le plus souvent parmi les gens de l’arrière front, là où l’on avait des loisirs et où, en tous cas, la vie n’était pas tellement désagréable. Les braves Borains en kaki, qui passaient leur permission chez Rose, le plus benoîtement du monde, sourirent d’un air incrédule lorsque je prononçai cette phrase.
Et cependant, j’avais décidé Rose à nous accompagner le soir même au
théâtre de L’événement avait son importance. Depuis vingt cinq ans qu’elle habitait Paris, Rose n’y allait jamais, faute de chaperon. Tout au plus, s’était-elle hasardée, de temps en temps, au Français, et encore.
Lorsque le rideau se leva sur « Habituellement j’allais seul au spectacle. J’avais un faible pour l’Opéra-comique, l’Opéra n’était pas goûté par mes compagnons de séjour. J’avais fini par ne plus les inviter. Pour eux, le vrai bonheur consistait à aller faire quelques emplettes au Bazar de l’Hôtel de Ville ou aux Galeries Lafayette, histoire d’être servis par un minois avenant. Ou alors, ils déambulaient dans les rues, les mains au fond des poches, comme tout Belge qui se respecte. Ah ! Ce théâtre parisien du temps de guerre, qui donc un jour en écrira l’histoire ? Que de soucis il fit oublier ? Que d’illusions il rendit à ceux qui n’en avaient plus ?
Le poilu qui allait applaudir Marcel Simon dans « Les salles ne désemplissaient pas. Les uniformes bien entendu y dominaient. Non pas que tous les spectateurs fussent venus des premières lignes, mais, en temps de guerre, les embusqués portent la tenue aussi. Alors… On trouvait tous les genres de spectacles dans ce Paris immense, carrefour des permissionnaires, refuge des attachés d’ambassades étrangers, et paradis de ceux qui voulaient bien que l’on tint jusqu’à la victoire, à condition qu’on les laissât tranquilles.
L’Opéra n’ouvrit ses portes qu’en 1917, je crois. J’y allais, au hasard
de mes congés, y applaudir l’inévitable Faust,
Les Huguenots et Cavalleria
Rusticana. J’eus l’impression d’être allé écouter la messe dans une grande cathédrale. Depuis des années, je rêvais d’aller m’asseoir là. Grâce aux réductions consenties aux militaires, j’avais pu obtenir une place que je n’aurais pu m’offrir en temps de paix et voilà que j’étais déçu. Il y avait du plomb dans l’atmosphère et il était visible que les étrangers étaient aussi déçus que moi. Eternel danger qui consiste à exagérer la valeur des choses avant de les avoir vues ?
Mais on se rattrapait à l’Opéra-comique et la salle de la rue Favart
faisait recette. Tout le répertoire actuel de Les Guitry exploitaient le Vaudeville où ils donnaient leurs pièces exclusivement. J’y ai passé de bonnes soirées. A l’Odéon, on n’allait guère. C’était un peu loin. On préférait le Châtelet, avec sa mise en scène fantasmagorique. On y jouait : Les Exploits d’une petite Française, Le Chemineau, Le Tour du Monde en 80 jours.
Quant à ceux que les spectacles pornographiques intéressaient, ils
allaient se réfugier au petit Théâtre Edouard VII, où l’on donnait des pièces
dans le genre de Il y avait alors les innombrables music-halls, disparus pour la plupart depuis, à cause de la concurrence cinématographique. Les poilus raffolaient de ce genre d’exhibitions. Le Casino, l’Olympia, les Folies-Bergères, pour ne citer que ceux-là, connurent, grâce aux Anglais et aux Américains, une vogue inouïe. Les douze girls et le danseur à ressorts, n’accaparaient pas, comme aujourd’hui, tout le spectacle. Quand Rose Amy, au minois charmant, Polaire qui portait les cheveux courts avant la lettre ou Mistinguett éternellement enrouée venaient chanter leurs couplets sur les Boches, le Kaiser ou le Kronprinz, la salle s’électrisait. A voir ce désir de vengeance s’allumer dans tous les yeux, je me demandais si les embusqués n’allaient pas enfin se décider à venir nous rejoindre. Grand fou que j’étais. Il leur eût fallu, pour cela, quitter Mistinguett, Polaire et Rose Amy. Qu’importe ! On achetait la chanson du jour pour l’offrir là-bas, aux propriétaires d’harmonicas qui, au cantonnement, la déchiffraient du matin au soir. « Je sais que vous êtes jolie… » ou bien « Celle que j’aime est parmi vous… » Pendant des mois, cela devenait la scie du jour. Mais on revoyait en pensée le music-hall parisien et on pardonnait à l’instrumentiste de ne respecter ni le ton, ni la mesure. Pour en finir avec le chapitre théâtre, je m’en voudrais de ne point parler d’une certaine soirée aux Folies Bergères. Ceci se passait après l’armistice, en 1919 exactement.
J’étais allé à Paris présenter mon épouse à la marraine. Comme de juste,
nous essayions tous les deux de la remercier pour tout ce qu’elle avait fait
pour moi. On jouait, à cette époque, aux Folies Bergères, une revue qui faisait
sensation. Les grands couturiers de la rue de J’y invitai Rose, qui ne pouvait refuser, puisque cette fois… elle était chaperonnée. Ce fut, pour elle, un éblouissement et … une révélation. Je lui avais conté bien souvent, en effet, qu’à Paris, on nous accostait partout, ce qui lui paraissait invraisemblable. Je profitai de notre soirée aux Folies Bergères pour en faire la démonstration. A l’entracte, on se promenait dans le jardin d’hiver, dans une foule bigarrée, pendant qu’au balcon, un orchestre nègre nous donnait un avant goût de ce que nous réservait l’après-guerre. Je proposai de prendre deux mètres d’avance dans la foule, pour n’avoir point l’air d’être accompagné. Naturellement, mon uniforme me transformait en cible. Une demi-heure plus tard, j’avais été accosté à vingt reprises, plusieurs fois par les mêmes quémandeuses qui ne me reconnaissaient certainement pas d’une tentative à l’autre. A l’heure où j’écris, Rose n’est pas encore revenue de son étonnement. 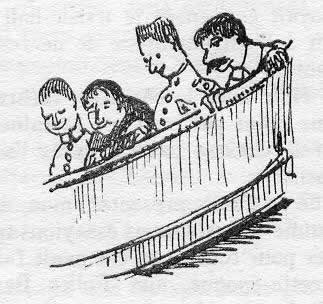
Chez les Princes Russes Il ne s’agit pas ici, bien entendu, d’une randonnée sur le front des armées du Tsar. Le fantassin restait attaché au sol qui l’avait vu naître et tout au plus, pouvait-il de temps en temps, nanti d’une permission en règle, aller respirer l’odeur du crottin parisien, qui devenait de plus en plus rare, au fur et à mesure du développement de l’industrie automobile. C’est donc au cours d’un de ces séjours à Paris que j’eus l’occasion de pénétrer dans un hôtel russe – d’un Russe authentique – et d’en sortir dans un état général qui rappelait plutôt le polonais. Je reconnais tout de suite que cette histoire ne relève pas du marrainage proprement dit, mais je l’y rattache parce qu’elle me valut d’être en brouille avec Rose, pendant une journée tout au moins. Or donc, quelques années avant la guerre, vivait à Ghlin, dans la propriété qu’occupe aujourd’hui Mme Lambilliotte, une honorable vieille dame qui avait pour maître d’hôtel, un monsieur se prénommant Henri.
Je ne l’avais jamais vu. Je fis sa connaissance en pleine guerre, à la
terrasse d’un bistro de Henri m’avait repéré, grâce à une réflexion prononcée en patois, que je venais de faire au mineur dourois permissionnaire, qui m’accompagnait. Comment voulez-vous que la joie, résultant d’une telle rencontre ait pu se manifester autrement que par l’absorption de « picons » bien tassés ? Etions-nous au dixième, je ne pourrais le certifier. A un moment donné, Henri me confia qu’il était maître d’hôtel chez des princes russes, installés dans un immeuble de l’avenue du Bois, et s’écria : j’ai demain un grand dîner d’amis, j’espère que vous y assisterez tous les deux. On accepta, comme de juste. Le Dourois avait une inquiétude. Le brave type se figurait qu’il allait être obligé de manger à côté des princes et n’était guère rassuré. Henri le tranquillisa en lui expliquant que ses maîtres avaient rejoint leur pays à la mobilisation, que lui, Henri, était le seul maître à l’hôtel après Dieu, et que nous ne rencontrerions que des gens sans façon, pour le plupart Belges comme nous. Le lendemain, à l’heure dite, nous faisions une entrée sensationnelle chez les princes russes. L’absence des patrons nous mettait à l’aise. En temps normal, j’aurais eu un scrupule, je me serais demandé s’il était correct de venir ainsi me restaurer aux frais de la princesse, mais en temps de guerre, le poilu ne s’empêtre pas dans des considérations de ce genre. Les amis d’Henri étaient nombreux et bien élevés. Les dames avaient de la conversation et les messieurs pour la plupart mobilisés à l’arrière, fransquillonnaient à nous en donner la nausée. Il y avait également parmi l’assistance quelques civils belges, en âge de porter les armes, qui parlaient de leur appel éventuel sous les drapeaux, en roulant des yeux de moineau pris au piège. Par délicatesse, je ne parlerai pas du menu. Les princes russes, avant de s’en aller, avaient donné carte blanche à leur maître d’hôtel et il en profita pour nous servir de la « Carte d’Or » et de la « Veuve Clicquot ». Le reste était à l’avenant. On triquait à la santé des maîtres. Où étaient-ils ? En Galicie ? Au gouvernail du fameux rouleau compresseur qui, à en croire les journaux, allait tout balayer jusqu’à Berlin ? J’avais plutôt l’impression, quant à moi, que les choses se passaient là-bas comme chez nous, et que mes gaillards se trouvaient à l’abri, dans un opulent quartier général. J’avais eu soin de ne pas le dire, bien entendu, pour rester poli, mais, dans la flamme qui illuminait le regard du poilu français, mon compagnon d’en face, j’avais surpris qu’il pensait la même chose. Ce poilu était le seul de l’assistance qui venait du vrai front. Je l’avais compris tout de suite, à cause de sa tenue d’abord, et puis, parce qu’il évitait de parler de la guerre. Les autres, d’ailleurs, ne lui en donnaient pas l’occasion. Prudents au début, ils avaient perdu toute mesure, le bourgogne aidant, et racontaient leurs exploits avec une conviction telle que je finissais par me demander si eux-mêmes ne croyaient pas à la véracité de leurs récits. Les dames étaient pâmées. Le poilu français souriait tristement en me regardant. Nous venions de deviner l’un et l’autre ce que serait l’après-guerre et nous triquâmes autant que nous pûmes, pour ne plus entendre les discours de ces héros de contrebande. Rose avait dit au moment du départ : « On mange à sept heures ». C’était net et prononcé sur un ton qui n’admettait pas de réplique. Où étions-nous à sept heures, bon Dieu ? Chez Henri, sans doute. Etait-il dix heures lorsque en compagnie du poilu français nous prenions un verre – le dernier – chez le bistrot du boulevard. Nul ne l’a jamais su. Mais l’heure n’avait plus d’importance. Nous avions oublié celle du souper et Rose pleurait à chaudes larmes. Pensez donc ! Une pareille infraction au règlement ! Je m’attends à être secoué comme un prunier, lors du jugement dernier, quand je devrai rendre mes comptes. Je ne le serai certes pas autant que je le fus ce soir là, en revenant de chez les Russes. Pauvre marraine ! Elle avait préparé, comme toujours, un souper succulent et ce grand « Jeanfoutre » de Jules… car pensez bien que, dans cette affaire là, j’étais seul rendu responsable. J’acceptais d’ailleurs allègrement les reproches et, tout en essayant vainement de me déchausser, je répétais sans cesse : « Tu vas voir, Rose, les Boches, ce qu’ils vont prendre… » 
Les Marraines de l’hôpital Elles étaient là, toutes blanches, avec une Croix-Rouge sur le voile, allant d’un lit à l’autre, apaisant des souffrances, donnant du courage et foi dans l’avenir à ceux qui n’en avaient plus que pour quelques heures. Etaient-ce bien des marraines, ces femmes là, allez-vous me demander ? Elles le devenaient. Elles devinrent même parfois la compagne d’existence du poilu démobilisé. Bien des blessés pourront vous dire en présentant leur épouse : nous nous sommes connus à l’hôpital de X… Pouvait-il en être autrement quand on pense aux trésors de tendresses que peut contenir un cœur féminin ? La femme a beau prendre des airs détachés, se déclarer blasée pour essayer de ressembler à l’homme, elle n’en reste pas moins femme. J’ai juré en commençant ce récit d’écarter au tant que possible les narrations pénibles. Et cependant, dans ce chapitre, dont le titre seul évoque tant de misères, puis-je me dispenser de faire allusion aux souffrances du soldat ? Suivez-moi, en pensée, dans un grand hôpital de l’arrière. Là-bas, au front, la bataille fait rage. Le roulement sourd du canon dit aux infirmières : faites de la place, ils vont venir. Et ils viennent. Des autos d’ambulances pénètrent dans la cour, tout doucement pour éviter les heurts. On en extrait de véritables loques humaines. Ils sont tous pareils. La boue, le sang, ont maculé leurs nippes. Des bandeaux de gaze appliqués en quatrième vitesse avant l’embarquement sont déjà tout rouges. Le personnel s’empresse, habitué à ces visions d’horreur. On case tout le monde, on débarbouille, et l’on transporte, en les dissimulant autant que possible, ceux qui ont rendu l’âme en route. Soins de toilette, interventions chirurgicales et voici chacun en place. Mais il en arrive d’autres, sans cesse, et bientôt l’hôpital est plein, les déchets de l’offensive devront être transportés ailleurs. 
Et voilà que, dans cet hôpital, aux murs blanchis, une véritable garnison est installée. De jour en jour, les blessés renaissent à la vie. Tous pareils lors de leur arrivée, ils sont maintenant tous pareils encore à un point de vue, car ce sont de grands enfants, mais leur degré d’instruction et surtout d’éducation diffère. Il s’établit entre eux et le personnel de l’établissement une familiarité et une camaraderie de bon aloi. Il y a évidemment un genre d’hospitalisés qui ne voient avant tout que le confort matériel, mais il y a les autres. Ceux-ci s’épanchent, disent leurs projets, parlent de ce qu’ils ont laissé là-bas, dans ce pays envahi qui semble se trouver à l’autre bout du monde. Puis, dans ce décor infiniment propice, la petite fleur bleue du sentiment apparaît, timide d’abord, comme une violette sous le taillis, puis grandit…, grandit… La convalescence est venue. Il est temps de penser à retourner au pont de Dixmude ou à Nieuport. Le blessé d’hier, sent son cœur se serrer au moment du départ. Mais est-ce le moment de s’attendrir ? Et pourtant cette femme, qui l’a arraché aux griffes de la mort… - Bon courage, n’ayez pas de pitié pour ces sales Boches ? - Madame, je ferai de mon mieux, mais… il m’est impossible de vous dire adieu…Voulez-vous être ma marraine ? Les Marraines internationales La guerre a eu ceci de bon, c’est qu’elle obligea tout le monde à étudier la géographie. Tel poilu qui, avant la mobilisation, eût défini difficilement les quatre points cardinaux, en était arrivé, après deux ans de campagne, à parler du front russe comme il parlait de son village natal. Il semblait que les distances étaient abolies. Dans l’esprit du soldat, Salonique était à deux pas de Marseille, à force d’étudier les cartes, on finit par trouver le monde infiniment petit. Et c’est ainsi que, perdus au fond d’un baraquement, dans un camp hollandais, les soldats belges cherchèrent des marraines… en Suisse. Si le combattant du front avait l’espoir d’aller voir sa marraine française, au cours d’une permission, l’interné, en Hollande, ne pouvait guère entrevoir la possibilité de connaître la sienne, les permissions n’étant pas à sa portée. Il cherchait et trouvait néanmoins des femmes qui ne demandaient pas mieux que de s’intéresser à lui. Ceci prouve une fois de plus que, dans bien des cas, le marrainage n’a pas été ce que l’on a cru injustement qu’il fut.
Ces marraines étrangères remplissaient en quelque sorte le rôle de boite
aux lettres. Les correspondances provenant des pays neutres, bien que
surveillées de près par les Allemands, avaient cependant plus de chance de
parvenir à leur destinataire que celles émanant d’un pays belligérant. Les
marraines suisses devinrent donc l’intermédiaire indispensable pour acheminer
vers Çà n’allait pas tout seul, bien entendu. Ainsi, en ce qui me concerne, malgré l’obligeance d’un ami interné en Hollande, qui avait bien voulut me mettre en relations avec sa marraine de Lausanne, j’eus toutes les peines du monde à faire parvenir, de temps à autre chez moi, un mot consolateur. Mais, étant donné l’importance que l’on attachait à l’arrivée d’une carte, si laconique fût-elle, le résultat obtenu par cette voie était appréciable et apprécié. Plus difficile encore était l’acheminement des correspondances de Belgique envahie vers le front. D’autant plus que Ghlin se trouvant à certain moment dans « l’étape », on ne pouvait même plus gagner la capitale comme on l’aurait voulu. Or, c’était de la poste centrale de Bruxelles seulement que l’on pouvait expédier son courrier pour l’étranger. Son courrier !! Cela me fait sourire. J’ai sous les yeux une carte photo que m’adressa ma femme, au cours de l’été de 1917. Elle me parvint là-bas, sous enveloppe, grâce à Mademoiselle Anne Dewantai, la marraine suisse dont il s’agit. Je m’en voudrais de ne pas la copier textuellement. L’adresse : Mademoiselle Anne Dewantai-Landrieux-Blasse 23, Closelet Lausanne (Suisse) Bruxelles, le 15-6-17. Ma chère Anne, Reçois le meilleur souvenir de tous les membres de la famille, ainsi que les baisers de ta petite Lisette et de ta Nelly. Bonnes amitiés de tante Marie et de cousine Anaïs. (s.) Virgile Lefèbvre, 13, rue de Un Allemand, même mal luné, ne pouvait, logiquement, y trouver à redire. Et cependant, voyez un peu combien de renseignements contenaient ces quelques mots. Souffrez que j’en fasse l’analyse. Mademoiselle Dewantai était donc la marraine suisse. Monsieur Landrieux, le soldat interné en Hollande. Tante Marie, sa dame. Cousine Anaïs, sa fille. Nelly et Lisette, ma femme et ma fillette. Monsieur Virgile Lefèbvre signataire de la carte, le docteur ghlinois, émigré vers la capitale et la famille, cela intéressait l’un et l’autre. On était rassuré. Tout le monde vivait, c’était l’essentiel et on recevait une gerbe de baisers ayant conservé leur fraîcheur, après avoir franchi trois ou quatre douanes. 
Je riais, malgré le malheur des temps, en constatant que me femme m’appelait « ma chère Anne » car je ne me dissimulais pas qu’en écrivant cela, elle pouvait ajouter tout bas, « Hélas ! Je ne vois rien venir ».
En a-t-elle trouvé des appellations pendant la guerre ! J’étais son
oncle, son frère, sa sœur, suivant les exigences du moment. Cette fichue
mobilisation nous a fait commettre des « insectes » ainsi que le
prétendait élégamment une baronne Zeep au lendemain de l’armistice. Et les
marraines suisses se sont faites nos complices. N’importe, beaucoup d’entre
nous peuvent s’estimer heureux de les avoir connues, de nom tout au moins, 
Quinze ans après La dernière ligne écrite, on voudrait recommencer. Pourquoi, diable, éprouvons-nous le besoin de reparler toujours de ce temps-là ? Ne vaudrait-il pas mieux exclure à tout jamais de nos conversations, de nos écrits, tout ce qui a trait à cette période infernale ? A quoi bon, au fond, montrer ce que fut la guerre, ce que furent ses à côtés, à une génération qui pousse et à qui on ne cesse de répéter que le vrai bonheur est dans l’oubli. Oublier ? Comme si l’homme n’oubliait pas assez vite ? Après avoir lu ma pauvre petite histoire, vous vous représentez sans doute Mademoiselle Rose Honorez, adulée par ses filleuls et leurs familles. Vous vous figurez certainement qu’au lendemain de la guerre, elle reçut des lettres émouvantes de ceux qu’elle avait si généreusement hébergés ? Comme vous connaissez mal le cœur humain ? Rentrés au bercail, la plupart eurent tôt fait de reprendre leur train-train de vie d’autrefois. L’égoïsme réapparut. La marraine avait dormi à l’occasion sur des caisses à sucre pour les céder son lit ? Et après ? Et eux ? Permettez moi de ne pas insister sur ce chapitre affligeant. Quand je pense à tout cela, malgré moi, je me gonfle. Rose, elle, en a pris son parti. Dieu lui rendra tout cela là-haut, dit-elle. Elle est heureuse d’avoir fait le bien, sans ostentation, pour le seul plaisir de le faire. Quand elle rencontre certains de ses enfants, comme elle les appelait, une lueur traverse ses yeux, mais ils passent indifférents et lointains parce que, de nos jours, c’est dur de devoir dire merci. Ah ! Nous le savons tous, l’après-guerre a été une cruelle désillusion et le vrai combattant dont le cœur ne s’est pas aigri au spectacle de tant de choses malpropres qui nous entourent peut se vanter d’avoir une fameuse dose de philosophie. C’est peut-être pourquoi « les anciens » sont moins excusables d’oublier ceux qui les soutinrent pendant la grande tourmente.
Et croyez-vous que les poilus seuls furent ingrats ? Les pouvoirs
publics firent de même. On décora, à cause de la guerre, pour des raisons
multiples et variées, des citoyens qui n’avaient rien à voir avec elle. Il
n’est venu à l’idée de personne d’octroyer

|
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©