 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
LES ÉVASIONS DE BELGIQUE d’après les RÉCITS DES ÉVADÉS Introduction et avertissement Ce
livre constitue une belle synthèse des multiples témoignages des jeunes gens,
qui, au mépris de leurs vies, voulurent rejoindre l'armée du roi Albert
derrière l'Yser. Rejoindre le petit morceau de la patrie restée libre
constituait en effet une aventure très risquée. Il fallait d'abord rejoindre la
Hollande en franchissant une frontière très gardée qui rapidement s'électrifia.
Une fois en Hollande, les « évadés » s'embarquaient pour l'Angleterre
où ils pouvaient s'enrôler dans l'armée belge. Rejoignant ensuite la France,
les engagés volontaires suivaient alors leur entraînement militaire dans un
centre d'instruction belge situé en Normandie. Ce n'est qu'après plusieurs mois
qu'Ils pouvaient enfin rejoindre alors le front de l'Yser. Ces jeunes soldats
avaient donc déjà risqué leur vie avant de combattre. Grâce à eux, l'armée
belge parvint à maintenir un effectif suffisant malgré les pertes encourues
lors de la retraite vers la mer et lors de la première bataille de l'Yser. Le
lecteur sera surpris de la diversité des moyens mis en œuvre pour franchir la
frontière hollandaise. Nous émettrons cependant un regret : l'anonymat des
jeunes héros, voulu par l'auteur sans doute pour éviter d'éventuelles
représailles de l'ennemi sur leurs familles restées en Belgique ! Le
livre d'origine ne contenant aucune reproduction photographique, nous avons cru
bon d'agrémenter ce récit au moyen d'illustrations provenant de sources
diverses. Dr Loodts
P. 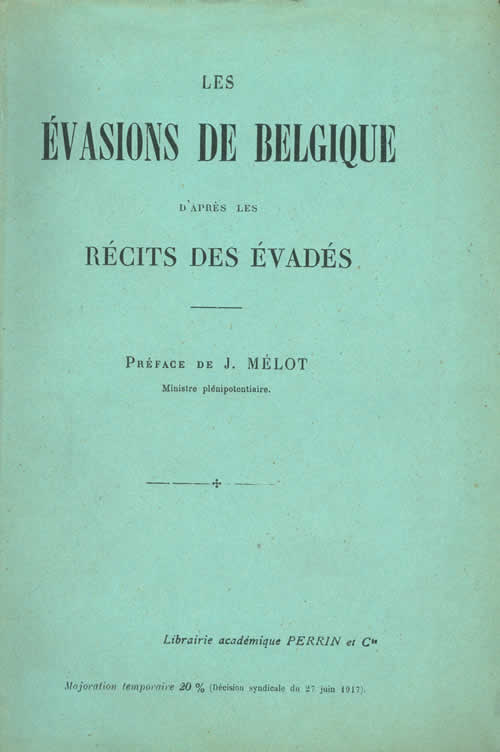
PRÉFACE De nombreux jeunes gens qui n'avaient pas pu sortir de Belgique avant l'occupation allemande, sont venus, depuis lors, grossir les rangs de l'armée belge. Des milliers d'entre eux ont eu à surmonter de grandes difficultés et à courir des périls de mort pour échapper à la surveillance de nos ennemis. La plupart ont raconté leurs aventures, non pas en vue de la publication, mais dans le style et avec 'l'abandon de notes intimes et familières. Étudiants, ouvriers, fils de famille, petits artisans, commerçants, ils ont pris la plume pour livrer au papier la confidence de l'aventure la plus impressionnante de leur vie, de celle qui laissera le plus grand souvenir dans leur mémoire. Ils ont écrit, suivant leur degré d'instruction et leur habileté à s'exprimer, les uns avec une élégance naturelle, d'autres avec une sécheresse un peu rude, et d'autres enfin avec le relief pittoresque des gens du peuple en Belgique. Il a fallu choisir dans ces notes quelques traits essentiels et les grouper autour d'une idée centrale, pour éviter les redites, les longueurs, les incidents parfois dépourvus d'intérêt. Mais on leur a laissé leur physionomie propre et par conséquent on n'a point supprimé les négligences de style ou les incorrections inévitables chez certains évadés peu habitués à manier la plume. Qu'on n'oublie pas, en les lisant, que plusieurs extraits sont tirés de lettres d'ouvriers des villes ou des campagnes qui racontent ce qu'ils ont vu ou éprouvé avec une bonhomie rustique et sans se soucier du style. Les détails d'expression s'effacent d'ailleurs devant le grand enseignement d'énergie que ces notes contiennent. L'amour de la liberté a inspiré, soutenu et guidé leurs auteurs. C'est la pensée maîtresse qui a groupé toutes leurs activités et conduit leur volonté, comme c'est elle aussi qui a suscité et fortifié les innombrables manifestations d'indépendance de toutes les classes de la société en Belgique occupée. L'élan du pays entier pour résister à l'agression longuement préparée de l'Allemagne, en août 1914, ne s'est pas ralenti pendant les années suivantes. L'armée belge, reconstituée, renforcée, et qui tient toujours la ligne de l'Yser, en témoigne éloquemment. Mais pour alimenter cette armée, il ne fut plus possible, dès 1915, de puiser dans les réserves de la nation envahie. La Belgique opprimée, et sévèrement gardée ne pouvait plus fournir que des volontaires résolus à s'exposer aux plus grands dangers pour passer la frontière et pour s'enrôler. Un peuple qui n'aurait pas eu la conscience de sa nationalité, se serait peut-être incliné devant la volonté du pouvoir occupant, dans ses manifestations les plus abusives et les plus contraires au droit des gens et aux lois internationales. Il n'aurait pas cherché à réagir contre les proscriptions, les déportations, les essais de scission du royaume. Il aurait prouvé ainsi son manque d'enthousiasme pour la liberté, car un pays qui se laisse fouler aux pieds n'est déjà plus une nation. Au contraire, celui dont la réaction contre l'injustice se manifeste hardiment, atteste et prouve sa force d'âme, même quand son corps est enchaîné. Les jeunes Belges demeurés en territoire envahi ont voulu montrer qu'ils comprenaient les devoirs qui s'attachent au titre de citoyens libres d'une nation indépendante. L'exemple leur est venu de haut. Le Parlement, la magistrature, le clergé, les institutions provinciales et communales, les fonctionnaires, le barreau, les professions libérales et les métiers, ont prouvé, pendant les quatre dernières années, l'existence d'une parfaite unité nationale de la Belgique, en protestant avec dignité et force chaque fois que l'occupant provisoire sort de la légalité pour entrer dans l'abus du pouvoir, et Dieu sait si le cas est fréquent ! De même les évadés Flamands et Wallons, Belges en un mot, réunis dans une même pensée patriotique, ont témoigné de la même ardeur que leurs aînés pour la cause de leur patrie, en affrontant la mort afin de rejoindre l'armée de ses défenseurs. Contre un pareil peuple il n'est pas possible à l'ennemi de détruire l'unité de la Belgique, car chacun gardera la libre volonté de guider sa conscience vers la résistance obstinée et tenace aux tentatives d'asservissement. La vraie liberté, selon le mot de Montaigne, c'est pouvoir toutes choses sur soi. Potentissimus est qui se habet in potestate. Le Belge démontre par ses œuvres, qu'il peut toutes choses sur lui, et il donne ainsi raison à la déclaration prophétique de M. de Broqueville, président du Conseil des Ministres, au Parlement de Belgique, le 4 août 1914 : « Je le déclare au nom de la Nation tout entière, groupée en un même cœur, en une même âme, ce peuple, même s'il était vaincu, ne sera jamais soumis. » Ne pas être soumis, ne pas se courber sous le joug, c'est l'ambition des volontaires qui ont tout sacrifié pour reconquérir leurs droits d'hommes libres. Nous devons un hommage ému à ceux qui sont morts en accomplissant ce devoir patriotique. Combien ont été tués au moment où ils passaient la barrière de fils de fer, soit par le courant électrique qui en rend le contact mortel, soit par les coups de feu des sentinelles allemandes ! Combien aussi ont échoué dans leur entreprise et subissent encore aujourd'hui la captivité dont l'ennemi a payé leur audace ! Malgré tout, la bonne humeur n'a jamais abandonné ceux qui ont réussi. On verra par leurs lettres que la notion du pittoresque ne leur a pas fait défaut. S'il est vrai, comme l'a dit Franklin, que la mauvaise humeur est la malpropreté de l'âme, ils doivent avoir l'âme propre, car ils ne récriminent point. Mais on comprend dès lors pourquoi les Allemands sont perpétuellement de mauvaise humeur. C'est leur âme qui dégorge. L'âme allemande est en mauvaise posture devant l'âme belge. Le dessin célèbre de Bernard Partridge les a montrées en présence, personnifiées dans le roi Albert et dans Guillaume II. Ce dernier plie sous le poids des forfaits, tandis que le Roi fièrement dressé, brave son ennemi de toute la hauteur d'une âme sans tache. On songera souvent à ce contraste en lisant les récits des évadés. Le ton en est clair et sonne juste, la joie du succès déborde en plus d'une page, et la conscience d'avoir bien agi dilate le cœur et suscite même des élans d'enthousiasme. Tous pourraient conclure comme l'un d'eux: « On est heureux d'avoir souffert et de souffrir encore pour la noble et juste cause que nous défendons, pour le Roi et pour la Patrie. » J. Mélot, Ministre plénipotentiaire LES I LES RAISONS DE S'ÉVADER Pourquoi tant de jeunes Belges, et même
tant d'hommes d'âge mûr, ont-ils tenté, au péril de leur vie, de franchir la
frontière et de pénétrer en Hollande ? Les héros de ces aventures vont nous
répondre eux-mêmes. Les mobiles ont été le sentiment du devoir envers le pays
et la soif de la liberté. Rallier à tout prix l'armée belge pour combattre
l'oppresseur à côté de leurs compatriotes, échapper à
un régime de servitude, tels sont les buts que cherchent à atteindre les
évadés. C'est ce que dit très simplement l'un
d'eux : « L'idée d'aller rejoindre mon frère au front n'était pas sortie de ma
tête depuis son départ. » Un autre : « Depuis longtemps l'idée d'être utile à
l'armée hantait mon cerveau. » D'autres le disent plus explicitement encore :
« Je suis parti pour rejoindre l'armée où mon devoir m'appelait. Nous
avions décidé d'aller servir notre pays, et nous devions passer la frontière
coûte que coûte. » Ceux qui n'ont pu servir, dès le commencement, brûlent du
désir de rejoindre : « Quand la guerre éclata, dit l'un d'eux, je ne pus
m'engager dans l'armée, parce que j'avais le bras gauche cassé. » Deux mois
après, ce courageux patriote veut partir pour s'enrôler. Il est pris et
condamné au travail forcé en Allemagne. Après deux tentatives infructueuses, il
réussit enfin à passer la barrière. Un autre qui vient de raconter toutes les
péripéties de son passage, les dangers courus, la perte de ses vêtements et des
craintes pour la sécurité des siens, ajoute en conclusion : « Je ne
regrette rien, si ce n'est de n'avoir pu servir plus tôt mon pays. » Après avoir énuméré les dangers où de
nombreux Belges avaient péri et qu'il venait de courir lui-même, un jeune brave
ajoute : « Cela ne nous faisait rien, car nous avions hâte de rejoindre
l'armée belge. » Parfois, c'est un père qui, non content d'exhorter
ses fils à rejoindre l'armée, leur donne l'exemple en les accompagnants et en :
les guidant. L'esprit de devoir le conduit : devoir envers sa patrie, devoir
envers ses enfants. Écoutez ce procès-verbal de quelques lignes : « Mes
fils et moi voulons rejoindre l'armée belge. Nous avons passé la frontière dans
la cale d'un bateau charbonnier. Le voyage horriblement pénible a duré six jours.
» C'est tout. Suit la signature. Nous
trouvons dans ces vingt-neufs mots, le mobile : servir le pays ; le moyen : un
bateau où, à force de ténacité, on parvient à passer, dissimulé dans du charbon
; la durée : six jours d'un martyre où la faim, la soif, le manque d'air, la
saleté, s'unissent pour vous assaillir, sans compter les visites des
patrouilleurs allemands. Et pas une plainte, une simple constatation : le
voyage est horriblement pénible. D'autres, partant en groupes, expriment
les mêmes sentiments. On retrouve en abondance des déclarations comme celles-ci
: « Nous étions bien décidés à
rejoindre l'armée belge, et ce au prix de n'importe quel danger. » « Nous étions six jeunes gens
décidés à passer la frontière pour rejoindre l'armée belge. » « Je ne pouvais pas supporter
l'idée que le pays était en danger et que mes frères et camarades étaient partis
pour servir la patrie. » « Je pris la décision de venir
rejoindre mes camarades des Flandres. Après avoir laissé tout ce qui m'était le
plus cher, parents et fiancée, je partis. » « J'étais heureux de pouvoir faire
mon devoir... de m'engager dans l'armée belge pour défendre notre pays. »
Un de ceux qui traversèrent la ligne frontière à bord de l'Atlas V dont nous
verrons plus loin la glorieuse aventure, tient à marquer que le sentiment du devoir
l'a poussé à quitter la Belgique : « J'ai quitté mon village
uniquement pour venir faire un service quelconque dans l'armée belge. Je
n'avais aucune autre raison de quitter mon village, puisque de par mon métier
de cultivateur fermier, je ne tombais pas sous le coup de la réquisition
allemande. Je n'ai donc pas quitté mon pays pour me soustraire à la
déportation. » Un témoignage particulièrement touchant de
l'amour patriotique qui anime tous ces jeunes hommes, c'est le trait que nous raconte
l'un d'eux : Après avoir essuyé les coups de feu des
sentinelles, dans un passage hasardé de la frontière, lui et ses compagnons
s'encourageaient de cette manière : « Nous chantions tout bas la Brabançonne. »
Ils furent tout heureux de se voir subitement nez à nez avec une sentinelle
hollandaise qui les arrêta. « Êtes-vous Belges » ? - Oui. Vous ne retournez plus
en Belgique ? - Non. Passez, nous sommes ici
pour d'autres gens que vous. » Un autre évadé nous dit ses motifs en
manière de conclusion à son récit : « Malgré tout cela on est heureux
d'avoir souffert et de souffrir encore pour la noble et juste cause que nous
défendons, pour le roi et pour la patrie. » Il est arrivé, à plus d'une reprise, que
la tendresse maternelle a essayé de détourner des fils trop jeunes de tenter
ces périlleuses aventures. Quelques-uns nous le disent avec une charmante
sincérité. L'un commence ainsi son histoire : « Depuis le début de la guerre, j'avais
toujours eu grande idée d'être aussi, comme mes amis, au front ; mais qui
est-ce qui me déconseillait toujours ? C'était ma bonne mère, en me disant que
je reste bien auprès d'elle, et pour la contenter, j'y consentais. » Un plus jeune encore nous dit : « Désireux, dès le commencement de la
guerre, de prendre place parmi nos glorieux compagnons d'armes, ma mère, vu mon
jeune âge, ne me donna pas son consentement. Après ma rhétorique, elle me
permit du moins tacitement de faire des recherches en vue de passer la
frontière. » Enfin celui-ci raconte ses incertitudes :
« Mon seul désir était d'être à l'armée
depuis le début de la guerre. Seul avec maman veuve depuis vingt-sept ans,
étant son seul soutien, c'étaient les deux choses que maman mettait comme
obstacle à mes idées. J'ai dû abandonner mon commerce, maman n'étant pas à même
de le continuer. J'ai tout quitté. Comprenant les devoirs d'un fils envers sa
mère, je m'arrêtais, tandis que j'étais honteux de ne pas être au milieu de
tous les braves Belges qui combattent. » Cette lutte intérieure se termina
par la résolution de passer en Hollande. L'évadé franchit la frontière au
milieu d'une bande qui, découverte et traquée par les sentinelles allemandes,
en tua deux avant de passer. Au lieu de la mère, c'est quelquefois le
père qui hésite à accorder l'autorisation, surtout quand il a déjà plusieurs
enfants au front. Quel horizon de sacrifices patriotiques nous ouvrent ces
simples mots par lesquels un des évadés commence sa lettre : « Enfin le
père a consenti au départ de son quatrième fils ! » Le motif patriotique est invariablement
au fond des tentatives d'évasion, mais il n'est pas toujours le seul. Parmi les
jeunes gens qui nous exposent très clairement et simplement la complexité des
raisons qui les ont fait agir, voici quelques exemples explicites. « Les raisons principales qui motivèrent
mon désir de fuir la Belgique occupée furent non seulement l'espoir de
m'enrôler dans l'armée belge, mais aussi le besoin de me soustraire à l'oisiveté
forcée dans laquelle se trouvaient la plupart des étudiants. Ajoutez à cela,
comme raisons secondaires, la crainte d'être déporté en Allemagne à quelque
prochain contrôle général, et l'obligation énervante de se soumettre sans
murmurer aux moindres prescriptions des Allemands. » L'impatience d'être soumis à la tyrannie
méticuleuse des Allemands en a décidé beaucoup. Les déportations ont fait le
reste. Les uns le disent en deux mots : « J'étais fatigué de la domination
boche » ; ou bien : « souffrant, surtout moralement, de l'occupation boche, je
me décidai à chercher un moyen de passer la frontière », ou encore : « pour en
finir avec la tyrannie allemande et pour être libre ». Rarement les expressions pathétiques de
vengeance interviennent. Ce n'est pas dans la nature belge. La vengeance peut y
être tenace, ardente, obstinée, mais elle ne s'y étale pas en mots
retentissants. Un nombre extrêmement minime d'évadés en font mention. Voici
l'une de leurs rares expressions : « Je voulais faire payer aux Allemands tout
ce qu'ils ont fait souffrir à nos malheureux compatriotes. » Les spectacles de l'horrible cruauté de
l'invasion allemande ont, dès la première heure, incité les Belges à chercher
refuge hors des griffes de l'ennemi. Un d'eux nous l'explique en ces termes : « Pendant six mois, depuis l'invasion,
j'ai pu rester en Belgique occupée, assistant tour à tour aux massacres de la
première heure et au pillage systématique organisé sous forme de réquisitions.
Tout cela ne me disposait pas à être un esclave docile dans les mains de
l'oppresseur. » Un autre raconte certaines scènes qui
lui firent spécialement impression. C'était un villageois. « Avant la bataille d'Haelen, le curé au
sermon nous invitait au calme. Il nous exhortait à reprendre la vie habituelle,
à veiller aux soins ruraux et à travailler comme par le passé. Mais, après la
bataille, les Allemands arrivent. Tous les habitants de notre commune furent expédiés
à Louvain. Pendant quatre jours nous sommes restés prisonniers dans le manège
d'artillerie, ayant pour toute nourriture un morceau de pain noir. Enfin ayant
obtenu l'autorisation de rentrer dans le village, quel spectacle nous cloue sur
place ! Toutes les maisons avaient été brûlées, pillées, et les meubles qui
n'avaient pas été la proie des flammes, étaient saccagés. Quelques bêtes à
cornes, quelques porcs et volailles, erraient par-ci par-là. Nous arrangeâmes
tant bien que mal quelques granges épargnées par les incendies, et chacun
apportait secours à son voisin. Toute querelle avait disparu, il n'existait
plus de rivalité, et nous écoutions avec respect les conseils que donnaient les
notables du pays. » Le narrateur résolut alors de rejoindre l'armée belge, et
profitant de l'obscurité, il se faufila le long des haies entre les deux armées
et parvint à sauter dans nos lignes. Quant aux déportations, elles ont été
l'injustice finale qui a déterminé beaucoup de Belges à passer la frontière.
Cette cause s'est exercée de deux manières : avant que la mesure ne fût
exécutée, par l'horreur qu'elle inspirait, et après
que les malheureux y eurent été soumis, par le martyre qu'ils eurent à endurer.
Leur départ, dans ce dernier cas, fut une véritable évasion de prisonniers. Parmi ceux qui se sont trouvés dans la
nécessité de se sauver pour ne pas être déportés, la plupart avouent en peu de
mots que ce motif a été déterminant. Ils disent simplement : « pour fuir les
déportations boches », ou plus explicitement : « A la suite des avis publiés
par l'autorité allemande disant que l'on allait procéder au recensement des
ouvriers chômeurs, et sachant à quoi j'étais exposé, je me décidai à suivre la
ligne de conduite que me dictaient mes sentiments patriotiques. Je me décidai
donc à faire l'impossible pour me mettre à la disposition de la patrie. » Dans ce but on est à l'affût des occasions.
L'un des évadés raconte d'une façon pittoresque cet état d'attente du jour et
de l'heure. « Il y avait très longtemps que nous avions projeté de passer la
frontière un ami et moi, tous les deux du même village. Mon camarade était sans
travail et il cherchait le moyen d'y passer sans trop de danger. Voilà qu'un
samedi à midi, il vient me trouver et me dit : « Écoute, nous passons la
frontière aujourd'hui, si tu veux ! mais à main armée, avec une bande de
Russes, de Français et de Belges. Nous sommes à soixante-quinze. « Je lui
dis : - accepte de suite, et nous
passerons avec eux cette nuit. » Voilà nos hommes en route avec la bande.
Ils arrivent à la frontière. « On nous dit : couchez-vous, vous êtes à dix
mètres du fil. » « Alors les deux guides se sont avancés sur la sentinelle, le
revolver au poing. A peine avaient-ils fait quelques pas que la sentinelle
tirait sur eux ; mais ils s'étaient couchés, et la sentinelle était debout, la
lampe électrique allumée sur la poitrine. C'était un beau point de mire. Les
guides tirèrent et cassèrent à la fois la lampe et le bonhomme. La sentinelle
de gauche fut tuée de la même façon. Deux hommes coupèrent les fils à trois
places différentes. Un lieutenant qui faisait sa ronde habituelle a été tué
avant qu'il ne fût descendu de son vélo. Alors la porte du poste s'est ouverte :
deux hommes se sont montrés. Ils ont été blessés très grièvement. Aucun des
nôtres n'était blessé. Alors on nous commanda : « - Debout, et au pas gymnastique ! » Nous avons alors
passé la frontière. Il était minuit juste. » Notez que c'est un ouvrier qui
parle. Il enregistre tout simplement ce qu'il a vu. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui se
sont enfuis d'Allemagne où ils avaient été déportés. Ils ont conservé de leur existence
là-bas un souvenir épouvantable, tel cet ouvrier de dix-huit ans qui nous
raconte sa vie misérable. Les Allemands le menacent, le maltraitent sous le
moindre prétexte. Il cite ce trait de raffinement dans l'insulte : « ils
faisaient crier leurs gosses après nous : « Belgien
capout ! » « La Belgique est morte ! » Cette
dernière avanie avait le don d'exaspérer dans son cœur les sentiments de haine
contre ses bourreaux. Un autre nous dit : « Quant à la
nourriture qu'on nous donnait (aux ouvriers déportés) les porcs ne l'auraient
pas mangée, tellement c'était mauvais. » Et par-ci par-là quelques mots nous
laissent deviner le martyre de ces pauvres gens. « Je voulais, dit l'un, mettre
fin aux tortures de la déportation. » Ce régime était abominable. A lire les
détails que racontent les malheureux qui l'ont subi, il rappelle les supplices
infligés aux esclaves. « Mon lieu d'occupation était dans une soierie
artificielle ; mon occupation était de casser le sel et de le transporter aux
cuves à acide. Les charges qu'on me faisait conduire seul atteignaient 200 à
250 kilogrammes. » Il s'échappe et est repris. « Là un sous-officier
et deux gardiens me rouèrent de coups. Après quoi ils me firent signer une
déclaration contenant ces termes : « Je m'engage par la présente à ne pas
prendre les armes contre l'armée allemande. » Voici sa conclusion, quand il a
franchi les barrières et est en Hollande : « Je sortais d'un cauchemar qui
torture encore tant de concitoyens et amis. » L'un d'eux prit son mal en patience
pendant cinq mois. Enfin, n'en pouvant plus, il refusa, un matin, de se mettre
à la besogne. Le résultat ne se fit pas attendre: « On me flanqua, dit il,
huit jours dans la boîte et une amende de 25 marks. » Écœuré de ce procédé sommaire,
il résolut d'en finir. « Un jour, en me promenant, je tombai avec un
Hollandais; je me mis à causer avec lui ; on commença à causer de la guerre, si
bien que je m'affranchis à lui dire que si je tombais sur un homme qui voudrait
me passer à la frontière, que je lui donnerais cent marks. Et voilà que pour
cent marks, le bonhomme céda à me passer. » A cinq heures du soir, en route,
dans le plus grand secret pour la frontière. On allait y arriver, quand le
guide fait signe : halte ! Il faut rebrousser chemin au plus vite. L'alerte
passée, on revient, on se glisse. A dix heures du soir, le fugitif est en
Hollande. Des centaines d'autres cherchent à
s'aboucher de la même manière avec des gens qui : connaissent les chemins. On
cause, on s'informe, on rencontre un fraudeur, et, comme dit un jeune ouvrier
des bords de la Meuse, « nous lui demandons tout bonnement s'il fait difficile
de passer en Hollande ». De fil en aiguille on arrive à combiner sa petite
affaire. Il y en a qui échappent d'une façon
merveilleuse après avoir cru échouer au port. Par exemple cet ouvrier
luxembourgeois belge, déporté en Allemagne, ne pouvant supporter plus longtemps
son sort, qui suit, un soir, une colonne de fraudeurs à travers bois. On
approche de la frontière hollandaise. Notre pauvre compatriote voit de loin les
contrebandiers qui s'insinuent dans un passage. Il croit qu'il n'a qu'à faire
de même. Il s'y glisse. Au même moment une patrouille allemande surgit et
l'empoigne. Il prie ses ennemis de le laisser passer, il tire de sa poche tout
ce qu'il a pu économiser d'argent : 200 marks. « Tout est à vous si vous me
lâchez. » L'argument est convaincant. La patrouille le laisse aller et empoche
le magot. Voilà notre homme en Hollande. Un déporté qui travaillait dans une
usine allemande, écrit des détails navrants sur le traitement auquel il fut
condamné : « Pendant trois mois je fus soumis à un travail forcené par tous les
temps et sous la menace continuelle des coups de crosse de fusil et de
baïonnettes. Aussi, un soir de janvier, après avoir travaillé toute une journée
de neige et de froid rigoureux, l'idée de m'échapper me vint à l'esprit. »
Un autre, non moins résolu, prend la chose plus gaiement : « Je suis jugé apte
à remplir les fonctions de laboureur. Ce métier a pourtant très peu de
rapprochement avec celui de typographe que j'exerçais avant la guerre. Aussi je
trouve bon de m'enfuir après 3 jours de vie au grand air, Je suis repris le
lendemain matin, après avoir passé la nuit dans un marais. Résultat : 35 jours
de prison, régime sévère et conseil de guerre, » Deux autres tentatives ne
réussirent pas mieux. La quatrième lui permet de passer la frontière, grâce au
déguisement d'un de ses compagnons en soldat allemand. La vie n'est ni meilleure, ni pire pour
les prisonniers dans les camps. Voici un exemple des procédés à leur égard :
« Au camp, beaucoup de blessés meurent faute de soins. Les soldats chargés
de la garde des prisonniers étaient plus brutaux que ceux du front, et voulaient
justifier leurs mauvais traitements en disant que les Belges étaient la cause
du retard de leur marche sur Paris. » Un autre dit : « J'ai vu quatorze
hommes mourir de faim. » Dans les camps de prisonniers civils
belges en Allemagne, les tentatives des autorités pour recruter des étudiants à
l'Université de Gand sont intenses. Un jeune étudiant nous donne d'intéressants
détails. L'esprit du devoir l'a soutenu pour rejeter avec indignation les
avantages qu'on lui offrait afin d'aider les essais de scission. « La
propagande pour l'université bochophile de Gand
battait son plein, dit-il. On promettait de nombreux avantages aux étudiants,
et en effet les quelques lâches qui avaient signé ont été mieux logés. Ils ont
essayé de me séduire. Je leur ai répondu que j'aimerais encore mieux suivre les
cours d'une université allemande avec professeurs ennemis. » Ce sentiment se
comprend bien, tant l'horreur des traîtres est forte chez les natures
généreuses. Cet étudiant parvint à s'enfuir, mais faillit être tué d'un coup de
feu en franchissant la frontière. On conçoit qu'après ces tortures, nos pauvres
compatriotes qui ont pu s'échapper, poussent un long cri de délivrance, Le
contraste leur paraît délicieux. Parlant de son arrivée à Folkestone, un des
déportés évadés écrit : « Accueil touchant ; nous avons été très
bien logés et nourris, c’est là que pour la première fois depuis longtemps j’ai
mangé à ma faim, du pain bien entendu. » II L’ESPRIT DE DÉCISIONS Peu à peu les causes exposées dans le
chapitre précédent déterminaient une volonté irrévocable de passer la
frontière. Mais les difficultés semblaient d'abord insurmontables. Comment
sortir d'un pays où les hommes, surtout ceux en âge de milice, sont tenus en
surveillance continuelle, doivent se présenter tous les quinze jours au
contrôle et sont empêchés, sous les peines les plus dures de quitter le canton
qu'ils habitent ? Ici intervient l'esprit de décision qui lève tous les
obstacles et dont nous allons voir les preuves. Les uns cherchent des guides,
les autres fuient seuls ; les uns passent directement de Belgique en Hollande,
d'autres font un détour par l'Allemagne, parce que la frontière
germano-hollandaise est moins gardée et n'est pas munie de fils électrisés. 
La haie électrisée avec une sentinelle allemande. Remarquez le panneau avec le texte " Danger de mort " (photo Prof. Dr. A. Vanneste) Ces fils sont
en effet un des grands dangers. Le moindre contact avec eux amène la mort. Ces dangers ne rebutent d'ailleurs
personne; ils excitent au contraire les jeunes et viriles intelligences. Voici
un exemple remarquable de décision et de sang-froid. Ce sont quatre jeunes
compagnons, trois frères et un ami. Je laisse la parole à l'un d'entre eux :
« Comme les guides devenaient de plus en plus rares en Belgique, je
résolus de partir par l'Allemagne. Puisque des évadés pouvaient se sauver sans
guide et sans carte, je supposai que nous pouvions en faire autant, ayant
l'avantage de pouvoir prendre des précautions. Je me munis en conséquence d'une
boussole et d'une bonne carte. En passant à Liège, nous achetons des cisailles
pour couper, à l'occasion, les fils de fer. Nous avons passé la nuit dans l'Hertogenwald où nous n'avons pas dormi. Il neigeait et
gelait. Le grand froid nous empêchait de dormir, car nous n'avions pas de
couverture. » « Le lendemain, dimanche, nous nous
mîmes en route vers la frontière à 5 heures du matin. Nous arrivons au bord
d'une rivière gonflée par les neiges de la nuit. Nous étions à la frontière. Je
coupai le fil barbelé séparant la Belgique de l'Allemagne, j'entrai dans l'eau.
Mon ami me suivait ; mais il perdit pied et voulut se raccrocher à moi. Il
tomba dans la rivière. Auguste qui voulut le retenir tomba à son tour au milieu
du courant ; en laissant aller ses souliers à la dérive, je le remis sur pied et
le conduisis de l'autre côté, j'en fis autant pour notre ami, et je retournai
prendre mon plus jeune frère que j'amenai aussi à bon port. Nos paletots
étaient trempés et nous avions en de l'eau jusqu'au haut des cuisses. Le plus
embarrassant était Auguste sans chaussures. Nous nous séchâmes tant bien que
mal et restâmes environ une heure en vue de la frontière, sans voir une seule
sentinelle. » Voilà donc nos jeunes gens en Prusse,
mais le plus difficile reste à faire. Ils doivent traverser un coin du pays
allemand pour arriver à la frontière hollandaise. En étudiant la carte et à
l'aide de la boussole, ils se dirigent vers la Hollande. Je leur rends la
parole : « n'étant pas très certain d'être en bon chemin, je demandai en
allemand à des gosses boches : « Est-ce ici le village de ... - Ya ,
répondit-on en demandant à leur tour : Belge, Belge ? - Nein,
répondîmes-nous en nous empressant de filer. « Plus loin, à un croisement de
route où nous hésitions, une fenêtre s'ouvrit et l'on nous demanda quelque
chose en allemand que nous ne comprîmes pas, car nous savions à nous quatre
peut-être cent ou cent cinquante mots. Nous cherchâmes à partir, mais la femme
nous rejoignit sur la route et nous demanda si nous n'allions pas à
Aix-la-Chapelle. Je dis en allemand : Nein ! ce qui était une bêtise. Elle demanda alors où nous allions.
Je fus pris au dépourvu car je n'avais pas de nom de village en tête et ne
voulais pas indiquer un village en arrière de nous. Je tirai donc hardiment ma
carte et dis le premier nom au hasard. Aussitôt on nous indiqua la route à
suivre. Enhardi, je demandai où nous pourrions trouver des sabots pour mon
frère. « - Dans le village »,
nous dit-on. Mais le village était rempli de monde et nous n'osions entrer
nulle part. C'était dimanche et il faisait beau. Nous étions tous quatre comme
des voyous, crottés jusqu'aux chevilles, Auguste en chaussettes, et nous avions
tous une casquette, ce qui n'est pas la mode en Allemagne. Aussi tout le monde
nous regardait. Nous n'étions pas à l'aise et croyions à tout moment être pris.
Quand il passait un tram conduit par des femmes, les voyageurs se retournaient
pour nous suivre des yeux. Je ne comprends pas comment nous n'avons pas été
pris. Nous nous empressâmes de quitter le village et de gagner la campagne. » Mais ici, nouvelle aventure. Une patrouille de uhlans, apercevant de loin ce groupe de vagabonds, se
lança sur eux au galop. Prenant leurs jambes à leur cou, même Auguste toujours
en chaussettes, nos amis se lancèrent sous bois où les taillis empêchèrent les
cavaliers de les suivre. Ils marchèrent ensuite dans la direction nord pendant
un quart d'heure, à l'aide de la boussole, obliquèrent à gauche et prirent
comme point de repère une étoile située près de la ligne de l'horizon. Ils
étaient à présent en pleine campagne. Tout à coup ils trébuchent dans un réseau
de fils de fer barbelés, couchés à ras du sol. Ils le franchissent et se jugent
sauvés. « Croyant que c'était la frontière, continue notre narrateur, nous nous
mîmes à causer tout haut. Mais nous étions dans l'erreur, et, par notre faute,
nous avons risqué de nous dénoncer nous-mêmes aux postes placés de cent en cent
mètres. Un ruisseau s'offrit à nous, que nous traversâmes sans encombre. Nous
étions enfin en Hollande, car deux douaniers néerlandais, croyant avoir affaire
à des fraudeurs, nous arrêtèrent et nous conduisirent au poste frontière
hollandais où nous passâmes la nuit. Ils nous félicitèrent de la chance que
nous avions eue de tomber entre deux postes sans attirer leur attention : nous
ne nous doutions même pas de leur présence. » D'autres fois, on s'en va à pied à
travers champs, sac au dos, comme des chemineaux. Arrive une patrouille non
montée. Il est trop tard pour se cacher dans un fossé ou derrière une haie.
Alors il faut détaler, comme ces deux Bruxellois, dont l'un nous raconte cette
fuite éperdue. « Nous avons été poursuivis; dit-il, par un soldat allemand
plus d'une heure à travers champs, prairies, ruisseaux. » Les bottes du soldat
s'empêtraient dans les terres grasses ; il hurlait et tempêtait, mais il
galopait toujours, enjambait les ruisseaux, laissait des empreintes profondes
dans les guérets, gesticulait des deux poings. Pendant ce temps-là, nos deux
Bruxellois détalaient devant lui comme des lièvres. Au bout d'une heure d'une
course échevelée ils ne virent plus derrière eux leur persécuteur. Il s'était
sans doute affalé contre un talus. Ces deux là passèrent, la nuit, les fils
électrisés en les écartant avec un bâton. Ils étaient sauvés ! Le sang-froid est une des qualités qui
importent le plus dans ces entreprises où l'imprévu se dresse continuellement
devant vous. Ceux qui sont pourvus à haute dose de cette qualité arrivent
parfois à des résultats étonnants. Un ouvrier wallon parvient à passer en
Allemagne, entre à Aix-la-Chapelle en disant bonsoir aux sentinelles d'un air
de bonne humeur. Interpellé, il répond qu'il revient de son travail. Il arrive
à pied à la frontière hollandaise vers 1 heure du matin. Près des fils, il
entend marcher : on relevait les postes. Il se couche dans l'eau pendant une
demi-heure et voit passer les sentinelles à quelques pas de lui. Il remarque
une barrière mobile, à un endroit des fils, par où les soldats passaient. Quand
ils ont disparu, il y court. Elle est restée ouverte, sans doute en attendant
le passage du poste montant. Il n'a que la peine de traverser, passe une
rivière à la nage et se trouve en Hollande. Si le sang-froid est nécessaire il ne
faut pas non plus être distrait. Il faillit en coûter cher à un de nos amis
d'avoir eu une minute de distraction. Il avait essayé de franchir la frontière,
mais avait été arrêté sur la route. Comme il était porteur d'un papier
compromettant, il l'avait glissé dans son parapluie ; n'ayant rien trouvé de
suspect sur lui, on le relâcha de sa prison au bout de quelques jours ; mais
dans sa joie, le malheureux, y oublia son parapluie ! Il joua d'audace et se
représenta, le lendemain, au geôlier, pour lui réclamer son riflard. Celui-ci
lui fut remis sans peine. Le billet s'y trouvait toujours ; on n'avait pas
songé à examiner de plus près cet instrument pacifique. Ce ne sont pas toujours des hommes
expérimentés qui font preuve de cette audace et de ce sang-froid, mais aussi
des adolescents, presque des enfants encore. Témoin, celui-ci, de seize ans,
qui, le matin même de son départ, assiste encore à la classe « afin,
dit-il, que tous les élèves fussent témoins de ma présence ce jour-là ». Le
lendemain, à cinq heures du matin, il est près de la frontière. « Ce ne
fut pas, ajoute-t-il, sans un tremblement que j'y arrivai. Heureusement les
sentinelles, voyant mon petit air innocent, ne me firent pas de difficultés ;
mais je dus tout de même rester couché deux jours avant de tenter le passage.
Quelles angoisses durant ce temps ! à tout moment les
Allemands pouvaient entrer et me mettre la main au collet. » Enfin notre
jeune ami réussit son évasion, et il nous dit gentiment en manière de
conclusion : « J'espère pouvoir rendre service activement, mais vu mon âge,
je ne sais pas encore ce qu’on me fera faire. » D'autres trouvent cette décision si
simple, qu'ils racontent l'aventure au même titre qu'une promenade. « Je
me suis enfui, dit l'un, du camp d'Holzminden. Je m'étais procuré des vêtements
civils, une lampe électrique, un compas et une bonne carte d'Allemagne. Après
avoir coupé la clôture je passai au travers avec six camarades ; la sentinelle
qui nous avait aperçus fit feu et tandis que les autres hommes s'arrêtaient, je
parvins à m'esquiver. J'étais habillé comme un ouvrier avec une gibecière et un
bidon à café sur le dos. Aussi partout tout le monde me prit pour un ouvrier
qui allait à son travail ou en revenait. Je marchais le matin de cinq à sept,
de midi à deux, et le soir de sept à dix ; le reste du temps je me cachais le
mieux que je pouvais aux yeux de la population. Je m'étais attaché autour des reins
une large bande de toile dans laquelle se trouvaient 5 kilogrammes de lard
coupés en petits morceaux et qui m'avaient été envoyés de Belgique par ma
femme. Cela constitua toute ma nourriture avec une ration de soupe que j'allais
prendre dans les maisons du peuple de différentes villes. Ne connaissant pas
suffisamment l'allemand je n'osais aller manger et dormir dans les hôtels. Je
suis arrivé à la frontière hollandaise où je me suis caché dans un grand bois
jusqu'à trois heures de l'après-midi sans être remarqué par les sentinelles ;
il n'y avait pas de clôture le long de la frontière hollandaise. Pendant mon
voyage qui dura environ vingt jours je vis souvent des prisonniers de guerre
qui travaillaient dans les campagnes. » Parfois l'esprit de solidarité qui anime
ces jeunes gens, les conduit à de belles actions de défense et d'aide
mutuelles, comme ce trait raconté par l'un d'eux : « Dans un café tout près de là les
Allemands étaient occupés à chanter et à danser et faisaient un bruit de tous
les diables. Nous rampons tout doucement jusqu'à cinq mètres de la sentinelle
tenant en mains nos couteaux et nos souliers. Puis brusquement nous bondissons
en avant et prenons la fuite. La sentinelle allemande se précipite vers nous,
crie : « Qui est là ? » et tire en même temps. Nous sommes assez heureux
pour nous échapper à cinq tandis que trois autres restent en arrière. Après
avoir marché un quart d'heure nous arrivons à une habitation où nous frappons
et entrons. Après nous être restaurés et désaltérés, le propriétaire de la
maison nous montre le chemin à travers bois et champs et nous arrivons enfin en
Hollande. Apprenant là dans la maison où nous nous trouvons que nos camarades
perdus avaient aussi passé le canal la même nuit, et qu'ils se trouvaient à une
demi-heure de la frontière belge, nous retournons de nouveau en Belgique pour
les chercher. Nous sommes assez heureux pour les trouver, et avec eux, nous
repassons fièrement tous ensemble la frontière. » L'une des évasions qui prouvent le mieux
les qualités de décision, d'énergie et de résolution des Belges, c'est celle
qui fut accomplie sur un vapeur de la Meuse : 
Le remorqueur « Atlas V » amarré en face du café Warnier à Eysden (Hollande). (Livre d’Edouard Dehareng, "L’odyssée du remorqueur Atlas V" – Imprimerie Wagelmans à Visé) Tout le monde se souvient de l'exploit
du remorqueur l'Atlas V de Liège, qui
réussit à forcer le passage vers la Hollande et emporta ainsi cent trois jeunes
Belges, à la barbe des Allemands. Voici les impressions d'un de ces braves : «
A minuit moins vingt, le moteur ronfle, le remorqueur démarre, nous quittons
Liège. Au moulin d'Argenteau, le remorqueur est signalé. L'Atlas V accélère (j'oubliais de dire qu'il avait profité de la crue
de la Meuse pour éviter le canal) et ralentit aux ponts. « Au premier pont de
Visé, premières mitrailleuses qui nous canardent au passage. Au second pont,
leur fameux pont en béton, nouvelles mitrailleuses et projecteurs qui nous
éclairent en plein. Le remorqueur accélère encore sa vitesse, donne en plein
dans le pont de service, troisième pont de Visé, sur lequel courait une voie
ferrée, le coupe en deux (nous sommes alors très rudement secoués), continue et
prend de flanc un radeau sentinelle qui nageait sur la Meuse, dix mètres après
le pont, le précipite à l'eau avec six Boches et deux mitrailleuses. Le remorqueur
va plus vite que jamais dans une fusillade ininterrompue. Les journaux
hollandais prétendent même qu'un canon donnait. Bref, à une heure du matin,
nous étions à Eysden. » Un des passagers de l'Atlas V fait ce bel éloge du pilote : « C'est ainsi que, grâce au sang-froid
et à l'énergie de cet héroïque pilote, qui osa prendre sur lui la
responsabilité de cent trois vies humaines, parmi lesquelles celles de sa femme
et de ses deux enfants, nous pûmes atteindre la Hollande et y débarquer tous. »
Un autre passager conclut ainsi : « Il
paraît que notre passage a coûté la vie à douze soldats allemands. En tout cas
il a donné cent soldats à la patrie belge. » Il y eut toute une série de passages du
même genre sur des bateaux. Celui-ci, par exemple, raconté par un des acteurs
principaux, fut effectué sur une embarcation allemande; il témoigne d'un esprit
de décision vraiment remarquable : « A minuit et demie, nous partons par
groupes de douze à quinze hommes, où je me trouvais à la tète du premier groupe
pour capturer et utiliser le remorqueur. Quelques sentinelles avaient été
placées sur le passage. Je descends dans la cabine avec mes hommes, où se
trouvait couché le capitaine du remorqueur boche. A mon arrivée, il sort peu à
peu de sa torpeur et cherche à se dresser. Immédiatement je m'élance sur lui.
Quelques conseils bien sentis et mon revolver que je lui appuie sur la tête ont
bientôt fait ; il se recouche sur son lit. Je l’ai maintenu, revolver au poing,
sur sa couchette jusqu'à notre passage à six heures du matin, c'est-à-dire le
passage des fils électriques qui se trouvent tendus à travers la Meuse. Le
remorqueur à toute allure passe à travers sans le moindre inconvénient. Sur le
pont du remorqueur se trouvaient des hommes de notre complot, habillés avec les
costumes des Boches et portant leurs fusils. » Un autre moyen de franchir la frontière
qui demande une énergie presque surhumaine, c'est la traversée des
« Schorres ». Les « Schorres » sont des lagunes du Bas-Escaut
vers la Flandre zélandaise. A voir ces étendues de boues mouvantes et la façon
dont elles sont gardées par les Allemands, on pourrait dire : « Vous qui y entrez,
abandonnez tout espoir. » Et
pourtant des hommes s'y sont risqués, préférant être engloutis dans la vase,
que rester aux mains de l'oppresseur. A certains moments, ils enfonçaient jusqu'aux
genoux. Il faut se remuer tout le temps, si l'on veut éviter d'être enlisé,
même quand on est forcé de se jeter à plat ventre pour dérouter les phares
mobiles qui fouillent incessamment cette morne étendue. Un homme a réussi la
moitié du trajet. Il aperçoit de loin la frontière : « D'un bond je m'élançai
sur la plaine boueuse me séparant du poteau. Haletant d'épuisement, voilà les
deux feux des phares qui sont braqués tout à coup dans ma direction ! Un coup
de feu... un deuxième ! Je crus ma dernière heure venue ! Je poursuivis
cependant ma route, me croyant maintenant plus à l'abri à cause du brouillard,
et me voilà devant ce fameux poteau... J'avançai tout doucement, marchant
maintenant dans l'eau glacée, cette fois-ci jusqu'à la ceinture. Coûte que
coûte ! Advienne que pourra !... Je passe ! Quel moment inoubliable !... Une
bonne demi-heure après, je me trouvai tel une loque humaine sur le gazon humide
de la digue hollandaise ! ... Ils ne m'avaient pas eu » D'autres ont réussi comme lui, mais à
quel prix ! « L'endroit où nous étions arrivés était
très dangereux, aussi nous épions avec le plus grand soin la sentinelle qui se
trouvait seulement à 2oo mètres de nous. Les projecteurs placés par les
Allemands éclairaient chemins et champs. Nous enlevons nos souliers et une
partie de nos vêtements et nous nous engageons sans tarder sur les terres
d'alluvion, car c'était marée basse. Mais quel chemin ! Plus nous avancions
pire c'était, nous enfoncions de 50 ou 60 centimètres dans le limon, enfin nous
finissons par arriver à un ruisseau où il y avait heureusement très peu d'eau.
C'est là qu'un de nos camarades faillit perdre la vie, il disparut entièrement
dans la vase et nous ne parvînmes à le sauver qu'après beaucoup d'efforts.
Comme il avait perdu connaissance, nous fûmes obligés de le porter et c'est
ainsi que nous arrivâmes seulement à deux heures du matin en Hollande où notre
ami fut soigné et où nous fûmes très bien reçus. » Enfin voici les péripéties par où passa
une autre bande, aux mêmes lieux : « Nous avions dû nous cacher souvent pour échapper aux patrouilles, aussi étions-nous dans un vilain état, les habits, le visage et les mains abîmés, couverts de boue de la tête aux pieds. A 9 heures 1/ 2 ou 10 heures c'était marée haute dans l'Escaut. Nous quittons le cabaret où nous étions rassemblés et arrivons au bord du fleuve. Nous étions là à genoux, nous baissant continuellement pour échapper aux projecteurs, tandis que les sentinelles allemandes se tenaient à 15 mètres de nous sans nous remarquer. Maintenant commençait le plus difficile. Le fil électrique pénétrait environ 300 mètres dans l'Escaut mais par suite d'une tempête quelques piquets étaient arrachés. Nous l'avions remarqué la veille et ainsi nous allions essayer de parvenir de l'autre côté. Mais ce qui nous effrayait le plus, c'était le projecteur établi sur la digue de l'Escaut ; s'il nous découvrait nous étions certainement perdus et tués à coups de fusil. Au début tout alla bien, mais à mesure que nous avancions, nous enfoncions davantage dans la vase, de sorte qu'elle atteignit bientôt notre poitrine et que nous étions obligés de nous aider continuellement l'un l'autre dans les passages difficiles. Chaque fois aussi que le projecteur éclairait de notre côté, nous étions obligés de nous coucher à plat ventre sur un endroit résistant de manière à ne pas être aperçus. Après avoir pataugé ainsi pendant une heure et demie dans la boue nous avons passé le fil électrique environ un mètre au-dessus de lui. L'eau nous arrivait déjà au-dessus de la poitrine, car la marée montait. A onze heures du soir nous arrivions enfin à la frontière hollandaise. » L'esprit de décision donne aux jeunes évadés une sorte de témérité joyeuse où la volupté de courir une aventure périlleuse se mêle au plaisir d'affirmer son caractère indépendant d'homme libre. « Je suis léger comme une plume », dit l'un d'eux pour nous faire saisir ses dispositions à tout entreprendre. C'est le même qui, blotti dans une cachette à quelques pas d'une sentinelle, s'amuse à noter les faits et gestes de celle-ci : « elle attendait la relève et pour passer le temps, couchait en joue la lune en fredonnant à mi-voix une tyrolienne. » N'est-ce pas un trait copié sur le vif et qui prouve le sang-froid de l'observateur ? Rien ne décourage l'énergie de ces jeunes patriotes. On leur refuse le logement dans certains villages où l'on se défie d'eux ; alors ils font comme le jeune évadé qui, la première nuit, s'installa dans une vieille grange sur des betteraves, et la seconde, dormit dans un four à cuire le pain ; ou, comme cet autre, qui logea avec les cochons. Là, du moins, il ne mourut pas de froid. D'ailleurs il ne faut pas être difficile sur le couchage. C'est tantôt l'herbe humide d'une prairie, tantôt une étable ou un tas de betteraves, tantôt une salle froide ou un plancher dur. « Depuis que je suis à l'armée, dit un des évadés, j'ai parfois rencontré des gens qui se plaignaient de nos dortoirs: qu'ils aillent donc un peu voir là-bas, ils m'en diront des nouvelles. » C'est bien aussi l'avis de cet évadé qui nous dit : « Ce soir-là, nous empruntons l'étable d'une chèvre et passons clandestinement la nuit dans le fourrage. » D'autres fois, les refus et la mauvaise volonté des gens qu'ils rencontrent en Prusse, les animent d'une froide audace : Traqué, perdu en Allemagne, aux environs de la frontière germano-hollandaise, ne sachant plus par où se diriger, un jeune évadé qui parlait couramment la langue allemande, se décida en désespoir de cause à se renseigner auprès d'un garçon de ferme allemand. Celui-ci refuse obstinément de lui donner aucune information. Craignant d'être trahi par son interlocuteur et arrêté, dès que ce dernier aura pu le dénoncer à la police, le Belge tire son couteau, l'ouvre, et s'adressant au domestique lui dit : Choisis. Tu auras quinze marks si tu me renseignes ; mais si tu refuses, voici mon couteau. » Le garçon accepta et conduisit lui même notre jeune homme jusqu'au delà de la frontière. L'esprit de décision survit chez beaucoup à des échecs et à des tentatives manquées. Des prisonniers en Allemagne, repris, punis, maltraités, recommencent avec une nouvelle audace. L'un d'eux, après diverses tentatives qui lui avaient valu le cachot et les camps de travail, nous dit : « Je risquai le tout pour le tout et je préparai en hâte une nouvelle évasion. Dix jours après ma sortie de cachot, je m'évadai de nouveau. Pour cela je m'étais dissimulé sous un tas de fagots en dehors de la clôture, et la nuit venue, je traversai en rampant la ligne des sentinelles. Après six nuits de marche, j'arrivai sur le sol hollandais, après plus de vingt-trois mois de captivité. » Un autre qui avait pris part en qualité de maréchal des logis, au début de la campagne, et, blessé dans une rencontre où ses compagnons avaient été tués, s'était trouvé prisonnier des Allemands, nous raconte les péripéties extraordinaires de son évasion d'Allemagne en Hollande. Aucun récit d'imagination n'atteint cette réalité simplement contée. Après des difficultés inouïes pour sortir avec quelques amis du camp où il était emprisonné, il parcourt le pays pendant des semaines entières à la recherche de la frontière hollandaise, dormant en plein champ, souffrant atrocement de la faim et de la soif. Certaines péripéties sont particulièrement bien contées et poignantes. En voici trois « Vers minuit, sans nous en douter, en sortant d'un bois, nous tombons devant une ferme. Nous apercevons dans la cour une pompe. La tentation est trop grande ; nous mourons de soif. Un grand arrosoir se trouve là. Nous n'y tenons plus; un des Anglais tient l'arrosoir et je pompe à tour de bras. Le chien se met à hurler ; des lumières se montrent. Nous fuyons à toute vitesse, emportant notre précieux récipient. Un kilomètre de course folle, puis halte au coin d'un bois. L'arrosoir est vide en un clin d'œil. Deux minutes après, nous devons traverser une route. Nous tombons nez à nez sur un sous-officier allemand à bicyclette. Nous ne bronchons pas et lui envoyons un formidable « Gut Nacht ». Notre accent nous trahit probablement, car en me retournant, j'aperçois mon Boche qui ralentit puis descend de son vélo, « Au galop », criai-je à mes camarades et nous voilà fuyant vers un petit bois qui se trouve à proximité. Nous continuons jusqu'au matin et nous nous installons dans un fossé à la lisière d'un bois. » « A ce moment nous apercevons à deux kilomètres une petite ville. Nous tenons conseil. D'après nos calculs nous devrions être arrivés à la frontière. Nous serions-nous trompés de direction ? Il est décidé que je pars avec un Anglais pour tâcher de découvrir le nom de la ville, les deux autres doivent nous attendre pendant deux heures ; si nous ne sommes pas revenus alors, c'est que nous nous sommes fait prendre et ils ne doivent plus s'occuper de nous. Nous partons, et arrivés à l'entrée de la ville, je conseille à mon Anglais de me laisser aller seul. Il accepte et je pars. Mon cœur bat un peu. Ne vais-je pas faire de rencontres désagréables ? J'enfile une rue puis une autre. Tout est tranquille; mais il fait diablement clair dans cette ville, et je maudis à ce moment la découverte de l'électricité. J'avance à pas de loup et me trouve sur une place. Un grand bâtiment : des affiches sur la façade ! L'hôtel de ville probablement ? Je tâche de déchiffrer ce qu'il y a sur les affiches espérant y trouver le nom de la ville. Rien ! Je fais le tour de la place. Une église ! Encore des affiches ! Pas plus de succès. Enfin devant un magasin sur le trottoir, sur une caisse, une étiquette : je l'arrache et file retrouver mon Anglais ; tout en marchant, je regarde mon étiquette ! Hourrah ! Nous sommes dans le bon chemin ; la petite ville, dont j'ai oublié le nom, avait été notée par nous avant de partir comme n'étant pas fort éloignée de la frontière. Nous rapportons la bonne nouvelle et nous nous remettons en route ... » « Il est 4 heures du matin. Nous passons près d'une barrière de prairie. Il y a un écriteau ; je regarde et je crois devenir fou en lisant l'inscription « Verboden Ingang ». Nous avons réussi ! L'émotion est trop forte ; nous pleurons, nous rions, nous dansons. Tout est oublié : fatigue, faim, soif ! « En route», dis-je à mes camarades, et nous voilà déambulant gaiement sur le sol hollandais. Nous voilà maintenant en plein dans des marais, et pas une habitation. Enfin, vers 6 heures, nous arrivons devant une petite ferme. Nous nous expliquons tant bien que mal. On nous fait entrer : l'accueil est touchant. La brave fermière pleure sur nos malheurs passés tout en nous servant du café, des tartines, des fruits ... » L'un des évadés qui dut faire un trajet en territoire allemand, trouve le courage de noter le côté pittoresque de sa situation en tramway. « Vous voyez ma figure en tramway, dit-il, entouré de tous côtés de soldats boches, et même, à un moment, deux soldats se sont familièrement appuyés sur moi. Heureusement aucun n'a eu l'idée de m'adresser la parole. » Celui-là, arrivé sans encombre à la frontière, voit devant lui la barrière de fils. Mais comme il est en Allemagne et veut passer de là en Hollande, il n'a pas à craindre de fils électrisés. Ce sont simplement quatre rangées de clôtures à escalader. « Je m'élance, écrit-il, à l'assaut des fils libérateurs. Comme je passais le premier, la sentinelle boche se retourne, m'aperçoit et crie : halt ! Mon compagnon retourne, montre ses papiers pour la seconde fois, et pendant le temps qu'il met à inspecter les papiers, je parvins à passer les trois autres rangées de fils, dont le quatrième à 2 m. 50 de hauteur. Le tour était joué ; encore un Belge passé : » Il faut que cet esprit de décision mis à la disposition de l'amour du devoir et de la patrie, soit bien fort dans certaines âmes pour leur avoir permis d'exécuter leur plan, malgré des circonstances parfois effroyables. Voici par exemple un jeune soldat qui avait pris part aux premières batailles de Belgique et avait été blessé, puis fait prisonnier par les Allemands. Sa jambe est paralysée. Il ne peut avancer qu'avec les plus grands efforts. Peu importe ! Il tentera l'aventure dont il nous conte les péripéties, et dont la fin est simple et grande, d'une vérité intense : « J'avais bien difficile de me traîner sur mes béquilles ; j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Encore 150 mètres... Je vois des uhlans. J'étais près d'une petite ferme. Le propriétaire, encore un brave, me cacha sous son lit. Dix minutes après, je sortis. Je voyais la borne à cent mètres. Risquerai-je ? Oui. Je me traîne tant bien que mal dans le fossé. Il faisait froid. J'avance, je cours. Encore un pas. Les Boches m'ont vu. Ils tirent, mais, c'est en vain. J'avance toujours. Serais-je en Hollande ? Oui, je vois une sentinelle hollandaise qui me met sur le bon chemin. Mon bonheur fut grand, car ayant souffert physiquement et surtout moralement, je n'avais, jusqu'alors, connu que le malheur. » Que dire de l'esprit d'énergie et de la force de caractère de certains guides ? Si quelques uns ont été parfois âpres au gain et ont même trompé l'espoir qu'on avait mis en eux, d'autres ont été sublimes. Tel ce garçon de café qui aida généreusement beaucoup de jeunes gens à passer la frontière. Une nuit, il arrive au fil avec quelques étudiants. Un de ceux-ci nous fait le récit de la scène qui fut fatale au guide : « Nous étions couchés à plat ventre dans la plaine. La sentinelle nous vit et nous cria de nous lever. Comme nous ne bougions pas, elle fit feu. Sur l'ordre du guide, nous fîmes alors demi-tour, et toujours à plat ventre, nous rampâmes pendant quatre ou cinq minutes, puis nous nous mîmes à courir. La sentinelle tira encore quatre coups. Le lendemain après-midi, nous apprîmes que notre guide avait été arrêté par les Boches. Quinze jours après, le pauvre homme était fusillé, laissant une femme et deux mioches.» Un autre eut une fin non moins tragique que raconte un des témoins de la scène : « Nous étions en tout 7 pour passer, y compris le guide qui voulait aussi s'évader en Hollande. A 6 heures 1/2, nous étions aux fils, et l'on pose une échelle pour sauter au-dessus. Le guide grimpe le premier, glisse, et tombe électrocuté. Les 6 autres ont dû passer au-dessus de son cadavre. » 
Un tonneau placé entre deux fils inférieurs (photo Prof. Dr A. Vanneste) Pour faire contraste avec ces guides-héros, voici maintenant un guide qui manque de parole : Un jeune Wallon, accompagné de 43 de ses compagnons, par un jour de la fin de juin, avait pris rendez-vous avec un guide pour la Hollande. Celui-ci ne vint pas à l'heure dite. Les 44 hommes s'étant donc réunis en pleine nuit, au bord de la Meuse, furent bien empêchés de n'avoir personne pour leur indiquer le chemin. Heureusement notre Wallon ne perdit pas la tête. Puisqu'on ne pouvait être conduit par un être humain, pensa-t-il, on serait conduit par un élément. « Qui sait nager ? demanda-t-il ? » Une dizaine de jeunes gens de la bande se présentèrent. Laissons la parole au guide improvisé : « Nous nous sommes déshabillés, et, à une heure du matin, on se mettait à l'eau, puis on se laissait choir par une planche qui était levée à l'écluse, puis on passait en dessous du pont du chemin de fer boche. Ayant dépassé les autres d'une centaine de mètres, je passai la première ligne de barquettes avant que le projecteur ne nous eût découverts. Les autres ayant été aperçus, on les reçut avec les coups de mitrailleuses. Ayant eu peur, ils se sont réfugiés sur les rives. Les Boches les ayant aperçus les firent prisonniers. Moi je continuai mon chemin et j'arrivai en Hollande à 4 heures du matin, en caleçon. Ayant acheté un costume et des bottines, je me rendis à 9 heures chez le consul qui me fit un bon pour aller coucher à l'hôtel où j'apaisai ma faim et me reposai de mes fatigues. » L'esprit vigoureux de décision se marque surtout dans les expéditions à main armée, celles qui se sont faites à une quarantaine d'hommes résolus, et qui ont demandé une longue préparation et des conciliabules préliminaires. Ayant pris rendez-vous pour une réunion générale de discussion, dans un lieu désert, les conjurés arrivaient tous très exactement au rendez-vous. Un des acteurs de l'un de ces drames où plusieurs hommes furent tués, nous décrit ainsi la scène: « Ceci fut recommandé à tous : armez-vous de revolvers et de poignards et ne vous faites pas d'illusions. La partie sera peut-être dure à disputer. A la réunion, le moment fut solennel. Tous ont juré de donner leur vie, s'il le fallait, plutôt que de prêter aide à l'ennemi en consentant à aller travailler dans des fabriques de munitions. » Après ces préliminaires, on se munit de cisailles, de pinces isolatrices pour couper les fils électrisés, et d'armes. Puis, en route pour la frontière par une nuit noire. Les électriciens qui font partie de la bande coupent les fils. Aussitôt les postes allemands en sont avertis par la sonnerie d'alarme. La bataille commence. Pendant que le gros des évadés s'engouffre dans la brèche et fuit vers la Hollande à travers la zone neutre, une arrière-garde échange des coups de feu avec les sentinelles. « Ce fut, dit notre narrateur, une course furibonde sous la pluie des balles d'une mitrailleuse installée au sommet d'un monticule, et sous les rayons d'un phare qui nous a cherchés en vain, car nous sommes arrivés sains et saufs en Hollande. Une fois le pied mis sur la terre neutre, on était fou de joie : les uns chantaient la Brabançonne, les autres s'embrassaient et pleuraient. « L'arrière-garde rejoignit le reste de la troupe, après avoir essuyé le feu des sentinelles et en avoir abattu 3. » Les passages se font souvent en bandes de 5, 10, 14, 17. Un Flamand hardi et débrouillard parti dans un groupe de 14 compagnons, nous raconte comment ils marchèrent de 7 heures du soir à 5 heures du matin, leurs petits baluchons sur le dos. Le matin, ils se cachèrent dans les bois, et y restèrent jusqu'à 9 heures 1/2 du soir. Alors ils envoyèrent un d'entre eux en éclaireur pour reconnaître les abords de la frontière. Le cœur serré d'anxiété, ils le suivaient des yeux, du fond de leur cachette, pendant qu'il s'avançait vers le passage qu'il croyait libre. Soudain une sentinelle surgit devant lui, s'en saisit et l'emmena. Ils n'en eurent plus jamais de nouvelles. La nuit venue, ils voulurent reconnaître eux-mêmes les passages, et se perdirent dans les bois où ils errèrent jusqu'à 4 heures du matin. C'était en plein été. Le jour naissant leur permit d'apercevoir une ferme où ils purent passer la journée dans une grange. « Le soir nous sommes partis, et à 10 heures, nous étions à 500 mètres des fils électrisés. Nous étions dans l'eau jusqu'aux genoux. A 50 mètres de la frontière, nous nous couchions à plat ventre dans l'eau. Nous avancions. La sentinelle se trouvait à 10 mètres devant nous. Elle passa trois fois... En deux minutes nous avons passé à 14. Ce fut à minuit et demi... Nous étions libres enfin ! La fatigue, les misères de ces quatre jours furent oubliées. » Il faut une volonté inébranlable pour poursuivre dans certaines conditions. Un des jeunes gens avait réussi à s'embarquer avec douze compagnons dans un chaland qui transportait du charbon. Ils étaient blottis dans un trou creusé au milieu du combustible. Le voyage ayant été interrompu pendant quarante-huit heures, ils n'eurent plus rien à manger pendant deux jours. Néanmoins ils tinrent bon, mais à quel prix ! Le narrateur raconte ceci : « Je tombai évanoui d'inanition. On me réveilla avec des sels ammoniacs. Chacun de nous fut malade à son tour. » Ces courageux patriotes arrivèrent tous en Hollande à demi morts, et comme dit un autre de ces jeunes héros, « noirs de charbon, titubant de faiblesse ». Et cependant ils avaient gardé une charmante pointe d'humour, car l'auteur du récit dit en manière de conclusion : « Voilà quel fut notre voyage avec tout confort en première classe. » Parmi les évadés beaucoup sont pauvres ; et cependant ils ont dû payer leur logement et leur nourriture en route, ils ont été entraînés à des frais considérables pour eux. Eh bien ! aucun n'a reculé devant ces considérations. Écoutez cette constatation faite par l’un de ces jeunes gens, et remarquez le ton exempt de plainte, mais profondément pénétré d'une tristesse contenue : « Ma maison était réduite en cendres comme beaucoup de maisons du hameau. Vingt-huit maisons sur quarante huit ont été incendiées. Treize civils dont plusieurs femmes, ont été fusillés. C'est la ruine complète. « J'étais parvenu à élever une génisse qui, au moment du désastre, était en prairie, ce qui fut cause qu'elle échappa à l'incendie. L'argent que m'a procuré la vente de cette bête m'a permis de couvrir les nombreux frais que m’a occasionnés mon aventure. » III L’HABILETÉ D’EXÉCUTION Ouvriers,
étudiants, employés, jeunes gens de toutes les conditions sociales et de tous
les métiers, se trouvent réunis dans la même pensée, et tous mettent à sa
réalisation une habileté et parfois une finesse qui révèlent de l'imagination
et du savoir-faire. Il est vrai que nous avons seulement les récits de ceux qui
ont réussi dans leur entreprise. Peut-être tous n'ont-ils pas apporté au même
degré la promptitude de décision nécessaire, ou plus vraisemblablement, tous
n'ont-ils pas été servis par les mêmes circonstances. La chance joue en effet
un rôle considérable dans ces aventures où le plus petit incident peut ruiner des combinaisons préparées deux mois à l'avance. Quoi qu'il en soit, l'on est étonné de
voir quelle somme de patience, d'habileté et de ténacité il a fallu à nos
jeunes évadés pour triompher des difficultés accumulées. L'un d'eux imagina
tout seul un plan singulièrement aventureux. « Étant bon nageur, dit-il, je
voulais passer la Meuse à la nage et je parvins à atteindre en rampant un petit
marais situé près du fleuve. Il était 9 heures du soir. Je me cachai là tout en
surveillant les mouvements de la sentinelle allemande. Je voulais suivre une
petite rivière qui coulait vers la Meuse, malheureusement sur le pont établi
dans la digue du fleuve, se tenait une sentinelle allemande. Ne pouvant choisir
un autre chemin, puisqu'il y avait une sentinelle tous les cent mètres, je dus
bien passer par là. Je me laissai glisser tout doucement à l'eau, et nageant
sur le dos, j'atteignis la Meuse après avoir passé en dessous de la sentinelle.
Je dus nager vigoureusement pour ne pas être entraîné par le courant ; aussi la
sentinelle ayant entendu quelque chose, un « Halt ! Werda ? » résonna dans la
tranquille nuit d'été. Je me laissai alors entraîner tout doucement par le
courant, puis nageai pour atteindre l'autre rive où j'arrivai au village
hollandais. » Souvent il y a un guide qui les mène et
leur donne de précieuses indications ; mais quand le guide les quitte, il faut
se débrouiller seuls, comme les héros de l'aventure suivante : « Après nous
avoir fait marcher en file indienne pendant une demi-heure, le guide nous dit
que nous sommes arrivés au point déterminé et que la réussite dépendra de notre
calme et de notre prudence. Je m'étais muni d'une bêche chez le paysan. Sitôt
que le guide nous a quittés, nous commençons à ramper, faisant le moins de
bruit possible, et ainsi, pendant plus de trois quarts d'heure, nous nous
traînons dans l'eau et dans la boue jusqu'à ce qu'enfin nous sommes arrêtés par
les fils électrisés. Je me mets aussitôt à la besogne. Je creuse un trou entre
les fils, travail assez difficile, car nous sommes dans une prairie. Le premier
des neuf fils électrisés est à 15 ou 20 centimètres du sol, de sorte qu'il faut
une très grande prudence pour ne pas le toucher, surtout que la bêche est
humide, et de ce fait bonne conductrice de l'électricité. Mon camarade retire
la terre du trou au fur et à mesure que je creuse. Un autre fait le guet,
couché à plat ventre à quelques mètres des fils. A certain moment, nous
entendons la voix de trois sentinelles qui s'avancent vers nous. Immédiatement
nous cessons tout travail, et blottis dans notre trou, nous attendons qu'elles
soient passées. Mon ami, la tête dans mes jambes, reste calme, et moi de même.
Les Boches ne remarquent rien, et nous continuons jusqu'au moment où nous
trouvons que la fosse est assez profonde pour pouvoir passer sans toucher le
fil. Mes deux camarades passent. Je les suis. Nous sommes en Hollande ! Nous
sommes sauvés ! Fous de joie, nous nous serrons la main tout en courant. Mais
bientôt nous voici arrêtés par une rivière que nous passons à gué, et cinq
mètres plus loin, par une nouvelle barrière de fils électrisés. Nous n'étions
donc pas en Hollande. Il faut passer. A quelques pas de nous se dresse un arbre
assez mince et à moitié mort. Nous le cassons, et après de nombreuses
difficultés nous réussissons à passer de l'autre côté. » Les péripéties ne sont pas finies. Une
troisième barrière de fils se dresse à une heure de là. En réalité les évadés
avaient dû faire fausse route et revenir sur leurs pas sans s'en apercevoir. Au
moyen d'une perche, les deux amis du narrateur parviennent à franchir
l'obstacle, mais ce dernier risque d'y rester: « En mettant le pied sur
l'avant-dernière rangée, je sens que je perds l'équilibre. Je n'ai pas le temps
de recommencer. Je prends le meilleur élan possible et je me jette au-dessus
des fils. Je suis arrêté par le dernier fil et je tombe brusquement entre les
deux dernières rangées. En rampant je passe la dernière, et au moment où je
veux me lever, je tombe de tout mon long sur le champ labouré. Ma jambe gauche
est paralysée. En courant comme un chien à trois pattes, je rejoins mes
camarades qui m'aident à marcher. Nous étions sauvés, mais pour de bon cette
fois ! » D'autres imaginent des moyens de passer
la frontière qui rappellent les contes dont on berce l'enfance, et qui pourtant
sont authentiques : celui-ci par exemple. (Seul du village, je connaissais une carrière
formant tunnel souterrain et qui aboutissait en Hollande. L'entrée de la
caverne se trouvait à environ 200 mètres de la frontière, dans un petit bois ;
la sortie se trouvait en territoire hollandais. « Je conduisais les hommes dans
un café et les y faisais attendre jusqu'au soir. A la nuit tombante, je les
réunissais. Avec de grandes précautions et dans le plus grand silence, je les
conduisais jusqu'à l'entrée de la caverne. Une fois l'entrée atteinte, le
danger n'existait plus. La première fois, j'en ai passé cinquante-neuf. »
Figurons-nous ce cortège, défilant dans les ténèbres, au milieu du bois, et
gagnant en silence la caverne ; puis s'engageant dans ce long couloir
souterrain au bout duquel était le salut. C'est une scène de Gil Blas ou d'Ali Baba, et un beau sujet d'eau-forte. Mais
c'est surtout un témoignage pathétique de la condition où sont réduits les
Belges. Cette caverne ne tarda pas à être
découverte. Un mois environ après le premier passage, les Allemands la
trouvèrent, et l'entrée en fut obstruée. Le narrateur parvint cependant à
s'échapper lui-même. Beaucoup, inventant un autre stratagème,
sont arrivés près de la frontière dans une charrette à porcs, entassés dans ce
véhicule fermé et tout heureux d'être pris pour les animaux qu'ils remplaçaient
ou qu'ils accompagnaient. Voici par exemple une douzaine de jeunes
gens qui sont parqués dans une carriole de cette espèce. Le conducteur fouette
son cheval, et en route pour la frontière. Dans certains villages, dit un des
évadés, où notre carriole était arrêtée, à la demande du Boche : « Qu'avez-vous
là-dedans ? » le cocher répondait invariablement : « Des cochons », et il avait
l'autorisation de transporter les cochons pour les revendre aux environs de la
frontière. » Il ne faut surtout pas manquer d'adresse
dans certaines circonstances qui n'étaient pas prévues au programme.
Quelques-uns voient, en effet, leur tentative se compliquer de péripéties
imprévues. Un groupe était arrivé aux environs de la fameuse barrière de fils
de fer qui ferme le dernier cercle de l'Enfer. Entre cette barrière et la
frontière proprement dite, il y a encore une zone découverte de quelques
kilomètres à travers laquelle la poursuite par les sentinelles ou leurs coups
de feu sont possibles. Nos amis s'étaient couchés dans une prairie, attendant
le moment propice. Il était 11 heures du soir. Une demi-heure s'était passée
dans le calme, et ils allaient commencer leurs opérations, quand un officier
allemand du poste voisin, voulant vérifier les fils, s'en approcha imprudemment
et tomba électrocuté. Aussitôt ce fut un grand branle-bas dans tous les postes.
Se doutant que les médecins et d'autres officiers allaient arriver d'urgence,
nos compatriotes se glissèrent à travers la prairie et s'enfuirent. L'un d'eux
nous dit : « Nous n'avions pas fait dix pas sur la route qu'en effet nous
voyions déboucher tout contre nous l'auto amenant les officiers boches. Nous
avons eu juste le temps de nous laisser tomber au bord de la route, et ils ne
nous ont pas vus. » Quelques jours après, ils recommencèrent. Ils furent
récompensés de leur persévérance, car cette fois, ils passèrent, mais non sans
un dernier incident : « Nous franchissons les fils, mais malheureusement
un de nous avait fait du bruit. L'effet ne se fait pas attendre. Je passais le
dernier fil, quand je vois un Boche déboucher à côté de moi et me crier :
« Halt ! » il était à 2 mètres de moi. J'ai
néanmoins continué ma route au triple galop ; j'ai rejoint les autres ; nous
avons sauté deux ou trois haies : puis nous nous arrêtons ; nous nous étions
perdus, nous ne savions plus quelle voie prendre. Nous n'avons pas hésité longtemps.
Nous étions à peine depuis une minute dans cette prairie entourée
de haies, quand nous entendons qu'on nous poursuit. Nous reprenons notre galop,
et heureusement nous retombons par hasard sur la route que nous devions
prendre. Nous continuons à courir, cette fois-ci, sur un sentier et dans la
bonne direction, quand soudain nous tombons nez à nez avec une sentinelle. » Ce
soldat qui montait la garde dans les ténèbres, est épouvanté de voir surgir
tout à coup un groupe d'hommes à ses côtés. Il croit qu'on va l'égorger et se
met à détaler comme un chevreuil avec les Belges à ses trousses. Nous croyons
volontiers le narrateur quand il conclut : « Ce fut avec un immense plaisir
que, vers une heure du matin, nous arrivons à la borne frontière. » S'il y a des alertes périlleuses comme
celle-ci, il y a aussi des scènes amusantes. Trois jeunes compagnons wallons
étaient arrivés à peu de distance de la frontière, mais il leur restait un
dangereux bout de chemin à parcourir. Se garant des sentinelles allemandes, ils
se croyaient près du but, quand, au sortir d'un bois, ils se trouvent en
présence d'un officier prussien. Ils se jugèrent perdus, d'autant plus que
l'officier les aborda. « Vous allez au travail, mes amis ?
- Oui, capitaine. - Vous connaissez bien le
pays alors ? - Parbleu ! - Voulez-vous m'indiquer le
chemin pour aller à X ... ? - Vous devez faire un bout de
route avec nous. Venez par ici. » Ils cheminent ensemble. On passe ainsi
devant une patrouille qui salue respectueusement, puis on se débarrasse de
l'officier en lui indiquant un sentier dans les champs. Voici la suite : « Nous
étions munis d'une pelle que nous avions pu nous procurer au village ; alors
motte par motte, nous avons pu creuser un renfoncement sous les fils et enfin
nous y faufiler. Nous étions en Hollande. » Ce n'est pas la seule fois qu'un
officier allemand ait été berné par nos jeunes amis. Un adolescent résolu joua
un autre tour à l'un d'eux. Il nous en fait lui-même le récit : « Une
sentinelle allemande que je n'avais pas remarquée, me demanda mes passeports.
Je n'en avais pas évidemment. Elle me conduisit au poste et me commanda
d'attendre l'officier. Celui-ci me demande où j'habite. » La question
était d'autant plus embarrassante que notre ami se trouvait loin de chez lui,
dans une ville où il était inconnu. Il donne au hasard un nom et une adresse,
proposant d'y retourner sur-le-champ pour y chercher son passeport. « La ruse,
dit-il, ne réussit pas, et l'officier me pria de l'accompagner jusqu'à
l'adresse indiquée. Je m'efforçai de faire bonne contenance et arrivai à la
maison indiquée. Je sonnai comme si j'étais chez moi, je priai l'officier d’entrer
et de m'attendre, le temps de monter dans ma chambre ; puis je pris un corridor
perpendiculaire à celui de l'entrée, et j'ordonnai à la servante qui me suivait
fortement étonnée, de m'indiquer une issue. Après quelques difficultés, elle y
consentit, et je pus de la sorte gagner la campagne par des chemins écartés. »
Celui-là aussi est arrivé sain et sauf en Hollande. Il le méritait bien pour
avoir fait faire le pied de grue à un officier allemand, d'une façon aussi
originale. Les déguisements sont habituels parmi
les évadés, et demandent aussi une bonne dose d'habileté pour soutenir le rôle.
Plusieurs disent : « Je m'étais habillé en fraudeur et je portais un sac sur le
dos ». Il faut savoir qu'entre l'Allemagne et la Hollande, les fraudeurs ne
sont pas nécessairement antipathiques aux sentinelles allemandes à qui ils
rapportent souvent du lard et du pain de Hollande. On appelle ces fraudeurs des
« puddings », et c'est, pour un évadé, un avantage évident d'être pris pour
l'un d'eux. Cet avantage échut à un de nos compatriotes qui nous raconte son
aventure. Il était arrivé près des fils avec un de ses compagnons qui parlait bien
l'allemand, quand ils se trouvent en présence d'un soldat : « Halt !
» crie la sentinelle. L'un des Belges va droit à elle et lui
dit « N'avez-vous pas vu un homme avec un
sac ? » L'Allemand, croyant avoir affaire à des
fraudeurs, répond : - Non, mais passez votre
chemin, car il est défendu de parler aux sentinelles. » « Nous ne demandions pas mieux que de «
passer notre chemin », raconte le narrateur. Nous traversons un petit pont, et
quand l'Allemand a le dos tourné, je me jette à plat ventre, et je franchis la
clôture. Mon compagnon fait de même. Nous sommes en Hollande. » Parfois les chefs de groupes ont inventé
des signaux et des avertissements d'alerte qui rappellent les romans
d'aventures. Un groupe attend au bord d'un canal pour le passer vers la
frontière. « Tout à coup nous entendons un cri de hibou. C'est un signal
convenu, en cas d'alerte. Tout le monde se tapit dans les roseaux. On entend
dans le lointain un bruit de moteur. Bientôt apparaît un canot automobile qui,
feux éteints, patrouille sur le canal. » Le canot passé, on se jette doucement à
l'eau et l'on franchit ce mauvais pas. L'esprit doit être fertile en inventions
instantanées. Un évadé est arrivé en bon port jusqu'à un village voisin de la
frontière mais il faut sortir de la gare du chemin de fer, et on va lui
demander ses papiers qu'il n'a naturellement pas. Heureusement, il parle bien
l'allemand, et il a fait la connaissance, en route, d'une Allemande qui
voyageait dans le même compartiment. Elle l'a pris pour un compatriote ; on a
causé de la dureté des temps, de la vie du soldat. Notre homme a inventé les
plus sublimes histoires. Bref, arrivés à destination, il semble qu'on se
connaît depuis dix ans. Au sortir du train, l'évadé s'empresse auprès de sa
compagne de voyage, il se charge de tous les colis, il l'accompagne
obligeamment vers la sortie de la gare. L'employé se fait montrer les papiers
de la dame, qui sont parfaitement en règle, et voyant le porteur écrasé sous
une montagne de colis, lui demande s'il est avec elle. Tous deux répondent
affirmativement, et l'Allemand dit à notre compatriote : « Passez, inutile
de montrer vos papiers. » Cette même nuit, il escaladait les fils à la
frontière. Un autre, arrêté par une sentinelle,
près des fils, lui tend sa carte d'identité, l'assomme à moitié d'un coup de
poing accompagné d'un coup de tête dans la poitrine, puis passe la frontière au
milieu d'une grêle de balles des postes voisins. IV LES DANGERS COURUS Ces dangers sont de tous les instants et
de cent natures diverses. Nos compatriotes en donnent par leurs récits une idée
très frappante. Quelques-uns les ont même indiqués en raccourci. L'un des évadés qui indique, heure par
heure, le détail des périls courus et des épreuves subies par trois compagnons
pendant les onze jours de leur tentative réussie, nous permet de noter les
principales causes de danger et d'angoisse. Le sommeil dans des prairies
humides où l’on est harcelé par les moustiques ; le passage d'une rivière avec
de l'eau jusqu'aux épaules ; la soif que nos amis étanchent « à l'aide
d'un fétu de paille, en essayant d'absorber les quelques gouttes d'eau que la
pluie a amenées sur les tiges de blé » ; des alertes continuelles causées par
des patrouilles allemandes ; le passage d'un fleuve à la nage, en aidant au
moyen d'une corde ceux qui ne savent pas nager; l'orientation incertaine qui
entraîne des méprises et des pertes de temps; le défaut de nourriture, car les
provisions sont vite épuisées; et l'on n'ose s'adresser aux maisons, de peur de
tomber sur des Allemands ; on mange des pommes de terre crues et du blé ; enfin
le danger d'être vu par des sentinelles allemandes, en rampant vers les fils de
la frontière. Tout cela concerne en somme les
préliminaires de l'acte décisif qui est le passage des fils. Mais, comme le dit
un jeune Belge débrouillard et intelligent qui a réussi à passer, en 1917 : «
En résumé, la grande difficulté reste, malgré la diminution sensible des gardes
allemandes, de gagner la zone frontière. Il suffit qu'un Allemand rencontré
vous demande vos papiers, pour mettre à néant la préparation la plus sérieuse.
Pour arriver, il faut encore en plus une grande dose de chance. » C'est donc presque toujours le principal
que d'arriver aux fils, mais ce n'est pas tout. Là commence le danger immédiat.
L'un des évadés explique très bien en quoi il consiste, en indiquant avec
précision comment sont disposés les obstacles : « La frontière hollando-belge est défendue
sur toute sa longueur par une triple haie de fils barbelés et électrisés.
Au-dessus du dernier fil électrisé se trouve un fil-sonnerie prévenant le poste
allemand au moindre toucher. En plus de ces triples haies métalliques, l'ennemi
pose encore de nombreuses sentinelles espacées à une cinquantaine de mètres.
Dans l'eau même, la Meuse par exemple, les mêmes haies de fils se trouvent
placées sous l'eau et jusqu'à environ 75 centimètres au-dessus. » Un autre donne des détails sur chaque
clôture : « D'abord une rangée de fils, simple barrière de deux mètres de
hauteur. Un mètre cinquante plus loin, la rangée de fils électrisés, et à un
mètre cinquante de là, une troisième rangée semblable à la première. » Au delà
il y a encore, suivant la nature du terrain, des obstacles naturels, comme une
rivière, des marais, des haies d'épines. C'est bien le cas de répéter avec Gauchez dans Les
Rafales : « Ils ont barré de fils, de fils pointus de fer, Telle est la disposition des lieux. Les
dangers sont donc semés sur les pas des jeunes patriotes, d'abord pour arriver
jusqu'à la frontière, et ensuite à la frontière même. Dans le premier cas, quelles angoisses
sous une apparence tranquille, quand on n'a pas son passeport en règle et
qu'une autorité de police survient ! Tel ce Wallon qui n'avait aucun permis et
qui fuyait vers la frontière. « J'étais en tram. Un Boche s'amène et dit de sa
voix gutturale : « Les passeports ! » Cette fois, je me croyais coffré. Je tâche à m'esquiver par l'autre porte. Un autre
Boche s'amène. Pendant qu'ils inspectaient les passeports, je sors du tram et
tente de m'esquiver. Mais hélas ! une vingtaine
d'Allemands entouraient la voiture. » Notre compatriote se croit perdu. Il
rentre dans le tramway et met sur ses genoux son pain qu'il portait avec lui.
Quand l'inspecteur arrive à lui et lui demande ses papiers, il fait semblant
d'être empêché par ce pain, et pendant qu'il fait mille efforts pour atteindre
son portefeuille, l'Allemand prend le pain, le lui met sous son manteau en
disant : « Bien ! bien ! » et il passe. Mais tous n'ont pas la même chance. Tel
ce Flamand tenace qui finit cependant par réussir, mais nous raconte une
aventure où il aurait pu laisser sa vie : « En cours de route, à moitié chemin,
nous entendons soudainement parler et remarquons une patrouille qui nous
interpelle. Nous nous enfuyons dans toutes les directions sans répondre. La
patrouille tira 7 coups de feu mais heureusement personne ne fut
atteint. » Ou encore cette bande dont un de nos
amis nous raconte l'aventure : « Soudain nous apercevons une patrouille
de deux soldats et aussitôt deux coups de feu partent ; deux autres patrouilles
et le poste viennent appuyer la première et nous envoient une quarantaine de
balles dont plusieurs ont sifflé à nos oreilles. Nous avions eu l'heureuse
idée, après les premiers coups, de nous séparer et de nous distancer d'une
dizaine de mètres ; de cette manière les balles ne nous atteignirent pas. » Même parmi ceux qui ont enfin réussi,
après mille difficultés, à arriver en vue des fils, il y en a qui sont
poursuivis par une fatalité terrible. Écoutez cette suite de drames
épouvantables : L'un des évadés nous raconte que son père a été tué par les
Allemands. Sa mère, folle de douleur, est morte quelques jours plus tard. Son
frère avait été fusillé, lors de l'invasion, en 1914. Sa femme, déportée en Allemagne,
est morte dans un camp de concentration. Sa petite fille de onze ans est
toujours prisonnière en Allemagne, il ne sait où. Lui même, emprisonné pour
avoir refusé de signer l'engagement de ne jamais prendre les armes contre les
Allemands, s'enfuit, gagna la frontière. Voici comme il raconte la chose : «
Enfin je touchais à la frontière hollandaise et je croyais la franchir sans
encombre, quand je reçus d'une sentinelle un coup de feu dans la poitrine et un
autre dans le ventre. Il était environ 5 heures 30 du soir. C'est un Belge, un
noble cœur qui malheureusement m'est resté inconnu, qui vint, la nuit, me
ramasser et me transporter chez de braves Hollandais qui m'ont soigné. Ma
convalescence s'est passée en Angleterre. L'altération de ma santé m'a obligé à
différer de quelques mois la date de mon engagement dans l'armée belge. » Qui pourrait se défendre d'émotion en
lisant ces quelques lignes si simples dans le pathétique ? Voici un autre exemple d'accident
malencontreux : « La nuit était noire. Nous sortons du
champ ; mais en descendant le talus, un de mes compagnons tombe sur la voie du
tramway et se démet l'épaule. Malgré ses souffrances, il ne voulut pas
abandonner la partie. Malheureusement son courage fut inutile, car en arrivant
à proximité de la frontière, des signaux lumineux firent comprendre à notre
guide qu'il était impossible de passer. » Ce n’est pas seulement la nature, les
obstacles accumulés et les sentinelles allemandes qu'il faut craindre, mais la
délation des Allemands qui rôdent tout le temps, en espionnant, aux environs de
la frontière. Un évadé nous conte son expérience en ce point : « Nous décidons d'attendre la nuit et
nous rentrons dans le bois tout le jour, à la pluie, tout mouillés et raidis
par le froid, quand, vers 4 heures de l'après-midi, un paysan allemand arrive
dans le bois, nous aperçoit et va nous dénoncer au poste boche. Il fallait
absolument passer ou nous étions pris dans le bois. » Après des péripéties et des alertes, ils
arrivent à quatre aux derniers obstacles : une barrière de fils barbelés de 3
mètres de hauteur. « Un civil boche nous suivait pour voir si vraiment
nous allions travailler en Allemagne. A peine avons-nous dépassé le poste de garde
de 200 mètres, que nous nous jetons dans les fils barbelés. Alors le civil est
accouru, a retiré mon frère et mes deux amis hors des fils, où ils étaient
empêtrés, et moi seul suis parvenu à me tirer à travers tout, déchiré, mains,
figure, costume. Le poste accouru aux appels du civil boche les fait tous les
trois prisonniers. On les a emmenés en Allemagne. Pour moi, j'étais sauvé en
Hollande. » Comme tous les mouvements se font dans
une obscurité complète, il arrive qu'on se heurte à l'imprévu. Tel cet évadé
qui rampait dans les ténèbres vers le fil fatidique, quand il dégringola dans
un fossé profond de 3 à 4 mètres. Heureusement il ne se blessa point et parvint
à la barrière. Ses compagnons le laissèrent passer le premier. Ils étaient trois
; tous eurent tant de chance qu'ils franchirent au moyen d'une échelle les
obstacles de la frontière, et arrivèrent en Hollande, sans avoir essuyé un seul
coup de feu. Il fut plus heureux qu'un autre dont un
compagnon dit le malheur dans un style de procès-verbal : « Au cours de cette
opération périlleuse, un des fuyards a été électrocuté. » Ces malheurs, hélas ! ne
sont pas rares. En voici encore un exemple : Un Belge dévoué et débrouillard, traqué
par la police allemande pour actes de patriotisme, menacé de douze ans de
travaux forcés, décide de passer en Hollande, avec une dizaine de compagnons.
« Vers 10 heures du soir, dit-il, nous nous mettons en route pour
l'endroit où nous devons franchir les fils électrisés, munis d'une échelle
spécialement arrangée à cet usage. Six jeunes gens réussissent à passer.
Malheureusement les sentinelles allemandes avaient aperçu l'escalade et
déchargèrent quatre coups de feu. Une balle avait touché l'échelle ; celui qui
était au haut de l'échelle tomba sur un de ses
camarades; ils restèrent tous deux inanimés sur le sol ; ils furent faits
prisonniers et conduits à la Kommandantur porteurs de l'échelle. Le reste prit
la fuite pour se cacher dans les bois. Nous y restâmes toute la journée du 21
pour recommencer la nuit suivante. Entre temps il fallait refaire une nouvelle
échelle. Vers 10 heures du soir, nous partons pour un autre endroit et
attendons jusqu'à deux heures du matin, à 50 mètres des fils, le moment propice
pour risquer le passage. Inutile ; les postes sont doublés et les sentinelles
rapprochées ; les projecteurs travaillent. Nous devons donc renoncer à la
tentative. » 
L'échelle...(Sterken, 1952) (photo Prof. Dr A. Vanneste) Cependant notre ami ne se décourage pas.
Il réussit à se procurer des cisailles et des gants en caoutchouc, instruments
qui constituent, comme nous l'avons déjà vu, une aide précieuse pour passer la
barrière. Par une nuit profondément, obscure, il recommence sa tentative avec
ses compagnons. Profitant d'un changement de sentinelles, ils parviennent à
s'approcher des fils et à les couper, puis, se glissant dans les herbes, ils
arrivent enfin en Hollande. Combien moins favorisés restent en route
! Vingt-quatre jeunes gens avaient réussi à arriver sans encombre dans les
environs de la frontière. L'un raconte : « Tout avait bien marché jusque-là.
Malheureusement, en passant près d'une ferme, un chien s'est mis à aboyer, et
cela a attiré sur nous une patrouille allemande. Cette fois, nous fûmes
aperçus, et nous avons dû essuyer le feu d'une douzaine de fusils. Il en est
résulté un sauve-qui-peut général. » Le narrateur est parvenu malgré tout à
franchir la frontière. Mais il ajoute mélancoliquement: « Nous ne nous sommes
retrouvés que dix-sept. Nous avons vainement attendu les manquants toute la
nuit. » Parfois, dans ces récits, le malheureux
qui se débat contre les circonstances défavorables et les hommes embusqués pour
le saisir, fait l'effet du gibier traqué de toutes parts, et courant de ci de
là vers les fusils qui l'attendent. Cette impression, on la ressent surtout en
lisant le récit d'un jeune Wallon qui, passé sans encombre en Prusse, fut
trompé par un guide, au moment de franchir la frontière hollandaise, et se
trouva seul en face de l'inconnu. « Nous étions au haut d'une colline. Sur le
versant de la colline voisine passait la route hollandaise où la sentinelle
neutre faisait les cent pas. « Filez, me dit le « guide, vite, rien ne vous en
empêche. Voilà « la Hollande. » J'hésitai ; puis enfin, prenant mon élan,
je me jetai dans la prairie, sautai une haie... et vins tomber de l'autre côté
dans les bras d'une sentinelle boche postée devant un fil de fer barbelé de 2
mètres de hauteur garni de treillis sur toute sa surface. » Le soldat le
retient et appelle un lieutenant. Heureusement notre homme connaît très bien la
langue allemande. Il invente une histoire; il voulait aller chercher un pain
blanc au village hollandais voisin. On le relègue, en attendant une décision
sur son sort, dans la guérite de la sentinelle. Au bout d'une demi-heure, il
profite d'un moment d'inattention du soldat, lui jette 15 marks pour qu'il
s'abstienne de tirer, et se met à fuir de toute la vitesse de ses jambes par un
chemin de traverse vers la grande route. De là il se précipite dans un bois, il
fait mille détours, repasse dans un champ, perd complètement la notion des
lieux, traverse un marais, se cache au passage d'une sentinelle allemande. Il
lève les yeux : « Là-haut, sur la colline, deux adolescents s'amusaient...
» Là-haut, c'était la Hollande, la liberté. Dans ce moment d'angoisse où cet
homme lutte pour conserver la vie, son regard se porte sur ces deux adolescents
qui jouent tranquillement, sans se douter qu'un drame se déroule si près d'eux.
Puis profitant d'une minute d'inattention des sentinelles, l'évadé saute la
barrière, s'enfuit, court aux enfants et s'informe. Il est en territoire
neutre. Il est sauvé. D'autres réussissent du premier coup,
mais non sans danger. Ils étaient quatre jeunes Wallons
blottis à plat ventre dans les herbes à quelques mètres des fils, et attendant
le passage des sentinelles pour franchir la barrière. « A ce moment, dit
l'un d'eux, la sentinelle remonta de notre côté, en même temps qu'une autre
venait du poste. Les deux Boches s'arrêtent juste devant nous, à cinq mètres,
et commencent à parler, la face tournée vers nous. Nous, nous restions aplatis
sur le sol, retenant notre respiration. Enfin, après cinq minutes d'angoisse
terrible, ils s'échangent et tout redevient calme. Immédiatement nous
approchons des fils. Un de mes camarades se met un genou en terre et doucement
fait glisser les mâchoires de sa pince sur le premier fil du dessous et le
coupe d'un coup sec. Au même instant, le cri de « Halt
! » retentit, et tout le poste accourt sur nous en hurlant comme des
bêtes. Nous coupons immédiatement un deuxième fil, et n'ayant pas le temps de
continuer, nous passons à plat ventre tous quatre sans accident, et après avoir
reçu de terribles commotions dans les flammes des fils qui brillaient toujours.
« Après quoi, nous franchissons une
haie, et nous courons droit devant nous. Les Boches nous envoient une fusillade
d'ailleurs inutile, car dix minutes après, nous étions bien reçus en
Hollande. » D'autres encore échappent comme par
miracle à un péril imminent. « Il y avait clair de lune et de la neige, dit
l'un d'eux. Nous étions tapis dans l'ombre d'une haie, quand, à moins de trente
mètres de nous, un officier allemand passe accompagner d'un chien policier. Le
chien se dirige de notre côté. Heureusement l'officier allemand siffle pour le
rappeler, et l'animal obéissant retourne près de lui. Bienheureuse
docilité » ! Parfois ils sont soumis à des brutalités
que leur font subir les patrouilles par lesquelles ils sont arrêtés. Un
ouvrier, qui cherchait à s'évader, est surpris au moment où il se dirigeait
vers la Hollande. « J'aperçus une patrouille de uhlans qui venaient à ma
rencontre et arrivés près de moi, me demandèrent ce que je faisais là. Je
répondis que je me promenais ; puis l'un d'eux me demanda ma carte d'identité
et ce qu'il y avait dans le paquet que je portais. Je leur donnai ma carte et
leur fis signe que, dans mon paquet, il y avait de l'herbe. L'un d'eux me dit :
Kommandantur ! Je regardai autour de moi pour déguerpir, mais ils me firent
mettre entre leurs chevaux, et je dus me contenter de les suivre. Ayant fait à
peu près une cinquantaine de mètres, celui qui avait pris ma carte me demanda
mon paquet, et l'ayant soupesé, me le rejeta comme on jette un os à un chien,
et je dus le ramasser et les suivre. » Il est mené dans un poste, et
condamné à être emprisonné en Allemagne, où il est emmené dans un long et
fatigant voyage. Le récit de son premier interrogatoire en terre allemande est
fait avec une ingénuité pleine de bonhomie. « On me conduisit dans un
bureau. Là je me trouvai en face de deux Boches à haute moustache. Je me
croyais devant le Kaiser, mais par bonheur ce n'était pas lui, car au lieu
d'être à Berlin, j'étais seulement à Düsseldorf, et le bureau où j'étais en ce
moment était le bureau de police. Souvent l'on me posait des questions, et moi
ne pouvant répondre puisque je n'y comprenais rien, celui qui lisait faisait
relever ses moustaches en grinçant des dents et me regardait, croyant me faire
peur, mais je ne bougeais pas et me plaisais à le regarder, franchement dans
les yeux. » Le malheureux est mis au cachot « où j'y ai resté un temps si
long que je croyais y avoir resté un an, et il y avait à peu près trois ou
quatre mois que je m'y trouvais. » Après quoi on le força à travailler dans une
usine. Voici quel était le menu des ouvriers déportés : « le matin, j'avais du
pain et de l'eau, à midi un peu de soupe et un petit morceau de viande, et le
soir, de nouveau du pain et de l'eau. » Un soir, il s'enfuit et parvient à la
frontière hollandaise. Trompant la vigilance des sentinelles, il rampe, passe
les fils et les haies, rampe encore dans les herbes, et tout à coup voit
arriver deux soldats dans sa direction. Je voulus m'enfuir ; mais j'entendis
crier : « halte ! » et je m'arrêtai. Comment dire mon émotion, quand j'ai vu
que je n'étais pas en face de Boches, mais bien en face de soldats hollandais !
Mes malheurs avaient pris fin, j'étais libre ! Ce qui est admirable, c'est la constance
de la volonté au milieu de ces dangers. Un jeune homme qui est resté deux ans
et demi en captivité en Allemagne pour avoir tenté de s'évader une première
fois, nous dit : « Moi et mes compatriotes fûmes cernés par des soldats
allemands qui tirèrent sur nous sans pitié, et en tuèrent beaucoup. » Il
tente une seconde fois l'évasion, et est de nouveau arrêté et emprisonné par
une patrouille allemande. Enfin, sans se décourager, il recommence une troisième
fois et parvient à franchir le fameux passage. L'effort de volonté doit atteindre son
point culminant pour ceux qui n'ont pas eu recours à un guide, au moment où ils
arrivent aux fils. Presque toujours, la sentinelle entend du bruit. Alors une
fusillade éclate. Les évadés répondent parfois par des coups de revolver ou de
couteau. Ce sont de vraies escarmouches dans lesquelles les morts ne sont pas
rares. L'exemple suivant nous est raconté par un témoin, acteur de la scène : Un groupe, à l'approche de la frontière,
est suivi par un policier allemand accompagné d'un chien. Arrivés à un endroit
sauvage, nos compatriotes l'attendent. Il interroge, personne ne répond. Alors
il se met à tirer des coups de revolver et à faire des signaux avec sa lampe.
Des lumières apparaissent dans la plaine. Encore quelques minutes et nos évadés
seront perdus. L'un d'eux se jette sur le policier allemand et lui plonge son
couteau dans la poitrine. Une lutte féroce s'engage ; les deux hommes roulent à
terre enlacés. Le Belge se relève et fuit avec ses amis ; mais le blessé se
redresse, tire un coup de revolver sur son agresseur et lui perce la cuisse
d'une balle. Clopin-clopant, ce dernier parvient à s'échapper, soutenu par ses
compagnons, et il arrive enfin en Hollande. Les habitants du voisinage de la
frontière, entendant presque chaque nuit des fracas de batailles, soumis
continuellement à des interrogatoires par les Allemands, sollicités par les
uns, soupçonnés par les autres, parfois arrêtés, emprisonnés, vivent sous une
impression de terreur, avec l'image toujours présente des fureurs germaniques.
Quelques-uns, plus nombreux qu'on ne pourrait croire, ont secoué cette
impression et font preuve d'un courage inébranlable. Un des évadés peint bien cette
situation et ses résultats. « Là, dit-il, grand étonnement, à me
voir, des habitants d'une petite ferme à l'entrée du village, me prenant pour
un Deutsch, mais après quelques paroles familières, ces gens reprirent
confiance, et après m'avoir offert à boire, la mort dans l'âme, la terreur sur
le visage, ils me .montrèrent de derrière les rideaux, le chemin à suivre, avec
force recommandations et exemples des cruautés boches. Enfin tout cela me
disait clairement que c'était le règne de la terreur. » Continuant son chemin,
ce bon patriote remarque dans tous les villages voisins de la frontière, la
même impression. Heureusement il a l'idée de s'adresser au curé. « Arrivé à la
demeure du curé, je poussai la grille et me glissai dans le jardin sans être
aperçu. Une courte entrevue avec ce vénérable prêtre que je n'admirerai jamais
assez pour sa loyauté et son patriotisme sincère, et je fus chez moi,
complètement chez moi ! La servante reçut des ordres, et M. le curé lui-même
aidé par la demoiselle sa sœur, me prodiguait tous les soins possibles. Il me
fit prendre place près d'un bon feu, me fit enlever mes bottines et m'offrit
ses pantoufles bien chaudes. Après, ce fut un copieux repas, cependant que je
lui parlais de ses amis et connaissances, et il pleurait de joie, le pauvre
brave ! » Les périls et les angoisses qui
assiègent ceux qui s'en vont vers la barrière de fils au delà de laquelle la
liberté les accueille, ne manquent pas non plus aux jeunes évadés qui ont
choisi pour passer la frontière, le moyen des chalands au fond de quoi ils se
sont cachés. A première vue, il semblerait que les dangers sont moindres, mais
en réalité ils sont au moins égaux. Enfoncés dans le charbon des cales, sous
le plancher des chalands, ils sont serrés les uns contre les autres, pouvant à
peine dormir, la nuit, et restant dans cette position soixante-douze heures
parfois. Les patrouilles allemandes font des visites à bord, et alors il s'y
passe des scènes comme celle-ci : « Six Allemands vinrent visiter le bateau. A
ce moment notre cachette était complètement fermée; nous suffoquions. A travers
les fentes du plancher, nous voyions les soldats ennemis ; ils étaient
accompagnés de deux chiens policiers. Les Boches trouvant leur examen
insuffisant, usèrent d'un autre moyen : ils injectèrent du formol. Nous étions
prévenus ; nous nous couvrîmes la bouche et le nez et pûmes à grand' peine nous
passer d'éternuer et de tousser. Enfin, après être restés là une heure, ils
commencèrent à sonder le bateau. Les pointes arrivèrent dans notre cachette, et
l'un de nous eut juste le temps de se retirer pour ne pas recevoir une blessure
dans le dos. » C'était heureusement la dernière épreuve, et ces vaillants
furent sauvés. Celui qui va nous raconter son aventure,
le fut aussi. Il était caché dans une sorte de double fond du chaland. « Il ne
restait plus, dit-il, qu'à passer l'inspection des gardes frontières. Là encore
une surprise nous était réservée. » « Les Allemands, en pénétrant dans la
cabine, avaient perçu un léger bruit. Ils eurent des soupçons, mais ne trouvant
aucune ouverture praticable, ils ne virent rien de mieux que d'enfoncer leurs
baïonnettes dans une fente de la cloison de bois qui nous protégeait.
Heureusement, par la même fente, nous avions aperçu leur mouvement. Ils ne
rencontrèrent que le vide. Au moment propice, je m'étais doucement aplati
contre le fond de la cachette. Là-dessus les Allemands reprirent confiance, et
continuant leurs investigations ailleurs, ils nous quittèrent. Vers les 11
heures, le bateau se remit en marche, et quelques minutes plus tard, nous
étions en Hollande. » Un autre s'était blotti trop près de la
chaudière. Il dit : « Après la visite par un officier et sept soldats
allemands, le capitaine fut forcé de venir me retirer, car j'étais plus mort
que vif, tout à fait brûlé aux mains et à la figure. Il m'a fallu quelques
jours pour me rétablir ; mais que ne ferait-on pas pour sa chère patrie ? » Un jeune homme qui a pu rejoindre
l'armée belge par le même moyen, nous écrit : « L'émotion nous étreignait
lorsque les coups de sonde résonnaient à dix centimètres de nos têtes. Si cela
sonnait creux on ne respirait plus. Et quand les quelques rayons de lumière
qu'ils nous envoyaient nous parvinrent, angoissés, les yeux fixés comme ceux
d'une statue, vers le haut, nous nous attendions à voir apparaître une figure
grimaçante coiffée du casque à pointe. » Pour comble d'angoisse, ces malheureux,
après avoir passé des jours et des nuits dans cet état, font horreur à tout le
monde par leur apparence répugnante. L'un d'eux le dit simplement. Il était
resté soixante-douze heures dans cette cachette nauséabonde, avec 17
compagnons, et le voilà arrivé en Hollande. « Les gens, dit-il, à nous voir si dégoûtants
et si nombreux, n'osaient pas nous ouvrir. » Enfin ils trouvent abri dans une
grange : « C'était bon et doux, conclut-il, de dormir dans de la paille et
an bon air ! » V LA JOIE DE LA DÉLIVRANCE Les récits, les impressions, les lettres
que nous venons de dépouiller, nous emplissent de fierté pour les magnifiques
sentiments de courage, de résolution et d'amour patriotique dont ils
témoignent. Mais ils nous font aussi tressaillir
d'indignation en nous montrant l'extrémité où l'ennemi a réduit la Belgique.
Ils nous émeuvent sur le sort de tant de jeunes gens dont l'évasion eut une fin
tragique. Pour que le dernier chapitre de ce petit
livre laisse une impression de réconfort et de confiance, écoutons les accents
qu'ont su trouver tant d'ardents patriotes pour dire l'élan de leur joie, quand
ils ont été délivrés de leur cauchemar. En voici qui ont couru des dangers et
ont même vu un de leurs compagnons électrocuté en passant les fils. Puis ils se
sont perdus dans la nuit en pleins champs. Il est 3 heures du matin, un
brouillard épais les entoure. Où sont-ils ? Vont-ils se retrouver sous la dure
domination de l'ennemi, ou bien le jour leur apportera-t-il la fin de leurs
misères ? Tout à coup le carillon d'une ville hollandaise se fait entendre dans
la brume matinale. Ils se dirigent vers l'endroit d'où le son semble partir.
Comme un chant d'espérance les notes agiles guident leurs pas vers le salut, et
l'aube, en colorant le ciel, leur découvre les toits, les flèches et les
clochers de la cité qui les accueille. « Oh ! s'écrie l'un d'eux, je ne
sais pas quel sentiment j'éprouvai en cette minute où toutes nos fatigues et
nos heures tragiques n'étaient plus que des souvenirs. » Un autre nous envoie ce joli récit du
moment où il a su qu'il était sauvé : « A 4 heures 30 du matin, nous
rencontrons deux ouvriers qui vont au travail. Je leur demande où nous sommes.
Ils sont tout étonnés de la question. Vous êtes en Hollande, nous disent-ils.
Alors je m'élance dans les bras de mes compagnons. Nous nous embrassons comme
des enfants. Fous de joie. Les ouvriers m'offrent leurs tartines. Oh ! les bons cœurs, je ne les oublierai jamais. Ils font
demi-tour et nous voilà partis chez leurs parents. Quel accueil impossible à
décrire ! Je me croyais au milieu de ma famille. Merci, braves gens, bons
cœurs. » Un jeune évadé dit avec un ardent
patriotisme : « Enfin nous arrivions en territoire hollandais, nous saluions la
liberté. Notre joie fut grande de pouvoir librement venir nous mettre à la
disposition de notre patrie et de notre Roi, et venger nos frères qui souffrent
du joug des barbares. » Celui-ci s'exprime de la même façon : «
Inutile de vous exprimer le contentement que j'éprouve d'avoir échappé à
l'oppresseur allemand et d'avoir pu me rendre utile à ma patrie dans la mesure
de mes moyens. » Et combien exhalent leur bonheur dans
des termes touchants ! On croirait voir des gens qui n'ont plus respiré de bon
air depuis des années, et qui, tout à coup, se trouvant dans une atmosphère
pure, aspirent la vie à pleins poumons. « Dire ce que nous avons éprouvé, quand
un Monsieur qui passait nous dit que nous étions en Hollande, serait chose
impossible. Nous étions libres, et notre rêve réalisé. » « Quelle joie de se savoir hors des
griffes des Boches, de pouvoir se sentir à nouveau libre ! » L'oppression a été si longue, les
dangers ont été si nombreux que beaucoup doutent encore de leur délivrance.
Tels ces deux évadés qui hésitent à croire qu'ils sont en pays indépendant. Ils
s'en allaient à tâtons dans la nuit, après le passage des fils. Tout à coup, dans
l'obscurité, ils vont se heurter à un soldat belge interné en Hollande
travaillant dans ces parages. La connaissance fut vite faite. Un autre, récapitulant les périls
courus, ajoute en conclusion : « Tout cela n'est rien quand on a réussi.
On oublie tout, et puis quelle joie d'être libre et de pouvoir rejoindre nos
soldats ! » Après des fatigues sans nombre, un très
jeune homme, les pieds en sang, parvient à passer. « Nous chantons, nous
dansons, nous ne sentons plus nos fatigues. Mes pieds me font horriblement
souffrir. Je suis moulu, car j'ai marché tout le temps en chaussons, et le pied
n'étant pas soutenu, est gonflé. La tête me tourne. Je voudrais rester là, mais
il faut continuer. Il fait un froid terrible. Enfin nous trouvons deux soldats
hollandais. Sous leur conduite, nous repartons après avoir reçu du thé et du
pain beurré. Ils ont été très accueillants. » Tous sont d'accord sur la cordialité de
l'accueil en Hollande. Les soldats de garde et les habitants rivalisent de
bienveillance. Puis l'immense satisfaction de ne plus sentir continuellement le
poids du joug sur les épaules, emplit tout à coup l'esprit de tous ces braves,
et ils dansent, ils rient, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre : « On s'embrasse de joie, dit un des
héros de l'aventure. Nous nous dirigeons vers un couvent. Il était 2 heures et
demie du matin. Nous réveillons les religieux. C'étaient des H. P. franciscains
qui nous reçurent admirablement. Ils nous réconfortèrent, nous logèrent et nous
offrirent le déjeuner et le dîner. » Dans son enthousiasme d'être hors des
griffes allemandes, le narrateur termine son récit par les cris de : « Vive la
Belgique, vive le Roi, vive l'armée ! » On ne pourrait mieux finir. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©