 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
L’aide précieuse
du médecin belge, le Dr Frère, à celui qui deviendra le général Giraud 
1) Comment le docteur Peters participa à
l’évasion du capitaine Giraud Laissé pour mort sur le champ de
bataille de Guise[1]
le 30 août 1914 à 15 heures, le capitaine Giraud du 4ème régiment de
zouaves, fut ramassé le lendemain matin par des brancardiers allemands qui le
transportèrent jusqu’à l’hôpital de campagne d’Origny-Sainte-Benoite tenu par
les Allemands mais où travaillaient des infirmières françaises. Pour rappel, la
bataille de Guise permit de protéger le flanc gauche de l’armée française lors
de la retraite de celle-ci vers la Marne. A l’hôpital, Henri Giraud a, comme
voisin de lit, le capitaine Schmitt, un autre compatriote victime de la
bataille. Ils sont soignés principalement par l’infirmière Mlle E. Lemaire,
fille du maire de la localité et dont ils admirent la douceur. Cette jeune
femme est tombée dans l’oubli aujourd’hui et aucun document sur le Web ne
permet de la remémorer. Seul le témoignage d’Henri Giraud paru dans son livre «
Mes évasions »[2]
témoigne de son existence. Henri souffre d’une pleurésie purulente conséquente
d’une balle ayant atteint le poumon et il lui faudra deux mois pour se
rétablir. Le 10 octobre, Mlle Lemaire vint signaler aux deux officiers que les
blessés militaires français seraient bientôt déportés en Allemagne. Giraud et
Schmitt résolurent alors de s’évader pour rejoindre la France libre.
L’intrépide infirmière les aida dans leur projet en leur apportant chaque jour
une pièce de vêtement civil qui devait leur permettre de passer inaperçu lors
de leur évasion. Les vêtements furent cachés entre paillasses et matelas. Le 31 octobre au soir, les deux hommes
sortent de leur chambre et descendent de leur étage vers la cuisine où une
porte donne à l’extérieur. Les deux hommes s’échappent sans encombre mais quand
le jour paraît, ils se sentent épuisés et cherchent un abri pour se cacher
durant le temps nécessaire à leur entier rétablissement. Ils le trouvent
d’abord dans une ferme où le propriétaire leur conseille vivement de se
réfugier à Saint-Quentin, ville où ils pourraient passer inaperçu au milieu de
tous les Belges qui s’y étaient réfugiés. Nos deux comparses, après une nuit
dans la grange, se mettent alors en route pour Saint-Quentin. Se faisant, ils
sont obligés de repasser par Origny où ils trouvent un abri chez Monsieur
Cléry, le marchand de grains qu’il connaissaient pour être l’époux d’une
infirmière de l’hôpital. Le marchand leur conseille de se recommander de lui
lorsqu’ils seront auprès du maire de Saint-Quentin. Arrivés auprès de lui, les
fugitifs reçoivent le conseil de loger dans le quartier de La Fère qui héberge
beaucoup de réfugiés belges dans ses nombreuses auberges. C’est dans une de
celles-ci, faisant aussi office de charcuterie, que les deux hommes, se
présentant comme réfugiés belges, trouvent une chambre de libre. Mme Venet, la
charcutière se chargea elle-même de déclarer à la mairie l’hébergement chez
elle de deux réfugiés belges. Nos deux fugitifs ne comptaient rester à
Saint-Quentin que quelques jours mais, finalement, ils y restèrent plus de deux
mois ! Henri devait en effet
patienter, le temps que sa plaie du dos, par où passait encore un drain, se
ferme entièrement. La patronne leur demanda cependant de travailler pour elle.
Henri aurait à s’occuper des chevaux et son collège Schmitt, de la porcherie.
Henri se rendit vite nécessaire car il avait l’expérience des chevaux. Il avait
aussi l’avantage de parler l’allemand. Il était devenu en peu de temps le
palefrenier idéal pour atteler ou dételer les chevaux des officiers allemands
qui venant passer une journée à Saint-Quentin en confiant leurs montures à
l’auberge. Parfois même, l’un d’entre eux remerciait Henri d’une pièce de
cinquante pfennigs. Après quelques temps cependant, Henri trouva un autre
employeur beaucoup plus rentable. Ce fut une marchande de charbon, madame
Jaffary, qui cherchait alors un comptable capable de discuter en allemand avec
un important client qui n’était autre que l’état-major du général von Schieber,
directeur des services de la IIème Armée. Au cours de cette période, Henri devint un
spécialiste des catégories de charbon, que ce soit le gras, le maigre, le
flambant etc. et le général allemand ne douta jamais qu’il traitait avec un
officier français qui devint même ami d’un de ses sous-officiers du bureau
radio de la IIème armée. Grâce à ce militaire allemand, Henri put se
tenir au courant des évènements militaires. C’est à cette époque qu’Henri se décida
d’aller trouver un médecin. Madame Venet, sa logeuse, lui donna le nom d’un
médecin en qui elle avait confiance. Ce médecin fut fort étonné en examinant
Henri. Il lui signala qu’il était inconscient d’avoir gardé un drain dans sa
plaie thoracique si longtemps car le drain aurait dû être renouvelé tous les
deux ou trois jours. Mais ouf, Henri fut
soulagé d’apprendre en même temps que ce drain ne donnant plus, on pouvait le
retirer immédiatement. L’évènement qu’d’Henri garda en mémoire de son séjour à
Saint-Quentin fut la visite en inspection de Guillaume II vers le milieu du
mois de décembre 1914. Henri ne voulait manquer ce spectacle sous aucun
prétexte. Il se déguisa avec des lunettes, un cache-nez et un vieux pardessus,
et se plaça à côté de la compagnie d’honneur à l’entrée de la ville. C’est
ainsi qu’il put apercevoir, à moins de quelques mètres, Guillaume II descendre
de sa voiture et passer devant la compagnie, accueilli par le commandant de la
2ème Armée ! Ce jour-là, Henri s’il l’avait voulu, en échange
de sa vie, aurait pu abattre l’empereur…. En janvier 15, Henri dut subir comme
tous les réfugiés un recensement durant lequel un officier posait des questions
embarrassantes avant de signer un laisser-passer que chacun devait présenter à
toute réquisition. Le bruit courût que tous les non-français allaient être
expulsés à l’occasion de ce recensement. Henri décida alors de ne plus se
cacher sous une identité belge mais de reprendre une nationalité française sous
le faux nom d’un agent de commerce qui, avant la guerre, avait à résider à
Tarsienne pour des raisons professionnelles. La guerre survenue l’avait alors fait retourner en France où il
avait retrouvé du travail dans la maison Jaffary ! L’officier allemand
trouva cependant étrange qu’Henri n’ait pas été mobilisé. Ce dernier dut se
défendre en prétextant avoir été réformé pour myopie mais, quand il dut
présenter ses lunettes, le médecin militaire allemand présent aux côtés de
l’interrogateur, constata que ses verres de deux dioptries, ne constituaient
qu’une faible correction. Henri dut alors ruser une deuxième fois en expliquant
que lors de son passage devant la commission médicale, à l’âge de 20 ans, sa
myopie était beaucoup plus importante. -
Est-cela possible ? demanda alors l’officier au médecin militaire. - Très possible, mon colonel, répondit ce
dernier. - Oui, mais pourquoi alors ne l’a-t-on
pas mobilisé comme employé dans l’administration militaire puisqu’il en a la
capacité ? Henri eut alors la présence d’esprit de
dire, en rusant une troisième fois qu’il avait en fait bénéficié d’un piston
grâce à un député de son arrondissement ! La réplique de l’Allemand,
amusante, ne déplût pas à Henri qui la retranscrit plus tard dans ses
mémoires : -
Allez, allez, dit le major, signez- lui son billet, au
« Pistonné ». Pistonné,
pistonné ! Sont-ils bêtes ces Français ! » C’est ainsi que, grâce à ses réparties
judicieuses, Henri trouva une issue heureuse au piège que représentait cet
interrogatoire ! Henri et son ami Charles qui avait quant
à lui réussi l’épreuve du recensement beaucoup plus
facilement par le teint jaune qu’il présentait depuis sa blessure au foie,
décidèrent peu après de continuer leur périple vers la liberté. Dans le courant
de janvier, un marchand de bestiaux, colporteur de denrées rares, qui faisait
beaucoup de navettes entre France et Belgique accepta d’emmener d’abord Henri
en Belgique. A la frontière surveillée, un stratagème fut employé. Le
colporteur bien connu passa en expliquant qu’il devait entretenir une de ses
propriétés en Belgique et que le lendemain devait le rejoindre un de ses ouvriers
avec un tombereau de fumier. Le lendemain, Henri Giraud passa effectivement
sans difficultés le poste frontière en menant fièrement sa charrette de fumier. 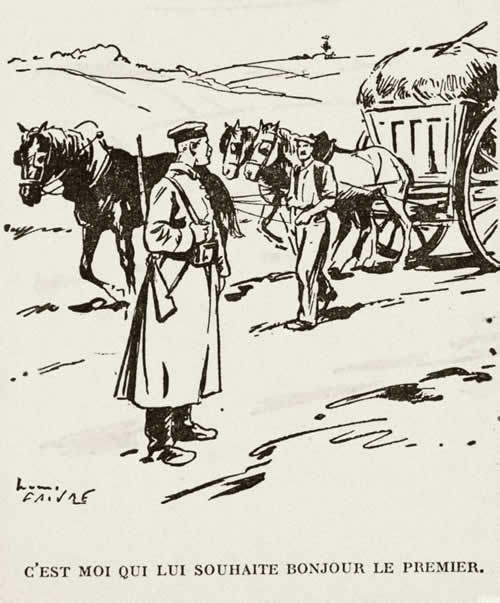
Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud En Belgique, il se rendit à Walcourt en
pleine kermesse chez un cafetier qui lui avait été signalé. Là, il trouva un
forain désireux de trouver un aide pour l’aider à transporter et à monter son
carrousel automobile à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, le carrousel s’installa
sur le boulevard du midi. Un ami du forain prénommé Etienne fut alors invité à
souper dans la caravane. Ce fut là un grand cadeau du destin car cet homme
faisait alors partie du réseau d’évasion d’Edith Cavell. Henri, pendant le
repas, dévoila peu à peu son identité réelle et le dénommé Etienne le
convainquit de le suivre. C’est chez le docteur Frère qu’Etienne introduisit le
fugitif, rue des vétérinaires. Une dame ouvre la porte. Voici la relation que fit Henri de son
arrivée : « Madame, je vous amène un officier français.
» dit Etienne. Stupéfait, je fais rentrer de force mon
guide dans le vestibule, le suis et tire la porte derrière. Sur le trottoir, au
même moment, trois soldats allemands passaient en causant bruyamment. « Que dis-tu, Etienne, un officier
français ? Quelle chance ! Frédéric, Frédéric !
Une porte s'ouvre sur le vestibule.
J'aperçois une salle à manger sobre et de bon goût. Un homme, petit, portant
lorgnon, parait, derrière lui, une fillette attirée par le bruit regarde
curieusement. « Frédéric, voici Etienne qui nous amène
un officier français. Quel bonheur ! C’est le premier que nous voyons depuis la retraite. Comme je suis
heureuse ! Le mari est aussi froid que sa femme est
excitée. « Que signifie tout cela ? Etienne, d'où
viens-tu ? - Monsieur le docteur, je faisais mon
métier. Ce soir, J'ai su que nos amis X ... étaient arrivés sur le boulevard du
Midi avec leurs voitures. Je suis allé leur dire bonjour, Et, en causant, j'ai
découvert monsieur. Il ne voulait pas venir, mais j'ai cru bien faire en vous
l’amenant. C’est ainsi que
se trouva Henri dans la maison d’un chirurgien, le docteur Frère qui, faisant
partie du réseau d’Edith Cavell, œuvrait à héberger et à faire conduire les
rescapés anglais de la bataille de Mons en Hollande afin qu’ils puissent
rejoindre l’Angleterre. Bien entendu, cette organisation servait aussi de ligne
d’évasion pour des soldats français et pour des jeunes Belges désireux de rejoindre
l’armée du roi Albert derrière l’Yser. Le lendemain de
cette rencontre providentielle, Henri put constater l’efficacité du réseau
Edith Cavell : on conduisit Henri à la mairie d’Anderlecht où on lui
délivra de vraies pièces d’identité avec un faux nom ! Ensuite ce fut la
séance photo pour l’obtention d’un ausweis permettant de voyager pendant 15
jours dans le nord de la Belgique comme un artisan fabriquant de cravates que
l’on appelait à cette époque un « coupeur en cravates ». Notre coupeur de
cravates Henri parvint d’étape en étape en Hollande. Je ne vous détaillerai pas
ici de ce voyage, mais sachez que le futur général Giraud écrivit dans son
livre un éloge magnifique des Belges qui l’avaient aidé à retrouver sa liberté et
cela souvent au péril de leur vie. Voici ce qu’il écrivit : Ici, gîte modeste, là, maison
somptueuse. Les membres de l‘association appartiennent à toutes les catégories
sociales. Une seule pensée les anime : l’amour de la Patrie et la haine du
Boche. Ils savent tout ce qu'ils risquent, Ils le font joyeusement, simplement.
Je ne dirai jamais suffisamment ma reconnaissance à tous ces hommes, à toutes
ces femmes, de la noblesse, de la bourgeoisie, de la ville ou de Ia campagne,
riches ou pauvres, savants ou illettrés qui ont protégé le passage de Belgique
en Hollande de tous les proscrits voulant échapper à l‘emprise allemande. Le capitaine
Giraud retrouvant l’armée française, il reprit du service. Il s'illustra à
nouveau à l'automne 1917 lorsque le 3e bataillon du 4ème
zouaves qu'il commanda reprit le fort de La Malmaison, au Chemin des Dames. Après la guerre,
il rejoignit les troupes du général Franchet d'Esperey à Constantinople puis, à
la demande de Lyautey, il gagna le Maroc où il combattit, pendant la guerre du
Rif, les mouvements insurrectionnels. Le colonel Giraud contribua ainsi à la
reddition d'Abd-el-Krim (27 mai 1926), et reçut la Légion d'honneur. Sans doute,
après-guerre, Henri était loin de pouvoir imaginer qu’il effectuerait encore
deux évasions spectaculaires, cette fois lors d’une deuxième guerre
mondiale ! 2) La deuxième évasion lors de
la Deuxième Guerre mondiale d’Henri Giraud devenu général Fait prisonnier
le 19 mai 1940, le général Giraud fut incarcéré, en Allemagne, dans la
forteresse impressionnante de Königstein. Dans celle-ci, plus d’une centaine de
généraux et amiraux étaient emprisonnés avec une série d’hommes de troupe pour
leur servir d’ordonnance, de cuisiniers et d’hommes de corvée. De cette
forteresse, on ne s’évadait pas ou plutôt très peu : deux généraux,
Gaillard et Brunneau avaient essayé mais avaient été repris près de la
frontière suisse. Henri semble avoir été le seul à réussir une évasion. Il fut
aidé pour cela par le général Mesny qui confectionna avec lui le câble de
chanvre qui servit à la descente des quarante mètres de muraille. (Le général
Mesny devait payer de sa vie l’aide donnée à son collègue. Il fut abattu par
l’ennemi un mois avant la délivrance de Köningstein). Des bouts de ficelle d’un
mètre qui avaient servi à entourer des colis envoyés de France étaient
collectés par un jeune français le caporal N…du bureau postal de la prison. La
nuit, les deux généraux faisaient des épissures et tordaient la corde. En un an
elle atteignit 45 mètres et fut renforcée par des bobines de fils téléphoniques
que la femme d’Henri lui transmettait dans des boites de conserve. Toute une
organisation fut mise au point pour envoyer à la date de l’évasion un émissaire
muni d’une valise avec des vêtements civils, une pièce d’identité alsacienne,
de l’argent. Evidement la correspondance du général avec sa femme fut précieuse
pour convenir des modalités. L’évasion se passa sans encombre. Henri fut
descendu le 17 avril 1942 le long de la paroi de quarante mètres, suspendu au
bout de sa corde ! Ayant ensuite
revêtu les habits civils apportés par un émissaire venu en voiture au pied de
la forteresse, le général parvint à rejoindre la Suisse par le train. Un voyage
facilité par sa connaissance de l’allemand, connaissance qu’il avait même
approfondi durant son séjour dans la forteresse en suivant là des cours auprès
d’un professeur qu’on avait bien voulu lui donner ! 
La fameuse forteresse de Köningstein 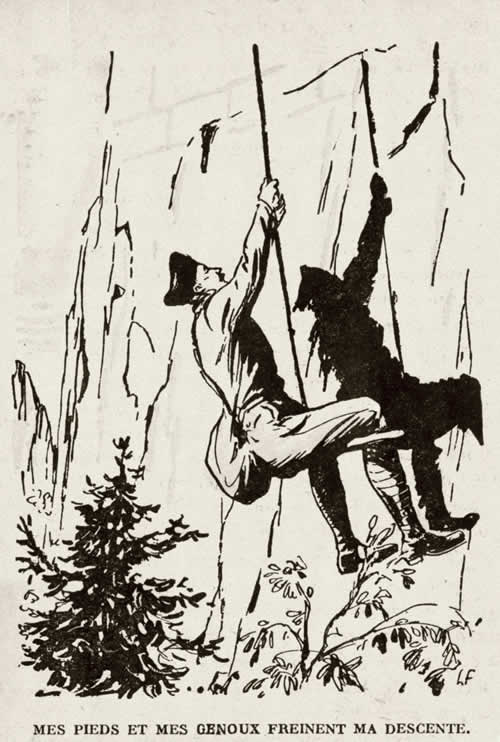
Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud Son arrivée en
France libre fut tumultueuse. Il fut convoqué plusieurs fois par Pétain et
Laval. Ce dernier le pria de retourner librement en sa prison car son évasion
mettait à mal les relations entre le Reich et la France libre. Laval continua
son chantage et lui dit que son évasion empêchera le rapatriement des
prisonniers en cours. A partir de ce moment, Henri s’efforcera de prendre de la
distance avec la maréchal et Laval et cela malgré les pressions qui
continueront encore. Persuadé que la libération de la France devra se faire
avec les Américains, (Les Anglais et de Gaulle ne lui ont donné aucun appui
pour son évasion), il rentrera en contact avec eux et discutera d’un
débarquement allié sur les côtes françaises de Méditerranée ou en Afrique du
nord. Il possède en France l’aval du général Weygand et du général de Lattre.
Le contact avec les américains se fait par Mlle Constance Harvey,
vice-consulesse des Etats-Unis à Lyon qui, elle-même, est en contact avec
l’attaché militaire américain à Berne. 3) La troisième évasion d’Emile
Giraux, cette fois par un sous-marin Peu à peu la
situation se précise et Henri Giraud accepte de collaborer avec les Etats-Unis
pour convaincre les troupes françaises en Afrique de reprendre les armes en abandonnant
Pétain, Laval et l’amiral Darlan. Les évènements vont alors s’accélérer. Un débarquement
en Tunisie est prévu le 8 novembre pour prendre Rommel à revers et Henri est
prié de s’échapper de France pour rejoindre Alger. Sa fuite est organisée grâce
à un sous-marin croisant à proximité de la plage de Lavandou en Provence. Un
petit bateau le transporte en pleine mer le soir du 6 novembre jusqu’au
sous-marin « Le Seraph » qui doit rejoindre les environs de Gibraltar
où un hydravion les attend. Le transbordement du général dans l’hydravion n’est
pas facile suite au remous important qui secouent le canot et l’hydravion. Il
laissera au général un souvenir épique ! 
Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud Atterri à Gibraltar,
Henri rejoint le P.C du général Eisenhower dans la célèbre forteresse. Le 8 au
matin, il diffuse un message radio vers les garnisons françaises de Casablanca,
Oran, Alger… Il convient qu’elles ne prennent pas les armes contre les alliés
qui débarquent et qu’elles s’associent avec eux. Des malentendus se font jour
entre Henri et Eisenhower sur le commandement du débarquement. Finalement il
est convenu que le débarquement achevé, les troupes françaises ne recevront d’ordres
que d’Henri. Tout ne se passera pas de la meilleure façon. La masse des troupes
d’Algérie et du Maroc s’opposera d’abord au débarquement. Darlan à Alger
signera cependant vite un armistice avec les alliés. Henri s’envole alors vers
Alger. Une aventure qui conduira finalement les forces françaises d’Afrique à
quitter l’orbite de Vichy et à entrer en guerre contre les troupes de l'Axe en
Tunisie le 19 novembre 1942. 
Les commandants des Forces Françaises Libres, le Général Charles de Gaulle serrant la main du Général Henri Giraud devant Franklin Roosevelt et Winston Churchill (Conférence de Casablanca 14 Janvier 1943). Capture d'écran du film de propagande de l'Armée Américaine de 1943 Divide and Conquer (Why We Fight ) réalisé par Frank Capra et basé en partie sur des archives des actualités de l'époque, des animations, des reconstitutions de scènes, et du matériel de propagande capturé provenant des deux bords. Un peu plus
tard, après une poignée de main entre Giraud et de gaulle, les deux hommes
s’associent et deviennent le 30 mai 1943 les deux coprésidents du Comité
Français de Libération Nationale (CFLN). Cependant entre ces deux hommes,
beaucoup de malentendus persisteront. Le principal consiste en ce que de Gaulle
a un dessein politique pour la France de l’après-guerre et qu’il craint la main
mise des Américains tandis que Giraud considère que le soutien des Américains
est essentiel à la victoire. La lutte d'influence entre les deux hommes pour le
monopole de représentation de la France est alors engagée. Giraud, en juillet,
à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unis, avait obtenu de Roosevelt
d'importantes dotations en armes et équipements pour l'armée française. En
septembre 1943, sans en informer au préalable le CFLN ni les américains, il conduisit
les opérations qui menèrent à la libération de la Corse. Malgré le succès
militaire de l'opération (La Corse sera le premier département français libéré),
il subira de nombreuses critiques du général de Gaulle pour avoir armé la
résistance communiste corse. De plus en soutenant Pierre Pucheu, ancien
ministre de l'intérieur de Pétain qui avait rejoint (tardivement) la France
libre, il finit par se discréditer. Giraud est alors évincé de la coprésidence
du CFLN le 1er octobre 1943. Il jouera cependant encore un rôle
important dans la préparation de l’armée française en vue de la libération de
l’Italie mais, en avril 1944, il se retire car le CFLN lui enlève son poste de
commandant en chef de l’armée française. Henri Giraud
paya le prix fort pour son combat pour la liberté. Suite à son évasion, 16
proches de sa famille furent déportés en Allemagne dont sa fille chérie Renée
qui y succomba. Après la guerre, il est élu député. Il décède le 11 mars 1949 à
l’âge de 70 ans et repose aux Invalides près du général Leclercq. Conclusion Giraud eut une
grande importance dans le sursaut de la France en vue de sa libération. Il sut
convaincre de nombreux militaires français, fidèles au gouvernement de Vichy de
rallier les alliés. J’aime la personnalité de cet homme qui eut le mérite de
signaler combien le destin lui avait été favorable en lui faisant rencontrer
des collaborateurs de toutes conditions sociales sans lesquels il n’aurait pu
accomplir son œuvre. Parmi ces derniers, il y avait une jeune femme infirmière
à Orbiny, Mlle Lemaire, la fille du maire qui prit de grands risques en
préparant son évasion. Je n’ai retrouvé aucun document concernant cette jeune
femme. Sans les quelques lignes d’Henri Giraud, Mlle Lemaire serait tombée
totalement dans l’anonymat. Il en est de même pour le docteur Frère, ce
chirurgien bruxellois qui faisait partie du réseau d’évasion organisé par Edith
Cavell. A nouveau, sans les quelques lignes qu’Henri consacra à ce médecin, le
docteur Frère serait passé aujourd’hui dans l’anonymat le plus complet. Sans le
témoignage du général Giraud, nous ne connaîtrions pas aujourd’hui son
existence. Emmanuel Debruyne a réalisé une étude très complète[3]
sur le réseau Edith Cavell. Il a recensé toutes les personnes qui y furent
impliquées au nombre de 179. Quatre personnes y occupent une place centrale,
Réginald Capiau, Réginald de Croÿ, Edith Cavell et Louise Thulliez … Ces quatre
noms ont traversé l’histoire mais il faut reconnaître que la toute grosse
majorité des membres du réseau sont restés anonymes en œuvrant pour la plupart,
sans autre satisfaction que d’avoir fait leur devoir. Alors pour tous
ces anonymes qui firent autrefois leur devoir pour retrouver ou garder un monde
juste et libre, je dédie cet article. Je ne peux
m’empêcher de le dédier aussi à tous ces « anonymes » d’aujourd’hui
qui, chacun à leur niveau, souvent dans l’ombre, se consacrent aux autres malgré
les immenses difficultés qu’ils rencontrent. Parmi toutes ces personnes mes
pensées vont, aujourd’hui, à tous les juges, éducateurs et assistants-sociaux
cherchant désespérément des solutions pour rendre la vie plus douce à 5.100 enfants
de Wallonie et Bruxelles en situation de détresse et cela, malgré le manque
flagrant de moyens attribués par les pouvoirs publiques[4].
Dr Loodts P |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©