 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Le
capitaine Ferdinand Belmont, sans doute un héros, peut-être même un
saint ! A ma chère
fille Isabelle Loodts qui connut l’histoire du
capitaine Belmont bien avant moi ! 
Ferdinand Belmont à vingt ans Introduction Il y a plus de vingt ans que je lis
livres et documents sur la Grande Guerre. Aujourd’hui je découvre les lettres
du capitaine Belmont. Après leur lecture, je dois avouer avoir été bouleversé
par sa personnalité. Comment ce jeune homme de 24 ans est-il parvenu à acquérir
une telle maturité ? Comment a-t-il pu développer une foi chrétienne si forte
au point de consoler ses parents de la mort au combat de ses deux frères ?
Comment malgré la mort de ses deux frères, aucune parole de haine envers
l’ennemi ne sortit de sa plume ? Comment cette même foi put-elle lui donner la conviction sans faille que
l’autre vie, celle d’après la mort, devait être le dessein de chaque homme car
faite sur mesure pour lui autour de tous ceux qu’il a aimé ? Mais ne nous
trompons pas, Ferdinand n’était pas un dépressif car il était resté, malgré la
guerre, un amoureux de la vie. Ses lettres sont en effet parsemées de
description des paysages magnifiques rencontrés notamment dans les Vosges où
son unité combattra la plupart du temps. La nature reste pour lui le signe de
Dieu, le signe d’une harmonie et cela malgré son apparente indifférence aux
malheurs des hommes. Ferdinand évoquera aussi avec une sensibilité de peintre
impressionniste ses souvenirs d’enfance au milieu des montagnes de Savoie qu’il aimait sillonner pendant ses
loisirs. De véritables pages d’anthologie, digne du grand écrivain qu’il serait
peut-être devenu après la guerre s’il avait survécu à celle-ci. Mais la Foi de
Ferdinand, ses dons d’écriture ne sont pas les seuls atouts de ce jeune homme.
Il est un chef efficace et aimé et deviendra le commandant d’une compagnie de 150
hommes. Des responsabilités énormes pour son jeune âge qu’il accepte avec
grande modestie. Malgré les honneurs qui lui sont fait (il est décoré de la
légion d’honneur), les véritables héros sont pour lui les humbles soldats qui ne
se sont jamais préoccupé de leur aura qui souvent mourront dans l’anonymat. A
l’âge où la compétition rentre en jeu, où l’on doit prouver aux autres sa
valeur d’autant plus que l’on a effectué des hautes études, Ferdinand montre
une entière humilité. Sa soumission au « destin de masse », sa Foi
vertigineuse, son amour de la vie et son mépris de la mort nous émeuvent au
plus profond de nous-mêmes simplement parce que ces caractéristiques n’appartiennent
pas à celles que l’on rencontre chez un jeune homme de 24 ans. L’on doit donc
se résoudre à admettre que Ferdinand qui n’était pas « normal » et qui n’était pourtant pas « fou »
pourrait bien rentrer dans la catégorie des Saints. L’écrivain Henry Bordeaux
dira de lui : « Ce Dieu présent, ce Dieu révélé
en fonction de qui s’accomplissent les actions humaines, il semble que le
voisinage de la mort ait communiqué à Ferdinand Belmont, le don de la
rapprocher. Il avait desserré peu à peu lui-même les liens qui le retenaient à
la terre, et Dieu l’a trouvé libre quand il l’a appelé. » 
Ferdinand Belmont Qui était le jeune
Ferdinand Belmont ? Ferdinant Belmont est né le 13 août 1890 à Lyon de
Régis et de Joséphine Marguerite Raillon. Issu d’une famille implantée à
Grenoble depuis 1893, il a six frères et une sœur ; Jean, Joseph, Maxime, Paul,
Émile, Jacques et Victorine, tous élevés dans la foi catholique. Son père est
le neveu de monseigneur Belmont, évêque de Clermont et sa mère est l’arrière
petite nièce de monseigneur Raillon (évêque de Dijon et archevêque d’Aix).
Quand la guerre survient, Joseph se destine à être prêtre, Jean est en classe
préparatoire à l’institut polytechnique de Grenoble alors que Ferdinand fait
des études de médecine. Maxime deviendra un brillant architecte et le
conservateur des antiquités et objets d’art des Hautes-Alpes. Ferdinand Belmont
fait d’abord son temps militaire au 14ème BCA de 1908 à 1910
avant d’étudier la médecine tout en exerçant comme externe des hôpitaux. Quand la guerre éclate, il
s’apprêtait à passer le concours pour l’internat des hôpitaux mais est rappelé
dans son l’unité. Il ne fera pas la guerre comme médecin mais comme officier. Le lecteur trouvera
ci-dessous le résumé de la correspondance de Ferdinand à ses parents qui nous
permet de suivre son parcours durant la Grande Guerre. Le parcours de
Ferdinand Belmont raconté grâce à ses lettres 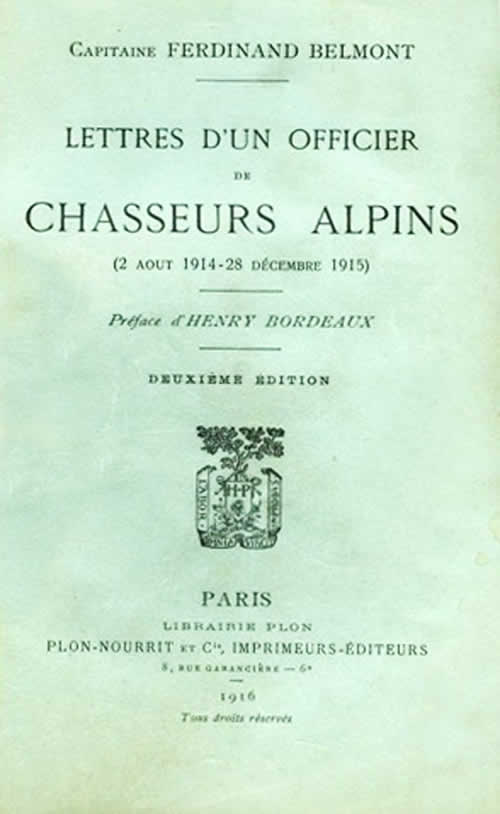
Avertissement Le texte ci-dessous est un
résumé des lettres de Ferdinand Belmont. Le recueil qui les contient renferme
plus de trois cent pages. Grâce à ce travail, j’ai pu retracer toute l’histoire
du capitaine Belmont durant sa vie au front. Le choix des citations est
tout-à-fait personnel. Au Cantonnement
de Macot Le 5 août 1914, il
s’embarque à Annecy en train avec son 11ème bataillon des Chasseurs.
Le 8, il se retrouve cantonné à Macot dans la vallée de l’Isère. Le site est
charmant. On instruit les réservistes. La compagnie de Ferdinand ne possède que
deux officiers : lui-même et un autre lieutenant. Un capitaine de carrière,
le capitaine Rousse qui commande une autre compagnie, aide Ferdinand de ses
conseils. Ferdinand écrit le 10 août : « Nous sommes dans la main
de Dieu, nous le sentons mieux que jamais ; nous sommes si peu capables de
juger des évènements ! (…) J’imagine que la guerre est un des grands
moyens dont Dieu se sert pour donner des leçons aux peuples et pour agiter
leurs destinées. » Le 13 août, Ferdinand fête ses24 ans. Il
s’interroge sur son anniversaire suivant. « Serai-je encore sous les
armes ou aurai-je repris ma médecine si brusquement interrompue ? Serai-je
seulement encore de ce monde ?(…) Insignifiance de toutes nos œuvres et de
tous nos désirs, puisqu’il suffit d’un vent qui se lève un jour pour balayer
comme des feuilles nous et nos œuvres. » En
regardant ses soldats, le médecin qu’il est, regarde ses hommes dont beaucoup
paraissent vieillis à cause de l’alcool. « Des dangers qui menacent la
France actuellement, celui-ci (l’alcool) est peut-être aussi redoutable que les
canons et les baïonnettes des Allemands. » Ferdinand
continue sa lettre le soir car entretemps on l’a appelé pour l’accouchement de
l’épouse du postier de Macot. Celle-ci met le jour à des jumeaux.
L’accouchement a été compliqué mais s’est finalement bien passé. Le 14 août,
Ferdinand conquis par le paysage visible de la petite chambre qu’il occupe
écrit : « Par ma fenêtre, j’aperçois la croupe herbeuse qui
descend du Rognaix et où s’allument comme chaque soir comme des veilleuses
rares et minuscules des bergeries ou des haberts. Ce lambeau de paysage,
semblable à tant d’autres qui m’ont ravi ailleurs, je vais l’emporter fixé dans
ma mémoire quand nous quitterons cette sereine solitude pour les champs de
bataille… » Le
15 août, il assiste à la messe au village et se réjouit de voir encore des
femmes coiffées de leur bonnet brodé d’or de Tarentaise et les épaules
couvertes des fichus de couleurs vives. 
Macot , hier 
Macot , aujourd’hui Le
19 août, l’inaction pèse. Les journées sont longues. « Les
chasseurs quand on n’a pas d'occupations de service, car on n'a pas de quoi
lire, et il est défendu de s'éloigner des cantonnements. Les chasseurs
eux-mêmes sont désœuvrés ; ils errent dans les rues les mains dans les
poches, allant et venant sans savoir que faire ; d'autres écrivent dans
les coins de granges, de longues lettres appliquées el patientes. A les voir de
loin si absorbés clans leur besogne, s'arrêtant après chaque phrase, promenant
la plume d’un geste circulaire au-dessus du papier avant de s'attaquer à la
suivante, on s’imagine volontiers le style, à la fois naïf et contourné, et
l’objet à la fois désintéressé et généreux de leur de leur correspondance. D'autres
encore, avec cette lenteur et celte pesanteur caractéristique de tous leurs
gestes, lisent avec une attention concentrée, en épelant chaque mot, les
nouvelles d'il y a quatre ou cinq jours, qu'on affiche sur les murs de la
mairie ; puis on s'arrête, on commente, on discute, on parle un peu de
politique ; car c'est un fait que plus les gens sont ignorants des choses politiques,
plus ils aiment à en parler. Puis on s'en va ; le clairon sonne la soupe :
c'est un des meilleurs moments de la journée qui correspond au moins à une
réalité présente. Bientôt on les voit tous assis sur les troncs d'arbres
abandonnés, le long des maisons, sur les pierres, sur les brouettes ou les
charrues des hangars, la gamelle entre les genoux et le corps penché très bas
au-dessus du rata, avalant bruyamment chaque cuillerée, avec une régularité de
pendule jusqu’à ce que tout soit mangé. » Ferdinand
fait encore ce jour un peu de médecine car on l’appelle aussi pour une dame qui
crache ses poumons ! « Si nous restons
encore ici, écris Ferdinand, je ne désespère pas de préparer l’internat par la
pratique, sinon par la théorie » 20 août. « Emporté
dans le remous formidable de la tempête, nous sommes comme un grain de sable
qui ne sait d’où il vient, ni où la porte cette fatalité. Faisons comme
lui ; comme ces feuilles que le vent d’orage saisit dans ses tourbillons,
abandonnons-mous, non pas à la fatalité, mais à Dieu qui nous agite et seul
sait où il nous mène. Dans l’attente toujours prolongée où je vis, je prie, moi
aussi pour vous que j’ai laissée dans l’inquiétude et l’impuissance. » Devant Dijon, la mort du capitaine Rousse Le 22 août, Ferdinand quitte enfin Macot
pour les Vosges. Après trois jours de voyages en train, les troupes arrivent le
25 août à Saint-Dié et vont se poster à 3 km à l’est de la ville pour la
protéger. C’est le premier contact avec la dure réalité de la guerre :
Ferdinand voit les hommes épuisés du 22ème régiment se replier après
trois semaines de combat en Alsace. Le
28, tôt le matin, l’ordre est donné à la compagnie du capitaine Rousse et à un
détachement de la compagnie de Ferdinand qui maintenant occupe Dijon de donner
l’assaut aux lignes allemandes.
L’attaque échoue et il y a beaucoup de victimes. Dans un bois de sapin, à la
sortie de Dijon, l’assaut est donné. Les Français commencent à tomber
lourdement sans bruit sur la mousse. Alors le capitaine Rousse s’est dressé en
criant « A moi, à moi » à la baïonnette ! » Et tout de
suite, au premier mouvement pour se lancer en avant, il est tombé foudroyé.
Ferdinand suivait avec une section : « J’ai pris, dit-il, le
fusil d’un homme tombé à côté de moi, et j’ai tiré quelques balles en
m’abritant tant bien que mal mais très vite en regardant autour de moi, j’ai vu
qu’il n’y avait à peu près plus personne debout. Alors, plutôt de me faire
massacrer tout seul, ce qui eût été plus héroïque sans doute, je me suis sauvé
vers les maisons de Dijon ». Finalement Ferdinand, arrive à rejoindre
une batterie alpine. Il est un miraculé de ce premier combat. « J’ai
constaté que quatre balles m’avaient touché ; une a effleuré mon sac
tyrolien, une autre a traversé ma gourde, une autre a percé de part en part
tout mon sac avec ce qu’il contenait ; une autre a même atteint la crosse
du fusil que j’avais en mains. (…) Pour notre début, c’était terrible et
triste. Pauvre capitaine Rousse ! Je le verrai toujours, la tête
renversée, les genoux pliés, emporté à travers les balles par deux de ses
hommes qui le portaient sous les bras. Avant de mourir, il leur a encore
dit : « vous remercierez ma compagnie pour moi, et puis vous prendrez
les ordres du capitaine Deschamps. Il a même dit à son caporal qui l’emportait
de prendre son sabre et de le donner à son fils. » 

La première tombe du capitaine Rousse Ordre
est donné ensuite au régiment de se replier dans la vallée qui va de Saint-Dié
à Rougiville. Les hommes perdent du terrain un jour, en regagnent le lendemain
mais après trois jours de combats, ils ont vu tomber beaucoup des leurs et
manquent de ravitaillement. Du 51ème bataillon, il ne reste que des
débris. Il n’y a plus de capitaines et la moitié des lieutenants et
sous-lieutenants ont été tués. Le 2 septembre, Ferdinand et sa compagnie sont
relevés. Le pauvre bataillon est réduit au minimum par les pertes encourues et
fusionne avec le 11ème bataillon qui de cinq compagnies passe à
sept. Le 3 septembre, le commandant Augerd avec quatre compagnies partent à
l’assaut de Kemberg, une crête hérissée de sapins. 
Saint-Dié et, en arrière, le massif du Kemberg Ferdinand devient commandant de compagnie Les
Allemands les attendent avec leurs mitrailleuses. Une vingtaine d’hommes sont
tués ou blessés, un capitaine est tué et l’autre blessé. Ainsi tombent les
derniers capitaines du bataillon ! Le commandant ordonne la retraite. Le
soir, Ferdinand est sommé de prendre le commandement de la 5ème
compagnie ! « Mon Dieu, comment vais-je m’en tirer avec le peu
d’expérience que j’ai ! Et quelle responsabilité que celle de conduire 250
hommes à la guerre ! Je prie Dieu de m’éclairer sur les devoirs auxquels
je suis insuffisamment préparé. » Le
6 septembre, du village de Taintrux, Ferdinand s’étonne : « Comment
suis-je encore là entier, le même que j’étais le jour où je vous ai
quittés ? » La nouvelle de la victoire de la Marne réjouit les
combattants et Saint-Dié est abandonné par les Allemands. Ferdinand et son
bataillon poursuivent les Allemands qui se retranchent entre Saint-Dié et le
col de Saales. Le contact est gardé avec l’ennemi pendant deux jours. Le 14
septembre, le combat fait perdre beaucoup de monde et le sac tyrolien de
Ferdinand reçoit encore une balle. « Cette journée du 14 septembre,
avec un temps abominable, restera un des souvenirs de la campagne. Depuis le
combat de Dijon, je n’avais pas vu la mort d’aussi près… » Combats sur la Somme Après
une nuit de repos à Saint-Dié, le bataillon se met en marche pour le village de
Magnières à 12 km de Rambervillers et, le 20, il atteint Clermont. Adieu les
Vosges, voilà la Somme. Ferdinand apprend qu’il a été nommé lieutenant depuis
le 2 septembre. Il y a des heures où on se laisse aller à penser au
foyer : « Je pense aux belles
journées d’automne dans la campagne de Lonnes, aux crépuscules lumineux dans
les grands chênes à l’heure où n s’achemine en rappelant les chiens vers la
tiède intimité de la vieille maison. (…) alors je pense à vous, à Emile (son
frère aîné décédé de maladie) ; dans ma poche je sens mon chapelet que je
porte toujours sur moi ; quelque fois, dans ces moments-là, j’en égrène
quelques Ave Maria et la confiance renaît ; j’espère en de meilleurs
jours, car il y en a de bons après les mauvais. Je tâche aussi de vivre chaque
minute sans penser à plus, au jour le jour et à la grâce de Dieu ! »
Le 28 septembre, dans les tranchées, le bataillon a perdu encore pas mal
de monde et plusieurs officiers. « Que de vies cette guerre nous aura
coûtées ! Mais il faut garder l’espoir en la victoire, quel que soit le
prix dont on l’achète. Ce sont les grands sacrifices qui fortifient et
purifient les nations comme les individus. » 3 octobre, à Dompierre, à l’ouest de Péronne,
Ferdinand vit dans sa tranchée. Son poste de commandement est une véritable
caverne souterraine. Autour de lui, son ordonnance, trois agents de liaison et
trois téléphonistes. Ferdinand est très fier de sa cuisine souterraine qui
permet à ses hommes de manger chaud. Le 4 octobre, le village de Dompierre
subit l’assaut de deux compagnies du bataillon. C’est un échec, mais
heureusement, le colonel qui commande la brigade donne l’ordre de repli ce qui
limite les pertes à 20 ou trente hommes. Dans sa caverne, Ferdinand a tout le loisir d’observer la faune. Des
morceaux de terre tombent sur le sol de temps en temps. L’explication est
rassurante : ce sont les taupes qui en creusant leurs tunnels, trouvent
commode de rejeter la terre dans la caverne. Les jours sont gris et les
souvenirs égayent Ferdinand qui repensent à la campagne de Lonnes avec ses
chênes que visitent les ramiers et son étang de Fromenteau où le vent promène
ses rides en soulevant les disques ronds des nénuphars. « Il y a tant
d’endroits où j’ai passé, où j’ai laissé un peu de moi-même que je peux
prolonger cette promenade sans épuiser aucune partie de mes souvenirs. » 
Dompierre en ruines 
Le village de Lonnes en Charente, dans le sud-ouest de la France 
Les étangs de Fromenteau Après
dix jours dans la tranchée, c’est le cantonnement dans un village. « Qu’il
est bon de se laver avec le bon savon de Marseille qui fit alors plus plaisir
qu’un morceau de pain ». C’est le paradis pour Ferdinand qui éprouve
cependant du remord à se complaire dans la quiétude. Le 11 octobre, la messe
est donnée par l’abbé Paradis, infirmier militaire. Les soldats sont venus en
grand nombre et les acolytes du prêtre sont deux capitaines, un artilleur et un
médecin. « Beaucoup venaient là, beaucoup se sont confessés et ont
communié aujourd’hui, qui n’avaient pas pris, depuis bien des années le chemin
de l’Eglise, oublié par négligence, ou déserté par égoïsme ou par intérêt. (…)
C’est la première fois, depuis le début de la guerre que nous passons un vrai
dimanche et que nous pouvons en faire un peu le jour du Seigneur. » Le
21 octobre Ferdinand écrit à ses parents : « Ne suis-je pas à
envier d’être bien portant quand tant d’autres souffrent de leur corps ?
N’ai-je pas tous ce qu’un soldat en guerre peut souhaiter de plus
précieux : la certitude des affections les plus profondes et les plus
désintéressées, les lettres qui viennent souvent m’en apporter l’écho ?
N’ai-je pas aussi avec la santé du corps, le repos de l’âme, puisque n’étant
pas indispensable à personne matériellement, je n’ai à penser qu’à mon âme, que
ni les balles ni les obus ne peuvent atteindre ? » Le
23 octobre, il apprend qu’il est nommé capitaine. « Quel honneur !
Je ne pensais pas quand j’ai reçu mon premier galon, arriver si vite au
troisième ! » Le
25 octobre, la messe du dimanche s’embellit. Cette fois des clairons du
bataillon ont sonné aux champs pendant l’élévation. Evidement le bon abbé Paradis
est ravi. « On se rend compte qu’on n’est rien soi-même, qu’on ne peut
rien par ses propres forces et qu’il faut se faire un instrument docile entre
les mains du Grand Ouvrier. Ah ! Comme il faudrait être vertueux pour bien
faire ! » Le
2 novembre, le lendemain de la Toussaint, Ferdinand apprend l’affreuse nouvelle
de la mort de son frère Jean. Il écrit à ses parents des phrases remarquables
et inhabituelles dans ces circonstances : « Il faut s’y
soumettre ; se faire à cette habitude, si dure semble-t-elle, de renoncer
à tous les liens matériels qui l’attachaient à nous, et nous attachaient à lui.
Hélas ! Pauvres hommes que nous sommes, ces liens nous tiennent si fort au
cœur que la plaie saigne douloureusement quand la Providence permet qu’ils soient
rompus ; et malgré toutes les raisons d’espoir, presque d’allégresse
qu’apporte la Foi, notre faiblesse gémit comme le roseau plie sous le vent. (…)
Comme vous, je suis certain que Jean est maintenant en sécurité, bienheureux
pour toujours. Nous avons tous la certitude que Dieu a bien accueilli cette âme
toute droite, toute neuve et fraîche, l’âme pure des enfants que dieu veut
laisser venir à lui ! » Combats en Flandre Le
12 novembre, le bataillon est parvenu en train via Amiens Abbeville, Calais à
Hazenbrouck en Flandres. Il ya beaucoup de trafic sur la ligne. Le train
tamponne celui qui le précède. C’est un train qui transportait des Anglais et
il y a parmi eux deux tués et des blessés. Le train débarqua le bataillon à Bailleul et de là, il fut transporté
par un convoi de bus britanniques à Dickebusch, à 5 km au sud d’Ypres. Le
contact avec la Belgique est morose. Dans une salle basse d’une maison
flamande, Ferdinand a le loisir d’observer tout un monde de femmes, de jeunes
filles, d’enfants qui pleurent tandis que les hommes silencieux fument des
pipes courtes en regardant le sol carrelé. « Les
gens se coudoient là, réfugiés flamands pour la plupart, sont taciturnes. Ils ont
bien des raisons d’être tristes ; et pourtant ils ont plutôt l’air de
subir passivement les événements avec une espèce d’inertie sans révolte. (…) On
sent bien à leur physionomie très vivante, à leurs yeux brillants et mobiles
qu’il se cache là derrière une âme ; mais elle semble lointaine et on se
demande quel est le chemin qui y mène. » 
Wytschaete 21
novembre, dans les tranchées devant Wytschaete. Les Allemands ont chargé à la
baïonnette en criant. Leur assaut a échoué. « Derrière notre tranchée,
il reste encore un morceau de maison où l’on peut la nuit faire du feu dans le
fourneau encore indemne, à condition de prendre de grandes précautions pour
cacher la lumière. Du moins cela permet de faire chauffer du thé et du café
pour les hommes ; car la cuisine de faisant très loin arrive à la tranchée
complètement froide. Il fait très froid depuis deux jours ». 
Soldats français dans leurs tranchées sur les bords de l’Yser «J‘ai
honte à penser à quel point mes hommes peuvent m’envier en me voyant recevoir
souvent, beaucoup plus souvent qu’eux de longues lettres que je relis et relis
indéfiniment. Parfois il me vient une grande pitié pour ceux qui marchent là
dans le rang, ignorés, modestes, humbles, déshérités de tout ; et je
trouve que ceux-là ont vraiment du mérite, que personne ne connaît, qui n’ont
point d’amis, qu’aucune pensée affectueuse n’accompagne le long de leur route
ingrate, et qui ne reçoivent jamais de lettres. Et je m’en veux de ne pas les
connaître assez, de ne pas faire dans la mesure de mon possible, ce que
personne ne fait pour eux. Que mon rôle est difficile à bien remplir et comme
j’en suis loin ! » Le 30 novembre, Ferdinand écrit d’une petite maison
abandonnée. Il se pose la question d’où provient l’impression qu’il a que la
population est aisée mais sans goût. « A l’aspect misérable de ces
masures à toits de chaume ou de brique, aux murs minces qui chancellent ou se
lézardent à chaque éclatement d’obus ? Ou bien au désordre de ces
intérieurs noircis et mal tenus où chaque objet semble malpropre, depuis les
petits bols ou les longs verres à bière accrochés obliquement au vantail des
cheminées, jusqu’aux objets religieux, crucifix grossiers ou statuettes naïves
qui fraternisent invariablement sur chaque meuble avec les plus vulgaires
objets de ménage ? » 
Clytte 8
décembre Le
bataillon a quitté le cantonnement de la Clytte pour se rendre à Haringhe. « Nous
avons quitté La Clytte hier à midi. La pluie qui tombait depuis la veille
n’avait pas cessé et a continué tout l’après-midi à tomber sans relâche. Aussi
l’étape a été très pénible sur des routes inondées de boue fluide, encombrées de
voitures et de convois. Et puis les sacs sont lourds avec les bagages d’hiver,
et on s’est désaccoutumé de ces étapes sur route à force de vivre sur place.
Finalement nous avons échoué hier soir à la nuit noire dans le secteur qui nous
est affecté, en rase campagne, où, sous la pluie, il a fallu se caser dans les
fermes de Haringhe, tout près de l’endroit où l’Yser franchit la frontière.
Allons-nous rentrer en France ? » 
Hôpital militaire français de Roosbrugge-Haringhe Retour en France tout près d’Arras 14
décembre. Le
bataillon a rejoint la France après trois nuits de marche. Il est arrivé à
Mingoval à 18 km au nord-ouest d’Arras. 
Mingoval, l’église Le
20 décembre, toujours à Mingoval, le capitaine Belmont assiste à la messe dans
l’église trop petite pour les chasseurs venus en grand nombre. Il
apprend ce jour-là que son frère Joseph part à son tour comme soldat. Le groupe
de bataillons auquel appartient le 11ème est commandé par le colonel
Bordeaux, le frère de l’écrivain. « Nous avons fait sa connaissance ces
derniers temps. Il paraît très sympathique. Il aime beaucoup les chasseurs,
parmi lesquels il a fait presque toute sa carrière. » Le
25 décembre, la messe de minuit : « Un soldat, dont le pantalon
rouge apparaissait sous la soutane, a dit la messe. Un sous-lieutenant,
l’officier de la section de mitrailleuses, a chanté Minuit chrétiens. Tous,
nous avons chanté en chœur les airs naïfs que tout le monde connaît : Dans
cette étable… les anges dans nos campagnes…il est né le divin enfant etc. (…)
Vraiment nous avons de la chance d’avoir passé au repos la fête de Noël !
Pendant ce temps, d’autres étaient aux tranchées dans le froid et
l’isolement ; j’ai pensé toute la nuit et le jour à ceux dont la Noël a dû
être si misérable ! J’y pensais surtout en allant à l’église, au milieu de
la nuit, et en entendant distinctement, dans le silence de cette nuit froide et
limpide, la crécelle intermittente des fusillades et les grondements espacés
des gros canons. Quelle misère d’entendre cette musique de guerre dans la nuit
de Noël ! » Le
28, Ferdinand mentionne l’attaque des tranchées de Saint-Eloi. Deux compagnies
sont parties à l’assaut mais celle de Ferdinand est restée en réserve.
Ferdinand est impressionné par les chasseurs : « Avec un admirable
ensemble, les deux compagnies qui se tenaient prêtes à partir, baïonnette au
canon, ont surgi hors de la tranchée et sont parties en avant, en une longue
file de tirailleurs, presque coude à coude, les armes à la main et la
baïonnette en avant. L’assaut est un succès. Le colonel Bordeaux en avait les
armes aux yeux. » Malheureusement, les tranchées prises doivent être
abandonnées car leurs ailes droites et gauches étaient toujours aux mains de
l’ennemi. Une des compagnies a perdu ses quatre chefs de section ! « Le 28 au soir, comme les brancardiers
ramenaient en arrière le cadavre d’un de nos sous-lieutenants, le colonel
Bordeaux (NDRL : le frère de l’écrivain Bordeaux) s’est baissé »
sur le brancard pour l’embrasser. Il a remis lui-même une médaille militaire à
un sergent entré le premier dans la tranchée allemande (…). » Ferdinand
mentionne qu’il a reçu diverses lettres de son père au cours de son voyage à
Saint-Dié pour se recueillir sur la tombe de son fils Jean. « J’imagine,
écrit-il, sans peine tout ce que papa a pu trouver, malgré l’étreinte des
souvenirs, d’apaisement peut-être et d’adoucissement dans sa peine, à rendre
les derniers devoirs à ces restes misérables. Avec quelle émotion j’irai à mon
tour, si Dieu le veut, prier sur la place qui a vu tomber mon frère. » Le
29, le bataillon est relevé et rentre à 3 heures du matin à Mingoval. Le
2 janvier, une nouvelle année commence. « Je
ne puis vous dire à quel point, j’ai, depuis le début de cette guerre, la
sensation de n’être rien par moi-même ; je me rends compte de la part que
je prends effectivement à ce que je fais, et il me semble être comme une
feuille saisie en un ouragan. Aussi, ne me parlez pas de courage, de
vaillance : je n’en ai pas. Emporté par ce tourbillon, j’y demeurerai
jusqu’à ce qu’il me dépose, mort ou vivant, sans quelques endroits tranquilles.
Et tant que dure cette danse, je m’abandonne le mieux que je peux à la volonté
de Dieu. (…) Hier matin, le plus ancien des sous-lieutenants, un brave
alsacien, tête dure et brave cœur m’a adressé au nom de la compagnie, dans un
petit discours très gentil, les vœux de bonne année et de succès. Je ne
m’attendais pas à cette surprise qui m’a beaucoup touché (…) La soirée s’est
passée à entendre des chansons (…) A la fin, nous avons tous chanté en chœur la
Sidi-Brahim (…). » A Géradmer Le
15 janvier. Ferdinand écrit de Gérardmer ou le bataillon s’est déplacé. Les
officiers logent en ville et c’est presqu’une vie normale pour eux. « La vie suit son cours
normal ; on va chez le coiffeur pour se faire raser et chez le cordonnier
pour se chausser. Il y a des magasins de presque tout et presque tout dans les
magasins. Quelle chose étrange ! quel plaisir aussi se sentir en pays
civilisé (…) » La
vie se poursuit agréable dans la petite ville paisible. Il neige abondamment.
Presque tous les hôtels sont transformés en ambulance de campagne et le 11ème
bataillon qui a connu beaucoup de pertes se reconstitue. Mais l’action manque à
Ferdinand qui pense aux alpins qui se battent au même moment sur
l’Hartmannswillerkopf. « Ici, nous avons des
loisirs, des commodités, du bien-être, et on sent très bien qu’à cette école on
ne gagne pas grand-chose ; c’est maintenant, par comparaison, qu’on mesure
le prix des jours plus austères dont chaque minute est comme une prière.(…)
C’est par la vie ordinaire qu’on acquiert toutes les grandes qualités ;
seulement, elles n’ont pas l’occasion de se manifester bruyamment dans
l’uniformité des petits devoirs. Elles se révèlent dans les circonstances
extraordinaires seulement, parce qu’alors les circonstances leur font un cadre
qui attire l’attention. » Le
4 février, Ferdinand part en reconnaissance du côté du lac Blanc avec un
détachement de dix hommes et trois mulets chargés de provision. Du point
culminant qui domine le lac, Ferdinand admire le paysage. « Quelle joie secrète
de revoir, même de loin, de vraies montagnes comme les nôtres ! On se
sentait presque près de chez soi en fouillant de l’œil les creux d’ombre bleue
encadrée de reliefs aux profils délicats, en suivant la ligne fantaisiste des
sommets lointains. » 
Le lac Blanc et son point culminant 
Le lac Noir Ensuite,
c’est la visite du lac noir et un agréable hébergement chez le curé du petit
village de Pairis. « Pairis nous a paru un site fort accueillant, et à
nous qui avons connu les plaines ravagées du nord et les fermes mutilées des
Flandres, cela nous paraissait étrangement savoureux se dîner tranquillement à
la table hospitalière du curé, à quelques centaines de mètres des lignes
ennemies. » 
Pairis, hameau de la commune d’Orbey De
retour à Gérardmer, Ferdinand assiste le 10 février à la visite du président
Poincaré qui fut auparavant officier de réserve au 11ème Chasseur. 
Poincaré en 1897, lieutenant de réserve Le
13, petite fête chez le commandant avec une petite revue qui amusât beaucoup de
monde dont le général Blazer. Le 15 février, la vue routinière de l’arrière
continue avec le risque d’affaiblir les caractères. « Presque
quotidiennement, nous éprouvons combien les hommes redescendent vite la pente
qui mène au vulgaire. La discipline, quand elle ne s’impose pas d’elle-même,
leur semble une gêne, une torture détestée. (…) Sans doute, quand ils sont aux
tranchées, quand la mort les frôle pendant des jours et des nuits, où bien
quand ils s’en vont la baïonnette en avant à travers les balles, leur
personnalité s’oublie, ou plutôt s’élargit, s’épure et devient, pendant un
moment, simple et nue. (…) Ce sont des âmes presque neuves qui apparaissent
sous cette écorce fruste. Et c’est là une des plus belles émotions de la guerre
de sentir tout ce qu’a pu faire, en une seconde, le voisinage de
l’infini. » Le
20 février, le bataillon prend la relève du 12ème en Alsace, dans le
secteur de Sulzern, de l’autre côté de la Schlucht. Ferdinand effectue une
contre-attaque sans grand succès sur le Reichakerkopf. Il y a un officier tué,
trois ou quatre soldats tués et une quinzaine de blessés. 
Le Reichackerkopf aujourd’hui 
Reichackerkopf – Tombes de soldats français Il
replie alors sa compagnie sur le Sattel avant d’aller occuper une crête
au-dessus de Sulzern. Le 28, pendant la nuit, l’ennemi les attaque mais laisse
beaucoup des leurs sur le terrain. Le temps est affreux et il neige. Il faut
attendre le 2 mars au soir pour la relève. Le 6, attaque contre les lignes
allemandes des faubourgs de Stosswihr. La journée suivante, le bataillon doit
encore monter dans les avant-postes d’Ampferbach avant d’être relevé. 
Stoiswihr et Ampfersbach près de Munster « La
vie vaut ce que vaut l’homme ; les circonstances ne signifient rien par
elles-mêmes, c’est nous qui leur donnons leur couleur. Aussi pourquoi dire que
nous expions l’inertie des générations qui nous ont devancés ? Dans l’immense
creuset qu’est le monde, le temps et l’espace sont fondus. C’est un mécanisme
infiniment complexe, une chimie inextricable dans laquelle nous sommes jetés
atomes contre atomes. De ce tourbillon, que sortira-t-il ? Dieu le sait.
Mais que nous importe de connaître les événements si divers, si complexes qui
se heurtent ? Car Dieu est là. Soyons dans sa main comme la matière docile
dans celle de l’ouvrier. » L’hiver
ne cache pas les meurtrissures faites par la guerre à la forêt. Les sapins
rappellent à Ferdinand ceux des Vosges qui virent son frère Jean tomber et
mourir. « Pour ma part, je
reproche involontairement à ces forêts des Vosges la mort de notre pauvre Jean.
Je me le représente si bien, avec sa loyauté naturelle, avec sa générosité
insouciante, se jetant sous les balles, tombant sans être remarqué de ses
voisins, victime obscure et anonyme de l’immense rafale. (…) Les derniers
combats dans cette vallée de la Schlucht à Munster, nous ont coûté pas mal de
monde. Une fois de plus, je me trouve seul officier dans ma compagnie.
Heureusement nous venons de recevoir un renfort de 300 hommes dont j’ai absorbé
pour ma compagnie 57 hommes et quelques gradés.» La
vie de tranchée continue alors dans toute sa monotonie. Sulzern et Ampferbach
sont bombardés mais tous les habitants sont quasi tous restés et se terrent
dans les caves. Devant les tranchées tenues par Ferdinand se trouve même un
hameau de six à huit foyers encore habités. Le 20 mars, le Reichakerkopf est
repris par les Allemands. Le 23 mars, une contre-attaque est organisée et la
compagnie de Ferdinand est désignée pour effectuer une diversion par des feux de
salve sur les lignes allemandes. Après cette contre-attaque sans résultats, la
situation se calme. Le lundi de Pâques, Ferdinand a l’occasion de quitter son
camp de Bischstein pour redescendre jusqu’au camp d’Elrmatt. Il se confesse au
pied d’un sapin puis communie devant un autel de fortune. « Dans ce
cadre sauvage où manque tout apparat, où ce qui paraît importe peu, il semble
qu’on soit plus près de Dieu. » 9
avril « Que d’eau ! Que d’eau ! (…) C’est à travers des
océans de boue et par une nuit froide que nous sommes descendus hier soir des
bois de Bischstein pour venir relever une compagnie dans les
avant-postes. » 13
avril, le bleu du ciel apparaît enfin. « Voilà huit mois que la guerre
a éclaté. « Comment aucun des belligérants n’a-t-il été troublé par des
événements intérieurs ? Quel sera parmi eux, le premier atteint par la
désunion, par les luttes de partis, par la révolte, par l’usure, par tout ce
qu’on peut redouter vaguement sans le voir nettement, et qui peut arriver d’un
jour à l’autre pour bouleverser tout cet édifice, à la fois formidable et
fragile ? » Le
18 avril, le capitaine Belmont se rend dans les tranchées d’une section de sa
compagnie pour décorer de la médaille militaire un courageux Savoyard dont
malheureusement il ne cite pas le nom. Cet homme appartenait au 22ème
bataillon alpin au début de la guerre et le 2 septembre, à Mandray, il avait
pris le commandement de son peloton car les deux chefs de section avaient été
tués. Blessé de trois balles et d’un coup de baïonnette, il avait alors passé
36 heures sur le champ de bataille avant d’être relevé.[1] 
Dimanche
24 avril. Ferdinand écrit que les gens du village du no mans land ont été
évacués. « Nous avons eu ici, il y a trois jours, un spectacle bien
triste : le départ des gens du pays qu’on faisait tous évacuer vers
l’arrière. Pauvres vieux qui s’en allaient les yeux rouges et le cœur gros,
abandonnant tout ce qu’ils avaient connu et aimé pendant des années, et
emmenant par la main les enfants endimanchés dont l’insouciance presque joyeuse
contrastait péniblement avec la désolation résignée de leurs mères et de leurs
grands-mères. » Cantonnement au col de Bischstein Le 28 avril, la compagnie
quitte les tranchées pour rejoindre le cantonnement du col de Bischstein. 30 avril : « Aujourd’hui
une véritable petite cité sylvestre anime cette forêt autrefois sauvage, où les
chevreuils passaient sans frayeur sur les mousses vierges. Des abris de toute
sortes, de toutes dimensions, de tous genres s’offrent à ceux qui viennent d’en
bas après un séjour plus ou moins long dans la terre des tranchées. (…)
L’abri du commandant est un chef d’œuvre… Là-dedans, un intérieur boisé, un
plancher sous les pieds, un lit avec de vrais draps, une table, des chaises,
glace, etc. Il n’y manque rien : peut-être un piano ! L’entrée est
ornée d’un vrai petit jardin clos de grillage dont le clou est un grand cor de
chasse dessiné avec des mousses et portant le n°11 dans son cercle. Il y a
d’autres abris pour les médecins, sapeurs, agents de liaison, brancardiers, les
entrepôts, le magasin à vivres, le bureau. Il ya une salle à manger de
fantaisie pour les beaux jours, sur la lisière, avec une large baie vitrée par
laquelle on voit le Hohneck, l’Altenberg, et que nous avons inaugurée ce matin
avec le commandant. Il ya enfin une petite chapelle qu’on est en train
d’édifier, « Notre Dame des sapins ». 
Poste de commandement du 115e B.C.A. à Bischtein, au-dessus de Soultzeren, en 1915 (coll. S. Aiglin) Son deuxième frère, Joseph, sous les armes ! 10 mai Une nouvelle peu
réjouissante pour notre Ferdinand. Une lettre de ses parents lui apprend que
c’est le tour de son frère Joseph de prendre les armes. Il leur répond : «
Ce ne sont pas ceux qui partent qu’il faut plaindre mais ceux qui les regardent
s’éloigner et qui restent. Mais Dieu est bon ! S’il vous demande encore
l’offrande des angoisses qui s’ajouteront désormais à vos épreuves, il ne vous
refusera pas le don secret de cette grâce qui confère à tous la force, la
confiance et la paix. C’est cette paix profonde, promise par Lui-même aux
bonnes volontés de ce monde, qu’il faut désirer et chercher par-dessus-tout et
que je ne cesserai pas de lui demander pour vous. » Le soir, c’est l’émotion
dans toute la brigade. Une victoire a été remportée par l’armée française à
Arras et le colonel a décidé de faire chanter sur tout le front de la brigade,
le soir à 19h30, la Marseillaise et la Sidi-Brahim. « Quelle impression d’entendre ces
rythmes alertes sortant de terre ou tombant du ciel ; et que renvoyaient
les échos du ravin ! (…) A peine, ce concert avait-il commencé que les
cloches des villages en ruine mêlaient leurs voix aux nôtres. (…) Nous n’avons
pas été épargnés : les boches pour nous prouver qu’ils avaient bien
entendu, nous ont envoyé par trois fois des salves de shrapnells. Personne n’a
été touché ! Eck, non loin de Munster 11 mai. Le bataillon
quitte le col après un long séjour commencé le 19 février. La ménagerie
accumulée au fil des mois doit commencer sa transhumance. « Ce
soir puisque nous remontons dans les bois, le campement va se mettre en
mouvement un peu avant la compagnie, qui marche plus vite et qu’il ne faut pas
alourdir d’un cortège d’allure évidemment peu militaire. Les ânes, les
carrioles, les casseroles, les marmites, les tonneaux, les chèvres, les chiens,
tout cela va décamper sous la conduite des cuisiniers et des ordonnances, pour
transporter nos pénates en d’autres lieux ». 28 mai. Le bataillon est
en poste près de Eck (non loin de Munster). « Eck est devenu, comme tous les hameaux
d’alsace, un entassement de ruines, un coin de désolation et d’abandon, un
charnier et une tombe. Un jour, les paysans restés enracinés en leurs demeures
ont été surpris par l'avalanche des obus allemands, comme jadis les Pompéiens
paisibles par les laves du Vésuve. Une à une, les maisons ont été visées,
atteintes par la mitraille ; les unes ont brûlé au premier obus ; des autres
ont résisté plus longtemps et ne se sont écroulées qu'après plusieurs
bombardements : quelques-unes sont restées debout portant seulement les
balafres et les écornifleurs de leurs murailles ou de leurs toits. Ceux qui
n'ont pas été tués sont partis, sans rien emporter de leurs biens ; plusieurs
ont été brûlés vifs ou ensevelis sous les décombres. Du bétail a été assommé
dans les étables. Maintenant, depuis longtemps les Allemands n'ont plus tiré
sur Eck ; ils ne pourraient viser que des murs à demi croulés ou des toits
crevés et chancelants. J’habite une de ces maisons qui ont le moins souffert,
son toit a reçu trois ou quatre obus, mais il reste encore beaucoup de tuiles
intactes. Je suis installé au rez-de-chaussée, dans une pièce que nous avons
fait nettoyer tant bien que mal, mais où il reste des quantités de cafards qui
courent à toute vitesse et en tous sens sur le plancher. La maison possède une
bonne cave voûtée où est installé le téléphone et où nous pouvons nous réfugier
en cas de bombardement. (…) 
Perspective du front en 1915 dans la région de Munster (site alsace1418.fr) De plus en plus
les événements du monde apparaissent incompréhensibles pour nous. Où
allons-nous ? Personne, je crois bien, ne pourrait le dire. Ce qui est certain,
c'est que, pour chacun de nous, la vie, quels que soient le dessous et les
aventures qui la remplissent, aboutira à la mort. Tôt ou tard,
qu'importe ! Et qu'importent aussi les choses les plus formidables de ce monde
puisque ce monde passera et passe chaque jour ! A travers les émotions
ou les périls d'un champ de bataille ou bien dans la simplicité des humbles
devoirs du foyer, notre temps de vie s'égoutte ... et chacune de ces gouttes du
temps cache un trésor, comme le champ du laboureur dans la fable, On a tort de
désirer toujours quelque chose, La sagesse semble si simple, si facile, qui
consiste à être content de son sort ! Ce n’est rien et c’est tout ! » A Metzeral, combat pour le Braunkopf Le 5 juin, le bataillon
quitte Eck pour Metzeral. Le bataillon doit relever en première ligne les
unités qui ont enlevé à l’ennemi récemment le BraunKopf, grosse bosse
rocailleuse qui domine Metzeral. Le bataillon s’efforce
d’avancer vers Metzeral qui est aux mains de l’ennemi. Le 19 juin, deux
compagnies qui ont avancé ont été fort éprouvées : un capitaine et un
sous-lieutenant sont tués et le commandant du bataillon Foret est blessé
gravement à la main. Le 20 juin, Ferdinand se
considère comme un miraculé. « Je suis toujours
debout et bien portant. Depuis longtemps je comptai au bataillon parmi les
increvables et, bien que la guerre soit loin de finir, je me demande si une
balle ou une marmite ne m’atteindra jamais ! J’ai beaucoup à remercier
Dieu d’être resté » indemne si longtemps, et j’aurai bien à faire pour
mériter plus tard d’avoir échappé tant de fois à la mort ! (...)
Cependant, sachons ne rien souhaiter : nous aimons la vie parce que, malgré
tout, étant de ce monde nous voyons avec les yeux de ce monde : si nous savions
l'autre vie, la véritable, qui se cache derrière ce que nous appelons la mort,
nous la désirerions au point de détester celle qui nous est prêtée pour
quelques années. 21 juin 1915 
Metzeral, détruit par les bombardements Dure journée. Metzeral est
enfin réoccupé par les Français. Ferdinand et sa compagnie ont délogé les
allemands au bas du Braunkopf mais beaucoup de chasseurs ont perdus la vie et
tous les chefs de section ont été mis hors de combat : Capdepon et deux
autres sont tués, le quatrième est blessé sérieusement. Le lieutenant Capdepon
était particulièrement apprécié par Ferdinand. « Dieu m’a laissé en vie je ne sais
comment ! (…) Hier soir, en allant relever son corps dans les herbes
et recueillir les objets qu'il avait sur lui, je l'ai trouvé étendu de tout son
long, dans la pose qu'il avait au moment où la mort l'a surpris, les traits
parfaitement calmés, le visage naturel et gardant son expression habituelle.
Voilà une mort belle et propre, irréprochable. Jean a dû mourir de la même
manière les 29 aoûts, dans les genêts du col d'Anozel. Devant de telles morts,
on se demande s’il faut plaindre ou envier. La mort de Capdepon est une grosse
perte pour notre compagnie. Les trois autres chefs de section de la compagnie
sont tombés eux-aussi dont l’un était un très jeune adjudant (il n’avait pas 18
ans), d’Eichtal, grand garçon blond, de très belle allure, très brillant et qui
devait faire bientôt un excellent officier. » 4 juillet, toujours sur les basses pentes
du Braunkopf. « Quel délicieux
pays devait être cette haute Alsace quand elle vivait dans la gaieté et la paix
! Quels petits villages exquis dans ces bosquets de noyers ou de frênes, au
fond des vallons pleins de fraîcheur et de prés fleuris ! Et ces vieilles
montagnes au cœur de granit, usées par les siècles, comme elles encadrent
doucement ces vallées aimables entre leurs larges croupes rondes tantôt
coiffées d'augustes sapinières, tantôt simplement vêtues de leurs immenses
prairies où s'éparpillent les taches grises ou rouges des chaumières et des
toits de briques ! Dans les bois, des sentiers bizarres, qui paraissent ne
mener nulle part, serpentent indéfiniment entre les colonnades innombrables, et
par endroits, autour d'une source ou d'un rustique abreuvoir, une clairière
s'ouvre, enclose de petits murs bas en pierre sèche, tout festonnés de lichens.
Partout, dans la forêt, sur les chaumes, entre les rocailles des crêtes ou dans
les replis des valons, la verdure s'étale, des plantes surgissent et se hâtent
de croître sachant que l'été sera court. Des fougères drues sortent en tapis,
par champs immenses ; et dans taule cette verdure encore tendre, les hautes
grappes des digitales roses se balancent inlassablement dans la brise. Oui,
c'est un joli pays, bien différent, sans doute, de nos Alpes, mais empreint
d'une poésie tranquille, un peu triste, vaguement virgilienne. » Retour à
Gérardmer, Croix de Guerre pour Ferdinand et mort de son frère Joseph 8 juillet. Le bataillon est
de retour à Gérardmer. La veille, Ferdinand, à sa grande surprise est décoré de
la croix de guerre avec palme par le général de Maud’huy. 11 juillet. Ferdinand reçoit
une affreuse nouvelle qui succède à la joie d’avoir été décoré. Son frère
Joseph, à son tour, a été tué sur le front d’Argonne. Voici les mots
remarquables qu’il écrit à ses parents : « J'ai reçu tout à l'heure
votre lettre en sortant de la messe. Que la volonté de Dieu soit faite ! Ils
sont tous les deux maintenant, Jean et Joseph, à l'abri des dangers et des
seules vraies misères ; ils sont heureux de ce bonheur si parfait que nous ne
pouvons pas l'imaginer. Ce bonheur et cette sécurité dont ils jouissent
désormais compensent largement toutes nos tristesses. Mais il ne faut pas être
triste : toutes les souffrances sont finies pour eux. Que Dieu ait pitié de
vous et vous aide à supporter cette nouvelle absence, il l'accepter comme celle
de jean, comme toutes les séparations de ce monde qui ne sont pas définitives.
Ce n'est qu'une question d'années… Maintenant, il ne faut pas vous inquiéter
pour moi. Tâchez de vivre en acceptant sans trembler l'idée que nous ne nous
reverrons peut-être que dans l'autre vie. Comme cela, si je reviens, la joie
n’en sera que meilleure. Mais Dieu sait ce qu’il nous demande et pourquoi.
Prions-le toujours avec plus de foi et de confiance pour lui demander, non pas
ce que nous désirons, mais de qu’il désire pour nous. Courage ! Faisons
encore mieux notre devoir de chaque jour. C’est le meilleur et le plus sûr des
refuges en attendant l’autre ! » 15
juillet. Ferdinand reçoit la visite de ses parents qui vont se recueillir sur
la tombe de Jean au col D’Anozel. 16
juillet, du camp d’Haeslen, il décrit à ces parents ce que représentent, pour
lui, les liens familiaux : « Depuis que je vous ai quittés, je
garde de vous avoir vus un peu plus de calme, un peu plus de douceur et de
paix. Maintenant, il me semble aller plus tranquillement vers la destinée,
quelle qu'elle soit. Peu m'importe ce qu'on dit, ce qu'on fera, ce qui
arrivera. Je sais, je sens à chaque minute que vous êtes au même instant
quelque part sur cette terre, que vous m'aimez, que je vous aime, et que cela
est plus fort que tout le reste. Que Dieu est bon d'avoir permis cette réunion
de quelques jours ! Ce qui arrivera désormais ne tiendra pas beaucoup de place
à côté de ces trois jours, les plus beaux que j'ai connus depuis cette guerre.
Comme on sent bien que rien ne détruira jamais les liens qui unissent plusieurs
êtres pour en faire une famille. La mort ? Mais elle ne fait que les raffermir
encore en les éprouvant. Ces liens, ils sont quelque chose de nous-mêmes, non
pas de nos corps qui périssent et auxquels ils survivent, mais de nos âmes
qu'ils font participer éternellement à une même vie. » 
Le capitaine de Peyrelongue Le 29 juillet, deux
compagnies du bataillon de Ferdinand montent à l’assaut du Barrenkopf. Les
pertes sont lourdes. Le capitaine de Peyrelongue qui commande la première
compagnie est tué raide en sortant de la tranchée. Des mitrailleuses cachées
dans les carrières du Schratzmaennelé, prennent les chasseurs en enfilade. Les
Allemands sont retranchés derrière un enchevêtrement inextricable de chevaux de
frise, de fils de fer et d’abattis. Les chasseurs ne peuvent rien contre la
ligne de la Garde prussienne et tombent en masse. Toute la nuit, c’est un
défilé de brancards vers l’arrière pour évacuer les blessés. Le destin des
soldats ne dépend pas de leur courage. « Il se peut ici que
le plus brave et le plus courageux soit tué au premier pas qu’il fait hors de
la tranchée et que le moins courageux, épargné par le hasard du champ de
bataille, récolte seul les fruits. (…). Vraiment j’éprouve souvent pour mes
hommes une admiration profonde en considérant le mérite qu’ils ont à mener sans
se plaindre, loin de leurs foyers et de leurs familles, cette existence humble,
effacée, presqu’impersonnelle, à accepter sans révolte et même avec bonne
humeur d’être les vrais instruments de la victoire tout en restant dans l’ombre
et dans l’oubli… » Ferdinand en sort avec un éclat dans le
bras gauche. Il est évacué vers Gérardmer où l’on effectue une radiographie et
l’extraction du projectile. Le
9 août, toujours en convalescence à Gérardmer, Ferdinand reçoit la visite du
drapeau des chasseurs tenu par le général de Pouydraguin qui le présente à tous
les blessés. Chaque bataillon en a la garde pendant quatre jours. 
Le général de Pouydraguin Le
13 août, le capitaine Belmont rejoint enfin sa compagnie, cette fois près du
sommet de ce fameux mont Linge. Le
15 août, dans un misérable abri de pierres et de branchages, il y a la messe.
« Quelle ferveur, quelle poésie, quelle valeur elles prennent, ces messes
célébrées n’importe où, sur les autels de fortune, par des soldats et pour des
soldats ! » Assaut du mont Linge Le
18 août, assaut de la crête ravagée du mont Linge défendue par un blockhaus et
une tranchée. Après une préparation d’artillerie, les chasseurs parviennent à
atteindre la crête sans rencontrer de résistance mais la victoire n’était pas
acquise : « C'était trop beau, hélas ! A peine la ligne boche
était-elle occupée, à peine les travailleurs, protégés par les lanceurs de
pétards, commençaient-ils à entasser la terre dans leurs gabions que des
marmites boches, avec une précision mathématique, s'abattaient sur la position,
écrasant en une minute : une section de la 4e compagnie, dont un
officier est tué, l'autre blessé, En même temps, deux fourneaux de mine explosaient
sous la tranchée et le blockhaus, faisant voler en l'air des gabions, des sacs,
des armes, des morceaux d'étoffe bleue et... des membres ! Dix minutes après,
les survivants des deux compagnies étaient redescendus à la ligne de départ.
Une foule de casques à pointes grouillaient de nouveau sur la crête. Barrage
d'artillerie, vacarme assourdissant, appels irrités au téléphone, Je reçois
l’ordre de recommencer l’attaque. Pour éviter de nouvelles et vaines
hécatombes, je prends sous ma responsabilité de ne pas essayer de nouveau. Je
ne m'en suis pas repenti une minute. Et nous sommes toujours là ! et le 11ème
est en ruines et attend avec résignation qu'on le relève. Pauvre 11ème,
il me reste à peu près 70 hommes en ligne. Ce linge est le tombeau de nos
chasseurs. » 
Le Linge aujourd’hui Le
26 août, le bataillon est mis au repos. Ferdinand peut rentrer quelques jours
saluer ses parents. « Mais qu’ils passent vite ces jours bienheureux,
dans la douceur du foyer retrouvé, ces jours qu’on a désirés tant de fois, si
ardemment, aux heures des rêves nostalgiques ! Cependant, il faut savoir
en éprouver le bienfait. Tout passe… La guerre aussi passera… et puis ce monde.
Sachons cueillir les joies que dieu nous donne le long de la route. » Réflexion sur la Foi à Corcieux Le
7 septembre, Le capitaine est déjà de retour dans sa compagnie qui se rend au
bord du lac Noir. Le 12 septembre, avec
ses hommes, il descend à Plaimfaing et,
de là, à Corcieux où le bataillon doit se entraîner les nouvelles recrues
venues combler les pertes. Ferdinand
réfléchit sur la condition humaine : nous pressentons l’infini mais nos
connaissances en resteront à jamais limitées. Ainsi seule la foi est en mesure
de nous satisfaire : « Nous aussi nous sommes relatifs, limités à
nos moyens très infimes de connaissance. Dans ce domaine, dont notre ignorance
est I 'enceinte, nous pouvons nous mouvoir librement. Ce qui nous est
particulier, c'est que nous sentons notre relativité ; et notre premier
mouvement d'orgueil est pour protester et nous révolter : pourquoi l'infini que
nous devinons, que nous sentons partout, de tous côtés, au fond de tout,
pourquoi nous est-il fermé ? Si, pareils aux animaux (et encore, en sommes-nous
sûr pour les animaux ?), nous n'avions, aucun sentiment de l'absolu, nous
vivrions comme eux, satisfaits du monde que nous connaissons et parfaitement
maîtres de nos mouvements dans les limites de ce monde. Seulement, nous savons
que fout ne finit pas à l'horizon de nos perceptions. Tout le mérite de la vie
est là : dans un acte d'humilité et de foi. Le plus grand esprit, la plus haute
intelligence de ce monde seront estimés, glorifiés, flattés ; mais il y a plus
de vertu dans l'âme la plus humble si elle se dit une seule fois sincèrement :
je crois. (…) La foi est comme les grandes découvertes : elle jaillit tout
d’un coup de l’obscurité et elle apparaît instantanément si simple qu’on se
demande comment on l’a cherchée si longtemps. » Souvenir d’enfance concernant les marrons appelés « vaches » 27
septembre. Les jours diminuent. Le changement des couleurs rappelle à Ferdinand
son passé heureux et lui fait écrire ces magnifiques phrases : « Je
me rappelle, avec celle étrange netteté que gardent si souvent les plus
insignifiants souvenirs d'enfance, l’intérêt que nous inspiraient, dans le
jardin de la rue des Alpes, ces marrons tendres que nous appelions des vaches,
à cause de leur robe brune et blanche. Ainsi des images banales s'impriment
dans nos mémoires et, sans que nous sachions pourquoi, tout ce qui les évoque
revêt ensuite un charme et une douceur particuliers. C'est si vrai que nous
nous retrouvons partout ! Ce n’est pas vraiment un objet que nous aimons :
c’est nous-mêmes que nous aimons à travers cet objet. » Le
5 octobre, le bataillon est arrivé dans le Haut-Rhin où il cantonne dans les
villages de Frais et de Fontaine. Ce séjour n’est pas long puisque le 15
octobre, c’est le retour à Gérardmer via le train pris à la gare de Belfort. A nouveau près de la crête du Linge Le
20 octobre, le bataillon s’en est retourné près du Linge dans le
Schratzmaennelé. Ferdinand y rencontre le commandant du groupe des chasseurs le
colonel Antoine de Reynies[2]
qu’il admire beaucoup. 
Le colonel Antoine de Reynies est à gauche, casqué Un colis envoyé par les Allemands Le
31 octobre, petite aventure amusante sur le front. « Je viens d'être
interrompu par une aventure originale : les Boches qui occupent la crête
géographique du Schratz, à faible distance de nos lignes, ont jeté une boite en
carton, lestée d'un caillou, qui est venue tomber dans notre tranchée, La boîte
portait une étiquette d'envoi avec l'adresse d'un soldat boche. Cette étiquette
avait été soigneusement grattée, mais sur un des côtés extérieurs de la boîte
étaient écrits en grosses lettres, au crayon bleu, ces mots : « Hast
du kein kugelmehr ? » (Est-ce que tu n’as plus de balles ?) L'explication
de ce message peu banal est simple : dans l'après-midi des hommes de la section
la plus rapprochée des Boches s'étaient amusés (on s'amuse comme on peut !) ;
envoyer des pierres à ces messieurs avec des frondes faites d’un bout de toile
et de deux ficelles. Les Teutons ont voulu répondre à cette attention délicate,
d'ordinaire, ce sont surtout des pétards ou des boîtes à mitraille qu'ils nous
expédient ainsi par la voie des airs ; aussi cet objet anormal a-t-il excité au
plus haut point l'intérêt et la curiosité des chasseurs, qui se sont empressés
de m'apporter le corps du délit. Comme une politesse en vaut une autre, j'ai
renvoyé la même boîte pleine de journaux français se rapportant à nos dernières
victoires en Champagne, en y joignant un billet sur lequel j'ai écrit en
allemand : « Viens seulement, et tu verras si les Français n’ont plus de balles
pour les Allemands ». Décoré de la Légion d’Honneur Le
4 novembre, Ferdinand est décoré devant sa compagnie de la Légion d’honneur. « A travers l’émotion de cet honneur qui
m’écrase, je ressens comme un remord d’amertume de tant d’oublis et j’éprouve
comme le sentiment d’une injustice. Pauvres bougres, pauvres gosses qui sont
tombés dans les sapinières d’alsace, dans les plaines du nord ou de la Flandre,
pauvres petits chasseurs. (…) Les héros, où sont-ils ? Ils n’ont ni galon,
ni médaille ; ils sont invisibles et innombrables. (…) Est-ce que Jean,
Joseph n’ont-ils pas fait chacun cent fois plus et mérité cent fois mieux que
moi ? » Le soir, les hommes du capitaine lui font
une surprise : à l’heure du souper, un chœur de chasseurs vient en son
honneur donner une aubade et termine ses chants par une acclamation :
« Vive le capitaine Belmont ».
10
novembre. « Aujourd’hui, c’est le farouche automne hurleur qui passe.
(…) Les grands chênes de Fontaine-Froide
doivent gémir sinistrement, et sur l'eau froissée des étangs solitaires, toutes
les feuilles de nénuphars doivent se soulever en disques noirs. Des bandes
d'étourneaux doivent passer en nuages, au ras des terres brunes, et les
ramiers, en vol ample filent sans doute par-dessus la tête fauve des arbres,
emportés dans le vent. Il fait bon, alors, après une promenade ou un tour de
chasse, retrouver la tiédeur odorante de la pièce où ronfle un bon feu de bois.
Les bons moments que nous avons connus là-bas, dans le vieux nid de famille,
quand nous y passions les bienheureux automnes paisibles
d'autrefois ! » Des nuits féériques malgré la guerre 19
novembre. « Les nuits sont féériques : cette blancheur, ce silence
et la lune qui monte lentement à travers les colonnes brisées de spins,
dressées comme des piliers abandonnés de très vieilles ruines et dont les
ombres découpent de longues tranches obliques, le froid qui semble descendre
avec la lumière de ce ciel immobile, transparent et profond, le recueillement,
la majesté des montagnes au front invinciblement serein, peut-être aussi
la pensée vague du destin qui nous a conduits jusqu’ici, ou bien l’âme errante
de tous ceux qui dorment en paix sous ce linceul, tout cela saisit, empoigne
d’une émotion inexprimable. Vraiment, on se sent petit, petit, derrière
l’éternel mystère ! se peut-il que l’existence d’un seul d’entre nous ait
quelque raison d’être pour cet univers ? » Le beau village de Pairis 29
novembre Le
bataillon séjourne dans la vallée de Pairis. Ferdinand occupe dans le village
une cave spacieuse et rareté, celle-ci est éclairée par électricité ! 14
décembre « Dans notre cave, nous
vivons gaiement ; la meilleure humeur règne à table autour de laquelle se
groupent toujours une dizaine de convives ; car Pairis est fréquenté par
de nombreux visiteurs qui savent y trouver bon accueil. La nuit nous dormons
comme des loirs dans cette vaste cave qui est, décidément, un des endroits les
plus exquis que j’ai connus. » Le Vieil-Armand 21
décembre, le bataillon a mis fin à son séjour à Pairis pour rejoindre
Zainvillers, à 18 km de Gérardmer. Il n’y reste que quelques heures puisqu’il
arrive le 25 décembre à 4 heures du matin sur les pentes du Vieil-Armand. « Cela manquait au 11ème de
n’avoir pas connu le Vieil Armand ! Maintenant nous y sommes ! » 
Le vieil Armand hier… 
Le Vieil Armand aujourd’hui… La dernière lettre du capitaine Belmont 27
décembre. Fernand écrit sa dernière lettre, elle est adressée à son frère
Maxime… « Si loin que puisse
parvenir notre connaissance, elle sera toujours impuissante à résoudre les
seuls problèmes qui se posent, en fin de compte. Il faut que le cœur dépasse
l'intelligence et se jette au-devant de la foi qui l'appelle. Celui qui a fait,
une seule minute de sa vie, un acte de foi sincère ou bien une prière fervente,
a conquis plus de vérité que le plus laborieux génie. La foi du charbonnier
élève plus haut que l'intuition des plus grands savants. Bien souvent la façon
dont jugent et parlent les hommes pourrait faire se méprendre sur le chemin de
la vérité ; c'est que les hommes se trompent, et on ne peut leur demander que
de se savoir ignorants. Nous ne voyons jamais en ce monde que des apparences,
des formes, des effets isolés ; nous ne pouvons rien en conclure. Si le monde
caressé et flatte celui-là parce qu'il est intelligent, éloquent, riche ou
bienfaisant, on ne doit pas en conclure que celui-là soit un modèle de
perfection à imiter. Le plus parfait et le plus vertueux des hommes est
peut-être le plus obscur et le plus ignoré, de sa naissance à sa mort. Mais
alors, où chercher les conseils, les règles, la discipline dont on sent le
besoin ? A qui demander la solution des problèmes qui se posent pour chacun
d’entre nous ? A Dieu d'abord, puisqu’il veut le bien ; et parmi nous, à ceux
qui veulent notre bien parce qu'ils sont les délégués de Dieu auprès de nous ;
à ceux surtout qui nous aiment, parce que pour faire du bien à quelqu'un, il
faut d'abord et avant tout l'aimer. « Aimer, disait, je crois, le Père Gratry,
c'est vouloir le bien d’un autre » Quelle belle définition de l’amitié ! Au
fait, je ne sais pas ce que je t’écris ; je crois plutôt que je pense par écrit
avec toi. C'est bien un entretien, mais à grande distance. Nous sommes toujours
environnés de tonnerres sur les pentes inférieures de l'Hartman, presque au
seuil de la plaine bleuâtre et mouillée d'Alsace qui s'étend jusqu'à la ligne
embrumée de la forêt-Noire. Les Boches bombardent violemment ; nos canons
répondent. Pas d'attaque encore aujourd'hui. Au revoir ! Je te charge
d'embrasser tout le monde là-bas comme je t'embrasse avec ma fraternelle
tendresse. La mort de Ferdinand : Lettre du lieutenant Verdant aux parents de
Ferdinand « C'est
avec un profond respect et le cœur bien serré que j'accomplis la tâche pénible
dont m'a chargé monsieur votre fils, Ferdinand Belmont, mon capitaine. Au
combat du 28 décembre dernier, à 4 heures du matin, pris sous un violent bombardement,
monsieur votre fils, avec quelques agents de liaison et moi, était blotti sous
un abri quand un méchant éclat d'obus vint frapper le bras droit de mon
malheureux capitaine. De suite, avec un courage digne de tout éloge, il s'est
vu frappé mortellement. Son bras était presque sectionné au-dessus du coude.
Alors, avec un sang-froid admirable, il m'a chargé de la pénible mission de
vous prévenir du nouveau malheur qui allait encore frapper ses chers parents,
déjà tant éprouvés par la guerre. Il m'a chargé de vous dire, monsieur, que sa
dernière pensée était pour ses parents, qu'il regrettait le chagrin que sa mort
allait leur causer, mais qu'il était heureux d'avoir accompli son devoir
jusqu'au bout. C'était un brave et loyal garçon, bien aimé de ses chefs et
surtout de ses subordonnés. Les officiers et les hommes de sa compagnie avaient
pour lui une véritable vénération. Pour sa compagnie et pour moi, à qui il en a
passé le commandement, c’est une perte irréparable. » 
Ferdinand est enterré à côté de son frère Jean dans le cimetière militaire de Moosch Conclusion Ferdinand
Belmont aurait fait, après la guerre, un « grand homme ». Peut-être
un écrivain, un philosophe, un homme politique, ou même un religieux ? Il reste
pour moi un jeune être d’exception dont la genèse de l’âme reste bien
mystérieuse. Sa sensibilité à la nature, sa Foi comme une montagne en un Dieu
d’Amour malgré la guerre, sa force morale malgré les deuils de trois de ses
frères (il perdit son frère aîné Emile, mort de maladie à l’âge de 17 ans ainsi
que ses deux frères Joseph et Jean à la guerre), son talent d’écrivain et de
chef, son esprit de sacrifice, nous laissent tout simplement pantois. Bien
entendu, nous nous devons aussi de penser aux parents de Ferdinand qui vécurent
la mort de quatre de leurs enfants dont trois à cause de la Grande Guerre et, à
travers eux, nous compatissons à toutes les souffrances rencontrées durant ces
dernières semaines par la population Ukrainienne qui subit la guerre que nous
avions cru naïvement comme appartenant à un passé révolu en Europe. J’espère
vous avoir donné le désir d’aller plus loin dans la lecture de ses lettres que
vous trouverez sans difficultés sur le web Lettres d'un officier
de Chasseurs Alpins (2 Août 1914-28 Décembre 1915) Enfin,
ce dont je suis certain, c’est qu’après la lecture de mon article, la
description des paysages vosgiens faite par Ferdinand vous donnera l’envie
devoir tous ces joyaux de la nature qui, malgré les cicatrices de la Grande
Guerre, ont gardé tout leur pouvoir mystérieux d’émerveiller le cœur de
l’homme. Dr Loodts P. En ce 6 avril 2022 [1] Le 26 août, les 13e et 22e alpins sont dirigés sur Fraize pour soutenir les troupes qui occupent la crête de Mandray fortement menacée. Le lendemain, ils capturent par surprise un convoi de munitions allemand. Les prisonniers, au nombre de 250, sont dirigés sur Gérardmer par Fraize et Plainfaing. On les regarde passer, dans leur uniforme gris fer, avec une satisfaction non déguisée. Furieux de leur échec, les Allemands incendient l'église de Mandray et une douzaine de maisons du village, fusillent des civils innocents. Pendant quinze jours, de terribles combats, où l'on en vient souvent au corps à corps à la baïonnette, vont se dérouler à Mandray. Le village est à plusieurs reprises pris... repris... perdu... reconquis de haute lutte. De l'église incendiée, dont ils ont crénelé les murailles, les alpins vomissent un feu d'enfer sur les assaillants. Ne saura-t-on jamais les prodiges d'héroïsme de nos « diables bleus » ?... D'heure en heure, on amène à l'hôpital des blessés de plus en plus nombreux. Jour et nuit sur la brèche, les docteurs DURAND et HARTEMANN, qui secondent les médecins militaires, se prodiguent avec une abnégation admirable. Voir Fraize est en Première Ligne [2] A ne pas confondre avec son fils
Albert, qui fut un grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale : Albert de Seguin de Reyniès |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©