 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
L’âne d’Erezée
en novembre 1918 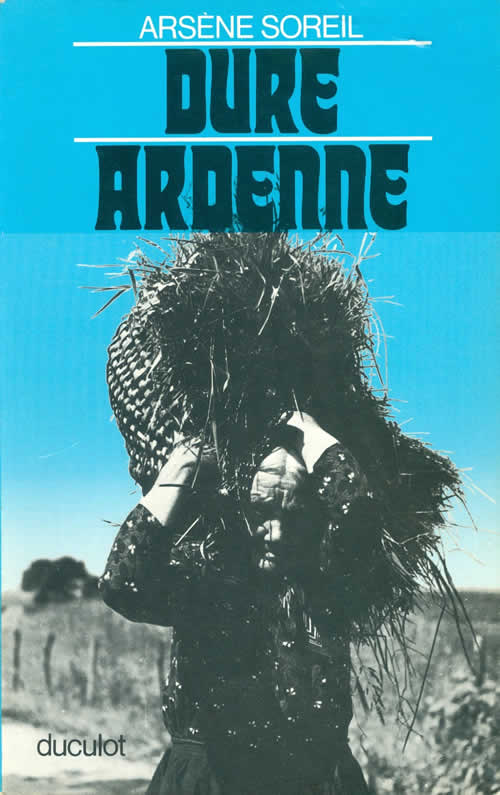
Novembre 1918. L'ennemi battait en
retraite. Précédant les régiments du front, c'était, par nos campagnes, le
défilé intermittent des troupes d'étape, suivant d'une botte pesante le charroi
trépidant. Certains groupes s'en venaient à la
débandade, poussant vers l'est, au petit bonheur, consultant les poteaux, interpellant,
de leurs voix rauques, les paysans abasourdis. Ceux-ci, parfois, s'offraient la
douce vengeance de les renseigner de travers. On laissa plus d'un groupe
s'égarer, à la nuit, vers des villages imaginaires, ou s'embourber avec leurs
attelages de fortune dans des chemins sans issue. Presque chaque soir, notre village
hébergeait quelques-uns de ces irréguliers. Ils entraient dans une maison un
peu au hasard, s'installaient autour du foyer, et, déballant leurs provisions,
palabraient en vociférant : ou bien, mâchant interminablement leur pain noir,
ils gardaient un air buté, refusant obstinément ce qu'on leur présentait. Ils avaient, en général, bien dépouillé leur arrogance de quatorze. Ces vaincus entraient peu à peu dans leur nouveau rôle, et sans doute ne demandaient-ils qu'à être oubliés dans leur coin, où ils se faisaient tout petits. Autour du quinquet tôt allumé, la famille soupait en leur tournant le dos, sans manifester, d'ailleurs, au moins par prudence, aucun sentiment de triomphe. Mais ils pouvaient voir, une fois la vaisselle lavée et emportée, la table encore fraîche se charger de papiers de soie, les doigts les plus agiles confectionner des roses et des guirlandes, l'aiguille maternelle assembler les trois couleurs si longtemps proscrites ! On répétait, sur des airs de complainte, des couplets pleins de bonne volonté, composés nul ne savait par qui et propagés patriotiquement de village en village. Les commères avaient eu toute la journée pour papoter de seuil à seuil, aux champs, aux fontaines, à la « boutique », sur la grande affaire du moment : le retour attendu des soldats de la commune. On imaginait les choses avec une ingénieuse naïveté. Un message officiel annoncerait, pensait-on, l'heure d'arrivée des braves à la station prochaine. Le village tout entier s'ébranlerait alors, précédant et suivant les chars à bancs enguirlandés, chargés d'enfants. Le mayeur et M. le Curé tiendraient prêtes des harangues bien tournées. La fanfare, toutes médailles cliquetantes, se déploierait face à la barrière, attendant pour éclater l'entrée en gare du glorieux convoi. Par ces mornes journées de novembre, la besogne manquant ou ne pressant guère, les hommes devisaient, avec de longues pauses, au coin des fumiers, aux portes des granges, à la forge. La pleine joie se réservait encore, mais on attendait tous les bonheurs. Les longues avanies allaient être oubliées, justice serait faite des accapareurs, chacun serait payé selon ses œuvres. Toutes les âmes simples qui ont vécu les grands espoirs de ces semaines vacantes n'en ont pas encore perdu la nostalgie. Mais ceux qui s'amusaient le plus, tout entier, eux, à l'imprévu du présent, c'étaient les enfants et les tout jeunes gens. Livrés presque tout le jour à eux-mêmes, ils couraient ici et là, le nez au vent, en quête de butin : quelque harde grise, une pièce de harnais, du fil téléphonique. Parfois, las de rafistoler un bagage branlant, les minables trimardeurs se délestaient, et on faisait, pour quelques marks, de fameuses occasions. C'est ainsi qu'un après-midi, trois soldats traversèrent Wéris, avec, à leurs trousses, les premiers gamins qui les avaient aperçus. Les trois hommes réglaient leur pas sur le trottinement d'un âne qu'ils avaient chargé de leurs effets. La pauvre bête n'en menait pas large. Elle boitait. Plus d'une fois, il fallut s'arrêter pour la laisser souffler. Les trois Allemands la flattaient et l'encourageaient de bonnes paroles, dans la langue de leur pays. Trébuchant à chaque pas, l'âne parvint tant bien que mal aux dernières maisons du village. Devant celle de maman Durdu, les soldats s'arrêtèrent tout de bon pour se concerter, et, un bref colloque les ayant mis d'accord, ils cherchèrent autour d'eux à qui proposer la bête. Il n'y avait là, faisant cercle silencieusement, qu'une dizaine de galopins. A tout hasard, pourtant, l'un des hommes étala ses doigts jusqu'à quatre fois et dit en allemand : - Quarante marks. La bête était bien tournée, d'apparence jeune, avec des pattes fines, une tête modérément longue pour un âne, un beau poil. Mais enfin, c'était un baudet ; son braiment seul eût déshonoré une étable. Les gamins s'entre-regardaient. - Trente marks ! dit le soldat ... Vingt-cinq marks ! A ce moment, apparut sur son seuil le fils Durdu, adolescent déjà grave, et devenu, pour ainsi dire, auprès de sa mère veuve, fermier en titre. Il se rendit compte de ce qui se passait et vint, lui aussi, considérer la bête. Les soldats n'en prétendaient plus que vingt marks. Il en offrit quinze et fut pris au mot. Il retourna quérir l'argent et revint avec trois billets, qu'il compta aux soldats. Ceux-ci, après s'être partagé le barda, s'éloignèrent dans la direction de Barvaux. Autour de l'âne et de son acquéreur, ce fut une jubilation. La mère Durdu avait mis le nez à la porte et s'informait. Son premier mouvement fut de gronder le jeune homme ; mais, bonne femme, elle s'intéressa à la bête quand elle vit qu'elle boitait. La jambe douloureuse fut inspectée et pansée. On ouvrit le petit clos plein d'herbe attenant à la maison, et l'âne, comprenant l'invitation, se mit à paître de tout son cœur. Quelques gamins goguenardaient. On criait : - Holà bourrique !... Hé Martin ! Au fait, quel était son nom, à cet animal ? Comme il ne pouvait être question de le lui demander, on prit le parti de le rebaptiser séance tenante. Des noms à coucher dehors furent proposés, parmi les éclats de rire. On criait tous ensemble, on trépignait, on s'amusait. Le fils Durdu laissa cette verve se calmer, puis il décida, comme c'était son droit : l'inconnu prendrait nom Maximin. 
Ceux qui ont connu Maximin sentent mieux qu'ils ne peuvent l'expliquer combien ce vocable lui allait bien : grave, un rien solennel, je ne sais quoi d'épiscopal. La mère Durdu songeait tout haut : - Une bête de réquisition, bien sûr. Et Dieu sait d'où il arrive, éreinté comme il est ... Du fin fond de l'Ardenne, si ce n'est même de plus loin. On avait fait bonne œuvre en l'adoptant. A défaut de retrouver son patelin, il resterait, du moins, chez des amis. Quant à employer Maximin, la mère Durdu n'y songeait pas. Ce fut là une idée de Julien. La jambe malade une fois guérie. - il n'y fallut qu'une paire de jours -, le jeune fermier déclara son intention. La mère Durdu crut qu'il plaisantait. Atteler un âne, eux, d'honnêtes gens nantis de terres ! Atteler un âne comme les gueux des roulottes et les chaudronniers ! Julien ne se laissait pas démonter. - Je mettrai Maximin en tête de l'attelage, expliquait-il, devant mes vaches couplées. On peut toujours se moquer : moi, je m'en fiche. Au moins, maintenant, je ramènerai des charretées pleines. Un âne et deux vaches, ça vaudra bien un cheval, à mon idée. Tenez, mame, notre moie de fagots qui attend là-bas dans les fonds, nous n'en finirions pas avec nos vaches toutes seules. Maximin était justement le renfort qu'il nous fallait. Laissez-moi faire. Il paraît que le départ du chariot, le lendemain, fut un succès. Les voisins, estomaqués, parurent un à un sur le seuil des étables et s'approchèrent pour assister au détail du harnachement. Quand Julien leva son fouet, ce fut un rire général. La mère de Julien souriait, de son côté, par contenance, mais elle hochait la tête, assez mortifiée de la tocade de son gamin. Quant au jeune homme, il menait bon train, enchanté de voir le grison, franc du collier, tricoter en tête de l'attelage, et comprendre comme un vieux serviteur le langage des harr, des hott et de la bride. Les fagots en question gisaient en tas dans un endroit impossible, un de ces ravins boisés qui procurent aux charmants villégiateurs de Barvaux l'illusion d'une petite Suisse, et que les indigènes dénomment, sans tant de poésie, les laids thiers. Julien, une fois rendu, chargea le chariot à son idée, c'est-à-dire tout de même un peu bien fort. Il tendit de son mieux la corde qui serrait l'édifice des fagots, et, quand tout fut prêt pour le départ, saisissant la bride, il cria : - Hue ! Le véhicule gémit, tangua légèrement, s'ébranla. On était, au départ, sur terrain presque plat. Mais tout de suite venait la côte. Maximin se raidit, tête et pattes, tout en diagonale, grattant, s'agrippant, entraînant derrière lui les vaches flegmatiques. La côte fut enlevée d'une traite. Julien ramena triomphalement et à vive allure sa haute charretée, qui fut suivie, le même jour, de plusieurs autres. La preuve était faite du zèle et du savoir-faire de Maximin. On s'étonna, on admira, et on s'habitua peu à peu, dans le patelin, au baroque attelage. Au reste, l'attention était ailleurs. Le bruit courut, un matin, que le fils Rémy était rentré la veille, à la brune. Un deuxième, le lendemain, traversa la moitié du village sans être reconnu. Son kaki l'avait fait prendre pour un Canadien. Il en fut ainsi des autres. Ce n'était pas de jeu, vraiment ! Les jeunes filles, déçues, chantèrent, à la veillée, leurs plus beaux couplets aux oreilles distraites des guerriers, qui s'informaient des prix atteints par le beurre et du bétail accru pendant leur absence. Quant à la fanfare, elle vint donner l'aubade, en détail, aux portes des maisons favorisées par le retour d'un soldat. Il y eut d'autres surprises. Un beau matin, arriva dans le village une commission officielle chargée de récupérer le cheptel égaré. Ces messieurs, très comme il faut, mais énergiques, miraculeusement renseignés, allèrent droit aux étables recéleuses. Ils ne dédaignèrent pas Maximin lui-même ; gros chagrin pour la mère Durdu, maintenant toquée de son âne. Julien le conduisit à Barvaux, rendez-vous fixé pour le rassemblement. Le brave garçon musa tout le jour à proximité des troupeaux, l'œil sur sa bête, obsédant l'officier qui commandait. Celui-ci, très affairé, faisait la sourde oreille. Mais vers le soir, il se laissa fléchir, comme s'il n'eût voulu qu'éprouver la patience du jeune homme. Julien, fou de joie, bondit sur le baudet et revint à cru, au petit trot. Je ne prétends pas vous intéresser, lecteur, à la chronique des faits et gestes de mon humble héros. Disons qu'il prit à cœur de justifier la bonne opinion qu'on avait de lui dans la commune et, paraît-il, dans quelques autres villages à la ronde. Tous les seuils lui étaient accueillants lorsqu'il lui prenait envie, au sortir des brancards, de courir un peu le village. Il était d'ailleurs très convenable, ne dépassant jamais lesdits seuils que de la longueur de son cou, de sa tête tendue, pour recevoir la bouchée de pain ou le morceau de sucre. Mais sa fortune en vint à un excès plus extraordinaire encore. Ce fut quand Julien acheta un cheval, comme tout fermier un peu à son aise, et qui se respecte. Les deux vaches redevinrent de simples laitières, et Maximin n'eut désormais rien d'autre à faire que traîner de temps à autre une carriole légère, achetée tout exprès pour les petits déplacements de maman Durdu. A l'époque de la moisson, Maximin, cela va sans dire, en mettait aussi un coup. Parfois, enfin, quelque villageois l'empruntait pour quérir un colis à la station. Dans l'intervalle de ces menus services, Maximin tondait à loisir l'herbe luisante du petit clos, sans effaroucher les poules ni écraser, au printemps, leurs étourdis de poussins. De temps en temps, pour rompre l'ennui d'une félicité si égale, le camarade s'offrait la diversion brève d'un cumulet. Cet exercice, précédé et suivi de tant de dignité, surprenant toujours le passant, jetait quelque désarroi dans le monde des gallinacés. Aux vacances, maintes fois, je me suis attardé face à la barrière du clos. Je ne songeai d'abord qu'à complaire, indulgent papa, à certain petit bonhomme ami des bêtes, qui aurait passé des heures à considérer Maximin. J'ai gagné par un nombre respectable de morceaux de sucre l'amitié du béat pensionnaire et, par la même occasion, celle de cette bonne madame Durdu. Te rappelles-tu, Poulot, la première promenade que tu fis, bien serré contre elle, dans la carriole ? La trépidation légère du siège imprimait un joli tremblement à tes bonnes joues. Tu étais grave ; tu tenais à deux mains le fouet bien perpendiculaire, et tout décoratif. A la barrière aussi, écoutant d'une oreille distraite tes questions ingénues, il m'est arrivé le recomposer à plaisir le passé de Maximin. D'autant plus arbitrairement que j'avais moins de données. Le sage aux longues oreilles ne laissait pas d'avoir, à l'occasion, des allures assez étranges. Je l'ai vu s'arrêter soudain de paître, comme à l'appel d'un songe, puis esquisser des pas contrariés, tracer des figures sur le gazon, avancer, reculer, virer, faire soudain un tête-à-queue, comme si des images anciennes, un instant ravivées, eussent déclenché en lui de mystérieux commandements. Maximin, pensais-je, avait-il été baudet savant dans un cirque ? Ses oreilles, désormais attentives au caquetage des poules et aux bourdonnements aériens, avaient-elles recueilli la rumeur des foules ? Ce museau lent avait-il humé les fumées de la gloire ? Mes imaginations se donnaient ainsi toujours plus de champ, alors que Maximin, depuis longtemps, s'était remis à manger, comme une brave bourrique sans histoire. J'avais beau scruter son œil obscur, lorsqu'il daignait, de son pas précieux, s'approcher de la barrière, s'arrêter à quelque distance, tendre lentement vers ma poche sa longue tête en quête de sucre. La menotte de Poulot s'insinuait entre les montants pour recevoir le souffle tiède du museau mou. Je caressais le chaume des capouls rêches, sur le front haut. Mais si je frôlais seulement ses oreilles, Maximin, froissé, faisait vivement un demi-tour, courait deux, trois pas, et se remettait à paître, sans plus s'occuper de nous. Toutes les créatures sous le soleil ont leur destin, heureux ou malheureux. Sans doute le Seigneur, en créant l'âne sobre et patient, le vouait-il au chardon maigre plutôt qu'à l'herbe drue qui vous monte au ventre. La malchance congénitale sut retrouver, au temps marqué, notre Maximin. Elle prit la figure d'une accorte Condruzienne que Julien Durdu, un beau jour, alla chercher pour femme. La jeune fermière, un peu glorieuse, ne vit pas d'un bon œil le mangeur d'herbe et se jura secrètement de s'en défaire, ne voulant pas « être d'une maison où il y avait un baudet ». Elle n'eut d'ailleurs pas à découvrir son aversion pour parvenir à ses fins. Rendons cette justice à la petite femme qu'elle était active et diligente, économe. Elle fit agrandir le potager au détriment de l'herbage, renouvela la basse-cour par des couvées, se défit des cochons, qui rendaient peu. En revanche, elle voulut élever des veaux. Or, une difficulté se présentait : le manque de place ; faudrait-il agrandir l'étable ? Les entreprises de la bru effaraient un peu la belle-mère, qui s'arrangeait fort bien de la bonne routine. Pour avoir la paix, on composa aux dépens de Maximin. Il fut convenu que, la place de l'indésirable étant toujours bonne à prendre, on substituerait à celui-ci un veau. Mame Durdu aurait eu honte de répondre sentiment à qui parlait raison. Quant à Julien, il était coiffé de sa femme, et le sacrifice du vieux camarade lui parut chose assez légère. Or, la sournoise avait déjà preneur pour le baudet. Elle fit savoir à certain pauvre diable du village que la bête convoitée serait à lui quand il voudrait. Dès lors, pour Maximin, adieu beau temps ! Il fallut bourlinguer à la pluie, au soleil, par monts et par vaux, ne se reposer que quand son rapiat de patron n'en pouvait mais, de son côté. Parfois, le malheureux, ahanant dans les brancards, repassait devant le clos de son bonheur, à jamais perdu. Le rustaud grognait d'avance entre ses dents : - Bête d'animal ! Tu vas voir qu'il voudra encore tourner vers son clos. Maximin, comme tiré par un aimant, esquissait un mouvement têtu vers la petite barrière. Alors, parfois, mame Durdu paraissait sur son seuil, un morceau de pain à la main, et le maître rentrait sa rage pour faire l'honnête. Mais si la porte demeurait fermée, Maximin n'avait qu'à reprendre vivement le milieu de la route, sur l'injonction précise de quatre ou cinq coups de bâton bien tassés. On m'a raconté ces choses aux dernières vacances, en même temps que la fin du pauvre baudet, car, vous savez, il est mort ... Les petites gens de nos campagnes se passent encore un sage dicton des manants leurs aïeux : Sers plutôt le riche arrogant que le pauvre comme toi. Maximin n'était pas échu à de méchantes gens, bien sûr ! Mais, là où les gens vivent quasiment comme des bêtes, quel peut être le sort des bêtes elles-mêmes ? Maximin, réputé infatigable, traînait toujours plus que son compte, dans une maudite charrette trop large, dont les cahots lui martyrisaient les côtes. Avec cela, le pauvre avait toujours faim. Il ne mangeait guère qu'à temps perdu, le long des routes, écœuré par les ordures des chiens, heureux s'il rencontrait, d'aventure, le long d'une haie dégarnie à l'automne, quelque bonne ronce verdoyante. Le pacant remarquait à part lui : - C'est tout de même vrai qu'un baudet, ça vit de rien. Il eut le tort de pousser l'expérience trop loin, comme le propriétaire du célèbre cheval. Un soir, Maximin remontait de ces mêmes fonds d'où il avait jadis ramené si brillamment les fagots de mame Durdu. Le vieux lui avait fait bonne mesure de bois mort. Le départ fut pénible ; Maximin s'arrêtait tous les dix pas, insensible aux coups. La nuit approchant, le vieux s'énervait. Il soulagea le chargement de quelques pièces, qu'il jeta contre le talus. Puis, il poussa à la roue. En s'y mettant à deux, la bête et l'homme vinrent à bout de la côte. Mais Maximin avait donné tout son effort. Il fit encore cinquante ou cent pas sur la route plane, puis il s'arrêta de nouveau, chancela, s'abattit dans les brancards. Un charretier wérisien qui revenait de Barvaux trouva le bonhomme accroupi au bord du fossé, où il avait traîné son âne, pensant le ranimer avec des tapes d'eau froide, puis il l'avait saigné avec son couteau de poche. En vain. Maximin ne donnait plus signe de vie. Le véhicule fut rangé au bord de la route, en attendant le matin ; on hissa la dépouille sur le tombereau et les deux hommes revinrent dans la nuit, l'un plaignant l'autre. Le vieux disait : - N'est-ce pas du guignon ! Une bête que j'ai payée trente-deux napoléons, pas moins, et que j'ai dû encore lui racheter cette charrette ... * * * La première fois que j'ai revu Madame
Durdu, - Monsieur, m'a-t-elle dit,
c'est péché de pleurer les bêtes, mais, que le bon Dieu me pardonne, ça été
plus fort que moi. On ne m'enlèvera pas de la tête que mon pauvre âne est mort
de chagrin ... J'ai cru saisir un remords dans le
regard qu'elle détournait, pour faire diversion, vers le petit clos. Elle
venait de mettre en pâture, pour la première fois, la benjamine de son
troupeau, une petite génisse folichonne. La nigaude se tournait ici, puis là,
tâtait les pointes du gazon moite, faisait une gambade courte, puis, stupide,
nous regardait, ne sachant apparemment ce que l'on voulait d'elle. ARSENE
SOREIL |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©