 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
L’ambulance du jardin
zoologique d’Anvers Introduction Le texte (1) que vous lirez ci-dessous est le seul témoignage connu concernant la vie dans l’ambulance installée dans le zoo d’Anvers. L’auteur en est un certain William Speth dont nous ne connaissons malheureusement pas la biographie. Cet Anversois francophone, féru de littérature et de théâtre, parvint à faire préfacer son témoignage par Emile Verhaeren en 1916. Speth écrit dans un français parfois pompeux. Il dépeint ses personnages en exagérant leurs défauts et qualités comme si il voulait en faire des personnages d’un drame théâtral. Malgré ce défaut, le récit de Speth possède le mérite de nous faire revivre l’ambiance de l’ambulance du zoo. Vous y lirez notamment la truculente description de la soirée cinéma offerte aux blessés en septembre 1914 qui vous amusera en même temps qu’elle vous fera découvrir les âmes rudes et simples de nos aïeux de 14. Il est dommage que l’auteur n’ait pas mentionné les noms des soldats décrits. On aurait bien voulu savoir qui était ce grenadier si vaillant qui mourut à l’ambulance du zoo. J’ai condensé le témoignage de William Speth en omettant de reproduire certains paragraphes qui me semblaient inutilement alourdir son récit. Je me suis aussi permis de rédiger des sous-titres qui permettront au lecteur pressé de s’attarder aux seuls évènements qui l’intéressent. Dr Loodts 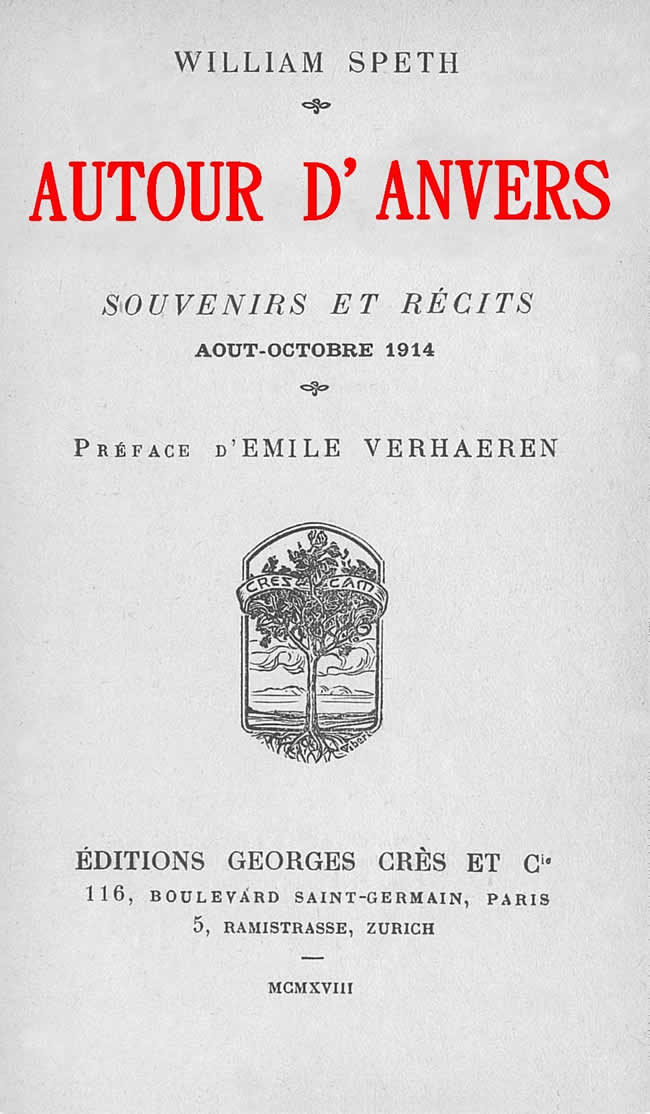
Décembre 2014 Le témoignage de
William Speth[1] Préface d’Emile Verhaeren Vos pages reflètent tour à tour la confiance et l’angoisse, la ténacité et le doute, la grandeur et la faiblesse dont les foules étaient saisies pendant la grande guerre. Anvers est le théâtre où vous déployez ce drame collectif dont tous nous avons frémi, en Belgique. Mille faits, cent anecdotes l’ont nourri. Ce qui me plaît en votre œuvre, c’est le scrupule d’exactitude qui s’y manifeste. On vous croit. Vous vous appliquez à ne rien exagérer, ni à rien diminuer. Si quelque jour un auteur dramatique songe à mettre en scène l’âme d’une foule tragique et douloureuse, il consultera votre livre. Le drame qui est en germe actuellement dans bien des cerveaux de poètes ne pourra s’alimenter qu’à l’immense source d’héroïsme et de malheur dont déborde le monde. Les sentiments qu’il mettra en lumière seront ceux des multitudes bien plus que ceux des individualités. Ce qui frappe en cette guerre, c’est que le premier plan y semble occupé tout entier par les soldats. Le chef est quasi ignoré. Aucun de ses gestes n’est dévoilé. On ne sait même où il commande. Certes on le saura plus tard, mais pour l’instant l’imagination s’est déjà habituée à ne voir la victoire dépendre que des troupes. Elles sont le héros multiple et formidable. Et de même en votre livre, mon cher ami, bien que vous mettiez en scène votre propre entourage, c’est le peuple d’Anvers que j’étudie et que je suis à travers votre texte ; c’est la ville qui agit, qui espère, qui pleure, qui se défend,, qui agonise. Vous m’intéressez à une littérature qu’on pourrait appeler obsidionale. Grâce à vous, mon âme a pu vivre en des milliers d’âmes et sentir ainsi son enthousiasme, sa ferveur, sa tristesse, sa pitié, son devoir comme intensifiés et élargis. C’est ce dont je vous remercie surtout ne tête de ce volume, dont l’écriture, mainte fois, révèle un bel artiste. Emile Verhaeren 
Saint-cloud,
25 octobre 1916 Premiers contacts avec
les blessés Un dimanche après-midi les premiers soldats furent évacués sur notre ambulance du Jardin Zoologique. Depuis quelques jours, les convois lugubres s'étaient multipliés ; la plupart des hôpitaux regorgeaient. La nuit, on était réveillé, comme dans un cauchemar, par le roulement métallique des tramways qui transportaient des hommes atteints serrés sur les banquettes. Ce dimanche-là, je me rendis très tard à mon poste d'attente. Une belle journée se développait, harmonieuse et chaude ; je venais de déjeuner avec des amis spirituels et des jeunes femmes jolie et confiantes. Sur la plate-forme du tramway, j'achevai distraitement mon cigare ; j'admirai en passant quelques jeunes filles, semblables dans leur robe blanche, à de mouvantes taches de lumière. Le petit ruban belge, voyant et vif, piqué à la boutonnière des hommes, se tordait et se dressait, agressif et pimpant. Les bourgeois aux ventres lestés et aux larges figures humectées de sueurs encombraient les terrasses des cafés. Léger, insouciant, malgré l'heure grave, je quittai cette foule soumise, à son insu, à l'irrésistible joie d'un beau dimanche. Je m'enfonçai dans la salle grise où reposaient nos premiers blessés. Si l’antithèse est le sommet de l'art, personne n'a éprouvé jamais une sensation artistique plus spontanée et plus vive que la mienne. Le binocle ajusté sur un nez énergique et mince, le regard perçant, un chirurgien examinait une blessure informe, sanguinolente ou des esquilles d'os perçaient, en flèche, les bourrelets de chairs tuméfiées. Dans un bassin d'émail, des bandages défaits s'entassaient en spirales irrégulières, superposées. A distance égale, des taches de sang, de plus en plus larges, maculaient la toile défaite ; dans un immonde mélange d'iode et de sang, nageaient des tampons d'ouate souillés. La nurse, jeune et élancée, jolie et si fraîche dans sa robe blanche aux manchettes et au col empesés, soutenait la tête brulante du blessé. La plaie immense, béante, lavée, noire d'iode, s'étalait monstrueuse et profonde, au milieu de l'avant-bras. La blessure avait rongé les chairs environnantes et les os seuls semblaient avoir résisté à cette succion bizarre et très grave. Déjà, sur le bandage blanc rattaché, une tache de sang minuscule perçait et grandissait et je m'imaginais cette blessure comme une « bête » vivante, une pieuvre immonde, blottie dans la chair d'un être condamné. Ce soldat étendu là, immobile, le corps serré par les draps rugueux, est un homme doué d'une personnalité unique, animé de pensées propres, grisé peut-être par un grand amour ; mais nous ignorerons l'agitation de son cerveau et les vibrations de son cœur et, pour nous, comme pour le médecin, la « bête » seule existera, nous passionnera et nous torturera peut-être. Dans d'autres lits, des soldats exténués dormaient et, sous les couvertures grises, les corps recroquevillés s’arrondissaient en des monticules étranges, aux formes variées. En s'étirant et se retournant, les malades omettaient des grognements inarticulés. L'un d'eux chantonnait ; un autre invectivait sans discontinuer les Allemands et il nous enseignait des jurons vifs et significatifs ; un des nouveaux venus me demanda un journal que je lui tendis en frôlant sa main moite ; il parcourut rapidement le communiqué laconique, et, baissant ses paupières lourdes, il marmotta : « J'aime mieux ne pas y songer. » Puis, il se retourna sur sa couche, serra ses poings, blottit sa tête bandée dans le creux de l'oreiller. De nombreux blessés restaient immobiles, les yeux ouverts et l'esprit absents. A leur chevet s'entassaient leurs effets que des brancardiers étiquetaient et rangeaient : des capotes durcies par la boue, des chaussures où s'étaient coagulés de la terre mouillée, de l'eau et du sang. Les képis avaient la nuance indécise d'une étoffe sans couleur, lavée et déteinte, et la chemise, humide et défraîchie, s'étalait au sommet de ce monceau de vêtements chiffonnés, écœurante et lamentable. Je circulais entre les interminables rangées ; les brancardiers redressaient un homme mal couché, ou relevaient une couverture défaite ; la plupart de ces blessés éreintés nous remerciaient par un grognement indistinct et bref. Je vais chercher des
provisions pour les blessés de l’ambulance Vers le soir, tous les malades se réveillèrent et s'agitèrent ; les souffrances des plus atteints s’accentuaient ; les mieux portants réclamaient leur repas à grands cris. A la cuisine, comme seule provision, quelques sacs de pommes de terre s’entassaient ; pas de viande, pas de pain, pas d’autres légumes, rien ! Que faire ? L’intendance des hôpitaux nous avait oubliés. Comment conjurer ce cataclysme ? Le dimanche soir, dans la ville agitée, les charcutiers, les boulangers chôment. Non, pas tous pourtant...! Le dimanche des Chrétiens n'est pas le dimanche des juifs. Les boutiques israélites ne ferment pas. On me chargea d'aller quérir des provisions ; accompagné d'une infirmière obligeante je quittai l'ambulance et je fus précipité, de nouveau, dans le remous du public grouillant. Le contraste entre le silence triste et lourd de notre ambulance et les rires de la foule endimanchée me peina et me froissa comme une inconvenance. Nous coudoyâmes de grosses femmes qui se promenaient pesamment, lentement, accrochées au bras de leur mari. Quelques jeunes gens nous bousculèrent en sortant d'un cabaret. Les brasseries regorgeaient de buveurs, entassés jusqu'au fond des allées sombres. En longeant le Viaduc de la gare, nous aboutîmes aux maisons basses ; sales et tristes du quartier juif, en partie vidé par la guerre. Bientôt nous fûmes aveugles par les dorures d'un étalage où s'entassait de la charcuterie que nous eut enviée l'Allemagne ; des saucissons enfilés en guirlandes compliquées, enveloppés de papier de plomb scintillant ; des jambons ornés de collerettes festonnées en papier rose, blanc ou jaune. Des boîtes de conserves s'élevaient en un monument aux proportions hardies et à l'équilibre instable. A ce magasin de « délicatessen », nous préférâmes l'échoppe obscure d'un modeste boucher juif. Derrière un comptoir de zinc terni, une grosse femme, aux seins lourds, au nez proéminent, trônait, majestueuse, L'importance de notre commande déconcerta la marchande qui nous dévisagea, incrédule, pendant quelques secondes. Son regard se perdait dans le vague, comme ses formes gonflées se noyaient dans la graisse molle et flasque, sous des vêtements mal ajustés. Les mains s'étalaient larges, et des bagues massives brillaient ; les doigts courts s'aplatissaient sous des ongles carrés aux bords douteux. Je cru utile d'instruire la bouchère des causes de notre achat tardif et insolite. – « Ah ! fit-elle, sans s'émouvoir, il y a vingt blessés au Jardin Zoologique... Elle abaissa un instant, songeuse, ses paupières jaunes sur ses yeux ternes : – « Huit livres ne suffiront pas, Monsieur, fit-elle. Il vous en faut dix au moins. Et, sans attendre notre réponse, elle ouvrit une porte marquée d'empreintes de doigts gras et elle disparut dans une trappe. Elle revint bientôt, tenant dans chaque main un morceau de viande : dans la gauche, du bœuf sanguinolent ; dans la droite, du veau rose à la chair ferme. Elle jeta la viande sur le comptoir imprégné de taches où des gouttelettes rouges s'étalèrent. Comme si elle eut accompli un rite sacré et grave, elle pesa sa marchandise. Sur son nez bosselé, elle fixa un lorgnon qu'elle approcha du cadran de la balance. Elle louchait d'émotion. Ayant constaté que le poids dépassait quelques peu notre commande, elle découpa deux minces langues de viande, en suivant l’aiguille de la balance d'un œil inquiet et clignotant. Le bœuf fut soumis à la même opération consciencieuse puis la massive bouchère enveloppa les deux morceaux dans une feuille de papier qu'elle couvrit d’un Journal ; les lettres imprimées se diluèrent peu à peu dans les taches de jus et de graisse. Mes impressions sur la
guerre Depuis l'arrivée de nos blessés à l’'ambulance qu’y avait-il de changé dans cette grande guerre ? Rien. Comme précédemment, les hommes ne cessaient de s'entretuer et de se haïr. Mais les impressions s'exacerbaient et nous bouleversaient plus intensément que jadis. Par leurs récits, leurs plaies, leurs souffrances, nos blessés nous entraînaient avec eux dans la lutte sauvage. Jusqu'ici, les couches profondes et secrètes de notre sensibilité n'avaient pas encore été atteintes. Pourtant l'enthousiasme, la haine, la pitié, l'espoir nous exaltaient ou nous dominaient sans discontinuer. La déclaration de guerre nous avait désorbités comme une impossibilité réalisée ; le mépris de l'adversaire avait germé et grandi en nous ; nous avions subi les angoisses brèves de la panique pendant notre fuite de la campagne où nous avions abandonné des êtres malheureux et des paysages connus. Des altitudes simples et rares nous avaient dévoilé la grandeur des âmes modestes, sereines malgré les rafales accumulées et l'absurdité de la vie. L'occupation de notre territoire était une plaie saignante au cœur. Pourtant les sensations et les idées de jadis, productives et fortes, étaient ; submergées maintenant par notre commisération, notre pitié pour nos blessés qui exigeaient des soins, réclamaient de l'abnégation et une parcelle d'amour. De nouveau Malines avait été occupée par l'ennemi et Anvers, entouré d'assaillants, se dressait au centre même de la guerre ; chaque minute avait la gravité et toute la beauté des minutes intenses. Des convois de prisonniers passaient. Des torpédos, grises de poussière, croissaient des aulos-mitrailleuses semblables à des caissons superposés et bizarres ; des voitures usées délabrées mordues par les balles, revenaient des champs de bataille tout proches. Dans les vitres ternies s'encadrait la figure pale d'un blessé, chargé comme un paquet lamentable avec son fusil ct son sac déchiré. Des camions de ravitaillement circulaient en files interminables ; la foule s'écrasait devant les listes de blessés, affichées aux portes des ambulances ; des régiments décimés par le combat défilaient entre deux murs de femmes et d'enfants. Au centre devant la gare, près de l'Etat-Major, dans les cafés les oisifs s’entassaient. De longs chariots montés sur deux roues grêles, trainés en remorque, transportaient des fuselages d’aéroplane. Aujourd'hui encore, toutes ces images se mêlent dans mon esprit dans une sorte de tableau aux couleurs vives ; les tons se heurtent , les épisodes se superposent sans art, mais ce chaos d'idées de figures, d'impressions se résume par un seul mot : « La guerre », en nous-mêmes, se développe un état d’esprit merveilleux, fait d'un aggloméré bizarre de certitude confiante, de fatalisme, et optimisme obligatoire, d’activité raisonnée, de routine naissante et d' incompréhension. Un grand
sous-lieutenant des lanciers Dans notre vaste ambulance, les journées s'écoulaient, rapides et toutes identiques. Le matin, nous donnions d'abord des bains aux éclopés, amateurs fidèles de la propreté rigoureuse. Nos clients ne variaient guère. Pendant trois semaines notre baigneur le plus assidu fut beau et grand sous-lieutenant de lanciers, jovial, bon garçon, choyé par les infirmières et traité même cri enfant gâté par le médecin, auquel il extorquait des permissions exceptionnelles. Cet épicurien guerrier appréciait les femmes, les boissons fortes, l'esprit gaulois autant que les délices de la savonnée et de l'eau tiède. Chaque matin, il brossait ses vêtements avec soin, les pliait et examinait à la jambe une plaie qui ne se fermait pas il jurait et il pestait contre sa maudite blessure qui, malgré lui, le retenait loin des combats. La toilette des soldats blessés Un soldat obèse, le visage poupin, le pied bandé jusqu’au dessus de la cheville, arrivait en sautillant sur une jambe du fond lointain de la salle. Il était interdit de l'aider et il nous défendait de le plaindre. Le savon moussait sur ses reins, il nous aspergeait d'eau et il s'arrosait de bon cœur comme un grand enfant ; mais, quand son pied malade heurtait le fond de la baignoire, il crispait de douleur sa figure joviale ; deux rides verticales, involontaires et fugitives se creusaient sur son front lisse, ses lèvres épaisses se tordaient et il poussait un cri bref de petit oiseau qui se terminait par un éclat de rire, afin de dissimuler la souffrance. Un paysan hâlé et râblé était exact au rendez-vous tous les matins ; il trempait l'extrémité des pieds et des mains dans l'eau, puis il s'en allait, pesant, lassé, sans prononcer une parole. Un jeune carabinier bavardait sans discontinuer et il tordait sa figure en une grimace comique quand, en guise de douche, nous lui versions un broc d'eau sur la tête ; ses yeux larmoyaient et ses longues mèches noires tombaient sur ses oreilles et s'effilaient jusqu'à son nez camard. La pudeur de l’aumônier
blessé L'aumônier venait se rafraîchir au saut du lit. Sa soutane mal boutonnée lui servait de robe de chambre. Pour ne pas offenser la pudeur du prêtre, nous développions autour de sa baignoire un grand paravent de toile cirée dont nous couvrions les jointures par des draps de bain.(…) Tandis que les brancardiers vaquaient à ces occupations prosaïques et indispensables, les médecins examinaient les malades, les infirmières rebordaient leur lit, les dames chargées de la cuisine distribuaient le déjeuner, les femmes de ménage lavaient le plancher à grande eau, et cette ambulance ressemblait à une immense ruche active, où la gaieté triomphait souvent de l'abattement et de la douleur. La salle d’opération Vers neuf heures, nous hissions sur les brancards et amenions les blessés à la salle d'opération. Combien en ai-je porté de ces pauvres diables qui dissimulaient leurs plaintes en riant bien fort, en se moquant de leurs camarades ; beaucoup allumaient une cigarette pour se donner une contenance. Pendant le trajet, leurs yeux cernés se fermaient ; à chaque secousse de la civière, ils étouffaient un gémissement bref ; les plus atteints même s'excusaient de leur poids et ils avaient honte de se faire porter. Dans la salle d'opération exiguë, blanchie au ripolin nous soulevions les patients sur l'étroite table dont la plaque mince couverte d'un drap blanc, reposait sur des pieds de métal ; La nurse déroulait les bandes et le médecin se penchait sur la plaie ouverte. Une vague odeur de chloroforme, d'acide phénique, de lysol et d'iode s'épandait dans la pièce étroite. Nous quittions notre blessé et, à travers la porte vitrée, ternie par une couche de peinture grise, perçait un cri aigu de douleur, un gémissement maîtrisé ou la divagation mystérieuse de l’homme endormi sous le masque de chloroforme. Quand retentissait un appel : « Brancardiers » nous retournions chercher notre client. Sur la table d'opération s'allongeait un être pale, les traits défaits, la peau mate, les yeux fermés, la tête agitée parfois par un frisson insolite; le médecin talait le pouls du patient. Nous ramenions à son lit l’homme exténué. La nurse nous accompagnait et soutenait l’opéré qui ressemblait à un moribond. Quand il passait devant les lits occupés, ses camarades le dévisageaient et hochaient la tête. Tous les jours, nous assistions à cette macabre contrefaçon de la mort : mais le malade se réveilla bientôt, secoué par des spasmes, la raison égarée et l'estomac délabré, ses chairs brûlées par le tranchant du bistouri et, après l'anéantissement, la souffrance recommencera. Un sergent que nous avions surnommé « Mon Général » En une même semaine, nous sortîmes trois fois le même soldat à la salle d'opération blanche ; trois fois il fut endormi, le chirurgien fouilla trois fois la chair : douloureuse. C'était un petit sergent, un corps grêle surmonté d'une tête blonde d'enfant. Les yeux aigus et rieurs nous dévisageaient ; un duvet à peine perceptible ombrait la lèvre exsangue. Ses muscles semblaient fondus par la fatigue, les privations et la fièvre, sa peau se moulait sur ses os minces. Il évoquait sans cesse cette effroyable retraite de Namur où il fut atteint. Nous l'avions surnommé « Mon Général » ; chacun, en arrivant à l'ambulance, s'informait de sa santé. « Mon général » avait-il bien dormi ? « Mon général » avait-il déjeuné de bon appétit ? Dès la première heure, les infirmières le lavaient et pomponnaient « Mon général ». Midi, dix dames empressées lui servaient un potage fumant. Les lendemains d'opération, quand « Mon général » était mis à la diète, tout un cortège s'organisait et un essaim de jolies femmes encadrait la prêtresse qui lui portait le bol de lait et l'œuf à la coque. Un Boute-en-train merveilleux Etendus ou assis, les blessés les moins atteints attendaient leur tour dans une sorte d'antichambre attenante à la salle d'opération. Un aide-médecin ouvrait la porte et disait : « Au suivant de ces messieurs ! » en imitant le geste obséquieux et fade des coiffeurs. Et chacun s'amusait de cette facétie innocente et toujours pareille. Un pauvre diable, obèse et lourd, perforé de part en part par une balle, s'esclaffait. Boute-en-train merveilleux, il encourageait et soutenait les camarades moins abîmés que lui. – « Moi, disait-il, ça m'amuse de me faire bander et même le nettoyage de la plaie ne m'embête pas. J'admire la nurse, est-elle jolie, mes enfants ! Elle me sourit et j'oublie le médecin qui me torture. Service au réfectoire A midi précis, nous servions à dîner au réfectoire, où les éclopés et les convalescents, très nombreux, s'asseyaient à de longues tables ; les assiettes, les verres et les bouteilles de bière étaient, alignés selon les règles d'une discipline toute militaire. Les brancardiers passaient les plats aux jeunes filles qui distribuaient les portions. Ah ! L’amusante et divertissante scène ! Nous oublions presque les grands blessés qui restaient alités dans l'immense salle maintenant silencieuse et presque déserte. Dès que les plats émergeaient du bord de la lucarne de la cuisine, des dizaines de voix impatientes nous interpellaient. Des hommes pressés et voraces appelaient familièrement les jeunes filles ; des soldats échangeaient les plateaux et aidaient les serveuses juvéniles. Puis le tintement des cuillers, au fond des assiettes, se mêlait au bruit de mastication. Parfois le repas était interrompu par l’arrivée de l'officier inspecteur qui, sur la proposition des médecins, désignait les sortants. Les hommes appelés se levaient de table, joignaient les talons devant leur supérieur et répondaient à ses questions bienveillantes et précises. Dès le lendemain, ils devaient aller rejoindre leur dépôt puis risquer leur vie à la guerre. Cependant, à leur place, à table, ils mangeaient de grand appétit ; sans appréhension ; seulement ils plaisantaient un peu plus bruyamment que tout à l'heure. La sieste au soleil L'après-midi, réunis sur la terrasse qui surplombe le jardin zoologique, les impotents s'allongeaient sur des brancards disposés au soleil ou à l'ombre, selon la température. Les convalescents bavardaient entre eux ou s'entretenaient avec les infirmières ou les médecins. Autour de la civière de « Mon Général », des blouses blanches évoluaient ; un rire aigu fusait et dominait le murmure des conversations monotones, Autour des petites tables où jadis, se groupaient, à l'heure au thé, toutes les belles dames anversoises, des soldats jouaient aux cartes. Ils mouillaient un doigt de salive et ils écornaient les cartons. Un jeune universitaire, la figure émaciée, les traits durs et nets, un bandeau blanc couvrant l'œil droit, lisait sans discontinuer. Il s'interrompait seulement quand l'aumônier s'accoudait à son guéridon et seuls, à l'écart, les deux hommes interprétaient les pensées de Marc-Aurèle et de saint Thomas d'Aquin. De ces groupes pittoresques, gais malgré la douleur et l'inquiétude latente s’élevait tout à coup un chant bizarre qui rappelait à la fois le sifflement d’une flute, le nasillement d'un hautbois et les vibrations sonores d'un violon. Un clown de cirque, adroit et joyeux, distrayait ses amis par sa musique fantaisiste. Tantôt, il phrasait des romances sentimentales, puis il rythmait des danses de music-hall. Et ces notes planaient sur toute l'assistance, elles l'imprégnaient en quelque sorte de leur mélodie et exprimaient la joie amollie par une vague appréhension. Pour nous amuser, le clown lançait son bon net de police en l’air en déformant sa figure par une indicible grimace de pitre triste, et il attrapait sa coiffure sur le bout de son nez en trompette. Ou bien, il imitait le pas cadencé du cheval de cirque ; il désarticulait ses bras qui s'écartaient de son corps minuscule et il parodiait la danseuse qui saule à travers un cerceau de papier. Les blessés entouraient l'acrobate et les malades ankylosés, immobilisés sur les civières, tordaient le cou et levaient la tête. Alors le pitre se haussait sur un escabeau et, d'un voix stridente, grave et entraînante comme les cuivres et les tambours d'une fanfare militaire, il entonnait la mélodie virile, allègre et vivante, à la mode à Anvers : « Demain nous irons à Berlin, pin, pin ... » Vers le soir, nous ramenons, à nouveau, quelques blessés à la salle d'opération ; d'autres étaient hissés dans leur lit ; la plupart marchaient seuls en sautillant ou bien ils se soutenaient l'un l'autre. Après un repas frugal et rapide, les lumières s'éteignaient, les infirmières s'en allaient et deux brancardiers de garde veillaient sur l'ambulance assoupie. Première nuit à l’ambulance Jamais, je n'oublierai les impressions contradictoires et bizarres qui m’assaillirent la première nuit que je passai dans cette salle haute où, dans les lits alignés, deux cents malades reposaient. Dans ce hall élevé, chaque murmure s'enflait et se répercutait comme une parole trop aiguë sous les voûtes d'une cathédrale. Du haut des galeries supérieures, une double rangée d'ampoules bleues baignait l'ambulance dans un brouillard étrange, à peine perceptible et lugubre indéfinissable. Une frayeur incompréhensible, nerveuse, irraisonnée me paralysait. Les lits paraissaient ensevelis dans un immense linceul bleu, les rangées s'étendaient à perte de vue et se noyaient dans le lointain gris. Les couvertures blanches étaient teintées d'une étrange couleur turquoise ; les ombres s'accentuaient en se creusaient. Les visages des soldats atteints par les rayons directs de la rampe s'immobilisaient, cadavériques et terrifiants. D'instinct, je guettais un soupir, une voix, un grincement rauque, le craquement d'un sommier qui m'assureraient de la vie de ces êtres endormis. Tout à coup, un homme toussotait ; un autre lui répondait par une toux plus longue, plus rauque et qui finissait par un étranglement. Un murmure de voix étouffées et de draps froissés parcourait toute la salle ; des plaintes montaient, se précisaient et s'enflaient avec la souffrance. Durant cette première nuit de veille, un long silence fut coupé par le râle macabre, rauque et profond d'un agonisant. Un frisson secoua ma torpeur. Mais déjà la bonne sœur se hâtait vers le malade lamentable qui, dans son inconscience, avait jeté le cri de détresse du mourant ; elle se faufilait entre les lits, et la cornette blanche glissait comme des ailes déployées. Elle toucha la main du soldat et le râle qui s'était répété deux fois, plus long et plus désespéré s’éteignit en un faible et touchant sanglot. « Ce n’est rien » – dit la religieuse – un soldat qui, sans doute, rêvait de la mort. » Et, au fur et à mesure que cette nuit interminable se prolongeait on eût dit que mille spectres changeants venaient distraire ou épouvanter nos patients. Les locomotives de la gare proche sifflaient et mugissaient ; les animaux captifs du Jardin Zoologique parlaient dans la nuit : à un grognement étrange et sensuel comme un miaulement, répondait un cri guttural qui se terminait par une plainte douce car, à quelques pas de notre ambulance douloureuse, dormaient des lions asservis. Le corps des malades reposait, mais leur esprit qui avait été ébranlé jusqu'au détraquement, veillait encore. Dans la journée, ils réfrénaient leurs hallucinations ; maintenant, elles seules les dominaient et vivaient encore. Dans la nuit, elles se libéraient de la tutelle de la raison. Deux rêves seulement hantaient nos blessés : le uns, par la pensée, rejoignaient des êtres aimés ; les autres, retournaient sur le champ de bataille et la peur qu'ils croyaient avoir maîtrisée revenait lâchement à l'assaut et prenait une traitreuse revanche ; mais la haine aussi, divinité impérieuse et farouche, ne les abandonnait pas. Sur les conseils d'une des religieuses, j'allai me reposer dans un des lits vides. Mais le sommeil tarda à m'assoupir. Des idées que je n'avais pas appelées venaient m’inquiéter. Je souffrais des lancinements d'une blessure imaginaire précise et sanglante, avec le battement fiévreux des artères dans la chair incisée. En vain, m'efforçais-je de détourner mes pensées de ce sujet lugubre ; je tâchai de revivre mon existence de jadis à Paris, avant la guerre, d'aviver mes amitiés, de préciser mes ambitions, de clarifier mes désirs... Malgré moi, je communiais avec nos malades, la douleur et l'angoisse fictive me semblaient plus réelles que la réalité... Le réveil sous la voûte décorée de guirlandes et de nymphes En glissant dans les ruelles des lits, la bonne sœur vint me réveiller. Elle souriait d'un sourire triste et qui ridait la peau parcheminée : – Avez-vous bien dormi ? me dit-elle. Le sommet du lanterneau vitré se teintait maintenant d'une lueur imprécise. Le matin naissait. Sur la coupole, les personnages peints émergeaient comme les images d'une plaque sensible. D'abord, les contours les plus opaques se fixèrent ; les formes bizarres et incomplètes ne correspondaient encore à aucune réalité. Puis, au fur et à mesure que la lumière montait, les silhouettes s'affinaient, se complétaient et les teinte s'avivaient toutes. Après quelques minutes d'inattention, je regardai de nouveau la voûte. D'autres figures étaient nées : des nymphes drapées se donnaient la main et se tendaient des guirlandes ; des guerriers armés de javelots montaient des chevaux massifs au cou trapu. En bas, dans la salle, un brouillard obscur et ténu enveloppait encore les objets et les êtres. Pendant quelques minutes, la lumière du jour lutta avec la lueur artificielle, puis elle l'enveloppa, la dissipa ; aux lustres du plafond et aux lampes des galeries restèrent accrochés seulement des points bleus presque imperceptibles. Jamais, me disais-je, la gaîté et la sécurité ne triompheront dans un lieu où s'accumulent tant de souffrances et tant d'idées lugubres. Cependant, un beau jour qui se lève, la plaisanterie spirituelle d'un blessé nous réjouissait. Nous nous efforcions de vaincre notre angoisse ; nous réagissions contre la tristesse d'un lieu démoralisant, mais surtout nous nous accoutumions à la douleur et nous apprenions qu'elle n'est pas incompatible avec la joie. Peut-être cette joie était-elle plus apparente que réelle, plus fugitive que nous ne l‘affichions. Notre esprit, comme la lassitude de nos malades, réclamait sans cesse des distractions nouvelles, mais la qualité de notre plaisir nous importait peu et nous nous servions de toutes les armes pour lutter contre le malheur. Représentation
cinématographique pour les blessés Jamais, je n'ai vu s'épanouir une exubérance plus franche et plus communicative qu'à une représentation cinématographique à l’ambulance. Ce jour-là, dès cinq heures, les jeunes filles servirent le diner ; tout le monde se hâtait ; les tables furent écartées et nous alignâmes les chaises. Au réfectoire l'écran qui avait été tendu dès l'après-midi fut poussé au fond de la salle. En croisant leurs mains ou en pliant leurs doigts, quelques facétieux projetèrent le bec mouvant d’un canard et la tête d’une vieille femme coiffée d’un bonnet de nuit. Un instant les gestes amplifiés de l'aumônier, sa tonsure, son nez pointu et son front bosselé se découpèrent sur la toile. Le prêtre gesticulait, levait le bras, courbait le bout des doigts et, à son insu, il nous divertissait infiniment. L'attente, les secousses du transport, la fatigue ne rebutèrent personne. Pourtant, qu’offrions nous à nos défenseurs : quelques scène sentimentales, comiques et banales ! Deux brancardiers hissaient les impotents sur leur civière ; l'un partant du pied droit, l'autre du pied gauche, ils s'ébranlaient ensemble. A leur passage devant les lits occupés, des blessés impatients les appelaient ; des malheureux, la tète bandée, immobilisée, la mâchoire fracassée, nous faisaient un signe impérieux de la main et des hommes faibles, les jambes percées de balles ou déchiquetées par les éclats de shrapnells s'asseyaient, appuyaient le pied par terre, puis se recouchaient, découragés, mordus par la souffrance, plus forte que l'attrait du plaisir. Au réfectoire, nous posâmes sur les tables les civières lourdes de blessés. Au premier rang, devant tout le monde, nous plaçâmes « Mon général » qui nous remercia de cette faveur par un timide sourire de petite fille. A côté, la grande salle vide s'étendait interminable, immense, sans vie. Deux ou trois blessés tristes, démoralisés ou inconscients, geignaient et somnolaient seuls. Mais ici, devant l'écran, la joie s'affirmait bruyante, un, peu vulgaire ; chacun criait, riait, chantonnait, comme si le bruit et l'exubérance exagérée eussent dû nous persuader de notre plaisir. Un long Ah ! se répercuta sur tous les bancs, quand le globe électrique de la lampe à arc se ternit tout à coup et s'effaça lentement, dans le noir ; un grand rond lumineux se dessina sur la toile lisse... Etrange et rare vision plongée dans la pénombre ! Une ligne claire d'infirmières en blouses blanches encadrait les hommes étendus, assis, accroupis ; le rouge de quelques vestons d'intérieur accrochait le regard, dans la bigarrure des uniformes usés et des vareuses défraîchies ; des têtes immobiles se levaient en une double crête, longue ligne de blessés étendus sur les tables. Des scènes connues se succèdent sur l'écran : de hautes vagues qui battent les rochers d'une mer lumineuse, bordée de falaises droites ; une belle-mère qui moleste son gendre et se venge avec esprit ; un acteur qui se démène et coiffe une duègne massive d'un seau rempli de colle de pâte ; un jeune américain qui poursuit un train en ballon. Nos éclats de rire emplissaient la salle. La sensibilité artificielle chassait la douleur vraie et la gaîté passagère imposait une trêve au souci constant. Mais bientôt, l'opérateur s'interrompt ; plus de scènes bouffonnes ou sentimentales, fantastiques ou vraies, plus d'impressions factices : dans l'obscurité de la salle chacun reste seul à seul avec lui-même. Des conversations timides et basses s'ébauchent ; une jeune infirmière fait triller un rire, une chaise grince, un blessé se lamente, la voix cristalline de « Mon général » perce, mais, invinciblement, dans le silence, l'attente et l'obscurité, le malheur aux aguets nous asservit ; peu à peu la tristesse dérivée prend sa revanche. Alors, toutes ces impressions, ces vibrations confuses s'accumulèrent et se précisèrent dans la tête pointue et difforme de notre clown ; elles furent exprimées, transmises irrésistiblement par la bouche tordue et grimaçante du pitre. Dans le silence lourd, dominant nos bavardages et nos réflexions personnelles, la voix grave du chanteur s'enfla, vibrante, prenante comme un génial poème. Il ne s'amusait plus à nous étonner. II n'imitait ni le hautbois, ni le violoncelle, ni le timbre nasillard du ventriloque. Lentement, il égraina l'Ave Maria de Gounod qui éternise la douleur et l'appréhension d'une âme. Les blessés s'allongeaient sur leurs civières ; personne ne parlait ; des jeunes femmes se tamponnaient les yeux de leur mouchoir ; je sentis dans ma bouche l'âcre goût de deux larmes. Chacun était soumis à sa propre émotion et nous croyions tous nous connaître nous-mêmes. A la dernière note qui s'éteignit en une modulation vague, nous n'applaudîmes pas : nous venions de célébrer spontanément le culte solennel de la douleur sacrée. Mais ce silence se brise, le charme religieux se rompt. Un gosier rauque éjacule des notes grêles, accouplées à un rythme commun. Parmi nous végète donc un homme qui n'a pas été subjugué par l'émotion et qui n'a pas saisi la signification rare du chant précédent ! Deux ou trois « chuts » brefs interrompent en vain. Le blasphémateur célèbre les amours larmoyantes et brutales d'un souteneur et d'une gonzesse. Des jeunes filles écoutent cette chansonnette grivoise ; le malaise s'accentue et se propage, mais le pauvre chanteur poursuit sans comprendre, insensible et buté... Sur l'écran, d'autres scènes succèdent aux images précédentes ; mais les impressions s'imposent moins vives et moins spontanées. Tous les blessés, les convalescents, les éclopés même sont torturés par leurs plaies et incommodés par leurs maladies ; leur force de résistance décroît, les sourcils se froncent et les traits se tirent. Les malades aspirent à dormir ; les blessés réclament du repos ; les infirmières ont hâte de regagner leur logis avant l'extinction des lumières dans la ville prudente. Nous portons les impotents à leur lit ; les nurses renouvellent les bandages ; sur les traversins durs, les têtes s'affalent ; les gardes-malades s'en vont et les religieuses veillent sur la salle submergée, comme de coutume, par les ombres bleues de l'éclairage nocturne. Après une sortie de
l’armée hors de la forteresse d’Anvers, nos troupes reviennent avec un afflux de blessés Après l'attentat des zeppelins, la
plupart de nos blessés s'énervèrent et s'agitèrent. La fièvre battait dans
leurs tempes ; la nuit de l'agression les détonations brutales, la panique
avaient ébranlé ces cerveaux affaiblis. Quel cataclysme si une bombe avait
percé le vitrage de la grande salle ! Imaginez les lits défoncés, les hommes
estropiés, déchiquetés, en sang, comme sur le champ de bataille ! Vision
d'épouvante et d'horreur que nous évoquions tous. Cette nuit-là, comme toujours, la
douleur luttait avec l'espoir et la vie se mesurait avec la mort en des combats
multiples. Malgré sa monotonie, la souffrance nous émeut toujours car, en sa
présence, nous nous replions involontairement sur nous-mêmes. Dans les épreuves
d'autrui, nous reconnaissons nos maux passés qui ressuscitent et l'image de la
fin certaine s'impose à nos réflexions. Un après-midi notamment, la
souffrance qui nous entourait, monta, nous envahit et s'exhala des blessures,
contagieuse et intolérable. Non loin d'Anvers, les troupes,
sorties dès le matin des remparts, avaient rencontré l'ennemi. Les convois
d'ambulances affluaient. Les trains sanitaires transportaient, entassés, des
hommes défaits, touchés par la mitraille. Du champ de bataille tout proche, les
soldats les plus atteints étaient ramenés en auto à Anvers. Sans arrêt, à notre
porte, les voitures déchargeaient des corps pesants. Toutes ces voitures, abîmées,
délabrées, bosselées n'avaient pas encore été enduites de la couleur grise
réglementaire. Chacune, malgré les avatars et les morsures de la guerre, avait
gardé sa personnalité ancienne. La laque havane, fine et luisante d'une
limousine neuve était ternie ; des carrosseries moins précieuses s'étaient
fêlées et, sous le capot défoncé, le moteur trépidait, Irrégulier, avec des
grincements inquiétants. Dans la salle d'attente de notre
ambulance, des vêtements s'entassaient, des chaussures s'alignaient, des fusils
s'appuyaient aux murs, des cartouches encombraient des étagères ; les blessés
restaient étendus sur leur civière, immobiles, prostrés, inconscients, la sueur
mêlée à la boue, la capote déchirée par les balles, les traits durcis. Au
milieu du sternum, une déchirure souvent imperceptible fendait la tunique, mais
cette entaille s'enfonçait jusqu’au poumon et transperçait l'homme de part en
part. Alors, avec mille précautions, les infirmiers déshabillaient les corps
mous, inanimés ; ils coupaient les lacets des chaussures et du linge encore
mouillé de sang jonchait le plancher. Le médecin, penché sur la plaie, ou
l'oreille appuyée sur une poitrine maigre, interrogeait ; mais les hommes,
abrutis, répondaient le plus souvent par des grognements vagues, inconscients
et les plus atteints se taisaient. Les soldats les moins grièvement touchés
restaient mornes, silencieux, effondrés sur des chaises de bois ; patiemment,
ils attendaient leur tour. Ils dévisageaient, indifférents, les blessés
étendus. Ils étaient déjà habitués à cette vision des champs de bataille. Vers cinq heures du soir, un train
sanitaire arriva à la gare toute proche.
Sur des civières, l'on nous amena immédiatement les soldats affaiblis
qui n'eussent pas supporté le transport à un hôpital plus éloigné. Des employés
du chemin de fer, coiffés de casquettes bleues à galon d'or, des prêtres, la
soutane noire avivée par le brassard de la Croix-Rouge, deux par deux,
traversaient la grande place. Dans le corridor de l'ambulance, l'inconscience
ou l'évanouissement des malades ressemblait à la mort. Les hommes touchés à la
tête, le front balafré, les cheveux coagulés de sang, étaient recouverts d'un
drap qui les dérobait à la curiosité de la foule agitée. Avec appréhension,
nous soulevions une couverture qui rappelait un linceul. Alors, un étrange, un
indéfinissable regard humain nous fixait ; des yeux sans expression semblaient
figés dans un masque de glaise.
Il n'eût pas fallu pousser beaucoup notre imagination pour que nous nous
crussions transportés dans la plaine de Haelen ou sur la grand' route de
Malines. Mais sur les champs de bataille, les fantassins crient, les charges
s'ébranlent, le courage, la frayeur, l'enthousiasme, la haine, l'abnégation,
l'héroïsme se confondent et s'exaspèrent, l'homme est stimulé par la lutte et
grisé par l'action ; mais ici, dans notre hôpital, la douleur seule était venue
se réfugier, sans faste, sans beauté, dans son horreur et sa désolation. Parmi les soldats blessés, un
jeune soldat au visage enfantin et candide Parmi d'autres victimes, deux
prêtres vinrent nous apporter un pauvre petit soldat imberbe, immobile et calme
comme un enfant endormi ; sa civière se balançait mollement au rythme des pas
des ecclésiastiques qui le hissèrent, avec d'infinies précautions, par
l'escalier de marbre, et ils le déposèrent par terre, avec gravité. Le visage
enfantin ressemblait aux pâles masques des saints, coulés en cire, étendus, à
côté d'un reliquaire d'or, sous des vitrines, dans les chapelles à la campagne.
L'adolescent, à l'expression douce et lasse, ne paraissait pas souffrir ;
lentement, il entr' ouvrit les paupières
transparentes qui retombèrent aussitôt sur ses yeux ternes. Les prêtres le
regardèrent un instant, en hochant la tête tonsurée, puis, les plis noirs de
leur soutane s'agitèrent ; à grandes enjambées, ils s'en allèrent chercher
d'autres malades. Maintenant, dans la salle, parmi
les patients, le nouveau venu seul existait et sur lui se concentrait toute
notre attention. Pourquoi ? Etions-nous émus par sa jeunesse, séduits par sa
joliesse un peu efféminée ou apitoyés par sa résignation calme ? Le médecin déboutonna la capote
neuve du jeune soldat et examina l'enfant avec attention, en fronçant les
sourcils sous ses binocles ; il étouffa un juron bénin, regarda dans le vide,
s'approcha de nouveau du blessé inerte. Nous interrompîmes notre travail pour
deviner les impressions du chirurgien penché sur le corps gracile. – « Rien à faire, bougonna-t-il
enfin, une balle a traversé le poumon ; nous ne pouvons pas opérer cet homme
ici, il faudra me procurer une ambulance et envoyer ce blessé à l’hôpital
militaire. » Avant de s'éloigner, le docteur
dévisagea encore une fois cette face pâle et jeta un regard aigu vers la
déchirure imperceptible, au-dessus du cœur, dans la tunique propre et neuve... Nous continuâmes notre ouvrage,
relevant machinalement nos blessés, entassant les vêtements épars, soutenant un
convalescent, consolant un éclopé découragé. Le flot des arrivants s'était tari
peu à peu, les autos ne trépidaient plus à la porte ; le nombre des malades
étendus dans l'antichambre diminuait insensiblement. La voiture d'ambulance réclamée ne
venait pas. Anvers, ce jour-là, débordait de
blessés. Les ambulances disponibles étaient prises d'assaut par les infirmiers
affolés. A la porte de notre hôpital, la foule silencieuse, compacte,
stationnait toujours. Autour de la gare, à l'étroite porte de sortie, sous le
viaduc, elle se creusait en un grand demi-cercle qui se redressait et
s'élargissait selon une poussée instinctive et irrésistible. Le drapeau de la
Croix Rouge, toile blanche salie, pendait, inerte, le long de la hampe. De jeunes boy-scouts entraient, sortaient,
couraient et les gardes civiques, chargés du maintien de l'ordre montaient la
garde inlassablement sur les trottoirs dallés. A la galerie du premier étage,
nous apportions et fixions de nouveaux lits. A la lingerie, des dames
distribuaient des serviettes ; à la cuisine, des jeunes filles babillaient.
Dans la salle d'opération, le médecin renouvelait des pansements mais le petit
blessé somnolait toujours sur la civière abritée, à l'écart, au pied d'un
escalier. Il ne râlait pas ; sa poitrine ne se soulevait plus et ses paupières
restaient closes ; la vie s'échappait goutte à goutte de son être. La mort
s'approchait de lui simplement, et, pour cette candide créature, elle ne
déployait pas le cortège théâtral et macabre de ses maux habituels. Vers six heures du soit enfin, une
ambulance s'approcha du Jardin Zoologique. Les cercles métalliques des Joues
émettaient, en roulant, un bruit strident de ferraille, et les carreaux,
tremblant dans les cadres de bois, tintaient sans discontinuer ; le coffre,
peint en gris, pesait sur des ressorts durs et, dans les rainures neuves, les
brancards s'ajustaient mal. Le cocher, gras et rouge, s'immobilisait, le fouet
à la main, sur un siège haut perché. Nous allâmes chercher le mourant. Il
reposait toujours ; son visage avait encore pâli, ses yeux s'étaient cernés et
deux rides minuscules amincissaient le nez ; une plaque rouge, à peine visible,
avivait les lèvres bleuâtres. Sa main pendait le long de la civière ; elle
s'était posée sur le marbre de l'escalier ; quand nous la touchâmes, son
contact glacé nous fit tressaillir jusque dans l'échine. Nous soulevâmes sans
effort le corps inerte et léger. Ainsi que des enfants maladroits, en partant
toujours du même pied, nous descendîmes les marches du vestibule. Dans la rue,
deux hommes de bonne volonté s'accrochèrent au montant de bois; la civière
faillit chavirer. Puis le support s'engagea mal dans les rainures. Malgré nous,
nous secouions notre lamentable fardeau ; seule, la tête lourde ballottait sur
le cou souple et maigre. D'autres brancardiers se précipitèrent. Un médecin
vint nous donner des ordres brefs que nous exécutâmes avec précision, comme si
nous eussions soulevé une masse inerte et pesante. Pourtant c'était une vie
ténue, vacillante, prête à s'envoler de ce corps que nous manipulions. Aucun
geignement, aucun mouvement, rien ne nous révélait sa présence et notre effort
qui, sans cela, eût été machinal et tout matériel, empruntait son mystère et sa
beauté à cette énigme.
Quand l'ambulance s'ébranla, lourde et massive, un prêtre traça le signe de la
croix sur sa poitrine ; nous inclinâmes la tête et tous les assistants
saluèrent. Conversation entre un soldat
flamand et un soldat wallon Le dédain et le désir du danger, la haine aussi
faisaient éclore des sensations admirables, aiguisées parfois par l'épouvante.
Un matin, des soldats minables vinrent sonner à la porte de l'ambulance ; aucun
d'eux n'était blessé, leurs traits fermes et marqués ne décelaient nulle
fatigue, mais dans leurs yeux brillait une flamme perçante de bête de proie.
Ils s'interpellaient, se querellaient, inaptes à maîtriser leurs nerfs ; ils
parlaient sans discontinuer. Ils nous demandèrent à manger. Nous les installâmes au réfectoire,
autour d'une longue table de marbre. Ils ne s'asseyent pas ; ils tombent sur
leur chaise. Ils se jettent sur le fromage qu'ils piquent de la pointe de leur
couteau et ils versent le café brûlant dans leur gorge desséchée par la
poussière et par la soif. Leurs dents s'entrechoquent et mordent, rythmiques et
rapides, comme les incisives blanches des carnassiers. Parfois, sans raison apparente,
ils partent tous ensemble d'un long éclat de rire primitif et sonore, semblable
au mugissement prolongé d'un animal. Nous les entourons, curieux, dominés tous
par un sentiment indéfinissable de crainte, de pitié et d'admiration. En mâchant bruyamment, la tête
plongée dans l'assiette, un Wallon sarcastique et un Flamand lourd, nous
contèrent leur merveilleuse et déconcertante odyssée. – Il y a huit jours, dit le
Flamand, le roi a demandé des hommes de bonne volonté ; il s'agissait de jouer
un mauvais tour aux Boches. Plus de cent hommes se présentèrent, mais tout le
monde ne pouvait pas être de la fête. L'on avait besoin de gaillards
débrouillards et vigoureux. Et il fallait aussi savoir rouler à bicyclette,
ajouta-t-il, en enfouissant une grosse tartine dans sa bouche ouverte. L'on
nous avait ordonné de détruire quelques voies ferrées, en Belgique, derrière le
front allemand et de faire sauter des ponts importants. – Enfin, quoi, résuma le Wallon,
embêter les Boches ! et sûr qu'on les a bien embêtés, je vous le jure !... Nous
nous mîmes en route, il y a trois jours. L'on nous avait munis de vélos légers
et d'épatantes carabines. LE FLAMAND. – C'est vraiment
dommage qu'on ait dû abandonner tout le bazar... LE WALLON. – Il s'agissait, avant
tout, de traverser les lignes ennemies. Vous vous imaginez que c'est difficile
? Jamais de la vie ! LE FLAMAND. – C'est enfantin
! Un « kinderspeel », Mesdames ! On n'avançait que la
nuit, comme dans un rêve. LE WALLON. – Les sentinelles ne
nous attendaient pas et quelques pruneaux réglaient leur affaire. LE FLAMAND. – Dame ! On était parti
pour cela... Quelques ennemis se sont pourtant défendus ; l'on a perdu pas mal
de monde. LE WALLON. – Nous étions encore
soixante ; mais c'est là seulement que la danse a commencé. Quand nous
affirmions aux soldats boches que nous étions de vrais Belges, ils pouffaient
de rire... LE FLAMAND. – Et pendant qu'ils
rigolaient de la « zwanze », on leur envoyait quelques balles, ou bien on leur
lardait proprement la poitrine, pour ne pas donner l'alarme. LE WALLON. – En reconnaissant nos
uniformes, les civils n'étaient pas moins abasourdis. LE FLAMAND. – Mais ils nous
aidaient et nous soutenaient ; même que nous nous sommes cachés toute une nuit
chez une bonne vieille dame qui nous a offert du lard et servi du café. LE WALLON. – Avant-hier matin, nous
démontions une voie. On était si occupé, qu'on avait presque oublié les Boches,
mais une sentinelle nous surprend ; elle tire, nous ripostons ; on la rate... LE FLAMAND. – Ce sont des choses
qui arrivent... LE WALLON. – Elle fuit à toutes
jambes et court chercher du renfort. L'imiter, nous ? Jamais, avant que notre
petit travail ne soit achevé ! Nous démontons encore un aiguillage et scions des traverses. Mais voilà
que, de l'autre côté du talus, un peloton de casques à pointe s'avance en bon
ordre. On les laisse approcher... A trois mètres, on exécute un petit feu de
salve réussi. Le premier rang culbute les quatre fers en l'air ; les autres détalent
comme des lapins. Mais décidément, ils ne veulent pas nous ficher la paix ; ils
reviennent à la charge. Deux hommes amènent une mitrailleuse. LE FLAMAND. – Ah ! Les cochons ! LE WALLON. – Notre compte est bon.
Notre besogne achevée, nous sautons sur nos bécanes et nous dévalons la côte...
LE FLAMAND. – Même qu'on aurait pu
croire que nous n'étions qu'une poignée de fantômes, tellement nous allions
vite. LE WALLON. – Derrière nous, la
mitrailleuse crépitait. Ah ! La belle fête ! On prenait les virages en vitesse,
sans se soucier de la surprise que les Boches nous réservaient au tournant. LE FLAMAND. – Dieu, comme on
pédalait ! Et ils nous rataient toujours, les crétins de Boches ! LE WALLON. – On riait, on
s'amusait... Un copain veut me rattraper ; il roule à côté de moi : « Ah ! Tu
ne me dépasseras pas », lui dis-je. – « Nous verrons bien », qu'il me répond. –
« Veux-tu parier ? » que je lui riposte. Mon concurrent penche la tête sur le
guidon, et son dos n'est qu'une ligne horizontale. Sa roue d'avant se rapproche
de la mienne ; j'appuie de toute ma force sur mes pédales et mes jambes remuent
! Je suis battu ? Non pas ! Voilà mon camarade qui dérape et s'étale dans la
boue. Je vous jure qu'il se souviendra de sa chute ! Etait-il drôle, le bougre
! Jamais, je n'ai tant ri qu'en le voyant culbuter : Une balle allemande venait
de lui fracasser la tête ...
Ce dénouement cruel et brusque nous déconcerta et nous révolta comme un
blasphème ; une sorte de malaise moral se propageait dans le silence lourd.
Nous regardions le narrateur avec crainte et avec dégoût, comme l'on contemple
un criminel. Ses yeux cernés de poussière brûlaient comme deux braises. Il
mangeait goulûment et mastiquait son pain avec tranquillité. Ses camarades
n'avaient même pas écouté le récit de cet épisode banal. L’arrivée d’un grenadier incarnant
la beauté, la douleur et le courage Rien n'est plus noble, plus instructif
et plus déconcertant que cette lutte finale qui résume et glorifie toutes les
autres batailles. En toute individualité, elle exaspère le duel entre l'âme et
le corps, entre la parcelle d'éternité que chacun de nous garde prisonnière
dans sa chair et l'éternité tout entière. Tous nos soins, nos gestes, l'art des
médecins, le dévouement des infirmières étaient concentrés vers un seul but :
vaincre la douleur, éloigner la mort ; nous étions une armée qui combattait,
disciplinée et confiante, contre le trépas, guetteur, sournois et cruel. Dans
ces multiples batailles, acharnées et silencieuses, nous avons remporté
beaucoup de victoires faciles ; nos médecins ont accompli les miracles, mais
nous avons été vaincus une fois, et cette défaite-là, je ne l'oublierai jamais.
Deux blessés, mortellement atteints
nous arrivèrent à vingt-quatre d’intervalle. Pendant quinze jours ils allaient
accaparer notre sensibilité, absorber notre curiosité émue et notre espoir. Le
premier des moribonds était un grand gaillard que deux infirmiers nous
apportèrent, étendu sur un brancard. Les tiges de bois s'arquaient sous son
poids ; il dressait sa tête expressive et régulière. Il avait passé sa main
sous sa vareuse, en un geste napoléonien, et il retenait ainsi le bandage et
les tampons d'ouate couvrant une large plaie saignante qui battait. Nous nous
empressâmes pour le dévêtir. – « Un soldat se déshabille tout
seul, dit-il, en esquissant un sourire pénible. Mais, dès le premier mouvement, il
retomba sur sa civière. Pendant quelques secondes, il ferma les yeux. Déjà, il
semblait que la vie l'abandonnait, annihilant son énergie et sa volonté. Un
jeune médecin prit le poignet flasque et tâta le pouls qui frappait de petits
coups secs et précipités, comme des trépidations. Mais, aussitôt, notre homme
ouvrit les yeux qui s'illuminèrent. – « Hé ! Mon petit, pas de ces
simagrées-là, bafouilla-t-il, s'interpellant lui-même. Tu vas être soigné par
des dames, c'est pas le moment de tourner de l'œil ! » Et, s'adressant à nous : – « Vous me déshabillerez sur mon
lit, là-bas ; je ne veux pas être transporté dans la salle comme un paquet.
Allons, aidez-moi à m'asseoir. » Nous obéîmes d'instinct, car il est
des ordres auxquels on ne résiste pas. Le malade geignait mais, du geste et du
regard, le beau grenadier nous obligeait à continuer. Pourtant la manœuvre
douloureuse n'était pas sans danger. Le buste avait été percé de part en part
par une balle : un éclat d'obus avait déchiré la jambe droite et un bandage
blanc, serré autour de la tète, masquait la morsure d'un éclat de shrapnell.
Enfin, quand notre héros fut assis, bien d'aplomb sur sa civière, un bras
toujours croisé sur la poitrine, le buste droit, il dit simplement, en
martelant les syllabes : – « Maintenant, Messieurs, faisons
notre entrée. » Toute la journée, nous avions
transporté beaucoup de blessés. Les brancards passaient entre les lits,
personne ne se souciait des nouveaux venus, si ce n'est une infirmière qui
s'empressait et le médecin de service qui examinait le malade. Mais, cette
fois, à peine la porte de verre, qui séparait le corridor de la grande, salle
commune, se fût-elle rabattue sur nous, qu'instantanément tous les regards
s'attachèrent sur notre grenadier. Vraiment, son allure était fière et belle ;
il avait raidi son bras ; il tordait légèrement la bouche et cette grimace
décelait la souffrance vivace et domptée. Par un geste qui lui était sans doute
naturel, il tendait le cou et levait son menton carré. Il avait conscience de
sa mâle beauté et de son rare courage. Il dévisageait les infirmières d'un air
martial et provocateur. Déjà, de nombreuses jeunes femmes en blouse blanche
l'entouraient. Son regard perçant et droit était attisé par la fièvre, et, les
chairs tendues sur les os, la figure allongée et maigre, accentuaient son
énergie et sa beauté. La taille, qui émergeait, droite et raide, des
couvertures repliées, évoquait plutôt l'idée de la force que la présence de la
mort et de la maladie. Les boutons neufs de la veste brillaient. Le nez droit,
un peu épais, aux angles arrêtés, projetait une ombre nette sur les lèvres
minces, exsangues et tordues. L'admiration transformait et
métamorphosait notre fardeau humain. Nous marchions lentement comme si nous
eussions porté une relique. Les infirmières nous aidaient dans
l'accomplissement de notre sacerdoce : l'une soutenait la tête du blessé ; une
autre, tout en marchant, arrangeait les plis de la couverture ; une troisième
maintenait le brancard. Au chevet du lit, tous les bras se tendirent pour lever
le malade qui, moulu par l'effort, de plus en plus affaibli, ne se cabrait plus
guère. Etendu sur son lit, il ferma les yeux et ne bougea plus. Du fond de la
salle, des gardes-malades, les dames de la lingerie et les jeunes filles de la
cuisine accouraient pour admirer ce blessé immobile qui incarnait, telle une
parfaite statue, la beauté, le courage, la douleur et l'héroïsme. Comme s'il
avait été ravivé par ce flot de respect et de sympathie naissante, il rouvrit
les yeux. Sa face était tordue par une brève et involontaire grimace ; mais il
se dominait encore, malgré la fièvre, la brûlure des plaies et l'inconscience
envahissante. Mais, à peine le médecin eût-il
renvoyé les admiratrices inopportunes que, tout à coup, le grand corps,
galvanisé d'abord par une incommensurable et surhumaine énergie, s'affaissa,
s'écroula, se détendit. Les yeux chavirèrent dans les orbites, la main, qui
était restée appuyée sur la poitrine, se desserra. Sur les draps blancs, il n'y
eut plus qu'un pauvre héros malade, qui poussait de brefs gémissements
d'enfant. Quand les bandages ensanglantés se déroulèrent, nous fûmes épouvantés
par deux plaies béantes qui s'étalaient, monstrueuses et informes, au milieu de
cette large poitrine ; la balle, en déchiquetant les chairs, avait creusé une
sorte de cratère profond, aux bords irréguliers et noirâtres. Mais en
tamponnant la peau, nous découvrîmes une autre blessure sous le sein gauche, un
imperceptible trou noir, profond, rempli d'iode et de sang coagulé. Le médecin
fronça les sourcils. Cette plaie si petite nous inquiétait. comme un mystère ;
d'instinct, nous devinions tous que c'était par cet orifice minuscule, qui
s'enfonçait sans doute jusqu'au fond de l'être humain, que s'en allaient la
force et la vie de cet homme superbe qui agonisait. L'autre blessé, qu'on nous amena le
lendemain matin, nous parut moins gravement atteint. Il arriva, dans un convoi,
accompagné de beaucoup de pauvres diables qui souffraient de rhumatismes, de
bronchites bénignes, ou bien qui se plaignaient d'épuisement et de fatigue. Ce
petit soldat pâle, chétif et tranquille ne nous inquiéta pas. Insignifiant, les
cheveux blonds coupés au ras de la tête irrégulière et bosselée, le regard terne,
sans expression, hébété, il n'éveillait pas la sympathie. Il affirmait que la
fièvre le terrassait tous les soirs et que des rêves terrifiants troublaient
son sommeil agité. Pendant quatre ou cinq jours, nous ne nous souciâmes guère
de lui ; nous le transportions à la salle d'opération où le médecin l'examinait
à la hâte. Mais la fièvre montait, l'homme ne se nourrissait guère et il
languissait dans un abattement continuel. Un soir, subitement, son état
s'aggrava. Il fut agité de tremblements convulsifs et il délira toute la nuit ;
il rugissait comme un animal enragé. Des gémissements aigus se fondaient en un
râle profond et guttural, exagéré parfois, comme des cris de théâtre.
Dans ce vaste hall, la mort rôdait maintenant, autour de deux lits. Mais nos
patients ne se souciaient pas d'elle. Le clown distrayait ses camarades par ses
sifflements et ses facéties ; « Mon général », se laissait gâter et choyer ;
des convalescents jouaient à la manille et tous les après-midi, le son ample de
cent voix s'élevait de la terrasse et remplissait toute l'ambulance du refrain
gouailleur et martial : « Pin, pin, nous irons à Berlin. » L’auteur se porte volontaire pour mettre à l’abri
les enfants des infirmières en
Angleterre. Il doit quitter l’ambulance… La veille de mon départ pour
Londres, j'allai rendre visite à mes blessés, à l'ambulance. Le soir tombait et
ternissait la verrière. Dans la grande salle, où les infirmières achevaient
quelques pansements, où le médecin accomplissait sa dernière tournée, une sorte
de brouillard gris enveloppait les êtres et les choses. La douleur me semblait
plus aiguë et la tristesse était victorieuse de la joie. Et je m'arrêtai au
chevet de mes malades favoris : « Mon général » causait avec son infirmière ;
il parlait de la guerre, de sa blessure, de l'obus qui était venu droit sur
lui, comme si le projectile le plus puissant eût visé le soldat le plus candide
et le plus faible ; la garde-malade ne s'émouvait plus à ce beau récit qu'elle
connaissait par cœur ; mais ces souvenirs hantaient le blessé triste et il les
exprimait. Le clown, attardé, jouait aux
cartes avec des camarades ; il criait, gesticulait, tordait sa figure de
caoutchouc en une lamentable grimace et, d'un geste vulgaire, il lançait sur la
table les cartons qu'il humectait du bout des doigts. Le lancier privilégié,
fumait une cigarette ; il se plaignait de sa blessure qui ne se fermait pas et
il en voulait au médecin qui lui avait refusé une sortie. Le peintre
sommeillait déjà ; sa face de cire jaune encadrée dans la barbe noire reflétait
ses préoccupations invincibles. Il avait froncé les sourcils en s'endormant et
deux rides s'étaient tracées, profondes et nettes, dans son front lisse. Le
grand grenadier, si beau et si viril, était subjugué, ce soir-là plus que
coutume, par la fierté et l'orgueil qui risquaient de lui être funestes. Malgré
les ordres du médecin, il s'était assis ; le bras replié sur la poitrine : « Je suis guéri, me dit-il. L'on
n'a pas dû me chloroformer ce matin. C'est épatant ! je suis guéri. » Mais il parlait d'une voix
caverneuse et trop vibrante. Ses yeux brillaient d'une lueur trop vive et,
derrière lui, son infirmière secouait la tête ; la grande plaie de la poitrine
se cicatrisait, mais le petit trou mystérieux et profond ne se fermait point.
L'autre mourant, le petit blessé à la tête rasée et blonde, crachait du sang,
divaguait sans discontinuer. Dans sa chambrette, construite, à la galerie du
premier étage, de paravents juxtaposés, je le vis étendu, immobile, serré dans
les draps blancs ; le cœur bat encore, mais la vie semble déjà s'en être allée
; le nez se pince déjà, la bouche reste grande ouverte, la poitrine se soulève
avec régularité, l'air s'engouffre dans les bronches avec un sifflement. Une infirmière
veille le moribond, en tricotant... Après avoir passé une semaine en
Angleterre l’auteur retourne à son poste à l’ambulance! De la gare encombrée, je suivis un
convoi de blessés, à l'ambulance du Jardin Zoologique, toute proche. Pendant mon
absence, le drapeau s'était encore terni davantage et la croix rouge, déteinte,
se confondait presque avec le fond gris et sale de l'étoffe molle, qui
s'affaissait le long de la hampe. A la porte ; les gardes civiques veillaient
toujours, ennuyés et las. Ce matin-là, l'ambulance
bouillonnait d'activité ; le vaste hall, où les lits s'alignaient, rappelait
une usine en plein travail et je m'étonnai de nouveau, de l'indifférence
apparente devant le malheur du prochain. Quelques convalescents nettoyaient le
plancher à grande eau ; une nurse, penchée sur un lit, la longue taille ployée
à angle droit sur les jambes interminables, bandait un bras troué par une balle
de shrapnell. Pressée, elle ne se souciait guère des geignements du patient
qu'elle encourageait par des paroles banales, répétées. (…) De nouveaux venus occupaient nos lits vides. Non loin de la porte
d’entrée, on avait installé un soldat qui « dormait le jour et divaguait
la nuit » . Son infirmière ne le quittait pas. A dix heures du soir, la
nurse blonde enfonçait le dard de la seringue à morphine sous la peau exsangue.
Il se calmait peu à peu ; les bouffissures de son visage se détendaient et
sa respiration se régularisait en sifflant. Dans son demi-sommeil, il revivait
des heures de tendresse et d'amour; il était grisé par une volupté subtile et
forte que son organisme vigoureux et rudimentaire ignorait sans doute. Mais la
congestion cérébrale se calma bientôt et il regretta sa souffrance et le
soporifique qui l'intoxiquait et l'élevait dans le monde imaginaire des
sensations malsaines et rares. Sur une autre couche, un gros
homme, accablé, était enfoui sous ses couvertures. Une balle avait effleuré son
front et un éclat d'obus avait traversé la cuisse ; mais cet ancien marin se plaignait
seulement de son immobilité au lit et, dans son inconscience, il se lamentait
du silence des vagues. A son réveil, après un long engourdissement, il jouait,
comme un enfant, avec des coquillages ; il les touchait, les caressait, les
fouillait, en respirait l'odeur saline, puis, soudain, sa main se détendait, sa
tête chavirait et il continuait son somme. A midi, à grandes gorgées, en
gonflant ses joues avant d'avaler, il buvait une tasse de bouillon où il
laissait tremper de gros morceaux de pain qu'il happait, en inondant ses draps
de graisse. Dans le réfectoire, les
convalescents entouraient un soldat bedonnant, vêtu d'une veste trop étroite
dont les boutonnières avaient craqué. Les yeux scintillaient, écrasés entre
deux bourrelets de chair ; sa tête lourde s'appuyait sur le renflement d'un
double menton et d'un cou gras et court ; le ventre encombrait ce petit être,
comme une monstrueuse difformité, comme une enflure phénoménale, soutenue par
des jambes courtes, toujours écartées. Etrange, bavard, insolent, cet ancien
brasseur raflait toutes les bouteilles de la table et il étourdissait ses amis
par d'interminables dissertations concernant la bière, sa préparation, ses
qualités et ses inconvénients ; quand on l'interrogeait sur sa blessure ou sa
maladie, il riait, en tordant sa bouche en demi-cercle, il désignait sa bedaine
étonnante qu'il caressait avec amour de ses doigts boudinés : – « Comment, disait-il, voulez-vous
qu'on se batte avec ça ! » Sa jovialité, son abord sympathique
réjouissaient tout le monde et nous lui pardonnions volontiers sa roublardise,
son impertinence et sa faconde. Mais une question me brûlait la
langue : que sont devenus nos deux moribonds, le grenadier qui se raidissait en
une attitude martiale, même en face de la mort, et le soldat agonisant qui
remplissait la salle des cris rauques de son délire ? J'avais peur
d'interroger, de savoir ; d'instinct, je reculais la minute nécessaire de la
certitude. Par lâcheté, je prolongeais mon angoisse ; j'allai lentement, de
chevet en chevet, à la recherche de mes malades. Ni l'un ni l'autre ne
reposaient plus à leur ancienne place. Le lit du beau grenadier était vide, les
couvertures pliées en quatre, le long des barreaux de fer. Au premier étage, la
chambrette faite de paravents mobiles avait été démolie. L'on change souvent
les patients de rangée, pensais-je. Je refoulais l'appréhension qui montait et
je me cabrais devant le malheur possible. Comment m'imaginer ces deux
hommes-là raides, exsangues, dans leur cercueil ? Nous nous sommes habitués peu
à peu à la mort violente, mais nous la tolérons seulement dans le décor des
champs de bataille. Là, des hommes sont broyés, fauchés, déchiquetés ; la mort
foudroie et des héros expirent. Mais ici, à l'ambulance, nous ne l'admettons
point ; nous luttons contre elle seule. Elle rôde et nous l'éloignons, elle se
rapproche et nous la maîtrisons. A force de la vaincre cent fois, nous croyons
que la défaite est impossible. Mais elle guette toujours, insinuante, brutale,
rapide ou tenace ; contre sa puissance incompréhensible, nous ne sommes armés
que d'un bistouri aigu, de quelques médicaments et d'un peu de patience. Je circulais lentement entre les
lits. Je me penchais vers des malades endormis qui respiraient lentement, avec
régularité comme des enfants qui sommeillent ; plusieurs se blottissaient en
boule comme des hérissons, les jambes repliées, la tête enfoncée dans les
épaules. Je saluais, sans m'arrêter, mes blessés favoris ; plusieurs essayèrent
d'ébaucher une conversation ; je leur répondais par monosyllabes ; j'étais
talonné par l'impatience plus déprimante qu'un chagrin. Ma fébrilité et ma hâte
déconcertaient mes amis ; je fixais une seconde mes regards sur chacune de ces
figures, émaciées par la souffrance, mais tannées et brûlées encore par le
grand air et le soleil. Je ne répondais pas quand un blessé m'appelait à voix
basse... Il ne me reste plus qu'un rang à parcourir et, d'un puissant et
absurde effort de volonté, comme un noyé qui sombre, je m'accroche à un espoir
impossible : là sont réunis les fiévreux atteints de grippes bénignes ou de
rhumatismes intermittents ; ce n'est pas ici que je retrouverai mes mourants. Je ralentis le pas, comme pour retarder l'instant où la vérité
s'imposera irréfutable, où je ne pourrai plus la vaincre par l'espérance
chimérique et les raisonnements aléatoires.
Pendant mes huit jours d'absence, j'avais apprécié l'ampleur, l'acuité, les
émotions fortes de la vie. Mon esprit s'était détendu dans le calme et la joie
simple qui s'épanouit ailleurs, malgré la guerre. Le petit soldat qui
râlait, mais vivait, il y a quelques jours encore, dans sa chambrette de
toile, ne goûterait donc plus la douceur d’exister ; le grand grenadier,
qui avait ébranlé déjà par la passion forte et la volupté consciente de sa
puissance, ne connaîtrait plus jamais le noble orgueil de la domination et de
l’amour. (…) Surprise ! Le petit soldat
malingre qui délirait a survécu tandis
que le grenadier si fort est mort Voilà-je ne veux pas en croie de mes yeux- qu’au milieu de cette salle
familière et pittoresque, un revenant se dresse devant moi, la tête ronde et
tondue, la face maigre, labourée de creux ; le ton vif d’un foulard rouge
noué autour du cou accentue la pâleur du visage ; les yeux d’un bleu très
clair, sans éclat, regardent dans le vide, comme privés de lumière et de vie.
L’homme est là debout, flageolent sur ses jambes grêles. Les doigts, longs et
minces, bosselés aux jointures, se crispent et les oreilles de parchemin s’écartent
du crâne, au contour précis. Cette vivante tête de mort se contracte en une
grimace qui exprime la joie : deux bourrelets de chairs comblent
l’excavation des joues, deux lèvres minces, droites, à peine visibles,
s’arquent puis se détendent. Une voix d’outre-tombe, tour à tour caverneuse et
sifflante, articule en haletant : – « Ah ! vous voilà revenu.
Avez-vous fait bon voyage ? » L'étonnement et l'émotion me
paralysaient. Pour me convaincre de son bonheur de vivre, le soldat, sauvé par
miracle, déformait son visage par un sourire macabre qui plissait la peau
tendue sur les pommettes. Et le revenant plaisantait : – « Oui, regardez-moi bien, c'est
moi ; j'ai déliré, pendant huit jours, dans la chambrette de la galerie.
Touchez-moi, je suis bien vivant ! » Et, d'un mouvement machinal, le
soldat sauvé tâtait ses jambes flasques, tordait entre ses doigts sa chair
insensible qui rougissait à peine. La bouche moulait des paroles que le cerveau
anémié concevait mal. – « Hein, je vous ai fait peur,
n'est-ce pas ? Je m'amuse ainsi à effrayer les camarades et ces dames les
infirmières. Si vous saviez comme c'est rigolo !... » Une grimace nerveuse, dénuée de
toute expression humaine, bouleversa sa face d'abruti que le délire
n'illuminait plus. En moi-même luttaient et se
confondaient des sentiments fugitifs et contradictoires : la satisfaction,
l'étonnement, une frayeur insolite et incompréhensible, le malaise du miracle,
le mécontentement de m'être inquiété sans raison et le reproche de ne pas me
sentir emporté par une joie plus vive.Tout à coup,
cette absence d'émotion forte me convainquit, comme une révélation, de mon
indifférence réelle pour cet homme médiocre. Que m'importait sa vie ou sa mort,
sa maladie ou sa guérison ? Ce revenant grotesque dont la mâchoire proéminente
mastiquait dans le vide, me dégoûtait et m'irritait peu à peu. Seul, l'autre combattant, le beau
el viril grenadier m'intéressait. Où gisait-il, celui qui avait gardé intacts
sa dignité et son sang-froid ? Disparu ou guéri ? Le sort illogique a-t-il
frappé l'homme vigoureux et vaillant, en sauvant l'être chétif et borné ? Je
délestais de plus en plus le ressuscité macabre dont la voix de crécelle
m'énervait ; ma haine s'alimentait de la certitude déprimante de la mort de
l'autre. Mon impatience m'entraîna. Sans
prudence, devant un blessé lucide et fiévreux, j'interrogeai une garde-malade.
L'infirmière secoua doucement la tête et les ailes de sa coiffe blanche
ondulèrent sur ses épaules ; elle s'éloigna de son patient et me répondit par
un flot de paroles afin de me dissimuler son émotion. – « Il ne fallait pas me
questionner devant cet homme. Il épie notre conversation ; il a été agité par
le mouvement insolite de l'ambulance et hier notre abattement l'a troublé. – Ah ! il est mort… – Oui, il n'y a pas vingt-quatre
heures. – On n'a pas pu le sauver ? – Le poumon touché s'est enflammé ;
hier matin, le chirurgien a opéré de nouveau ; il espérait encore, la blessure
n'était pas mortelle ; le pauvre grenadier a échappé à la pleurésie qui le
menaçait, mais le cœur n'a pas résisté. La dernière fois, c'est à peine s'il a
divagué sous l'effet du chloroforme. On l'a ramené au lit. Il était immense,
étendu sur le brancard ; il avait plié son bras sur la poitrine, comme à sa
première apparition ici, mais ses yeux restaient clos ; son pouls battait
encore ; inconscient, il a vomi, en entrouvrant à peine les lèvres, puis il a
respiré doucement jusqu'à cinq heures de l'après-midi… Le grenadier était beau à son
arrivée ; qu'il était majestueux et grand dans son cercueil ! il reposait dans
l'annexe de la pharmacie transformée en chambre mortuaire. Les fioles et les
bocaux étaient cachés sous un linge ; le vitrage de la porte avait été couvert
par un carton arraché à l'entrée et, sur un fond blanc, se détachaient les
lettres rouges : « Le silence est de rigueur ». Le mort remplissait toute la pièce. Son corps s'allongeait sur un lit
étroit et modeste. Sa tête s'enfonçait dans un coussin mou où la marque, une
minuscule croix rouge, ressortait comme une tache de sang. Le corps puissant
était gainé dans l'uniforme bleu dont les boutons luisaient ; la poitrine,
trouée de balles, émergeait, massive et large, des plis du drapeau belge ; les
bras repliés étreignaient l'étoffe. Les mains, très blanches, à peine gonflées,
résiliées déjà de quelques veines bleues dans la peau transparente, se
détachaient sur le fond noir. Le soldat était superbe ; la souffrance n'avait
pas ravagé ses traits. Son masque rigide n'était pas abîmé par l'expression
veule et détendue de ceux qui, avant de disparaître, ont accepté la défaite et
la déchéance. La mort ne le trahissait pas et ne l'enlaidissait point. La tête nue
était marquée d'une petite blessure et l'on s'imaginait que ce coup en plein
front avait abattu le géant, et cela simplifiait et embellissait sa fin
héroïque. Sur une table brûlait un cierge
dont la clarté était absorbée par la vive lumière du jour. Ce symbole nous
rappelait l'insignifiance d'un soldat dans la mêlée actuelle. Des palmiers au feuillage
fuselé cachaient de leur verdure les barreaux du lit d'hôpital. Des
reines-marguerites mauves et blanches, serrées en couronne, vivaient seules
dans cette chambrette imprégnée des odeurs mêlées du formol, des produits
pharmaceutiques, du cadavre et des fleurs. Dans le lit de fer reposait, inerte
à jamais, un corps magnifique d'athlète, bâti pour vivre cent ans. L'après-midi, quand je revins à
l'ambulance, un fourgon, attelé de deux chevaux harnachés de cuir, stationnait
à la porte, près d'un véhicule chargé de paniers à linge. Dans le couloir
désert, gardé à chaque bout par un infirmier, je croisai quatre soldats, la
manche cerclée du brassard de la Croix Rouge. Sur leurs épaules s'appuyait une
longue caisse de bois blanc au couvercle aigu. Le fardeau pesait ; en marchant,
les hommes ployaient les genoux. Ils passèrent vite ; à peine eussè-je le temps
d'enlever mon chapeau, d'incliner la tête et d'évoquer la présence du mort
qu'on enlevait. Les roues du fourgon résonnèrent dans la rue et le pas lourd
des chevaux s'éloigna.
Dans la pharmacie ouverte, le lit défait et le drapeau chiffonné attestaient la
hâte des croque-morts. Par terre, la couronne de reines-marguerites se fanait ;
le verre des quelques fioles découvertes luisait ; sur la table, la bougie,
empanachée, le matin, d'une flamme jaune, s'était éteinte ; une mèche
charbonneuse pointait, tordue, et une coulée grasse de cire durcie maculait le
bougeoir d'argent. (….) Un nouvel arrivant dans
notre ambulance : un courageux médecin provenant d’un village proche de
Malines Un jour, après une nouvelle évacuation de Malines par nos troupes, arriva à l'ambulance un petit médecin actif, trottinant, boiteux, obèse et jovial, échappé d'une bourgade conquise par l'ennemi. La goutte paralysait ses jambes et ankylosait ses genoux ; pourtant, il dédaignait l'appui des béquilles, claudiquait et sautillait sur un pied en se hâtant. Il réconfortait et soignait ses malades et palliait d'habitude la dureté de son regard énergique et perçant par un sourire qui tendait ses lèvres épaisses et distendait ses traits irréguliers. Le médecin avait subi le joug allemand, il avait été emprisonné dans le cercle de fer des batailles ; seuls son intelligence et son sang-froid l'avaient sauvé d'une mort ou d'un exil certain. II nous contait volontiers ses avatars tragiques, mais il ne discernait plus la grandeur de ses aventures et la qualité de son dévouement. Un sentiment unique le dominait et nourrissait tout son être : la haine de l'ennemi, le mépris de l'envahisseur. Simple et bon enfant, il dissimulait sa finesse tendre sous des dehors nonchalants et bourrus ; il n'assommait pas les oppresseurs d'injures sonores, mais il les jugeait et les fustigeait de sarcasmes précis. – « D'abord, nous dit-il, nos paysans n'ont pas cru à l'approche des Allemands ; pourtant, les plus incrédules furent bientôt convaincus. Des uhlans, en reconnaissance, sillonnaient le pays, par groupes ; ils s'arrêtaient à un estaminet, à la bifurcation de deux routes. A longues gorgées, ils ingurgitaient un verre de bière qu'ils payaient comptant, en faisant sonner les pièces de nickel et d'argent. Puis, ils demandaient « Wasser » en désignant leur monture. Les bêtes harassées, dont les naseaux palpitaient, tendaient leur cou vers un seau d'eau fraîche. Le luxe du harnachement émerveillait les serveuses : aux oreilles, les chevaux portaient des plaques de métal où l'aigle impérial, en relief, déployait ses ailes ; à l'arrière de la selle, une petite bande de cuivre brillait. Sur le poitrail du cheval se balançait une martingale lisse et un peu d'écume blanche adhérait au cuir. « Depuis quelques jours déjà, le canon grondait comme un tonnerre lointain. Mais une nuit, soudain, le bombardement se rapproche ; les vitres tremblent et le tintement aigu des carreaux ébranlés couvre, pendant quelques minutes, l'accompagnement de la canonnade. On a l'impression que la terre elle-même ne résistera pas à l'avalanche et un vent de terreur balaie le village. Les hommes, les femmes, les enfants, le bétail se ruent vers l'extérieur, se bousculent, et une masse noire d'êtres apeurés va se perdre dans les champs voisins. Chez eux, les villageois craignent l'ensevelissement sous les décombres et dans leurs chambres closes, l'impression de manquer d'air les affole. Des gerbes de feu, comme des paquets d'étoiles, montent dans le ciel ; les étincelles se perdent parmi les arbres, descendent, tombent, roulent, éclatent et cent langues de feu lèchent le sol qu'elles illuminent : le tumulte augmente ; les ronflements modulés, les roulements confus, les martellements précipités, les coups de massue dans l'air, les détonations brèves, longues, aiguës, basses se mêlent en un vacarme satanique, en une prodigieuse musique d'orchestre. Et les heures s'écoulent dans l'attente des événements qui ne se réalisent pas. « Au lever du jour, le fracas semble diminuer ; en réalité, nos nerfs, seuls, se calment ; avec la nuit, nos craintes se dissipent et chez la plupart une prostration invincible annihile et confond tous les sentiments. Les rares accalmies du bombardement nous déconcertent maintenant, comme une anomalie ; le silence passager pèse, insolite. » Le médecin s'étira sur la chaise-longue où il s'était étendu pour passer sa nuit de garde ; il ploya sa jambe douloureuse, en esquissant une grimace qui arqua ses sourcils épais et dilata ses narines larges et il poursuivit : – « Dès le lendemain, la plupart des villageois vinrent réintégrer leur domicile. Dans les champs, des paysans, placés en sentinelle, guettaient l'ennemi. Sans prudence, poussés par la curiosité, ils s'approchaient des lignes de feu ; plusieurs furent tués. Mais à chaque nouvelle alerte, la troupe des pauvres êtres s'ébranlait. Les récits des atrocités allemandes hallucinaient les imaginations. Les fuyards ployaient sous le poids des vêtements, des objets disparates empaquetés, pêle-mêle, dans des draps noués. Les femmes allaient s'abriter dans un village voisin ; les hommes, moins apeurés, se cachaient dans les champs. « Après quelques heures d'absence, les fugitifs réapparaissaient un à un. D'abord, un gamin circonspect et agile, dépêché en éclaireur, longeait les premières maisons, en se dissimulant ; bientôt, il rebroussait chemin ; il faisait signe au groupe suivant et, peu à peu, le village se repeuplait d'une foule exténuée qu'une appréhension maladive tenaillait. Cet exode précipité, suivi d'un rapatriement imprudent se renouvela cinq ou six fois. Peut-être, aurais-je aussi obéi aux ordres absurdes de la panique si la goutte ne m'avait cloué sur place, si des blessés – entre autre un prisonnier allemand dont le transport était impossible – ne m'eussent retenu. « Je me trouvais seul avec les vieillards, les blessés et les infirmes, quand un petit détachement d'infanterie bavaroise vint camper sur la grand' place. Un commandant et quelques officiers s'installèrent à la maison communale. La canonnade avait cessé ; il faisait beau ; l'après-midi était orageux et je prévoyais une averse dans la soirée. Je m'étais assis sur une chaise de paille, à ma porte, la jambe allongée. Et j'attendis. Un officier me remarqua, fixa un binocle sur son nez court et s'approcha de moi. Ses lèvres épaisses, aux contours nets, donnaient à son visage une sévérité et une dureté que les traits mous et les yeux bleus très clairs semblaient démentir. Il mêlait des mots français aux expressions de son dialecte indigène et s'imaginait parler flamand. Il me dit que je serais rendu responsable de tous les attentats commis contre les Allemands, au village ; il planta une sentinelle à ma porte et s'éloigna, en se dandinant sur ses jambes écartées à la manière des jockeys et des maquignons. « Vers six heures, un jeune aide-major allemand vint rendre visite à mes blessés. C'était un bon petit homme timide qui portait sans grâce, comme honteux, l'uniforme allemand. Il n'examina pas mes malades et n'adressa point la parole à ses compatriotes. Il murmura : « Gut, gut » (Bien, bien) et il m'interrogea minutieusement sur ma pharmacie ; je dus lui montrer mes instruments chirurgicaux. Il me demanda à boire, sans arrogance ; je lui versai du vin blanc dans un grand verre à eau. Nous arrêtâmes les dispositions indispensables à l'arrivée des blessés attendus, puis nous causâmes médecine, pendant que le jour tombait et accentuait, dans ma salle à manger basse, les contours du buffet de chêne et de la table massive. « Tout à coup, dans la pénombre, apparut un robuste commandant allemand ; il s'immobilisa une seconde, encadré dans le chambranle de la porte ; le sous-lieutenant se dressa, comme mû par un ressort, joignit les talons et porta au képi les doigts qui se raidirent. – Ah ! C'est vous le médecin qui séquestrez les blessés allemands ? fit-il, penchant son torse en avant et appuyant ses mains lourdes sur le dossier d'une chaise. Mais, du tac au tac, je ripostai : – Je ne suis pas un geôlier, moi, Monsieur ! « Et je martelais les mots et mes yeux se rivaient sur la large figure rouge du commandant qui bafouilla et s'embrouilla aussitôt. En vain s'efforça-t-il de se donner une contenance et de masquer la retraite précipitée que ma fermeté 1ui imposait. Ses gros doigts tambourinèrent sur la table et avancèrent tels de larges tentacules jusqu'à la bouteille qu'ils agrippèrent. L'officier versa lentement dans un verre propre le vin blanc qu'il huma ; il but, en gardant, un instant, une gorgée dans sa bouche ; ses joues se gonflèrent et il dodelina de la tête d'un air satisfait. Puis, d'un mouvement automatique et brusque, tout d'une pièce, il se tourna vers l'aide-médecin. Ses sourcils se froncèrent, les mots, à moitié avalés, saccadés, se précipitèrent en avalanche et souffletèrent le subalterne. Colérique et sec, il renversa le verre ; la boisson s'épandit sur la table, en ternissant le chêne ciré. Mais, sans s'émouvoir, le subordonné salua, joignit les talons et quitta la chambre. – « Votre vin – dit le commandant – est trop bon pour ce galopin-là ! » « Et, tourmentant sa face sévère par un sourire obséquieux et contraint : – « Avez-vous encore une bouteille, mon cher Docteur, nous trinquerons ensemble. » « En me quittant, il congédia la sentinelle clouée à l'entrée de ma demeure et fil griffonner par un caporal sur ma porte : « Gute Leute ; bitte schonen » (Bonnes gens ; prière de les épargner). Il appliqua sa signature illisible, parée d'un paraphe prétentieux, au bas des petites lettres pointues, irrégulières et maladroites qui dansaient une piteuse sarabande. « Mais, le lendemain, pendant une grossière perquisition, lorsque j'osai invoquer la protection officielle de mon inscription, le sous-officier de service haussa les épaules et assaisonna un juron sonore de l'appréciation irrévérencieuse : « Dummes Zeug » (des bêtises) et passa outre. « Pourtant, autour de nous, la lutte faisait encore rage ; les Belges revenaient à l'assaut ; je distinguais les voix diverses de la bataille : prenantes et compréhensibles comme d'humaines interjections. « Un soir, le tumulte exaspéré des canons, des fusils et des mitrailleuses fut submergé par une clameur inarticulée, par un aboiement rauque et bestial qui me glaça littéralement les membres ; les hurlements des soldats dominaient maintenant la voix insensible des engins. Peu à peu, ces vociférations sans âme, mêlées aux trépignements et au cliquetis, se modulèrent. D'indicibles grognements sortant des entrailles perforées, d'inexprimables cris naissant dans des cerveaux chavirés, remplirent ma chambre de plaintes, de râles et d'appels de détresse ... A la suite d'une brillante charge à la baïonnette, les nôtres venaient de reprendre mon village... » Que nous réserve l’avenir ? Ainsi les récits des fugitifs, les rencontres des soldats, les fournées de blessés las, les convois de réfugiés, tout, jusqu'à l'atmosphère de guerre qui enveloppait Anvers, nous rapprochait de la bataille. A l'assaut prématuré, affirmait-on, d'un des forts du sud, quinze cents ennemis s'étaient effondrés sur la plaine coupée de haies et de fossés à sec. Des soldats prétendaient avoir ramassé des casques à pointe et des fusils allemands. Mais des officiers démentaient ces faits sensationnels. Dans notre cercle familial, des amis « bien informés » colportaient les nouvelles de victoires inventées et de défaites imaginaires; ces bruits opposés ne s'inspiraient guère de la réalité, mais ils nous révélaient le caractère de chacun, l'optimisme béat ou le pessimisme irraisonné. Les uns prévoyaient l'attaque générale ; les autres niaient même la possibilité d'un bombardement. Le soir, quand la ville, plongée dans le noir, s'assoupissait, nous nous échauffions, en discutant ces questions passionnantes et oiseuses : nos nerfs vibraient sans cesse et nos sensations évoluaient par sursauts. Mais des bourgeois apathiques vivaient encore dans le calme, et l'instabilité de notre état ne les alarmait point. Sans doute, plus tard, quand les Anversois évoqueront les derniers jours avant l'attaque ennemie, le bombardement et l'exode – le plus dantesque épisode de ces jours d'angoisse – ils exagéreront leurs appréhensions et leur surexcitation nerveuse, ou bien, ils accentueront leur sérénité grandiose et leur insouciance voulue. Dans dix ans, ces gestes contradictoires et ces opinions divergentes se figeront en une attitude unique qui sera, devant l'histoire, l'attitude définitive d'Anvers avant sa chute. J'ai tâché de fixer et de préciser l'évolution de ma ville natale. Dans son ensemble la courbe en est harmonieuse : soumise aux événements tragiques, fructifiée par la douleur, presque constamment maîtresse d'elle-même, soulevée d'abord par un espoir absurde, alimentée ensuite par la flamme de haine, souffrant sans se laisser abattre, se soutenant par la joie, s'éperonnant par l'action, Anvers s'est montrée l'égale de toutes les villes héroïques. Au lieu de noter avec simplicité et exactitude les événements des dernières journées, il conviendrait de développer ici u poème que je ne saurais écrire. Un historien lucide analyserait peut-être nos sensations opposées : la confiance, l'énervement, le calme. L'artiste et le savant associés glorifieraient le passé et prévoiraient l'avenir. En toute simplicité, je veux revivre les heures d'agonie qui furent belles. Elles enrichissent la ville d'une semaine de douleur et la contraignent à une stimulante humilité. Ah ! Comme elle se dressa virile, noble, forte, unie et désintéressée, au milieu du flot montant et de l’orage déchaîné ! Les désirs et les impressions personnelles se soudent aux émotions et aux espoirs de la foule. Chaque heure diffère de l'heure précédente et chacune renferme le mystère d'un événement capital. Notre sang est fouetté, notre impatience bout, haletante ; le courage et la crainte se disputent notre être et nous ravissent à notre coutumière médiocrité ; nous croyons avoir grandi et nous nous imaginons plus précieux, mais notre vie ne vaut rien et notre agitation s'use, inutile. Ici, à l'apogée de la tragédie où vont s'accumuler des faits, des espoirs et des sensations, je renonce à coordonner ces lignes. Maintenant, le chaos va régner en maître : qu'importe la signification des actes que nous ne contrôlons plus ! Dans les périodes tranquilles et lentes de la vie, les événements se succèdent et ne se confondent pas ; les impressions se déduisent des faits et notre esprit s'arme dé logique. Mais, à présent, tout l'être est bouleversé ; les barrières sociales s'écroulent ; les obus vont semer la mort et engendrer la panique. Alors, les épisodes, les pensées se mêlent, s'effacent ou jaillissent, sans goût et sans raison. La vérité, exigeante et sommaire, succombe sous la rafale des visions. Des souvenirs évoqués se heurtent et se contredisent. Ainsi le bombardement et la chute d'Anvers s'agglomèrent en une matière disparate et précieuse ; le sublime et le ridicule se juxtaposent ; des préoccupations mesquines étouffent des soucis surhumains. La pitié s'exaspère, puis s'émousse ; l'espoir monte comme une fièvre. Sous la pression ennemie, Anvers se débat, s'illusionne, se raidit comme un moribond condamné, macabre et grandiose. L’exploit d’un
chauffeur dans les lignes ennemies Deux jours avant l'écroulement des premiers forts, à l'entrée de notre maison, se dressa soudain le spectre vivant de la guerre, et ce présage personnel nous convainquit dû danger proche. Sur le boulevard, un rassemblement d'hommes, de femmes et d'enfants entourait une auto délabrée. Cet empressement et cette curiosité étaient justifiés par l'aspect lamentable de la voiture. Nous rencontrions bien des véhicules minables, usés, ternis par la boue, éraflés par les balles, les phares bosselés, les cuivres rongés et noircis, les garde-boue tordus, les vitres étoilées et striées de brisures. Jamais je ne vis une machine plus abîmée, plus émouvante et plus grotesque que notre ancienne voiture bleue qui revenait du champ de bataille. La couleur avait déteint en un indéfinissable mélange d'outremer, de vert et de gris ; au pare-brise d'avant, deux trous étaient percés dans la glace, comme par une vrille ; sur la tige du volant touchée par une balle s'étalait une tache pareille à une ecchymose. Le côté droit du capot enlevé par un éclat d'obus laissait à nu les organes de la machine qui s'étalaient, compliqués et gras ; les arceaux de bois de la capote se ployaient comme des membres brisés. Écartant la foule qui l'entourait, le chauffeur courut à notre rencontre : – « Je suis vivant et j'ai sauvé la torpédo, s'écria-t-il, en nous tendant spontanément la main. » Sans nous permettre de l'interroger, le mécanicien nous désigna les centaines de trous, presque imperceptibles, creusés par la mitraille. L'arrière était criblé ; des crins tordus et frisés s'échappaient en touffe des blessures des coussins. – « Ils ne m'ont pas eu, les Boches ! « Hier, dit-il, on s'est battu pas bien loin, à vingt bonnes minutes d'ici. J'attendais, à l'arrière, le retour d'un officier d'état-major. Je fumais tranquillement, à l'abri d'un mur, à cent mètres de ma voiture. Voilà, tout à coup, je ne sais trop comment ça s'est fait, l'ennemi avance et la grêle de projectiles s'abat sur l'auto abandonnée. Je m'élance pour sauver la guimbarde ; mais c'est long, cent mètres sous le feu ! Il faut se garer ; je me jette d'abord à plat ventre, derrière un talus minuscule, où je me sens invisible. Les plombs sifflent sans jamais me toucher ; à la longue, accoutumé au danger, je me crois invulnérable ; je risque un pas vers la voiture, mais les Allemands avancent au même moment. « Je m'arrête : un mur de balles serrées me barre la route. Une salve, une avalanche, un enfer ! Je recule et je reste paralysé dans mon fossé, derrière les herbes basses. Si j'avais osé, peut-être aurais-je battu en retraite, abandonnant l'auto que la mitraille criblait. Mais sortir de mon abri c'était la mort. M'appuyant sur le sol, pressant ma tête contre la terre humide, je n'ai plus bougé ; j'ai attendu la fin de la rafale. « Quand les coups se sont espacés, soudain au hasard, j'ai émergé de mon coin et j'ai fait un bond en avant, vers l'auto bleue, immobile et solide comme une petite forteresse, sur la route proche. Cent détonations précipitées m'assourdissent ; les Boches me ratent dans mon saut ; me voilà, maintenant, accroupi derrière ma machine, protégé par l'acier du châssis. Il ne me reste plus qu'à grimper sur le siège. Mais patientons : un petit bruit sec avec un craquement de bois, c'est une balle qui vient se loger dans la carrosserie ; un tintement plus sonore, c'est du plomb qui s'écrase sur le capot. « Dieu merci ! le soir tombait ; les arbres, à l'horizon, s'éloignaient ; l'ombre de la torpédo s'allongeait sur la route ; le gris vert de mon uniforme taché de boue se confondait maintenant avec la teinte de la brume et des feuilles. « Risquons le coup », me dis-je. Je plie les jarrets, j'arque le dos ; d'un bond, je suis sur le siège et mes mains s'agrippent au volant. Quelle dégelée ! Quelle pétarade de détonations précipitées ! La nuit m'enveloppe. « Toute mon attention se concentre sur la mise en marche automatique ; ma main s'appuie sur le minuscule levier de cuivre et je guette la trépidation du moteur. D'abord, un ronronnement irrégulier hésite et s'enfle, puis, un grincement et un arrêt. Deux cylindres trépident et halètent avec des à-coups brefs qui m'effrayent comme les saccades du cœur. Enfin, je roule, je dévale, je m'élance dans le noir, sur la route pavée ; la voiture penche, je heurte des pierres et un pneu crevé me fait faire des embardées folles. Le crépitement des fusils s'éloigne. A chaque instant, je cours le risque de me rompre le cou. A gauche et à droite, de larges taches sombres marquent les trous forés par les obus dans le terrain plat. « J'ignore comment vingt fois je n'ai pas fracassé ma machine. Je fonce dans la nuit, comme un fou. Mais voilà que le moteur cogne et des ratés bruyants, scandés, angoissants comme des convulsions, se succèdent et se multiplient. Un chantonnement monotone mais aigu accompagne le ronflement. Je boite sur deux cylindres qui, faibles et lents, semblent traîner un poids surhumain. Prudent, malgré moi, je rampe sur la route étroite, creusée de fondrières..... Une heure après, j'étais arrêté à un poste belge par une sentinelle intelligente. La mécanique, en se détraquant, a eu le bon esprit de me sauver la vie. » Le chauffeur ne nous laissa pas le temps de le féliciter; nous n'eûmes pas le loisir de le gronder de son imprudence et de son amour insensé pour sa voiture délabrée. Déjà, sa main gauche se posait sur le volant; la main droite pressa le caoutchouc de la trompe qui mugit comme une bête atteinte. Des bouffées d'une fumée écœurante et lourde s'échappèrent par saccades, se réunirent en un nuage lourd et enveloppèrent les jambes des curieux attroupés ; la sirène grinça, assourdissante. En démarrant, l'auto frôla la foule et, bientôt, au bout du boulevard, la voiture blessée, perdue parmi les piétons et les véhicules, ne fut plus qu'une petite masse grise qui glissait sur le macadam, suivie d'une traînée de poussière blanche. La fin d’Anvers Dès le surlendemain, les premiers obus ennemis ravagèrent le fort de Wavre-Sainte-Catherine. La veille, en allant nous coucher, nous ouvrîmes nos fenêtres, vers le sud. D'abord, le silence, absolu, mystérieux dans la nuit, semblait remplir l'espace. Puis, en tendant l'oreille, on saisissait un bruit léger, comme une voix indistincte ; de nouveau, le silence s'étend. Notre imagination, un peu surexcitée, nous a-t-elle trompés ? Mais peu à peu, notre ouïe s'habitue et s'affine. A intervalles réguliers, nous percevons la rumeur nette du canon ; la vibration du coup s'est amortie dans cet air immobile dont on croit sentir la pesanteur. Un malaise inconscient, qui plane et se propage, ébranle les êtres les plus froids et les plus courageux. Par le murmure de nos conversations, nous dominons sans peine ce son à peine perceptible ; mais cette voix obsédante va s'enfler, se multiplier, se développer, déchirer les tympans, abattre des maisons, jusqu'à ce qu'elle nous ait imposé, par sa volonté de fer, la domination provisoire de l'ennemi rapace. L’auteur conduit une
parente en Hollande A cette heure, à nulle autre pareille, nous nous sommes réunis en un nouveau conseil de famille. Il ya un mois, nous nous étions préoccupés de l'éloignement des enfants, maintenant, nous nous soucions d'éviter aux vieillards l'ébranlement périlleux d'émotions trop fortes. Mais les personnes âgées qui ne tiennent plus à la vie sont obstinées. Seule, une parente de quatre vingt-quatre ans, très lucide, intelligente et douce, consentit à s'expatrier. L'on me chargea, de nouveau, des soins du voyage. Accompagné de la petite-fille de cette dame respectable à qui l'admiration et l'amitié m'attachent, je devais me rendre en Hollande, m'absenter quelques jours seulement et revenir aussitôt. Nous ignorions que, dès cet instant-là, le 28 septembre, à trois heures de l'après-midi, quand le premier obus s'abattait sur la coupole de Wavre-Sainte-Catherine, Anvers était touché au cœur... J'allais m'éloigner tandis qu'à mon insu la mort s'approchait de ma ville natale. Alea jacta est... La ville, que je quittai le matin, était assoupie dans le calme. Déjà, devant l'Hôtel de Ville, sur la Grand' place, encadrée par les anciennes maisons flamandes dont les ors brillaient, la foule se pressait, apathique et docile. La gare, surchargée de sculptures et de rosaces, est morte. Sous le hall arqué, les rails vides tracent deux lignes parallèles entre les quais déserts et s'enchevêtrent aux aiguillages lointains. Dans toutes les directions – la route de la Hollande exceptée – les locomotives lancées iraient s'écraser sur le mur de l'armée allemande. Aucun convoi de blessés n'est attendu. A l'écart, notre train stationne, minable, long, isolé. Deux gendarmes vérifient nos papiers ; ils ouvrent nos bagages ; des vêtements, du linge, des dentelles remués et mêlés émergent ; nos objets précieux et intimes sont manipulés et tâtés par des doigts épais et le couvercle des malles se rabat sur un inextricable et piteux désordre. Si j'avais prévu l'avenir, si j'avais su que je ne franchirais plus l'enceinte de ma ville, des appréhensions, des regrets, des remords m'eussent étreint et deux devoirs contradictoires se seraient opposés en moi-même. Mais je ne m'attendais pas à une reddition si prochaine : je me souciais seulement de réunir des valises éparpillées ; je soutenais la vieille dame à la marche lourde, et nulle idée ne me préoccupait. Combien de fois, dans mon enfance, n'avais-je pas voyagé par ce train d'Anvers à la campagne ! Je ne regardais même plus les paysages familiers qui s'encadraient, mouvants, dans la vitre : l'eau qui croupit au pied des fortifications, les champs plats, les prairies où les vaches ruminent, le canal peuplé de chalands. Aujourd'hui, tous les compartiments étaient encombrés de paysannes rubicondes, de maraîchères matelassées de jupes amples, qui rapportaient à leur ferme leurs paniers vides. Autour de moi, les femmes causaient. Elles ne se souciaient pas des opérations militaires ; mais leur pitié d'humbles et bonnes campagnardes débordait en paroles loquaces ; Lierre avait été bombardé ; sur tous les villages, blottis au sud de la ville autour des forts avancés, s'était abattu le fléau de la mitraille, allumant les toits, poursuivant la population qui fuyait sur les routes défoncées. Le flot déferlant des réfugiés, atterrés et minables, s'était enflé tout à coup. L'interminable cortège ne traversait plus le centre de la ville. La plupart des parlants étaient dirigés vers la Hollande ou vers les Flandres. En route, à un long arrêt, nous rencontrâmes un troupeau de ces pauvres êtres ahuris et prostrés. Ils étaient encagés dans des compartiments sombres, les têtes se touchaient presque et les membres semblaient entassés. Des enfants dormaient, étendus sur les genoux des mères qui ne bougeaient pas. Dans leur figure maigre leurs yeux luisaient. Ils ne parlaient pas ; ils ne pleuraient point. Et la pitié même ne s'éveillait pas devant ce bataillon d'exilés passifs. L'imprévu et la grandeur d'un incompréhensible cataclysme avaient paralysé les facultés de tous et nous étions inaptes à nous imaginer la somme de malheur accumulée sur des milliers de têtes. Ailleurs, des hommes et des femmes montaient dans les wagons et hissaient des enfants peureux. Ils ne se bousculaient pas ; ils obéissaient aux ordres de leur guide. Une expression identique, fixe, creusée par le malheur dans leurs traits tendus, les transfigurait comme un masque tragique. La plupart, dociles, se mouvaient, par saccades, sans comprendre : des mères oubliaient des enfants ; les hommes valides ne soutenaient pas les vieillards. La soudaineté de la catastrophe atrophiait leur cerveau et l'abrutissement pesant et lugubre, tuait jusqu'à la souffrance. Une sorte d'insensibilité passagère anesthésiait ces exilés ; leur flot s'écoulait à la porte de notre compartiment, continu, monotone et muet ; ce silence insolite pénétrait jusqu'aux moelles ; j'eusse voulu bousculer ces pauvres gens, secouer leur résignation accablante et pesante qui démoralisait… A la sortie de la haute gare d'Anvers-Dam, des spectacles guerriers s'intercalèrent parmi des paysages connus. Sur l'herbe rongée des fortifications, veillaient des sentinelles ; deux canons menaçaient une large route d'accès. La terre remuée des travaux récents tachetait les remparts de plaques jaunes disséminées. Un mur de tôle, percé de meurtrières carrées, fermait une brèche nouvellement taillée. Ces préparatifs sommaires terrorisaient deux vieilles filles qui s'exilaient en compagnie d'un glapissant King-Charles et d'un canari enroué. Mais la chère dame âgée, que nous menions en Hollande, écrasait sa figure ridée et bouffie contre la vitre ; elle contemplait les canons braqués, les soldats armés et elle se remémorait les guerres, toutes horribles et sanglantes dont elle se souvenait. Elle secouait doucement sa tête congestionnée et, au-dessus de son front labouré de rides, tressaillait le papillon de dentelle de sa capote démodée. Le train s'arrêta à la station de C*** : un employé qui, depuis vingt ans, poinçonne les billets, et dont j'ai vu la moustache noire blanchir peu à peu, vint nous prier de descendre : « Les maraîchers seuls ont le droit de traverser la zone militaire qui s'étend toute proche ; les voyageurs qui circulent « pour leur agrément » doivent s'arrêter ici. » Résignée, la vieille dame franchit pesamment le marchepied élevé, en s'appuyant sur mon bras. Les cultivateurs et les paysannes, penchés aux fenêtres des voitures, nous regardaient en riant et, dans leur simplicité, ils jouissaient de leur privilège. Devant la station où le poney au ventre bombé, m'avait maintes fois attendu, des voitures antédiluviennes, hétéroclites, innombrables, roues à roues, encombraient la place exiguë : Des landaus, à la caisse monstrueuse et bosselée, traînés par des bêtes squelettiques, des cabriolets attelés de chevaux de labour, des tapissières dont les rideaux déchirés et maculés flottaient, des charrettes à bagages hautes sur roues, des diligences du vieux temps, des « vigilantes » à la mode anversoise. Les cochers s'accrochaient aux dames, enlevaient les enfants, arrachaient des bagages, vantaient leur équipage, marchandaient, criaient, gesticulaient. Un gros bonhomme, le front perlant de sueur sous un chapeau déformé, le ventre rond sanglé dans une jaquette de notaire, nous hissa dans sa voiture, nous enlevant à la force du poignet à un concurrent moins vigoureux. Dans aucun pays, sous aucune latitude, je n'ai admiré une guimbarde semblable à celle où nous nous entassâmes, écrasés par nos sacs à mains, éborgnés par nos parapluies. Au siège, spacieux et haut était accrochée une sorte de caisse profonde, agrémentée de deux banquettes qui se faisaient face et, en arrière, comme un prodigieux arrière-train, suivaient les panneaux renversables du landau. Le cocher, à la face cramoisie où deux petits yeux mobiles clignotaient sans cesse, nous convainquit de l'impossibilité de charger notre malle sur ce véhicule, spacieux comme une maison. Il amarra le colis sur une petite charrette dont le plancher usé faillit s'écrouler sur deux roues minces. Un garçonnet à l'air minable et intelligent conduisait le cheval efflanqué, serré entre les brancards de ce triste véhicule. Notre landau s'ébranla avec un bruit de ferraille et de vitres heurtées ; la voiture à bagages, où s'était hissé un Hollandais économe, nous suivait en cahotant. Devant nous, derrière nous, zigzaguait le cortège pittoresque et lamentable des voitures chargées de vieilles dames et d'enfants qui se hâtaient vers la frontière. Dans le village que nous traversions, chaque maison, chaque arbre, évoquaient de joyeux souvenirs d'enfance ; ils revivaient tous en moi et je me défendais en vain contre leur assaut. Ici, se balance l'enseigne d'une modeste épicerie où, jadis, une grosse marchande bavarde nous distribuait des bonbons ; là, s'étale le large mur blanc d'une ferme, où, à la Fête-Dieu, un prêtre scintillant, chasublé d'or, venait s'agenouiller devant un reposoir, sous un dais grenat frangé d'argent. Nous contournâmes la maison communale en brique rouge. Dans notre jardin, les herbes avaient poussé dans les pelouses et elles masquaient et rongeaient la courbe des parterres. Mais notre hâte obligatoire, nous interdisait une halte à cet endroit aimé, et cela nous énervait, nous remplissait de tristesse. Nous croisâmes quelques villageois connus ; à notre retour de Berg-op-Zoom, dans le cabriolet cahotant et démodé, ces paysans s'étaient moqués de notre attelage ; notre entassement dans ce landau primitif ne les divertissait plus car tous les jours, à la même heure, défilait le même cortège navrant d’exilés minables. Toutes les voitures de cette triste caravane d'émigrés nous rattrapèrent une à une. Notre cocher cinglait son cheval maigre, qui trottinait péniblement. Bientôt nous nous trouvâmes isolés sur la grand' route bordée de jardins et de rares habitations paysannes. Au lieu de continuer tout droit, par la route la plus courte, vers la Hollande, nous bifurquâmes vers la droite et nous évitâmes les parages ravagés où gisaient les arbres abattus, où les briques pilées des maisons s'étendaient en nappe rouge, parmi les pieux fichés en terre et les fils de fer enchevêtrés. Nous cheminions par une belle journée d'automne, déjà fraîche ; la lumière était tamisée par des nuages blancs, éclairés sur les bords par les rayons diffusés. Parfois, le paysage, enveloppé d'un voile ténu de brume, se ternissait soudain, quand un cumulus noir masquait le soleil pâle ; puis, sans transition, lorsque le soleil émergeait de nouveau, les feuilles humides luisaient ; des ombres noires, aux contours nets, se précisaient sur le sol ; par terre, à nos côtés, s'accentuait le dessin sommaire d'une haridelle, haute sur pattes, le cou tendu, dont l'apparition se confondait avec la silhouette d'un caisson bizarre surmonté d'un siège majestueux comme un trône. Le paysage qui nous enveloppait m'était familier ; jadis, vers le soir, nous passions souvent, en voiture, par ce chemin étroit, bordé de bois de sapins et d'innombrables buissons de châtaigniers bas. Les pavés irréguliers se voûtaient au milieu de la route, et dans les défoncements, s'accumulait une pâte brune de boue séchée qui se craquelait. A gauche, des monticules herbeux jalonnaient le ruban cendré de la voie cyclable. A droite, s'allongeait une superficie sablonneuse où s'isolaient des touffes d'herbes, où des ornières profondes, aux bords écroulés, traçaient un sillon double et indéfini. Nous nous laissions pénétrer par l'atmosphère calme de ces lieux connus ; notre cheval trottinait ; la charrette, chargée de bagages, se détachait au loin, sur le fond grisâtre, avec la silhouette mince et arquée du conducteur et la figure anguleuse du Hollandais juché sur les malles. Tout à coup, le spectacle se transforme, comme le décor d'une féerie ; pourtant, nous ne quittons pas les parages aimés des promenades de jadis. Au bord de la route, se blottit une étrange cabane au toit pointu, d'où émergent deux soldats qui nous autorisent à entrer dans la région maudite. Si, par miracle, nous avions été transportés sur une autre planète, la surprise et une sorte de terreur vague et indéfinissable ne nous eussent pas bouleversés et contractés davantage. Ici, la grandeur tragique de la guerre s'imposait ; sa force de destruction nous épouvantait ; sa puissance créatrice nous plongeait dans l'émerveillement. Cette plaine éventrée, soumise au pouvoir militaire, était maltraitée, les flancs ouverts, asservie malgré elle à la défense d'Anvers. Aujourd'hui, dans mon souvenir, l'inutilité de ces ravages cruels ajoute encore au pathétique de ce site bousculé. Devant nous, une tranchée aux bords droits barrait la moitié de la route et se continuait, marquant une ligne serpentant dans l'immense plaine unie, parsemée çà et là de monticules de terre jaune. A deux mètres de là, un second fossé coupait l'autre côté du passage ; l'isthme de sable resté libre était raviné d'ornières et marqué de profondes traces de sabots. Plus loin, le chemin resserré était protégé par deux remblais élevés qui limitaient la vue ; dans ce boyau, le roulement de la voiture s'enflait bruyamment et une pénible impression d'emprisonnement avivait notre impatience et notre énervement. Quand ces fortifications de campagne s'abaissèrent enfin, nous débouchâmes tout à coup au centre même de la plaine désolée. Jamais je ne saurai fixer mon état d'âme ; jamais je ne décrirai ce spectacle tragique, guerrier, poignant au delà de l'exprimable. A l'avant-plan, les bruyères n'avaient pas été piétinées ; les fleurs tardives tachetaient de points roses les places limitées où d'autres bruyères, fanées et pâlies déjà, mettaient un fond d'un rose passé, fondu au brun des tiges desséchées. A côté, comme si l'harmonie eût été voulue par un artiste génial, s'étendait une plaque jaune de sable bouleversé et la section de jeunes arbres coupés à ras du sol semblait flotter sur ce lac safran. La lisière d'un bois détruit verdoyait encore ; les feuilles étaient la note la plus claire d'une gamme de tons hardis où se juxtaposaient les bruns divers des feuilles et des branches mortes, le rouge sombre d'une maison abattue et le noir d'herbes et de débris calcinés. La terre même paraissait rongée par la flamme. Un sentier traçait une ligne en zigzag comme la crevasse d'un tableau, palette mouvante de gris argent, de bleu turquoise, fondus à l'horizon avec les couleurs variées de cette plaine angoissante et merveilleuse. Lentement, nous traversions ce désert neuf dont notre raison et notre cœur appréciaient la beauté funèbre. L'homme avait imposé sa volonté à la nature ; en une improvisation nécessaire qui attestait sa force, il l'avait creusée, abîmée, modifiée conformément à ses besoins actuels et il prévoyait ici un combat indispensable et farouche ... Mais le silence plane sur cette désolation ; seul, le croassement discordant d'une volée de corbeaux couvre le roulement de notre landau et le trottinement de notre cheval harassé. Les cris lugubres nous inquiètent par leur présage. De la terre utile et vivante, nous venons d'être transportés dans un enfer au sol torturé. Nous croyions avoir atteint immédiatement le sommet de l'horreur et du sublime funèbre. Mais un autre aspect de cette plaine ravinée devait nous émouvoir plus profondément encore par la beauté et la laideur réunies, par la misère et la grandeur éparses. A un tournant, l'espace bouleversé grandit, augmenta, comme si la dévastation se fût étendue sur toute la terre : ce n'était plus seulement un cite restreint et limité qui s'étalait devant nous, mais une plaine immense, comme jamais je n'en vis de semblable ; les champs de bruyères roses où, jadis, nos chevaux ont écrasé souvent les tiges qui craquaient, paraissaient minuscules, comparés à ce désert artificiel. Dans la vaste zone travaillée, seule la masse de deux forts neufs accrochait le regard qui glissait sur le sol égal ; les ouvrages militaires et les bouches noires d'une batterie accusaient les effets et limitaient les proportions, comme les bouquets d'arbres taillés et les statues isolées d'un jardin dessiné avec art. Sur cette plaine morte, rongée par l'incendie, labourée par la destruction, comme des parages damnés, vivaient et bougeaient, tout au fond, les lueurs jaunes et rouges d'une meule incendiée. Notre attention se concentrait tout entière sur ce point lumineux où travaillait une force ravageuse, déchaînée, cette fois, par l'homme pour le protéger de désastres plus humiliants et plus irréparables. Nous traversions un champ de bataille, non pas un endroit sacré, où des souvenirs glorieux se concentrent dans la paix reconquise, mais un cadre préparé pour contenir la mort. Et cette perspective lugubre torturait notre esprit comme une hallucination. Dans ces fossés qui serpentent, sur ce fond de bruyère et de sable, des hommes vont râler et mourir ; de ces gueules d'acier, des obus vont s'élancer, fendre l'air en sifflant et anéantir nos ennemis au loin ; d'autres bombes, ayant parcouru leurs trajectoires courbes, exploseront avec fracas, soulevant des mottes de terre et des parcelles de chair humaine. Cette plaine, qui semble endormie, se réveillera ; les tranchées seront un cordon vivant de soldats coude à coude. Pourtant aujourd'hui, dans le matin calme ; nul souvenir n'apitoie ou ne soulève les travailleurs ; mais, au moment où la mort guettera, une vie tout entière renaîtra dans des milliers de cerveaux, un passé oublié s'imposera, péremptoire, chargé de désirs impossibles. Et notre imagination devance l'heure de l'attaque imminente ; elle précise les visions de la bataille qui a ce même instant, passe en rafale au sud de notre ville..... Le Hollandais allume une pipe et suit distraitement du regard les bouffées de fumée qui s'agglomèrent, puis s'écartent et se fondent ;.le cocher somnole sur son siège haut et les brides flottent sur les côtes saillantes du cheval éreinté. En face de moi, encastrée dans les coussins usés du landau, la vieille dame, couperosée, décoiffée, dit : « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » et, secouée par les cahots de la voiture, elle hoche la tète involontairement. Tout à coup, après un tournant imprévu, nous sortons de la zone militaire ; à côté des troncs abattus et des branches mortes, des arbres vigoureux se dressent, impassibles ; la verdure, lavée par des averses récentes, brille, inaltérable ; dans les parterres des jardins délaissés, des fleurs automnales, enchevêtrées aux mauvaises herbes minces, se juxtaposent en bouquets irréguliers ; des enfants jouent devant la terrasse d'une villa ; nous croisons des paysannes lourdes, rebondies et heureuses, affalées dans des charrettes à deux roues, traînées par des chiens haletants. Ici, à la frontière même du domaine de la mort, la paix s'impose et la joie se propage. En Hollande, j'ai traversé des petites villes attrayantes, paisibles et j'ai vu des gens heureux ; assises à leur fenêtre aux carreaux luisants, de bonnes vieilles dames cousaient, le nez penché sur leur ouvrage, et leurs mains lourdes bougeaient lentement ; des fillettes, pieds nus, pantalon haut troussé sur des cuisses grêles, clapotaient dans des flaques, étalées au fond d'un creux de sable jaune, au bord d'une mer calme et grise. Dans les rues, coupées-de ponts de bois, des hommes, préoccupés de leurs affaires, se hâtaient, et leurs jambes, trop minces pour leur corps épais, s'allongeaient et remuaient avec rapidité ..... En appuyant sur ma joue sa joue striée d'un filet de petites veines rouges, notre chère parente nous a dit simplement, avec un chevrotement dans sa voix usée : « Que Dieu vous protège, mes enfants ! » et nous l'avons laissée seule, là-bas, dans une maison aux volets verts qui donne sur une rue neuve pavée de « clinkers.» La façade de briques, sans caractère, se confond avec des villas voisines. Le vent, qui vient du large, creuse et meut le sable fin des dunes proches ; des tourbillons de poussière montent en spirale, piquent les yeux et s'abattent tout à coup. Du deuxième étage, mansardé sous un toit d'ardoises aux angles capricieux, la vue plonge dans la mer lisse et calme qui berce des barques de pêcheurs. Retour à Anvers Quelques jours plus tard, je me retrouvai à la frontière belgo-hollandaise, sur la grand' route de Berg-op-Zoom, à vingt kilomètres d'Anvers, à une lieue de notre demeure familiale. Pendant mon absence, le désastre s'était rapproché. Les obus ennemis avaient éventré les coupoles bétonnées des forts d'avant-garde ; le déluge de fer submergeait déjà les anciennes défenses de la seconde enceinte. La voix du canon qui, il y a six jours, vibrait à peine dans l'air tranquille de la nuit, couvrait maintenant la métropole de son tumulte comminatoire. L'imminence du bombardement, annoncé par le gouvernement militaire, secoua la population de sa torpeur confiante. Les autorités conseillèrent le départ et toute la ville se jeta, comme un fleuve dont les eaux montent, dans les grand' routes débordée . Maintenant, l'océan du malheur s'enfle ; l'angoisse, l'effroi, la désolation atteignent une hauteur que personne n'imagina jamais. Si, dans le flot déferlant de la souffrance, tout le monde n'avait pas été tenaillé par ses soucis et ses chagrins personnels, la contemplation d'un pareil cataclysme eût abattu les plus courageux. Mais chacun se soucie surtout des êtres aimés et chaque fugitif restreint, malgré lui, l'incommensurable catastrophe à un accident personnel. Une ville entière se vide ; des milliers d'êtres s'en vont, poussés vers l'inconnu, et l'instinct sommaire de la conservation atrophie les intelligences. Traînant à la remorque des enfants exténués, les pieds saignants, le visage boursouflé, les membres frêles trempés de sueur, une jeune femme avait couru jusqu'à la frontière hollandaise, sans prendre le temps de se reposer ; ici, comme la frayeur ne la galvanisait plus, elle s'était affalée au bord de la route, inconsciente et sans force. De lourds soldats hollandais portaient et serraient dans leurs bras des nourrissons, que leur mère, éreintée, ne soutenait plus. Dans des circonstances moins tragiques, ces gestes maladroits des militaires affairés, le contraste entre leur rôle guerrier et leurs occupations maternelles, nous eussent réjouis infiniment. Mais les premiers fugitifs rencontrés n'étaient, que les avant-coureurs de l'interminable cortège où l'angoisse, la fatigue, la haine s'incarnaient en des milliers d'êtres. Pour me rendre, par le chemin le plus court, à notre maison de campagne, je résolus de remonter le courant humain, lent et compact. La vague sombre de femmes, d'enfants, de vieillards, d'impotents, venait à ma rencontre. Je me faufilai entre les roues des véhicules dont parfois les essieux se touchaient. Sur le pavage central, sur les accotements cendrés, dans le sable et dans les ornières, parmi les voitures enchevêtrées, les fugitifs piétinaient. Je ne distinguais nulle figure dans ce ruban d'êtres humains et d'attelages disparates. Les naseaux d'un cheval heurtaient l'arrière de la voiture précédente qui s'arrêtait brusquement et la secousse se répercutait au loin, dans la file. Un conducteur casse-cou essayait de rattraper son voisin dont il éraflait la charrette et des protestations s'élevaient, bientôt apaisées. Des mères affolées appelaient leurs enfants et des bambins perdus, tout en larmes, étaient hissés sur les carrioles d'inconnus ; mais les petits, effrayés, poussaient des cris d'animaux écorchés qui vous heurtaient, une seconde, le tympan, pour se noyer aussitôt dans le bruit vague des appels lointains et des roulements de voitures. Des hommes et des jeunes femmes enjambaient les fossés qui bordent la route ; ils marchaient dans les champs ; ils écrasaient les herbes. Ailleurs, ils s'enfonçaient jusqu'aux chevilles dans les terres labourées ; déjà, à quelques endroits dans le sol piétiné, des centaines de pas avaient tracé un sentier dur où les fugitifs se suivaient à la file indienne. Chacun de ces milliers d'exilés abandonnait un foyer paisible et heureux, menacé aujourd'hui par l'ouragan des bombes. Le flot s'épaississait encore ; affalés dans des voitures de maraîchers, hautes sur roues, étendus sur de longues charrettes à bras, entassés dans des fiacres délabrés aux coussins crevés, étaient transportés les vieillards et les impotents. Sur un entassement de sacs de toile, de casseroles, de chaussures, de chaises brisées, trônait la cage dorée d'un perroquet. Une voiture d'enfant où un poupon dormait, bousculé et heurté, était attachée à une carriole traînée par un âne boiteux, au poil usé. A la sortie de la ville menacée, cette foule n'avait pas perdu tout sang-froid. Mais elle n'avait pas encore conscience des proportions surhumaines de la calamité. Peu à peu les incidents de l'exode la convainquaient de la vérité ; l'exaspération contagieuse tendait et crispait les nerfs. Je vis une fillette, le pied écrasé par la roue d'une tapissière ; l'enfant poussa un cri perçant, sautilla sur un pied et s'abattit, évanouie, près d'un arbre. Des parents, alarmés, traînaient des malades dont les yeux brillaient de fièvre, dans une face blême, pâlie par une longue claustration ; des vieilles femmes infirmes étendues sur des matelas et des ballots de vêtements, geignaient comme de petits enfants. Dans une charrette anglaise, conduite par une jeune femme, habillée d'un tailleur simple et bien coupé, un petit garçon se convulsait ; ses lèvres violacées se crispaient, et il tordait ses bras minces, les poings fermés ; une fillette suivait ; elle ne marchait plus, sa mère la tirait et l'animait par des secousses brèves, à lui démettre l'épaule. Mais l'enfant ne pleurait pas. Ces images d'horreur défilaient avec rapidité, sans nous retenir ; elles se superposaient en une vision vague. Personne n'osait approfondir et vérifier ses impressions en participant aux angoisses d'autrui, car nous avions atteint les limites possibles du malheur supportable, au delà de quoi les sentiments s'atrophient, comme le corps s'insensibilise dans l'évanouissement. Bientôt d'autres spectacles empoignants et brefs nous terrassaient comme des commotions physiques. Dans une brouette, une vieille femme charriait, comme un paquet lourd, un cul-de-jatte dont les membres coupés se raidissaient ; la face luisante et bouffie, tordue en une ignoble grimace d'ivrogne, l'estropié malmenait et insultait sa compagne épuisée. Une enfant perdue, blessée par une chute mortelle, venait d'être relevée par un citadin compatissant ; les cheveux de la fillette couvraient sa figure pâle, se collaient aux tempes, en se maculant de sang. Le corps mince, moulé par une robe de toile légère, se ployait comme une tige souple ; l'homme, chargé de son fardeau, courait de groupe en groupe cherchant en vain les parents de l'enfant inanimée. Dans une charrette de paysan, où la terre grasse des champs adhère au plancher épais et aux roues lourdes, une femme accroupie, tout en larmes, la tête baissée et le dos arrondi, évoque et incarne la douleur ; comme une Niobide. A côté d'elle, gît le corps de sa mère foudroyée pendant le trajet et un drap blanc noie dans ses plis le contour du cadavre, et à leur insu, les exilés suivent un corbillard. J'avançais lentement dans cette mer de fuyards pitoyables. Leur marée m'entourait et me noyait. Des chemins étroits au pavage bosselé, la foule affluait sur la grand' route. Les véhicules s'enchevêtraient et s'arrêtaient, bloqués ; les piétons se faufilaient entre les voitures et se perdaient dans l'immense courant. Des fugitifs pressés s'enfonçaient dans les bois de sapins et glissaient, en se hâtant, sur le tapis lisse des aiguilles sèches. On ramassa, ici, les cadavres d'enfants perdus, morts de fatigue et d'inanition. Au centre même dé cette monstrueuse tragédie se déroulaient des scènes presque drôles ; la gaîté inconsciente des tout petits, le ridicule involontaire des adultes étaient macabres. Un jeune père, maladroit, grondait un bambin qui ne lui obéissait pas. Deux gamins se disputaient une valise défoncée ; ramassée sur la route.. Ils se battent ; soudain, le plus vigoureux des deux coiffe son adversaire du sac ouvert et la tête s'engouffre dans l'objet même du litige. Une bourgeoise obèse, attifée d'une robe du siècle dernier, balaie de sa jupe longue la poussière du chemin. Les voisins piétinent la traîne ; la grosse femme trébuche, tombe, à genoux, en poussant des jappements de caniche qu'on écrase. Des évacuées, prises de panique, se sont mises en route vêtues d'étranges défroques, des chapeaux piqués de plumes audacieuses, des robes fragiles aux couleurs voyantes déjà grises de poussière. Un jeune bourgeois est coiffé d'un chapeau haut de forme qui émerge comme une cheminée, au milieu des casquettes et des coiffures basses. Les détails dramatiques, comme les aspects risibles de ce lugubre cortège, vous pénètrent peu à peu d'une tristesse incommensurable. Si je ne m'étais replié sur moi-même, si j'avais essayé de participer à cette misère accumulée, je me serais étendu par terre, au bord de la route, découragé, prostré, j'aurais versé des larmes d'homme, sans honte. Peu à peu le soir tombant épaississait le voile de poussière, semblable à un nuage bas, et enveloppait la foule et nous apportait la voix des canons plus proches. La fatigue luttait avec la crainte. Déjà, le sol était jonché de paquets abandonnés, d'épluchures, de coquilles d'œufs, avalés à la hâte ; çà et là, une valise trop lourde, qui avait pesé sur des épaules endolories, gisait, ouverte, bosselée, impressionnante comme les restes épars d'un champ de bataille. Dans la pénombre, les silhouettes s'effaçaient. Le ruban vivant, moins colorié, plus fondu, se déroulait toujours, comme il devait continuer à se développer pendant quatre jours infernaux. Où donc se dirigeaient ces fugitifs talonnés ? Vers quel but ces malheureux, chassés de leurs foyers, se hâtaient-ils ? Quels gîtes allaient abriter ces enfants résignés, qui ne se plaignent même plus ? Quelle Providence nourrira et sauvera les nouveau-nés de la maladie et de la mort ? Ces émigrés ne savent pas ; ils ne réfléchissent plus ; ils marchent. Leurs jambes molles se ploient et au haut de la nuque, la fatigue les charge de son poids. Chez la plupart, elle annihile et tue le germe néfaste des préoccupations. Mais leurs pensées vagues convergent encore vers ce sommet unique : Anvers ! Le martyre inéluctable de leur ville les apitoie ; la certitude impérieuse du bombardement prochain les investit, s'insinuant en eux. A leur insu, cette pensée douloureuse les accable plus que l'éreintement lancinant de la fuite. Mais la nuit désagrège le convoi sinistre. Des familles entières s'engouffrent dans les villas et les maisons endormies près de la .route. Les enfants tombent comme une masse, les membres ankylosés, endoloris par l'épuisement ; les femmes et les adultes mêmes s'affalent. Sous le dôme des arbres et dans les fossés secs, au pied des bosquets, des êtres exténués s'étendent et s'assoupissent ; les tout petits se blottissent contre la poitrine de leur maman, comme des bêtes frileuses. Dans la nuit qui s'épaississait, je suivais le chemin des piétons qui longe notre jardin. Au centre de la route, une ligne noire se mouvait encore ; je percevais le murmure des voix proches ; le piétinement des fugitifs et le bruit des voitures m'accompagnaient comme une musique triste. Parfois, dans l'étroit cercle lumineux d'une carriole éclairée, émergeaient des silhouettes confuses : des roues dont les rayons tournent, des croupes de chevaux, des paquets entassés, des corps allongés, de larges épaules qui se touchent... et je hâtais le pas. J'arrivai tard à notre maison de campagne ; la grille or et noir, vers la rue, était restée ouverte ; sans discontinuer, la foule hétéroclite et minable passait, et entrait dans le parc. Les émigrés allaient chercher un abri sous les arbres hauts, dans les écuries et les remises. Dans l'allée principale, autour de moi, des pèlerins fatigués étaient couchés. Quelqu'un parlait à voix basse et je distinguais les figures mouvantes qui évoquaient la présence de mille spectres. Des charrettes stationnaient au centre de la « drève » et, sous les bâches relevées, des enfants dormaient. Dans les communs, où la lueur des bougies et des lampes à pétrole mêlait des ombres, les réfugiés grouillaient ; ici régnait une animation inaccoutumée ; déjà, les plus fatigués s'étaient étendus et leur installation sommaire rappelait un campement de bohémiens. Des chevaux attachés aux arbres tendaient leur cou vers l'herbe broutée sans hâte. Des hommes affairés descendaient des greniers des brassées de foin et des bottes de paille ; dans un hangar bas, des corps qui se touchaient étaient étendus, parallèles. Parfois, une voix aiguë, forte, s'élevait ; une dispute naissait, mais ne se développait pas. Un mioche blond s'était assoupi, serrant un morceau de biscuit mordu, dans sa menotte fermée ; une jeune mère avait ouvert un paroissien qu'elle ne lisait pas, mais elle marmottait sans discontinuer des prières et des litanies. Maigre et délabré, un vieillard geignait ; comme si le moindre effort eût dû le briser, il adossait son dos voûté au mur blanchi ; sous son pantalon tirebouchonnant, saillaient les pointes des genoux ; des larmes, qu'il n'essuyait pas, coulaient et longeaient les rides creusées par la douleur. Des soldats, habitués à coucher sur la dure, ronflaient sans bouger ; mais les citadins, énervés, chatouillés par les brins de paille et de foin qui s'insinuaient sous leurs vêtements, se retournaient agacés sur leur couche... A la villa, dans le vaste hall, tapissé de faïences anciennes, je trouvai une nombreuse société. Des parents, en quittant Anvers menacé, étaient venus s'abriter chez nous ; à la salle à manger, les reliefs d'un dîner froid encombraient la table, mais ce repas improvisé n'avait distrait personne. Trop de douleurs nous entouraient ; l'inconnu de notre destin, le martyre prochain de notre ville nous hantaient et alourdissaient l'air de la chambre haute. Les langues se paralysaient ; en vain, s'efforçait-on, parfois, de stimuler la conversation, comme l'on attise les braises d'un feu qui meurt. En nous-mêmes, la faculté de souffrir ne s'était pas encore atrophiée, mais nous n'étions plus capables d'étonnement. Dès l'après-midi, des amis avaient demandé à être hébergés ; les premiers s'étaient excusés de tant de sans-gêne, mais les suivants avaient supprimé, d'instinct, les formules de politesse ridicules et déplacées au milieu de cette tragédie. Affalée dans un fauteuil, près de la cheminée où des bûches se consumaient parmi des cendres grises, une jeune femme, exténuée, écarquillait les yeux et dodelinait de la tête. Autour d'un de nos officiers que les tranchées ne réclamaient pas, des hommes grisonnants s'étaient groupés. Ils avaient discuté les probabilités de l'offensive allemande qui, déjà, étreignait Anvers. Des paroles graves avaient été dites et, maintenant, dans le silence, les cerveaux mâchaient des pensées décourageantes. Ailleurs, des boîtes de biscuits circulaient ; pour noyer leur appréhension et s'illusionner sur la réalité, quelques-uns de nos amis humaient des liqueurs et se versaient de grands verres de vin : c'étaient des êtres faibles qui n'avaient pas le courage de regarder la vérité face à face. Deux jeunes gens, qui avaient flirté dans le monde, en s'amusant, sans que jamais leurs sentiments sérieux et vrais ne se fussent précisés, étaient assis ensemble, à l'écart, sur un divan ; leurs mains se frôlaient et ils se dévisageaient, timides, à la dérobée. A cette heure, où nous ne discernions plus nos propres impressions et nos idées personnelles, une passion latente, profonde s'épanouissait en eux. Ils s'imposaient l'un' à l'autre un amour qui ne se serait sans doute pas révélé dans l'existence fade et normale. Mais la fatigue accablait cette étrange assemblée ; après un long silence, une parole nous réveillait, tout à coup de notre torpeur. Dans le chaos de mes réflexions vagues, flottaient des souvenirs heureux et des évocations tristes : les soirées calmes, en compagnie de bons livres ; les fêtes bruyantes, les anniversaires familiaux, les noces gaies, touchantes et si graves, et aussi l'heure affreuse où un cercueil de chêne, appuyé sur les épaules de quatre croque-morts essoufflés, s'arrêta ici, une seconde, il y a dix ans. Et, plus proches, les premiers jours de la guerre renaissaient aussi avec leur cortège de sensations mobiles ; mais, par le tragique concentré, par l'angoisse accumulée, la minute présente dépassait les malheurs individuels de jadis gonflés, unifiés, infinis, qui écrasent aujourd'hui toute une ville. Cette réunion unique fut interrompue de bonne heure. Nous aspirions à la solitude. En , nous absorbant ainsi dans des pensées intimes, au milieu de tant d'amis, une sorte de pudeur absurde et vive nous incommodait ; et l'on se sépara en se serrant la main ; très fort, sans mot dire. Et je m'isolai dans ma chambre. Par la fenêtre entr'ouverte s'engouffraient les rumeurs de la foule campée au jardin. Un chuchotement de voix proches montait ; un geignement vague couvrait des paroles raisonnables, mêlées à des plaintes. Le chant très doux d'une mère qui berce son petit accompagnait des pleurs d'enfants. Ces êtres que nous n'avions pas pu secourir souffraient du froid, de leur solitude et de l'appréhension accablante, plus cruelle que la douleur physique. Mais comment venir en aide à tant de malheureux ? Comment infuser du courage à des êtres affalés qui ne réclament plus aucun secours. Et à nous-mêmes s'imposait la certitude humiliante de notre impuissance. Tout à coup, un long mugissement, tour à tour rauque et, sifflant ; remplit de sa clameur stridente la chambre toute entière. D'instinct mes doigts se crispèrent et je serrai comme de la chair vivante la soie crissante et molle d'un coussin japonais. Une frayeur irraisonnée, absurde mais impérieuse envahissait et paralysait tout mon être. Cependant, d'instinct, j'attendais et je souhaitais presque le prolongement de ce ricanement sinistre. Après un bref silence angoissant et vide, le cri de bête terrorisée domina de nouveau, inarticulé et incompréhensible, les autres bruits submergés. Dans ce hurlement caverneux perçaient cette fois le son et le rythme d'une voix humaine, la voix d'une femme qu'aucune volonté ne dirige plus. Une raison chavire dans la tourmente ; la douleur, l'incertitude, l'horreur de cette nuit tragique étreignent un faible cerveau et l'annihilent. Bouleversée jusqu'au fond d'elle-même par les malheurs accumulés, une folle divague dans la nuit. Ces appels gutturaux et étranges rappellent les hurlements modulés d'un chien qui aboierait à la mort. Soudain, comme à l'approche des tremblements de terre pendant les nuits lourdes, mille lamentations éveillées par ces cris d'hallucinée jaillissent, se gonflent et remplissent l'espace tout entier ; l'appel guttural de la folle, ponctué d'exclamations aiguës, s'approche, s'enfle, se développe avec des sanglots, des hoquets et des ricanements. Et bientôt, comme si notre propre pensée eût participé au délire de cette femme qui divague, nous saisissons le sens caché de ce langage inarticulé, nous comprenons les derniers balbutiements du cerveau qui se désagrège. Chargés encore d'une parcelle d'impondérable conscience, ces quelques sons enchevêtrés nous infusent, nous imposent à jamais, une conviction sommaire comme un culte, unique comme un grand amour, indestructible comme une douleur éternelle : L'horreur de la guerre, l'ignominie de ceux qui nous l'imposent. La même nuit, le bombardement ennemi s'abattit sur Anvers. Pendant quatre jours, des exilés processionnèrent sur la route en un convoi de souffrance. Le 9 octobre, les Allemands entrèrent dans la ville abandonnée. Comme aux premiers jours de la guerre, notre drapeau se déployait à toutes les façades et, dans ses plis, flottait notre pensée. Les rues se prolongeaient, désertes, et alors – miracle de la confiance et de l'énergie – le silence « dans lequel se forment les grandes choses » imposa notre volonté à l'envahisseur. Effrayés par ces calmes, incommodés par ce vide, les officiers firent taire les fifres et les tambours : Au pas de parade, les armées du Kaiser défilèrent devant nos couleurs. [1] Autour d’Anvers, Souvenirs et récits, août-octobre 1914, William Speth, Editions Georges Crès et Cie, Zurich, 1918 |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©