 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
NOUS SERONS DERRIERE[1] 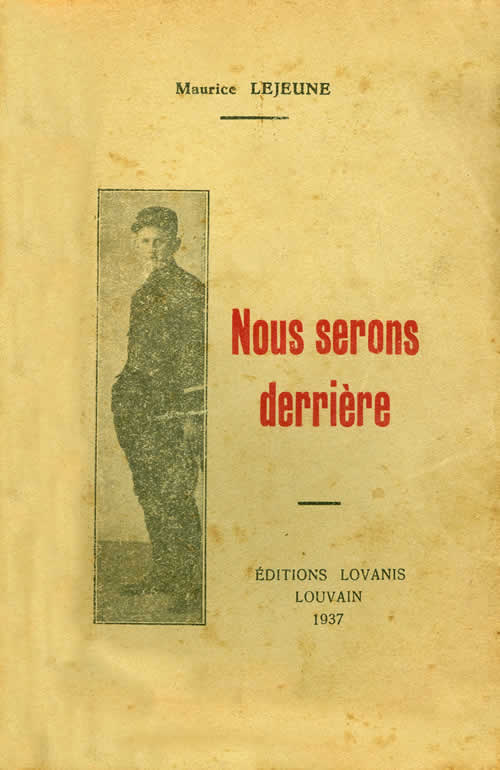
BRUXELLES (JUIN 1914) Dans la caserne de Gendarmerie de l'Avenue de la Couronne, c'est branle-bas de nettoyage. Les gendarmes frottent, lavent, astiquent. Les seaux d'eau sont jetés à toute volée dans les chambres. Les brosses raclent les pavés et font, gicler l'eau écumante. « Demain ; a annoncé le chef le général de Sellier de Moranville, commandant du corps et l'attaché militaire allemand passeront l'inspection de la caserne ». – L'attaché militaire allemand ! s'est exclamé un gendarme. – Mais oui. Cela vous étonne ? Le gendarme a réfléchi... – Non, a-t-il répondu ; cet attaché, comme vous l'appelez, vient voir combien il pourra, le cas échéant, loger, ici, de cavaliers allemands. – Que racontez-vous ? – Je raconte, chef, que d'ici deux mois, vous nous aurez conduits à la charge dans l'infanterie allemande. – Vous êtes fou, mon garçon ! a conclu le chef ; il y aurait lieu, je crois, de demander au docteur de vous faire mettre en observation. Allons plus de bêtises, je veux que tout soit propre. * *
* Un mois s'est écoulé. Dans la même caserne, c'est, maintenant, branle-bas de mobilisation. On distribue les bons effets. Les sabres et les yatagans grincent sur les meules à aiguiser ; les paquets de cartouches sont fourrés,. fiévreusement, dans les sacoches et les bissacs des selles. Le soir, notre peloton est de service. Nous partons en ville, à cheval où doit avoir lieu une manifestation contre la guerre. Il pleut. Les passants penchent leurs parapluies pour nous regarder passer. Bien campés sur nos montures, nous prenons un air imposant. Quelques cris fusent : « Vive la gendarmerie~! » Un frisson nous secoue. En ville, il flotte une espèce de fièvre. Nous ne trouvons pas trace de manifestation, mais, vues à la clarté des réverbères, toutes les faces sont pâles. Derrière ces masques blafards on devine une sourde inquiétude. Sabre au poing, nous sommes arrêtés sur une place. Sur deux rangs, notre peloton s'aligne impeccablement. Placé au second rang, je me sens, soudain, tiré légèrement par la jambe. Je me retourne. C'est un homme de mon village. Il m'interroge : – Sais-tu quelque chose ? Aurons-nous la guerre ? Mon fils Charles est rentré au 12ème de ligne à Liège. Nous vivons dans les transes. Allons, réponds-moi, dis-moi ce que tu sais. Et moi, qui suis convaincu que la catastrophe est proche et qui l'ai crié sur tous les tons à la caserne, je n'ai plus, ici, le courage de défendre mon opinion. Je réponds qu'il n'y a rien à craindre, que, même en cas de guerre franco-allemande, les Allemands n'oseraient jamais attaquer la Belgique. J'ai vingt-trois ans, et cet homme, qui en a soixante, m'écoute comme si j'étais un oracle. C'est drôle. AOUT 1914 En ville, les cloches sonnent l'alarme.
L'armée allemande est entrée en Belgique. La nouvelle envahit la cour de la
caserne, se répand dans les blocs, entre dans les chambrées. On se regarde,
atterré. La guerre ! La guerre ! C'est la guerre ! Cela m'entre dans la tête. J'essaie de me
représenter la chose, mais, je n'ai, pour m'aider, que ce que j'ai lu dans les
livres d'histoire. L'image que mon cerveau appelle ne vient pas. Brusquement, je pense aux miens : à mon père, à ma mère, à mes frères. Ils
habitent non loin de la frontière allemande et les histoires de Kaiserlics, racontées par les vieux au cours des veillées,
me reviennent à l'esprit. J'ai peur. – Nous sommes foutus ! dit Desy, un camarade de chambrée. Mon orgueil se rebiffe ; je ne veux
pas admettre que nous soyons foutus et je riposte : – Que te prend-il, toi ?
Naturellement l’armée belge en face des Allemands n’existerait guère ;
mais nous avons la France et les Français, mon vieux ce sont des soldats. – Oui, on l’a bien vu en septante. Je ne trouve rien à répondre et je sens
la colère m’envahir. – Oui, reprend Desy,
nous sommes foutus. Dans tous les cas, je sens moi, qu’à la première rencontre,
j’aurai une balle dans la tête. Si tu n’appelles pas ça foutu !... – Tu dis des bêtises Desy
et si même ton pressentiment était juste, tu devrais dire : « Je suis
foutu » et ne pas nous importuner avec tes idées macabres. – Tu ne sais donc pas ce que c’est :
« La guerre » ! – Le sais-tu toi ? – Oui. – Explique alors. Les autres qui sont dans la chambre avec
nous, se sont approchés. Nous sommes là, une douzaine de jeunes et solides
gaillards, entourant Desy et l’interrogeant du
regard. Desy prend son
temps : il allume sa pipe, puis enfin, dit : – Nous sommes tous, ici, de jeunes
gendarmes. Notre instruction n'est même pas terminée ; je suis le plus vieux et je n'ai pas
vingt-cinq ans. Ecoutez- moi : La guerre est comme on dirait un « massacre
des innocents ». Nous ouvrons de grands yeux. – Oui, reprend Desy,
c'est bien cela, « le massacre des innocents »… – Tu parles comme la bible, interrompt Emond, un grand gaillard du pays gaumais. – Laisse-moi dire. Quand j'évoque « le massacre des innocents » je
le fais à bon escient. Avez-vous vu dans les gares les régiments d'infanterie
qui allaient s'embarquer ? Avez-vous observé les grenadiers qui ont
logé ici deux nuits ? Dites-moi : combien
y avait-il de millionnaires parmi eux ? .. Vous ne répondez pas ? Moi, je vais vous le dire : il n'y en
avait guère. Le système du remplacement a fait, de l'armée belge, une
armée de pauvres diables. Nos soldats sont pour la plupart des ouvriers
ou de petits paysans et ce sont eux qui vont offrir leur poitrine aux
balles et aux baïonnettes allemandes. Ah ! il n'en reviendra guère de
ces malheureux ! Nous n'avons même pas deux cent mille hommes à
opposer à la monstrueuse armée qui entre chez nous. – Deux cent mille hommes, bien décidés,
ce n'est pas négligeable, lui fis-je observer. - Sais-tu s'ils sont décidés toi ? Ils marchent parce que c'est la loi, la
discipline. Oh ! ils se battront, je le sais ; ce sont des hommes élevés à la dure
et ils ont du sang dans les veines, mais, je vous le répète : ce sont des
innocents, des innocents ! Nous restons rêveurs. – Et s'ils ne marchent pas, achève-t-il,
nous autres, gendarmes. nous serons derrière pour les y contraindre ; on
nous commandera et nous obéirons. Oui, nous serons derrière, et
pourtant, que sommes-nous ? De pauvres diables, comme eux. – Ce rôle là ne me plait guère, objecte Emond ; j'aimerais mieux me battre. – On ne te demandera pas ton
avis, termine Desy. *
* * Les jours passent... Nous sommes de plus
en plus énervés. Emond est parti : il a été désigné pour
la troisième division d'armée ; il est, sans doute, à Liège, dans la mêlée. Par
les journaux, nous apprenons que les Allemands brûlent nos villages et
massacrent leurs habitants et nous sommes, ici, avec une carabine et des
cartouches sans pouvoir nous en servir. J'envie ceux qui sont là-bas. On nous cite Houba.
C'était un jeune gendarme de notre levée. Il est mort en brave, nous dit-on,
tué par les Allemands sur le seuil de la maison qu'occupait le général Leman. Dans la caserne, c'est un va et vient
continuel des gendarmes arrivent, d'autres partent. Dix fois, on nous fait
seller nos chevaux; dix fois aussi on nous les fait déharnacher. Fausses
alertes. A la gare d'Etterbeek, nous arrêtons un
jour, après une chasse mouvementée le long des hauts talus, deux individus
signalés comme espions. La foule s'amasse et veut les lyncher. Nous les
protégeons tant bien que mal. Pour ma part, j'attrape, d'une dame, un furieux
coup de parapluie sur la tête, coup destiné à l'espion que je tiens par le
bras, mais que je sens. Cela ne me met pas de bonne humeur. Arrivé dans la cour de la caserne,
j'allonge deux gifles à l'individu qui hurle et cela me console. Le lendemain, les premiers soldats en
retraite débarquent à la gare d'Etterbeek. Ils ont combattu à Liège. Hâves, les
yeux remplis d'épouvante, exténués ils racontent, tant bien que mal ce qu'ils
ont vu. C'est une débauche de renseignements contradictoires et de nouvelles
invraisemblables. Les idées et les informations les plus
folles sont accréditées. On raconte qu'on a placé quinze cents canons les uns à
côté des autres, près de Waremme, et que là on va pulvériser l'armée
allemande. D'autre part, les journaux affirment que l'ennemi n'entrera pas dans
la capitale parce qu'on a couvert de tessons de bouteilles les principales
routes y aboutissant et que, d'ailleurs, les vingt mille gardes civiques de
Bruxelles suffiraient pour défendre la ville. Enfin, un soir, nous partons. Nous
sommes les dernières troupes restées à Bruxelles ; en tout, trois escadrons de
gendarmerie, soit deux cent septante hommes destinés, nous dit-on, à fournir
des estafettes et des éclaireurs. Sale métier, trouve Desy. Nous sortons de la ville par la Porte de
Flandre. Nous tournons donc le dos à l'ennemi. C'est humiliant quand même : nos
cartouches nous tirent la cartouchière sur le ventre. On serait si heureux d'en
brûler quelques unes. Une idée m'obsède : je 'n'ai jamais essayé ma carabine : j'ignore
donc comment elle porte. Je sais que je suis adroit tireur : j'en ai eu les
preuves au régiment et, parfois, en abattant un lièvre, la nuit. Mais voilà, je
ne connais pas ma carabine, et une arme qu'on ne connaît pas, n'est pas une
arme. Collard est
mon meilleur ami. Il chevauche à côté de moi. Nous sommes entrés le même jour
au corps de gendarmerie. Collard est un Ardennais,
petit pour un gendarme mais râblé et fort en muscles. Il a assez mauvais
caractère : pour un oui ou un non il est prêt à se battre. Il dit souvent que
nous n'en formons qu'un à nous deux parce que nous n'avons chacun qu'une
demi-tête. Je lui fais part de mon souci au sujet
de ma carabine. « Il y a un moyen d'être sûr d'elle ; répond-il, c'est
d'approcher assez près du but avant de tirer ! ». Dans la nuit, je le regarde
de travers. Nous passons près de Grand-Biqard. Un oncle et ma sœur, une gamine de quinze ans, y
habitent. L'idée d'aller leur dire au revoir me tente. J'en parle à Collard. « Tu ferais une bêtise remarque-t-il : parce que
premièrement, tu ne retrouverais peut-être pas l'escadron et tu serais
déserteur ! Douze balles dans la peau, ce ne serait pas trop pour un bougre
comme toi ! Parce que surtout, tu irais les faire pleurer et, nous reviendrais avec
le cœur à l'envers ». Je suis partagé entre le désir de revoir
ma sœur et la crainte de ne pas retrouver l'escadron. Finalement, Je continue
avec un serrement de cœur. Dans la matinée, nous sommes à Assche où nous avons mis pied à terre et donné de l'avoine
à nos chevaux. Un avion allemand nous survole ; il décrit des arabesques. Nous
tirons dessus ou, plutôt, à côté car il continue tranquillement son petit
métier pour reprendre enfin la direction de l'Est où il disparaît. – Ce sale oiseau va aller raconter qu'il
nous a vus, dis-je à Collard. – Il ne t'aura quand même pas reconnu
va. La moutarde me monte au nez. – Tu me réponds toujours de travers !
Est-ce pour te moquer de moi ? – Et si c' était oui ? – Je t'enverrais mes cinq doigts à la
figure. – Fais alors comme si c'était oui. Au moment où je lève la main,
heureusement, un chef arrive. Son aspect nous remet d'accord ; nous tournons
notre mauvaise humeur contre lui ; nous lui cherchons misère. Il s'éloigne en
nous traitant de « républicains ». On remonte à cheval sans parler de
dormir. Nous partons vers Alost ; c'est à croire que nous fuyons. Arrivés dans
la petite ville, on distribue des billets de logement. Je reçois l'ordre de
porter un pli à un officier des gardes-civiques resté à Assche.
Je fais demi-tour et pars, au grand trot, sur la chaussée bordée d'arbres. Mon
cheval fait sonner ses fers. C'est une brave bête, peu élégante, lourde de
lignes même, mais dont les membres sont d'acier. Peu de chevaux de l'escadron
peuvent le battre au trot et même à la charge. Il n'a qu'un défaut : c'est de
me marcher volontiers sur les pieds, ce qui m'a déjà mis maintes fois en
colère. Quand je fais mine de le frapper, il me regarde d'un air si bête que le
n'ai jamais le courage de mettre mon geste à exécution. Je l’appelle « Le
gros » non à cause de son corps, mais de sa tête qu'il a volumineuse. Sur la route, je croise des charrettes
bondées de civils qui fuient devant l'ennemi. C'est triste à voir ces femmes,
ces enfants, ces vieillards. Ils ont les yeux grands ouverts ; on peut y lire
toute la crainte de ces gens qui vont vers l'inconnu. Une vieille femme fait un
geste de bénédiction en me voyant passer ; je réponds par un salut militaire.
C'est ridicule, mais je ne trouve rien d'autre à faire. J'interroge : on
m'apprend que les Allemands occupent Bruxelles et qu'ils avancent vers Assche. Je n'ai plus de temps à perdre ; je mets mon cheval
au galop ; sous les caresses des éperons il part comme une flèche. A Assche, je
ne trouve pas de gardes-civiques. « Ils sont partis en auto vers Alost. » me
dit un civil. Je fais le tour du village. A l'Est, j'entends de rares coups de
feu. J'aurai probablement croisé l'auto sans la voir, me dis-je, et je repars vers
Alost. Mon cheval s'énerve. On dirait qu'il craint quelque chose. Son
instinct l'avertit-il d'un danger ? Je ne sais. Je le laisse faire et il part
au galop. Je
dépasse des charrettes de fuyards et je remarque que mon passage sème la
terreur parmi eux. Ils se retournent épouvantés croyant voir, à ma poursuite,
les Allemands. Pour les calmer, je retiens mon cheval et je continue au trot. A mi-chemin d'Alost, je retrouve l'auto
des gardes-civiques, arrêtée au bord de la route. Les occupants discutent sur
l'accotement. L'officier, à qui je remets le pli, porte un képi de général ;
c'est presque un vieillard ; il tremble en prenant l'enveloppe. Il prend connaissance
de son contenu et veut remonter aussitôt dans l'auto. Cela ne fait pas mon
affaire. Je dois à mon retour à l'escadron être porteur de l'enveloppe signée,
qui constituera la preuve de l'exécution de ma mission. J'interpelle poliment
l'officier, lui demandant de bien vouloir signer l'enveloppe et me la rendre.
Il ne me comprend pas ; je dois lui donner des explications. Finalement, il y
trace quelques jambages illisibles et me la rend. Ma mission est terminée . je
salue et je pars. Le lieutenant Lebrun
commande notre escadron. C'est à lui que je remets l'enveloppe dès mon arrivée.
Je lui rends compte également, de ce que j'ai appris en cours de route. Il me
remercie et me fait remarquer que j'ai un bouton de ma tunique cousu à
l'envers. *
* * Les autres n'ont pas davantage profité
de leur billet de logement ; les escadrons sont déjà rassemblés sur la grand'
place. J’entre dans un magasin où je demande deux morceaux de chocolat. La boutiquière
m'en donne trois et ne veut pas mon argent ; elle pleure en me regardant. Je
suis tout bouleversé en allant reprendre ma place au peloton, oubliant de lui
dire merci. La nuit tombe quand nous partons vers
Termonde. Je croque mon chocolat. Je veux en donner une ligne à Collard ; il refuse. « J’ai mangé a Alost » dit-il. Pour
nous, il n'y a pas de service de ravitaillement. On nous paie notre
appointement et nous devons subvenir à nos besoins. C'est plus commode pour
ceux qui ont de l'argent. Quant à moi il ne m'en reste guère ; je n'ai rien
touché depuis le 1er août, j'ai joué aux cartes et j'ai bu trop de
bière à la cantine. Mais, bah ! je tirerai mon plan. Ne suis-je pas gendarme ? Sur la route, nous ne rencontrons
personne et nous nous endormons sur nos chevaux. Je suis réveillé par une voix
aux accents de tonnerre. « Où allez-vous ? » C'est le lieutenant Lebrun qui
vient de me hurler dans l'oreille. Mon cheval a marché plus vite que les autres
: je suis en tête de l'escadron. Je ne m'en rends pas très bien compte, je suis
tout perdu. Mais le lieutenant Lebrun me fait reprendre mes sens en me traitant
de « ramolli » et de « malheureux gendarme ». J'attends le passage de Collard pour reprendre ma place. – Je te croyais resté en arrière, me
dit-il. – Non, j'ai voulu aller commander
l'escadron, mais le lieutenant Lebrun m'a remballé. – Tu vas un peu trop vite ; prends
patience, tu seras, peut-être, un jour lieutenant ! – Je ne crois pas ; tout ce que nous
pouvons espérer pour l'instant, c'est de conserver notre vie. – Je crois que nous marchons vers le
Nord, fait Collard. – Oui, voilà l’étoile polaire. – Tu la connais ? – Oui, j'ai certaines notions
d'astronomie. Je lui montre la grande Ourse et lui explique
comment on trouve l'étoile polaire. Collard me
regarde, je crois, presque avec respect. – Pourrais-tu me dire maintenant quel
mouvement stratégique nous exécutons ? demande-t-il. – Nous fuyons ! – T'es bête ! Nous faisons le tour grand
assez pour prendre l'armée allemande par derrière ! Nous rions ; les autres
dorment. Nous sommes coiffés du bonnet à poils. Sous la clarté des étoiles, l'escadron
forme une file de hautes silhouettes qui se balancent de gauche à droite et de
droite à gauche. * *
* Pendant un mois, nous avons changé
plusieurs fois de cantonnement, patrouillé dans tous les sens, sans avoir
aperçu un seul Allemand. – Mais pendant ce mois nos officiers ont eu le loisir
de nous classer, dans leur idée suivant notre valeur. Collard et moi
n'avons pas bonne réputation. On nous a rencontrés ivres, un soir, que nous faisions
la noce ; une autre fois, le lieutenant Lebrun nous a surpris à faire danser
les filles au lieu de patrouiller : nous nous sommes battus deux fois ; enfin,
on m'a vu voler des pommes dans un verger. Ce jour là le major Blondiau, qui commande les trois escadrons a parlé de me
faire fusiller. Le lieutenant Lebrun est secondé par le
lieutenant Marchal et le lieutenant Massin. C'est
un hercule de cent et dix kilos doué d'une force prodigieuse. Il a une voix
tonnante ; dans ses accès de colère il ferait trembler un régiment. Mais quand
il est à cheval, son ventre dépasse le pommeau de la selle. Marchal est un superbe cavalier, ami des
femmes et du bon vin, grand fumeur de cigarettes. Massin lui, ne
se tait jamais : à tout propos il fait théorie à ses inférieurs, service
judiciaire, équitation, règlement intérieur, etc. Sa langue ne s'arrête pas. Dans son langage imagé, Collard dit : « Nous sommes commandés par un gros ventre, un fumeur
de cigarettes et une vieille femme ! » Lebrun et Massin
ne s'entendent pas toujours, ils se disputent parfois devant les hommes. Un jour,
qu'ils étaient aux prises, il m'est arrivé de rire un peu fort. Je me les
représentais nus : Lebrun avec sa grosse bedaine, Massin
avec ses courtes jambes : ils vidaient leur différent à coups de poings.
Maréchal servait d'arbitre et marquait les coups de la cigarette qu'il avait aux
lèvres. Lebrun m'a entendu rire et a tourné sa colère contre moi. – Vous riez de moi ? a-t-il hurlé. Lâchement, j'ai répondu : Non, mon lieutenant. – Pourquoi riez-vous alors ? – Pour rien, mon lieutenant. – C'est la preuve toute claire que vous
n'êtes qu'un idiot, a-t-il conclu. – Très juste, a ponctué Collard. Parfois, en regardant les officiers, je
me fais des réflexions bizarres. Propres et bien sanglés dans leurs tenues
faites sur mesure, ils ont quelque chose de raide dans leur allure. Leur
physionomie montre leur souci d'en imposer aux hommes. C'est certain, ils ont
quelque chose à dire et beaucoup de gendarmes les envient. Moi pas.
Naturellement, à eux le prestige et la grosse solde, à eux l'autorité, oui mais
! A nous la coiffure placée de travers, à nous l'allure libre et la chanson, à
nous l'insouciance, à nous le rire. – Je ne serai jamais gradé, dis-je à Collard. – Pourquoi ? – Parce que nous sommes les maîtres. Collard me regarde avec ahurissement : puis répond : – Va dire ça au lieutenant
Lebrun, pour voir ! * *
* A propos, nous sommes tous
gradés. Pour sortir de Bruxelles nous, les jeunes, étions brigadiers ; notre
nomination de maréchal-des-logis nous est arrivée quand nous étions à Gand. Là,
nous avons trouvé le nécessaire et avons cousu un galon d'argent sur nos
manches. Notons qu'au corps de gendarmerie, le grade de maréchal-des-logis ne
compte pas ; à part une légère différence de solde, il n'y a rien de changé
dans notre vie : nous sommes toujours astreints au même service et aux mêmes corvées.
Pour commencer à devenir quelques chose, il faut être, au moins, premier
maréchal-des-logis. Bref, nous sommes gendarmes, rien de plus. * *
* – Vous et vous à cheval, vous devez
partir en reconnaissance ! – C'est toujours aux mêmes, chef, que
vous en avez. – Vous dites ? – Rien, chef. C'est Collard
et moi qui protestons, histoire de tuer le temps et d'embêter le supérieur. En
somme, tout le monde y va, à son tour, en reconnaissance. Il y a bien, parmi
nous quelques pères de famille qu'on ménage un peu ; mais, c'est logique et
nous comprenons cela. Depuis deux jours, j'ai les moustaches
rasées et la tête passée à la fine tondeuse. C'est Desy
qui m'a fait la blague ! Il m'a dit que les longs cheveux infectaient les
plaies et, comme il n'a pas perdu l'idée d'avoir une balle dans le crâne, il
m'a confié que si un autre en faisait autant, il se laisserait tondre. « Je
suis ton homme » ai-je répondu. Immédiatement, nous sommes allés chez un
coiffeur où j'ai été servi le premier. Quand Desy a
vu ma tête pareille à un navet, il s'est dérobé et a gardé sa chevelure. Avec la plus visible mauvaise humeur du
monde, nous allons, Collard et moi, chercher nos
chevaux. – Je commence à en avoir plein le dos,
déclare Collard ! Nous allons reconnaître quoi ? rien
sans doute ! ce sera comme les autres fois ! Qu'on nous laisse dormir, c'est
dimanche aujourd'hui et j’ai la flemme moi ! Je suis de son avis, aussi
détachons-nous nos montures avec une lenteur digne d'un fantassin. – A cheval, nom de Dieu ! Cette fois-ci, c'est le lieutenant
Lebrun. Avec lui, il ne peut pas être question de faire la forte tête, il nous
a déjà menacés de nous brûler la cervelle à tous les deux. Sa voix nous a
rendus légers comme des plumes et nous enfourchons nos biques avec une
souplesse de jockey. Sur la chaussée, une dizaine de gendarmes,
parmi lesquels se trouve Desy, nous attendent. A peine
sommes-nous dans les rangs que nous y occasionnons du désordre, Collard touche des éperons son cheval et le fait cabrer,
moi, je tire sur la bride du mien qui s'arrête tandis que nous sommes déjà en
marche. Nous n'avons, pour le moment, rien de bon dans la tête. Ne sachant à qui m'en prendre, je cherche misère
à Desy. – C'est toi la cause que j'ai une tête
comme une boule de billard lui dis-je ! En même temps je fais appuyer mon
cheval qui bouscule le sien. Desy me
regarde. La vue du sourire qui chiffonne sa figure fait fondre ; mon humeur
querelleuse. – Qu'as-tu, lui dis-je ? Desy lâche un
profond soupir, m'explique que les Allemands marchent d'Alost sur Gand et que nous
allons à leur rencontre. « C'est ma dernière promenade, dit-il ! » Je hausse les épaules. Vingt fois déjà,
on nous a dit que nous allions à la rencontre des Allemands ! Y a-t-il une
seule raison pour que ce soit vrai cette fois-ci ? Pourtant, ce n'est pas une
reconnaissance comme les autres ! Ordinairement nous partons à quatre : un chef
et trois gendarmes. Aujourd'hui, nous sommes douze, parmi lesquels deux chefs.
Serait-ce sérieux ? Je dérange encore une fois mes collègues
pour me mettre à côté de Collard à qui j'explique la
chose. « Cela te donnera l'occasion d'essayer ta carabine ! dit-il simplement.
» Nous sommes partis de Melle et nous
marchons vers Alost. Passé le passage à niveau de Quatrecht,
je suis envoyé en éclaireur vers la droite. Par des chemins de terre, je gagne
un petit bois, puis deux hameaux. Mon cheval avance à regret. Lors de mes
précédentes reconnaissance je cherchais plutôt les belles filles que les Allemands
à qui je ne pensais guère ; aujourd'hui, je sens que ma vie et celle de mes
camarades sont en danger ; aussi je ne laisse aucun espace de terrain sans
m'assurer de ce qui s'y passe. Les civils me regardent curieusement. Je
ne puis obtenir d'eux aucun renseignement ; ce sont des Flamands : je ne
comprends pas leur langue. Un galop de cheval me fait subitement
mettre pied à terre. Je fais aussitôt appuyer ma monture contre une haie et le
bras embarrassé dans les rênes de brides, le doigt sur la détente de ma
carabine, je me mets dans la position du tireur à genou. J'attends ainsi
quelques instants ... Le galop de cheval approche ; j'ai le cœur battant : je
me sens cependant assez ferme pour ne pas manquer le cavalier si c'est un
Allemand. On m'appelle par mon nom. C'est Collard qui débouche entre deux haies au détour du chemin. En
me voyant à genou, il part d'un rire sonore. – Tu dis tes prières, je crois ! – Un Allemand pouvait déboucher, je
prenais mes précautions. – Ordre de rejoindre le groupe, nous
sommes le nez sur l'ennemi. Les éclaireurs de tête ont vu les Allemands dans le
village d'Audeghem. Nos hommes ont pu heureusement
faire demi-tour sans être vus ; il paraît qu'on va en profiter. Nous avons du
renfort : un commandant des gardes-civiques avec quelques fantassins et un
lieutenant des lanciers avec quelques cavaliers. Cela fait combien d'hommes ? – A peu près vingt-cinq. – Et les Allemands, sont-ils nombreux ? – Une centaine environ ; ils marchent
vers Wetteren et comme ils vont nous présenter le flanc ... Collard achève
par un grand geste comme s'il allait les faucher tous. Nous regagnons un des nôtres derrière
une maison où sont abrités nos chevaux. Nous lui passons nos montures et, au
pas de course, nous allons prendre position parmi les autres, dans un fossé longeant
la grand' route qui va vers Audeqhem. Je suis à genoux entre CoIlard et Desy. – N'as-tu pas peur, dis-je à ce dernier ? – Si, je vais me faire casser la gueule
! – T'es fou, allons ! – Non, mon vieux. notre position est
mauvaise ; nous ne sommes pas gardés du côté d'Ordeqhem.
Les Allemands vont passer en face de nous, là, sur la route, mais en admettant
qu'ils aient laissé des leurs dans le village, nous sommes cuits ! Je l’ai fait
remarquer tout à l'heure et ai demandé qu'on détache quelques hommes sur notre
droite. On m'a répondu que je n'avais pas à contrôler les actes de mes
supérieurs et, comme j'insistais, on m'a donné l'ordre de me taire. En plus,
regarde, le commandant des gardes-civiques a laissé son auto sur la route, elle
indique clairement notre position. Je te dis, nous sommes... Un commandement interrompt la phrase : «
Hausse à quatre cents mètres ! Visez les chevaux ! Tir à volonté ! En joue !
Feu ! Les Allemands défilent en face de nous.
Nous tirons... Nos coups de feu se succèdent sans interruption. Sur la route de
Wetteren, des chevaux se cabrent, des cavaliers dégringolent. Puis, plus rien,
les Allemands se sont abrités derrière une haie d'où partent des coups de feu.
Un éclair jaillit au coin de la haie : il m'indique la position d'un Allemand.
J'appuie mes coudes sur le bord du fossé, vise soigneusement et tire. – Là-bas un homme se dresse, lève les
bras en l'air, tourne sur lui-même et s'abat – « J'en ai un, dis-je à Collard
! » « Sur la droite et en arrière, nom de
Dieu ! ils sont sur nous ! » C'est le lieutenant des lanciers qui hurle comme un
démon. En faisant demi-tour, je cogne Desy qui râle à mes pieds ; un filet de sang jaillit de sa
tempe et glisse sur sa joue. Un autre est couché, face au ciel, sur le bord du
fossé. Ses yeux roulent dans leur orbite. De l'autre côté du chemin, je ne vois
rien. La colère me monte. « Les voilà ! crie Collard
: attention ! en face de toi, dans l'autre fossé ! Jamais, ma pensée n'a été aussi claire,
mes mouvements aussi précis d'un bond je suis derrière un des arbres qui
bordent la route, je rabats ma hausse et tire rapidement sur les Allemands que je
vois maintenant dans l'autre fossé. A l'arbre suivant, Collard
en fait autant ; notre tir est terrible, chaque coup porte. Les ennemis battent
en retraite ; entre les arbres, nous voyons passer des dos gris. Nous tirons
toujours. A chaque détonation l'homme visé s'aplatit comme un braconnier sur un
lièvre au gîte. Je suis enragé, et, un moment, l'idée de les poursuivre me
passe par la tête. Heureusement, la raison me revient : les cavaliers qui sont
sur la route de Wetteren peuvent très bien nous couper la retraite. Sur un
signe que je fais Collard, et moi sautons dans le fossé. Mais, où sont les
autres ? L'auto a disparu. Le commandant est étendu, mort, sur l'accotement.
D'autres gisent dans le fossé. Nous ne sommes plus que deux debout. Desy râle toujours. Au pas de course, nous fuyons vers nos
chevaux. Les Allemands nous voient et s'arrêtent. Une grêle de balles nous
sifflent aux oreilles. Je m'aplatis devant un aqueduc ; le canal est malheureusement
trop étroit pour pouvoir livrer passage. Je bondis et me laisse rouler de l'autre,
côté, Collard me suit. Nous passons près de la maison
où étaient abrités nos chevaux ; il en reste deux qui sont tués ; les autres
sont partis. Nous marchons maintenant sur
l'accotement. Les balles qui viennent de derrière ne m'inquiètent plus ; je
suis dominé par une peur insensée de passer en face des maisons. Je crie : – Nous sommes foutus Collard
: les Allemands sont au carrefour. – Penses-tu ! – Ils y sont, te dis-je ! – Il faut pourtant passer, gronde Collard. –
Mais je n'ai plus que deux cartouches ! J'ouvre ma carabine, elle est vide ; ma
cartouchière aussi. En fouillant dans mes poches je retrouve un chargeur garni,
que je pousse dans l'arme. Il faut passer ! il faut passer ! Ces
trois mots me martèlent le cerveau et me poussent à aller de l'avant. Je marche, les doigts crispés sur ma
carabine, les mâchoires claquantes de peur. Nous passons... Il n'y a rien. Nous nous
regardons et éclatons de rire. Pourquoi rions-nous ? Est-ce la joie
d'avoir échappé ? Je ne crois pas. Est-ce une réaction de tout notre être
contre la peur qui vient de nous étreindre ? C'est possible. Notre accès passé, nous allons, côte à
côte, sans nous presser, en jetant, de temps à autre, un regard en arrière. L'image de Desy,
râlant au fond du fossé, me cloue soudain sur place. – Nous sommes des fainéants, Collard ! – Pourquoi ? – Nous avons abandonné Desy. – Tu l'as vu ? – Oui, il râlait dans le fossé. –
Où était-il touché ? – Une balle dans la tête. – Il l'avait toujours dit, fait gravement
Collard en se découvrant. Je veux en faire autant, mais, dans
l'algarade, j'ai perdu mon bonnet de police. – C'est vrai, Desy
l'avait toujours dit ! Comment se fait-il que nous soyons ainsi prévenu, d'une
chose qui va nous arriver ? – C'est le pressentiment. – Mais oui, c'est le mot pour désigner
la chose, mais le mot m'explique rien ! Il y a une force qui se charge de nous
prévenir, mais quelle est-elle ? J'entends toujours le râle de Desy et j'ai une folle envie de faire demi-tour. – Inutile, trouve Collard,
s'il a une balle dans la tête, il est mort maintenant. – Je voudrais le revoir ; j'éprouve
comme un remord de le laisser là. – ColIard
s'impatiente ; il s'écrie : – Ce n'est pas notre faute après tout,
si Desy a été frappé à mort ! – C'est la faute à qui alors ? – Au Kaiser ! Devant mes yeux, se dessine une image. Je
vois une potence, ses bois et au bout de sa corde, un énorme hameçon à deux
branches. Le Kaiser y est pendu par les narines. Il y frétille comme un barbeau
au bout de la ligne d'un pêcheur. Je voudrais le voir frétiller ainsi toute ma
vie. Un bruit de sabots de chevaux nous fait
lever la tête. C'est notre escadron qui vient à notre secours. Nos officiers
sont en tête. Du coup, j'en oublie toutes les engueulades et toutes les menaces
dont nous ayons été l'objet de leur part. Lebrun nous appelle et nous regarde
comme un père, ses enfants, échappés à un grand péril. Il nous questionne. Nous
lui expliquons les faits. Quand nous parlons des morts, une buée lui voile les
yeux. – Vous irez manger, dit-il, vous devez
avoir faim ; nous autres, nous allons voir ! Tiens ! c'est vrai, j'ai faim, j'ai même
une faim de loup. Collard aussi, d'ailleurs. – Nous allons commander chacun une livre
de bifteck, dit-il. Puis, après un moment : – Nos officiers sont de fameux gueulards,
mais, il n'y a pas à dire, ce sont des hommes, à l'occasion... Nous retournons à Melle, d'où nous
sommes partis le matin. En route, j'ai dû demander une casquette pour garantir
ma tête rasée, des rayons trop ardents du soleil. Au cantonnement, nous retrouvons nos
chevaux ; ils mangent paisiblement leur ration d'avoine. Cette vue met Collard en colère : il va chercher son sabre et le brandit
au-dessus de la tête de sa monture. – Fainéant ! lâche ! hurle-t-il ;
pour une fois que j'ai eu besoin de tes quatre pattes, tu as fichu le camp ! Je
vais te trouer la panse ! J’essaie de le calmer : – Allons, ColIard
: ton cheval n'est qu'une bête ; il a suivi son instinct en fuyant les coups de
fusils. – Ah ! il peut fuir, lui, parce que
c'est une bête ? C'est parce que nous sommes malins, nous, que nous devons nous
battre comme des sauvages ? Tiens, ajoute-t-il, en levant son
sabre, tu me dégoûtes, tu es plus bête que mon cheval... et moi aussi ! – Si nous allions manger ? La proposition ,fait son effet ; Collard se calme. – C'est une idée, dit-il, allons manger.
II y a bien une boucherie dans les environs, sans doute. Après quelques minutes de recherches,
nous découvrons une boucherie où la dame parle français. C'est une chance ! – Chacun une livre de bifteck et deux œufs
sur le plat, commande Collard d'un ton sec ! Si ce n'est
pas assez, dit-il en s'adressant à moi, nous mangerons autre chose après ! A table, nous nous abîmons dans nos
pensées. L'image de Desy ne me quitte pas. Je pense
peu aux autres. Pourquoi ? Je n'en sais rien. La dame nous sert, à chacun un bifteck
de la largeur de l'assiette, orné de deux œufs bien rouges. C'est appétissant. Nous mangeons, je regarde Collard du coin de l'œil : C'est plaisir de le voir
attaquer son bifteck. – Neuf cent mille ! c'est un tas.
dit-il, entre deux bouchées. – Tu rêves, je crois. – Non, je calcule : Si les cent
cinquante mille hommes qui composent l'armée belge en avaient fait autant que
nous aujourd'hui. il y aurait neuf cent mille Allemands avec les reins cassés. En suivant le cours de ses idées, il
s'adresse à la patronne : – Venez ici, Madame, que je vous
raconte. Collard explique
notre fait d'armes, mais dans sa narration, il lui donne une ampleur
extraordinaire. Il conte à la femme éberluée, que nous avons exterminé un
peloton d'ennemis, puis, le peloton devient un escadron, pour se transformer
ensuite en régiment. Collard fait des tas de cadavres
Allemands : il en barre tout l'horizon. Sous la conduite des mêmes officiers,
nous avons mené une vie de nomades. Séparés, pour ainsi dire, du reste de
l'armée, nous avons poussé des reconnaissances parfois, lointaines. Nous avons appris de bonnes nouvelles :
la victoire de la Marne, le recul de l'armée allemande, mais aussi, le siège
d'Anvers, sa chute. On nous avait dit : « la place est imprenable » ; elle n'a pas
tenu une semaine. Nous avons entendu, gronder le canon des
jours et des nuits. C'était au loin ; nous ne savons pas encore ce qu'est un
obus ! Nous sommes près de Bruges ou nous
rencontrons des civils qui se disent gardes-civiques. On les a licenciés : ils
cherchent maintenant à regagner leurs villes respectives. La nuit nous partons. L'armée belge est
en pleine retraite. Pour la première fois, nous prenons contact avec des
militaires de toutes armes. C'est un fourbi épouvantable. Pêle-mêle, les régiments,
privés de ravitaillement, se dirigent vers l'Ouest. Depuis plusieurs jours,
nous n'avons plus eu de repos : toutes les troupes sont dans notre cas. La faim
nous tenaille ; l’ennemi nous talonne. Qu'importe, elle marche cette armée
d'ouvriers et de paysans, ils marchent ces soldats affaiblis par deux mois de
dures campagnes : ils marchent le jour, ils marchent la nuit. Parfois, une
unité s'arrête pour combattre et protéger les autres ; après une heure de
combat, pendant laquelle beaucoup tombent, les valides reprennent leur route.
Le long des chemins, les plus faibles s'affalent, car aux souffrances du corps
vient s'ajouter le supplice du sommeil. Les paupières sont lourdes, lourdes,
les têtes s'inclinent, les jambes fléchissent, ils ne marchent plus que par un
effort suprême de volonté. Les
fuyards civils augmentent les difficultés et la confusion. Leurs charrettes de
toutes espèces et de toutes grandeurs, s'embarrassent parmi les convois
militaires. De ce tohu-bohu montent des cris, des prières, des blasphèmes Des
centaines de voix forment un chœur lugubre que ne parvient pas à couvrir le
bruit proche de la fusillade. Entre-eux, les soldats s'aident : des
artilleurs hissent les plus exténués sur leurs canons, des cavaliers marchent à
pied tandis que des Fantassins sont en selle. Des officiers subalternes sont parmi
les groupes. Quand ils ne sont pas eux-mêmes à bout de forces, ils encouragent
leurs hommes, jurent, sacrent ou supplient ... La vue de tant de misères agit sur mon
cerveau. Brusquement, mon jugement et ma compréhension des choses changent. Le
« moi », qui s'imposait constamment à mon esprit, s'efface. Dans mes moments de lucidité je vois
maintenant que je ne suis qu'un infime rouage dans la machine détraquée qu'est
aujourd'hui, l'armée belge. En retraite. Demi-tour. Pied à terre. A
cheval. Ordres. Contre-ordres. Pendant des jours
et des nuits on nous a fait danser comme des marionnettes. En vérité, nous ne
sommes plus rien d'autre : nous avons les fesses en sang, notre tenue est
déchirée, nos chaussures baillent de partout. nos membres sont las, notre tête est
lourde, nous sommes matés. Nous n'avons même plus la force de discuter les
ordres qu'on nous donne ; pour des Belges, c'est un mauvais signe. Aux environs de Roulers, nous entrons en
contact avec la cavalerie française dont les hommes ne sont pas mieux lotis que
nous. Ils ont combattu dans le Luxembourg belge, sur la Marne et viennent de
remonter vers le Nord. Il y a là des cuirassiers énormes, des dragons superbes et
des hussards poids-mouche. Leur langage est pour nous une surprise ; ils
emploient d'autres termes que nous : ils appellent le café, du jus, le vin, du
pinard et les chevaux, des rosses. Quand ils racontent une bataille, c'est avec
un luxe de détails et de couleurs extraordinaire. Invariablement, ils terminent
par ces mots : « Ah ! ce qu'il en tombait des bons hommes ! » Ils ont une autre façon que la nôtre de
faire les reconnaissances. Notre système à nous, est de mettre pied à terre à
un ou deux, quand nous nous sentons à proximité de l'ennemi et en faufilant le
long des haies ou dans le creux des fossés, nous essayons toujours de voir sans
être vus. Les Français, eux, y vont plus carrément, ils continuent à cheval
jusqu'à ce qu'on leur tire dessus. C'est plus rapide, mais cette méthode leur
fait perdre inutilement beaucoup de monde. C'est ici que nous faisons connaissance
avec l'artillerie. Au cours d'un combat d'avant-garde, nous sommes salués par
des salves de septante sept. Cela ne nous effraie pas beaucoup. Les Français, qui
les connaissent, les appellent des pistolets. Toutefois, un de leurs officiers,
qui m'a entendu dire : « trop court messieurs les Allemands !» répond : «
Hélas ! non, ce n'est pas trop court, ils tirent en plein dans nos batteries !
» Après
deux jours de combat, nous battons en retraite avec les Français. Après je ne sais quels détours, après
avoir passé des nuits à la belle étoile, nous nous trouvons, un soir, dans une
ferme, le long d'une ligne de chemin de fer, près d'Oostkerke. L'armée est échelonnée le long de
l'Yser. De Nieuport à Dixmude, nos régiments, déjà si décimés, attendent le
choc d'une grosse armée allemande. Celui-el ne tardera pas à se produire. En face
de nous, dans les villages, à l'autre côté de l'Yser, les fusils et les
mitrailleuses crépitent. Ce sont nos avant-gardes qui résistent. Soudain sur toute
la ligne, l'artillerie allemande commence un formidable bombardement. L'air
vibre sous le sifflement et l'éclatement des obus. Tout tremble. Dixmude prend
feu, Nieuport brûle, des clochers s'écroulent en projetant dans la nuit des
millions d'étincelles. Notre artillerie répond faiblement ; les obus manquent. « Rassemblement de l'escadron ! » C'est
le lieutenant Lebrun qui nous appelle. On décrit un demi-cercle devant lui :
une lourde appréhension pèse sur le groupe. « Ordre du Quartier général ! dit Lebrun
d'un voix rauque. Nous allons installer des postes parallèlement à l'Yser. Vous
arrêterez tous les soldats, venant de la ligne de feu, qui se présenteraient isolément
ou en groupes non commandés. Vous les ramènerez ici, où nous les reformerons et
d'où vous les reconduirez en lignes. Je vous recommande le plus grand calme
dans l'exécution de cette mission difficile. Les hommes, rompez ! Les chefs,
restez ici ! » Nous nous dispersons par groupes dans la
ferme. – Cré nom de
Dieu ! il ne nous manquait plus que celle-là, rugit Collard
! » «
Nous serons derrière » , les
paroles de Desy me reviennent à l' esprit. Il avait
donc lui, une vision exacte de ce qui allait se passer ? Dommage qu'il soit
mort ! Une vague inquiétude m'étreint le cœur : Combattre les Allemands passe
encore ; on se défend, œil pour œil, dent pour dent : mais nous dresser en face
des soldats, belges, cela dépasse la mesure. Bon sang de bon sang ! Un chef m'appelle – Présent, chef. – Vous et Bodson,
prenez votre carabine ct suivez-moi. J'appelle Bodson
; c'est aussi un collègue de ma levée. Il est plutôt petit pour un gendarme ;
ses cheveux sont blonds. sa peau colorée ; il est d'une vivacité extraordinaire
et a des expressions à part. « Le temps passé c'était hier ». dit-il souvent. Quand
il s'aperçoit qu'il dit des sottises. il s'exclame : nom de Dieu ! je me fous
encore une fois de mes contes » et si, par hasard, ou lui dit : « tu en
es un, toi, Bodson ! » « Oui, répond-il, j'en suis
un, c'est quand je pisse qu'on le voit le mieux ! » – Que te faut-il encore ? dit Bodson en arrivant avec sa carabine en main. – Nous devons suivre le chef. – Où ça ? – Où allons-nous chef ? – Vous le saurez tout à l'heure.
Avez-vous des cartouches ? – Oui chef. Nous pataugeons dans la boue ; le
sifflement des obus nous fait arrondir le dos. II fait noir ; la lueur des
explosions nous montre le terrain pendant l'espace d'une seconde, puis, nous ne
voyons plus rien. Un « plouf » étouffé, suivi d'un « sacrebleu
» sonore nous apprennent que le chef vient de piquer une tête dans un trou
rempli d'eau. Nous l'aidons à sortir de son humide situation. Une envie de rire
me monte à la gorge. C'est bizarre quand même, ce besoin de rire qui me prend
chaque fois qu'il arrive un avatar à un de mes supérieurs ! En se secouant de temps à autre, le chef
nous conduit en face d'un gros bâtiment. – Vous monterez de faction ici, dit-il :
à l'intérieur de l'habitation il y a un général. Vous ne laisserez entrer
personne sans avertir le commandant qui lui est adjoint : lui seul peut
introduire quelqu'un. Sous aucun prétexte, vous ne quitterez votre poste, avant
d'être relevé de faction. – Et si on bombarde, chef ? – Et à manger ? – Taisez-vous, en ai-je moi à manger ? – Et si les obus tombent trop près ? – Sans aucun prétexte, vous dis-je !
Allons, bonne chance, au revoir. Le chef part ; nous regardons disparaître
sa silhouette dans le noir. – Je crève de faim, moi, Bodson ! – Moi pas, ce matin je suis allé porter
un pli à l'arrière ; j'en ai profité ; j'ai une gourde de rhum et du tabac. – Tu n'as rien à manger ? – Non. – Laisse-moi boire un coup ; puis tu me
donneras une chique de tabac ; cela me fera passer l'idée! Bodson me
donne sa gourde. Avec délice, j'avale deux ou trois gorgées. – Hé là ! ne bois pas tout ! – Ne crains rien ; tiens, voilà ta
gourde ; donne- moi une chique maintenant. – Tiens, donne ta gourde, je vais
partager le rhum. – Tu vas le répandre. – Non, donne... Y ou, ou, ou. – Qu'est ce que c'est que ça ? Un éclair nous éblouit : nos tympans
vibrent sous la violence d'une explosion. C'est un gros shrapnel qui vient
d'éclater au-dessus du bâtiment. 
Y ou, ou, ou. D'autres suivent ; les
explosions se succèdent. Nous nous collons contre le mur : j'ai les oreilles
bourdonnantes, le cœur me bat à grands coups dans la poitrine. Cela dure
combien de temps ? Je ne sais ! Cinq minutes... un siècle ? Ouf ! c'est passé. Nous nous promenons
devant le bâtiment pour nous réchauffer. – Halte-là ! Qui vive ! crie Bodson. – Chasseur à pied, porteur d'un pli pour
le général. – Avancez, là, un instant, nous devons
prévenir. J’entre dans le bâtiment : il y fait
noir comme dans un four : je crie : – Mon commandant, mon commandant ! – Qui est là, grogne une voix en-dessous
de moi. – Un gendarme de faction, mon
commandant. Un porteur de pli demande à entrer. – J'y vais répond la voix. Le commandant s'amène par l'escalier
d'une cave. Il est muni d'une lampe électrique qu'il me braque dans la figure.
Après avoir fait descendre sa lumière jusqu'à mes pieds, il questionne : – Où est le porteur dé pli ? – Devant la porte, mon commandant. –
Sortez. je vais voir. Sur la porte, il éclaire le chasseur
comme il m'a éclairé. – Donnez-moi le pli, dit-il, – Vous êtes mon général ? demande le
chasseur ? – Non. je suis le commandant-adjoint.
Donnez ! – J'ai ordre de ne remettre le pli qu'au
général. – Allons, pas de réflexion, donnez ! – Non, répond résolument le chasseur. – Entrez, gronde le Commandant. Les deux hommes entrent dans le
bâtiment. J'en profite pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. La lumière me donne
juste le temps de voir dans une pièce, à droite du corridor, un amoncellement
de poutres et de sacs de terre. Il y en a au moins, deux mètres d'épaisseur. Je
comprends : c'est l'abri du général. Il est dans la cave en dessous. – Il est blindé le général, dis-je à Bodson. – Tu dis ? J'explique la chose. – Que veux-tu, répond Bodson : Ce serait dommage qu'un général passât l’arme à gauche
! Nous entendons quelqu'un tâtonner dans
le corridor. –
Par ici, crie Bodson ! – Bon Dieu, de bon Dieu ! dit le
chasseur en sortant. – Qu'as-tu mon vieux ? Le chasseur ne répond pas ; il part en
courant. « Bon Dieu de bon Dieu » crie-t-il dans la nuit. Que peut-il bien
avoir ? Il
pleut et le bombardement recommence. La pluie nous cingle la figure ; par
rafales, les obus nous font courber l’échine, à chaque arrivée de projectiles,
nous buvons un coup de rhum pour nous donner du cœur. Bodson
trépigne : – Nom de Dieu de nom de Dieu ! rugit-il.
Faut-il que nous soyons des chiens pour être livrés comme nous le sommes ! Etre
trempés jusqu'aux os, grelotter de froid jusqu'à ce qu'un obus vienne nous écrabouiller
et, tout cela, pour veiller sur la peau d'un général, qui a deux mètres de
matériaux au dessus de lui ! Ah ! le chameau ! Le rhum monte à la tête de Bodson sans doute : il crie fort et ses propos deviennent
dangereux. J’essaie une diversion. Bodson m'a parlé
plusieurs fois, d'une certaine Eva qu'il a laissée au pays. – Si Eva te voyait comme tu es là !
dis-je. – Elle m'enverrait au
diable, répond Bodson. J'ai une barbe de trois
semaines, j'ai un demi centimètre de crasse sur toute la peau ; je pue nom de
Dieu ! Et puis, d'ailleurs, Eva, je ne la reverrai jamais, jamais... * *
* On nous relève vers midi. Nous montrons
aux deux autres une encoignure où l’on peut plus ou moins, s'abriter. Après
leur avoir souhaité, bonne chance, nous partons vers la ferme. Nous titubons ; des
étincelles dansent devant mes yeux ; j'ai faim. Dès notre arrivée, un chef marche droit
vers nous, il s’adresse à moi : – Vous revenez à point, dit-il : nous
n'avons plus de gendarmes ici ; vous conduirez ces soldats en première ligne
sur la droite de Pervyse ! – J'ai faim, chef, et je voudrais
dormir. – Est-ce que les autres dorment eux ?
Allons, grouillez-vous ! On va vous donner deux boîtes de sardines. Vous devez
partir à deux. Mais, où est l'autre ? Bodson a déjà
disparu. Une voix crie : « J'y vais moi ! » C'est Collard.
Il fait mettre les soldats par quatre. « En avant, marche ! » commande-t-il, «
Viens ! ajoute-t-il, en me tirant par la pèlerine du manteau. Je suis. En marchant, je vois danser les
silhouettes des soldats. J'ai les deux boites de sardines dans la main ; je ne
sais qui me les a données, je les ouvre successivement et en avale goulûment le
contenu. Cela me fait du bien ; mes forces me reviennent un peu ; mais j'ai sommeil…
sommeil ! Collard me
passe une boîte de lait condensé
et deux paquets de cigarettes. « Je les ai rapportés pour toi de l'arrière,
dit-il » Nous marchons ; je vois un peu plus clair.
Oh ! le lamentable groupe ! Les soldats vacillent ; plusieurs vont pieds nus
dans la boue humide et froide. Nous marchons... nous marchons... Que
c'est long bon Dieu ! que c'est long ! «Allons, courage, me dit Collard. » Enfin, nous arrivons près d'une petite maison,
à proximité d'une ligne de chemin de fer. Derrière l'habitation un officier
s'est abrité avec quelques hommes. Collard s'adresse
au supérieur, lui remet le commandement des soldats que nous avons ramenés, salue,
puis revient vers moi. L'officier à un rire nerveux ; ses
hommes se fâchent; ils nous insultent : « Lâches ! fainéant ! » Nous baissons
la tête. Que ferions-nous d'autre ? Monter de faction, arrêter des soldats,
les reconduire en ligne ; pendant la nuit, garder les chevaux attachés les uns aux
autres dans une prairie, tel a été notre service pendant plusieurs jours. Comme
nourriture ? une boîte de sardines le matin, une boîte de sardines le soir. A la
fin, c'est écœurant toujours des sardines ! La nuit tombe. A un passage à niveau
près de Dixmude, je fais les cent pas. Je suis seul ; mon camarade de faction
est retourné à la ferme avec une dizaine de soldats que nous avons arrêtés dans le courant de l'après-midi. Les éclairs des coups de canon zèbrent
les nues ; les fusils et les mitrailleuses crépitent. Les obus éclatent en face, derrière, à gauche, à
droite, mais assez loin de moi. Un bruit attire mon attention. Je
regarde, sur la ligne de chemin de Fer venant de Dixmude. Des ombres avancent.
Je crie : – Halte-là ! Qui vive ? – Douzième de ligne. – Un homme en avant ! Une silhouette massive avance en se
balançant. – Le mot d'ordre ! – Le sais-je moi, nom de Dieu, le mot
d'ordre ! Je reconnais l'homme. C'est le
commandant Grisard. J'ai servi sous ses ordres à la première compagnie du
douzième ; j'ai même été son ordonnance pendant plus d'un an. – C'est vous, mon commandant ? – Oui. Je suis le commandant Grisard.
Qui es-tu ? – Lejeune, votre ordonnance, de la
classe de 1911. – Tu es là toi ? Tu es gendarme je crois
? – Oui, mon commandant. – Tant mieux, tu as de la chance. Les hommes de Grisard se sont approchés :
J'ai en poche une lampe électrique de marque allemande, achetée à un soldat. Je
fais faire le tour à ma lumière. Voilà Cretz, Libert, Léonard, Marenne, Croisier,
tous des camarades du régiment. J'en vois d'autres que je ne connais pas. Ils
font le cercle autour de moi et me disent qu'ils sont « relevés » ; ils
vont en repos. – Que fais-tu ici, demande l'un d'entre
eux ! –
Je suis de faction. – Pour quoi faire ? – Pour arrêter les soldats isolés venant
de la ligne de feu. – Alors, si nous n'avions pas eu le
commandant avec nous, tu nous arrêtais ? – J’en ai l'ordre. Un grognement me répond : – Après nous avoir arrêtés, qu'aurais-tu
fait de nous ? – Je vous aurais fait attendre ici.
jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour vous conduire dans une ferme à Oostkerke. – Et de là ? – On vous aurait ramenés en lignes. – Silence, commande Grisard ! n'embêtez
pas cet homme avec vos questions. Pourquoi ne te mets-tu pas à l'abri,
ajoute-t-il en s'adressant à moi ; il fait dangereux ici. – J'ai l'ordre de rester à mon poste,
mon commandant. – Bon, bon : les ordres qu'on te donne
il faut toujours les exécuter : mais, prends garde à toi ! mon garçon, prends
garde à toi ! Si tu vois passer des hommes du douzième, laisse-les aller, nous
sommes relevés... – Bien, mon commandant. Grisard part. Il a toujours la même
allure ; en marchant, il balance ses épaules massives. Ses hommes le suivent :
un seul est resté près de moi : c'est François Croisier, mon meilleur ami de régiment. – Alors, c'est toi, Maurice ? – Oui François, cela s'est-il bien passé ? – Ne me parle pas de ça ; je n'en puis
plus ; j’ai faim. – Attends ; j'ai deux boîtes de sardines
en poche, tu vas les manger. – Une suffit ; garde l'autre. – Non, François, j'en ai comme je veux. –
Donne alors. – Minute, je vais les ouvrir ! Pendant que je me livre à cette
opération ; Croisier détache son sac, qu'il laisse tomber, puis s'assied dessus.
La tête dans les mains, il pleure. – Qu'as-tu François ? – Rien ; donne-moi à manger ; as-tu une fourchette
? – Non ; tiens, mange avec les doigts ;
ne jette pas l'huile, bois-la, cela te fera du bien. Croisier mange. Avec ma lampe
électrique, je l'éclaire. Oh ! le malheureux ! sa figure est noire comme
celle d'un ramoneur; sa capote déchirée est maculée de boue et de sang ; il est
maigri, ses yeux sont plus grands. Pauvre François ! – C'est bon des sardines, dit-il, entre
deux bouchées ! – Je le laisse manger sans rien dire. Un
besoin de pleurer me monte à la gorge. Dans un effort, je refoule le sanglot. – Ça y est, dit François ; maintenant ça
va mieux. – J'ai du tabac ! – Tu as du tabac ! – Oui, François ; en veux-tu ? – Je n'ai plus ma pipe ; je l'ai perdue. – Tiens, voilà la mienne ; attends, je
vais te la bourrer. – Ce n'est pas dangereux, Maurice, de
fumer ici ? – Non, nous sommes à trois kilomètres de
la ligne de feu. – Je suis à l'arrière alors ? – Pas encore, François ! Il fait encore
un peu dangereux ici. – Pourquoi y restes-tu alors ? – Il faut bien, François, je suis de
faction ! Croisier allume la pipe, puis me demande
: – Tu n'as pas encore été blessé ? – Non, et toi ? – Moi non plus. – Cela a été dur pourtant ? – Oui, à Dixmude surtout. – Vous y étiez depuis longtemps. – Je ne sais pas. – Vous aviez à manger ? – Non, nous avons pillé la ville, nous y
avons surtout trouvé des boissons. On allait chercher des bouteilles et on les
apportait en lignes. – Alors, les Allemands attaquaient ? – Oui, surtout la nuit ; mais, je ne
sais plus… je ne sais plus... – Vous avez perdu beaucoup d'hommes ? – Beaucoup, Maurice, beaucoup. Tu as vu
la compagnie ? C'est, je crois, ce qu'il en reste ; quarante hommes, peut-être ! – Et Grisard ? – C'est un homme ; nous l’appelons Papa ! Croisier pleure de nouveau. En hauteur,
je le dépasse d'une demi-tête, Je suis maréchal-des-logis ; il n'est que simple
soldat. Mais, comparé à lui, je me sens tout petit, tout petit. Des coups de canon partent des lignes
allemandes. – Attention ! couche-toi ! crie
Croisier. D'un même mouvement, nous nous aplatissons
dans la boue. Un ululement atroce me fait contracter le corps et les membres,
puis, c'est l’explosion. Des éclairs fulgurants m'éblouissent ; des détonations
formidables m'ébranlent la tête ; des éclats sifflent au-dessus de nous ; des
paquets de boue nous tombent sur le dos. – Tu n'es pas blessé ? – Non, et toi ? – Moi, non plus. – Pars François, il ne fait pas bon ici
! – Attention ! Ne te lève pas, en voici
d'autres ! Tout mon être se crispe. A travers la
boue, j' essaie d'incruster mes doigts dans les pavés du passage à niveau. Les
obus éclatent. Oh ! l'atroce sensation! – Ce n'est pas fini, me dit Croisier, ne
bouge pas. Les coups partent. Blottis l'un contre
l'autre, nous nous garantissons mutuellement un côté du corps, Le bombardement
continue... Je m'en veux de toute mon
âme d'avoir parlé avec Croisier ; il serait loin, maintenant. Croisier a compté le nombre des salves
d'artillerie. – C'est tout, dit-il : lève-toi, Maurice,
nous l'avons échappé belle. Tu ne devrais pas rester ici : cherche un fossé,
n'importe où, mais ne reste pas sur la route Maurice n'y reste pas. – Oui ; je chercherai, mais toi, va
t'en, tu n'as rien à faire ici. Tiens, voilà ton fourbi. J'aide Croisier à
replacer son sac sur ses épaules meurtries ; puis il me sert la main très fort. – Au revoir, Maurice. – Au revoir, François ; dépêche-toi. Croisier s'en va. Je
n'entends pas le bruit de ses pas ; peut-être n'a-t-il plus de semelles à ses chaussures
! Au loin, entre les coups de canon, je l'entends encore crier : « Ne reste pas
là… Maurice, n'y reste pas ! » * *
* – Vous permettez, mon lieutenant ? – Oui, que voulez-vous ! – Voici : nous avons encore vingt
soldats à conduire en lignes, mais, il n'y a plus de gendarme ici ; à part les
deux garde-chevaux et moi tous sont partis. Les jours sont courts, la nuit
vient vite ; permettez-vous que je les reconduise seul ? C'est difficile
d'arriver aux lignes quand il fait noir. – Je ne puis pas vous laisser aller seul
avec vingt hommes ; vous ne les tiendriez pas ! – Croyez-vous, mon lieutenant ? J'en ai
déjà reconduit beaucoup et je n'en ai pas encore vu un seul qui cherchât
à se sauver ! Ces pauvres diables ne demandent qu'à avoir quelqu'un pour les
commander. – Va., a terminé le lieutenant. Ce dialogue a eu lieu, dans la cour de
la ferme, entre le lieutenant Lebrun et moi. Ce n'est pas par bravoure que j'ai
demandé à reconduire les soldats. C'est tout simplement pour avoir plus facile et
pour pouvoir dormir la nuit et c'est ainsi que je me trouve avec vingt soldats,
sur la gauche d'Oostkerke, en route vers les lignes. Le terrain devient de plus en plus
difficile. Des trous d'obus l'emplis d'eau s'étalent partout ; nous pataugeons ;
la boue nous tire par les pieds ; nous enfonçons de plus en plus. Les soldats ne parlent pas : de temps à
autre l'un d'entre eux lâche un soupir, pénible à entendre. Ils sont à bout les
malheureux ; ils ont combattu pendant plusieurs jours sans repos, sans nourriture.
Ils ont eu faim ; ils ont eu soif. Nous en rencontrons d'autres, des
groupes de deux, quatre, parfois dix hommes errant, à la recherche de leur unité.
Privées de commandement, des compagnies entières se sont disloquées au hasard
des combats. Ils vont, les yeux hagards, la bouche tordue : ils ont abandonné
leur sac, trop lourd pour leurs épaules fatiguées ; seul, le fusil reste dans
leur main. Leur tenue est lamentable. Déchirée, trempée, dégoutante elle se
colle aux membres las et déjà maigris. Dans la boue et le sang, ils pataugent
sous les rafales de balles et de mitraille. Nous en rencontrons et ils viennent à nous,
comme des brebis perdues vont au troupeau qui passe. Mon groupe grossit. Nous allons... nous allons... Parfois l'un d'entre eux s'affaisse en
gémissant ; on le laisse et on continue. Nous approchons des lignes ; çà et là,
gisent les morts des récents combats. Ils sont recouverts d'une croute immonde,
faite de boue et de sang. Mon groupe a grossi. De
temps à autre, je me retourne pour regarder les soldats. De stature, je les
domine presque tous ; mais, de caractère, je ne suis en somme qu'un gamin
fanfaron et querelleur. Et je conduis quarante hommes vers l'avant… vers la
mort… * *
* Où suis-je ? j’ai perdu la notion du
temps et des lieux ; il y a un trou dans mes souvenirs. Ma tête est lourde, mes jambes sont engourdies
mais dans le dos, je sens une bienfaisante chaleur. Je suis assis dans la boue, appuyé
contre quelque chose de chaud. La tête légèrement renversée, je regarde le
ciel. Dans une course vertigineuse, les nuages passent devant une lune pâle qui
me fait la grimace. Je ne pense à rien, qu'à regarder la lune et les nuages. Je
voudrais regarder ainsi, toujours. Le quelque chose de chaud vient de
bouger ; j'incline la tête à gauche ; c'est mon cheval. La pauvre bête est
étendue de tout son long dans la boue : seule sa tête est soulevée dans un
mouvement pour me regarder. Je suis assis dans l'angle formé par son ventre et
ses membres de derrière. De temps à autre, il fait un léger mouvement des membres,
qu'il étire avec précaution pour ne pas me faire du mal. Brave bête, tu es meilleure
que les hommes ! Et je regarde encore la lune et les nuages... Notre service est beaucoup amélioré :
nous ne couchons plus dans les boues d'Oostkerke.
Nous y allons encore le jour mais le soir, nous revenons cantonner dans une
ferme à Lampernisse, à quelques kilomètres d'Oostkerke. Collard et
moi, nous ne couchons pas dans la ferme où n'y a plus guère de paille ni de
foin. Après cinq minutes de discussion nous sommes tombés d'accord pour jeter
notre dévolu sur une petite meule de foin cachée par une haie et des grands
peupliers. C'est Collard qui l'a découverte, rodant. Nous avions nos raisons pour choisit la
meule, d'abord nous avons jugé qu'il suffisait d'un obus de gros calibre pour
nous faire dégringoler le toit de la grange sur la figure : ensuite, en
couchant à deux, dans la meule, nous sommes écartés des chefs et des officiers
dont, à notre avis, nous n'avons rien de bon à attendre ; puis encore il y a deux ou trois amours de
poules qui viennent déposer leurs œufs dans la meule. Nous gobons les œufs au
fur et à mesure et nous réservons les poules pour le dernier jour. Ce n'est pas
tout : la nuit, à l'insu des autres, nous donnons une bonne ration de foin à
nos chevaux qui en était totalement privés. Il ne nous a pas fallu longtemps pour
creuser dans la meule un trou assez grand pour nous y fourrer tous les deux.
Nous avons orienté notre couche à l'Ouest ; ce n'est pas le rêve, car c'est de
là que vient la pluie, seulement en lui tournant le dos nous aurions pu attraper
les crachats, des canons allemands dans la frimousse. Nous préférons l'eau. Les premières nuits, nous avons dormi
comme des loirs : maintenant nous parlons longtemps avant de nous endormir. – Tu me diras ce que tu voudras,
philosophe Collard, mais je m'y fais, moi, à la vie
de guerrier. Le vent, la pluie, la fusillade, les coups de canon, tout cela
devient de la musique. Et puis, on mange ce qu'on a, on vole ce qu'on trouve,
ça me va, ça me va ! – Ma foi ! à moi aussi, quand je ne suis
pas trop près de ces imbéciles d'Allemands ! – Si on nous avait dit, il y a quatre
mois, que nous serions livrés comme nous le sommes, nous aurions crié comme des
putois, et, maintenant, ça nous plait ! – Oui, c'est un fait que nous n'avons pas
perdu tout au change ! A la caserne, il fallait être propre, il fallait ci, il
fallait ça. C'est quelque chose d'embêtant un gradé ! Nous en avons encore,
c'est vrai, mais ils sont aussi sales que nous ! Du moment que l'on fait
son service, que veux-tu encore qu'on nous dise ! – Oui, il y a certainement quelque chose
de changé ; s'ils savaient comme on se fiche d'eux maintenant ! Mais parlons
d'autre chose. Entends-tu le vent qui joue du violon dans les peupliers ? Boum,
boum. boum ! les canons sur la grosse caisse, pan, pan, pan, pan ! les fusils
jouent du tambour. Je te dis que c'est de la musique. – Oui ; mais voici la pluie ; cela fait
encore du bien, la fraîcheur de ces gouttes dans la figure. J'ai malheureusement
froid aux genoux. –
Mets-les en poche ! Et puis, dis-moi. Maurice, toi qui veux trop souvent faire
le malin, pourquoi sommes-nous heureux dans la situation où nous sommes ? – C'est le sang des Marcassins qui se
réveille dans nos veines ! – Que racontes-tu ? – Tu ne sais donc pas ce qu'étaient les
Marcassins ? – Non. – Tu ne connais pas l'histoire de ton
pays, inintelligent Collard ? – Comme-ci, comme-ça, je l'ai apprise un
peu à l'école ; mais, depuis, le temps !... – Les Marcassins : c'étaient nos
ancêtres, les soldats du trop fameux Guillaume de la Marck, le sanglier des
Ardennes. – Qu'est-ce qu'il faisait ce sanglier ? – Il faisait, en petit, ce que le Kaiser
veut faire en grand. – Et les Marcassins ? – Ils faisaient, en grand, ce que nous
faisons en petit. – Comment cela ? – Nous volons les œufs et les poules :
eux volaient les vaches et l'argent. – C étaient nos ancêtres, ça ? – Sans doute ; ne sommes-nous pas des Ardennais
? – Pas la peine de faire
l'honnête alors ! conclut Collard, tu m'endors
avec tes histoires de Marcassins. * *
* Les Français et l'inondation, ont aidé
nos soldats à arrêter les Allemands. Ils sont callés dans les boues de l'Yser. Nous, nous sommes en repos dans une
ferme tout près de la frontière française. Nous allons avoir le foin des fenils
pour nous coucher, c'est le rêve ! Collard trouve que
la position est tenable. Pourtant, nous n'irons pas coucher très
tôt aujourd'hui. On nous a dit que tout près, de l'autre côté de la frontière,
il y avait une petite ville Houschoote avec des
boutiques, des restaurants, du vin et de la bonne goutte. Nous avons de
l'argent ; on nous a payé régulièrement notre solde (225 frs par mois) et, sur
l'Yser, nous n'avons guère eu l'occasion de les dépenser. Naturellement, on va
aller voir : Dans la cour de la ferme l'escadron est
rassemblé sur deux rangs devant le chef de service. Nous entendons par chef de
service, le plus ancien des maréchaux-des-logis chef de l'escadron. C'est lui
qui dresse le rôle de service et qui veille au bon entretien des chevaux. – Garde à vous ! Cowez,
St Hubert, Fonck, Collard, monteront garde d'écurie. – Ah ! Bon sang ! notre sortie est
fichue : du moins pour Collard : quant à moi, on va
voir ce qu'on va voir ! Le chef n' a pas fini : – Maintenant, achève-t-il, nous sommes en
repos, mais comme vous êtes horriblement sales, je vous défends, formellement,
à tous, de sortir du cantonnement aujourd'hui. – Ah ! zut alors ! – Rompez. – Des réflexions fusent parmi les
hommes. – Nous voilà prisonniers ! – Que le diable l' emporte ! – Qu'en dis-tu, toi ! me demande un
appelé Dubuisson. – Moi ? Je dis que, si j'en trouve
un qui a autant de toupet que moi, j'irai ce soir à Honschoote ! – Je suis ton homme. – Convenu : à quelle heure ? – A cinq heures : il fait noir. – Va pour cinq heures. Dubuisson est un gaillard de six pieds
de haut ; ses moustaches en crocs lui donnent un air terrible. Il n'est pas
méchant pourtant ; c'est même un des joyeux drilles de l’escadron. Collard, que
je vais retrouver à l'écurie, n'est pas de bonne humeur. – Nous voilà callés, dit-il ! – Moi pas, je sors avec Dubuisson. – Tu sors ? – Oui, mon vieux. – On ne peut pas sortir ; il faut que tu
restes. – Il n'y a que mourir qu'il faut. – Tu vas te faire pincer ! – Tant pis ! Je préfère avoir huit jours
d'arrêts que de sécher d'ennui ici aujourd'hui, – Alors, tu rapporteras un litre ! – Je l'espère. – Et une bouteille de vin ? – Pourquoi pas ? – Il me faudrait encore des souliers. – Quand tu auras fini... – Des chaussettes, un caleçon, une
chemise... – Et une femme, sans doute ? – Si tu en trouves une, je ne dis pas
non ! – Tu peux compter sur moi, mon petit Collard. – Je ne compte sur rien, ni sur personne
: tu vas revenir avec une cuite et Collard se
brossera. – Et tu as une brosse ? – Va au diable ! – Non, je vais me laver, m'astiquer et
en route. – Oui, tu es beau. Tu as une barbe en
tire-bouchon : tu n'as plus aucun bouton à ton manteau ; on ferait une soupe
grasse avec ton bonnet de police ! Ah oui ! Tu es beau : tu es beau ! – Ce n'est pas la beauté qui plaît, mon
petit Collard, c’est la taille et la marche ! – C'est cela. Parlons-en de ta taille et
de ta marche ! – Je n'ai pas le temps : je vais me
laver. Au revoir, mon petit Collard : soigne bien les
biques : donne double ration à mon gros. Collard jure
pendant que je me débarbouille : Par exemple, il me faudrait bien une brosse en
chiendent pour me décrasser les mains. Je ne vois pas ma figure mais elle ne
doit pas être fraîche non plus ! Et je frotte, je frotte... Allons, bon ! Je dois commencer à
reluire sans doute. Mon couteau va me servir à me couper le bout des ongles qui
sont noirs comme du jus de chique. De larges traces de boue sont disposées
en mosaïques sur mes vêtements ; mais bah ! On pardonnera cela à un homme qui
sort des bourbiers de l'Yser. Ah là ! Mes souliers n'ont plus que des soupçons
de semelles ; mes chaussettes non plus naturellement. Enfin, je suis lavé, je dois être beau comme un chérubin. Vivement, qu'il
soit cinq heures ! * *
* L'attente m'a semblé longue. Mais enfin,
il est cinq heures. Dubuisson m'attend déjà sur la porte de l'écurie. – Alors, nous y sommes ? – Oui, ne parle pas si haut, filons en
douce. – Allons-y, – C’est ici la route, je crois ? – C'est tout droit m'a-t-on dit. Combien de temps faut-il pour y aller ? –
Vingt minutes. – Marche plus vite ! – Je n'ai pas les jambes aussi longues
que les tiennes ! – Si on chantait ! – On nous entendrait encore de la ferme ! – Mais non : le vent vient de là. – Allons-y alors. – Que chante-t-on ? – « Sambre et Meuse ». Une, deux, trois… Le régiment de Sambre et Meuse Marche toujours au cri de liberté Suivant la route glorieuse Qui la conduit à l’immortalité : – Tu chantes faux, Dubuisson – Non c'est toi ! – C'est peut-être tous les deux. – Possible ; je ne connais pas la
musique. – Moi non plus. Nous marchons vite. Mes pieds prennent
un bain de boue, mais je n'y pense guère. Je suis gai comme un pinson. Dubuisson aussi ; il siffle et chante
continuellement. – Pour le moment, le Roi n est pas mon
cousin, dit-il ! – Qu'allons-nous faire pour commencer ? – Manger, – Oui ; on va chercher un restaurant
chic. S'il faut mettre cinq francs on les
mettra ; nous pouvons même mettre, d’avantage ; nous sommes riches ! – On boira du vin. – Et du bon ! – Et après ? – Après ? – On verra. – Nous y sommes, je crois... Oui. Regarde, voilà une femme ! – Elle n'est pas mal ! – Si on allait le lui dire ! – Pas de bêtises ; mangeons d'abord. – Oui ; c'est vrai. – Où va-t-on trouver un restaurant ? – Continuons ; il n'y a rien de fameux
dans cette rue. Les plus chics restaurants sont souvent sur la grand' place. Nous arrivons, le nez en l'air ; nous
regardons les enseignes. – En voilà un, mon vieux. – Oui ; il a l'air chic ! Nous entrons. Dans le vaste corridor, il
y a des porte-manteaux où s'alignent des capotes d'officiers. Nous faisons la grimace. – Voyons dans la salle à manger. – Oui, regarde. Bon Dieu ! La position n'est pas tenable !
Entre deux magnifiques officiers français, le lieutenant Lebrun étale son gros
ventre ! Qu'il est propre l'animal ! Sa tunique est toute neuve ; il est rasé
de frais ; il tient sa fourchette de la main gauche s'il vous plait ! – Demi-tour, mon vieux Dubuisson cette sale
boîte n'est pas faite pour nous ! – C’est chic pourtant ! – Filons. Sur la grand' place, j'accoste un civil. – Pardon, Monsieur, pourriez-vous nous
indiquer un restaurant où il n'y a pas d'officiers ? – Où il n'y a pas d' officiers ? – Oui. L'homme parait réfléchir ; puis,
brusquement dit : – Suivez-moi : ce n'est pas précisément
un restaurant mais, enfin, on y mange. – Et y boit-on
du vin ? – Sans doute. – Alors ça va. Notre guide nous conduit dans un petit
café où sont attablés quelques soldats français. – Auriez-vous à manger pour ces deux
braves ? demande-t-il au patron. – Oui va. Un casse-croute quoi ? – Qu’est-ce que c'est un casse-croute ? demande
Dubuisson. – Du pain, du fromage et une
demi-bouteille de vin. Ça va ? – II faut bien, bon Dieu, que ça aille !
Nous avions rêvé autre chose, mais... – Oui, patron ; ça va. Vous remplacerez
vos demi-bouteilles par des entières et vous servirez trois rations. Monsieur,
mangera avec nous. – Mais, je n'ai pas faim, moi, mes
braves. – Ta, ta, ta ! Vous nous avez conduits ;
il faut manger. Allons vite, patron… Je regarde le civil ; Il est déjà d'un
âge avancé, mais il est resté droit et a conservé une certaine allure. – Je suis un ancien, dit-il, en
s'apercevant de mon examen. – Vous êtes un ancien ? – Oui : j’ai fait la guerre de
soixante-dix. – A la bonne heure ! Vive notre ancien !
On va boire quelques bouteilles à sa santé ! y êtes-vous, vous autres ? C'est Dubuisson qui s'adresse aussi aux soldats
français. – Bien sûr, bon sang, qu'on y est, où on
ne serait pas des zouaves alors ! – Vous êtes des zouaves ? – Bien sûr ! ça se voit. – Mettez du bon patron. – Du bon quoi ? – Du bon vin, bon Dieu ! En voilà-t-il
une demande ! Et bien, les zouaves, vous mangez avec nous ? – Non on vient de bouffer l'rata.
Alors... – Comme vous voudrez. Mettez une
bouteille à tous patron. –
Ils sont un rien larges les zigues, dit un zouave ! – C'est notre première sortie, mon vieux
; nous avons crevé de soif sur l'Yser. Aujourd'hui il faut qu'ça marche. – Voilà, voilà, crie le patron ; du
pain, du fromage, du vin. Allons, bon appétit. – Tenez, fait Dubuisson, en mettant un
billet de cent francs dans la main du patron ; payez-vous largement et
rendez-moi de même ! Nous sortons nos couteaux et mangeons
pain et fromage ; le vin y passe aussi. Quand les verres sont pleins on les
vide ; quand ils sont vides on les rempli. L'ancien mange et boit comme nous ;
sa figure s'illumine. – Permettez-vous que je vous raconte mes
campagnes dit-il ? – Bien sûr; on ne demande pas mieux. L'ancien raconte. Il le fait sans
vantardise et avec clarté. Il insiste surtout sur un hiver terrible pendant
lequel il a marché pieds-nus dans la neige. Nous nous regardons. Dubuisson grimace
et fait le geste de passer la main sous ses morceaux de chaussure. Moi je pense
« C'est bizarre, qu'à toutes les guerres les soldats marchent pieds-nus ! Nous,
nous saurons nous tirer d’affaire ; nous avons de l'argent. Mais, les soldats !
Quand seront-ils chaussés ? Voici, l'hiver; vont-ils aussi devoir marcher
pieds-nus dans la neige ? » L'ancien termine : – Nous avons été vaincus, dit-il en
baissant la tête ; Dieu veille que vous ne le soyez pas, vous, mes braves. – Nous ne le serons pas. On vous vengera
l'ancien; on vous vengera, hem! les zouaves ? L'ancien pleure pendant que nous
hurlons comme des possédés. – Ça manque de femmes ici, trouve Dubuisson. – Oui, voilà un piano automatique ; si
on avait des filles on les ferait danser... – S'il ne vous manque que cela, dit le
patron, nous avons de jeunes voisines qui ne demandent peut-être pas mieux. – Allez les chercher. – Dans quelques minutes ; elles soupent
assez tard. – Ce n'est pas tout ça, Dubuisson. Avant
de danser, nous avons des courses à faire. II nous faut des souliers ; nous ne
pouvons pas danser sur nos chaussettes ! Alors ; en route l’ancien nous conduira. – Où voulez-vous aller ? – Il nous faut des souliers, des
chaussettes, des caleçons, des chemises, un litre de goutte, une bouteille de
vin. – C'est tout ? – Oui – Je vais vous conduire. Pour le litre
et la bouteille de vin le patron peut vous servir. – Apprêtez ça, patron ; on va revenir.
N'oubliez pas les demoiselles surtout ! A tantôt les Zouaves. – A tout à l’heure, les frères. Bras dessus. bras dessous, nous sortons
du café. – Que voulez-vous pour commencer ? – Des chaussettes ; nous les enfilerons
en allant chercher des souliers. – Va pour des chaussettes. Dans la première boutique, où l'ancien
nous conduit une grosse femme nous sert le nécessaire sauf des souliers. J'achète
tout en double. Il ne faut pas que j'oublie Collard.
La grosse femme est devenue toute rouge
sous les œillades, que Dubuisson
lui décoche. –
Des souliers maintenant ? – Ici tout près Messieurs. – Où ça ? – Par ici ; nous arrivons ; entrez... – A vous l'honneur, l'ancien. Ici, c'est une charmante blonde qui nous
reçoit : – Ces Messieurs désirent ? Des
souliers ; des bons : pas trop chers, c'est pour des guerriers. – Comme souliers ; nous n'avons que ceci
; c'est peut-être un peu lourd ! Mais nous avons de solides bottines de chasse
qui feraient peut-être, mieux votre affaire. – Montrez. La demoiselle monte sur une escabelle et
prend les bottines dans les rayons pendant que nous regarderons la naissance de ses mollets.
Dubuisson me fait un clin d’œil. – Voici, Messieurs ; C'est de la
première qualité : semelle cousue, cuir souple. – Combien ? – Vingt francs la paire. – Et en en prenant deux paires ? – C'est le même prix, Monsieur, – Allons, allons, vous nous ferez bien
quelque chose ! vous nous donnerez ainsi 1'occasion de vous remercier en vous embrassant.
– Si vous étiez rasés, je ne dirais pas
non. – Y a-t-il un coiffeur dans les environs
? – Il y en avait un, Monsieur, mais il
est parti à la guerre. – On n'aurait pas dû mobiliser les
coiffeurs, trouve Dubuisson, Mademoiselle, ajoute-t-il, vous allez nous tourner
le dos pendant que nous essayons nos bottines. Vous ne devez pas voir nos pieds
: ils sont plus vilains encore que notre barbe. Des morceaux de chaussettes
viennent avec nos souliers et nos pieds apparaissent tout maculés de boue. Nous
les nettoyons vivement, tant bien que mal avec les pans de notre manteau et
enfilons nos chaussettes. L'ancien rit de bon cœur. – Vous pouvez regarder, Mademoiselle,
nous sommes présentables. – Je vous regardais dans la glace. – Ah ! bon sang ! – Ne vous inquiétez pas ; je comprends
cela. On ne peut pas faire la guerre et rester propre. – En voilà qui me vont ! Collard à la même pointure. J’en prends deux paires comme
celles-ci, mademoiselle. Toi, mon vieux, tu n'en trouveras pas ; on n'en voit
pas la fin de tes pieds ! – Ils ne sont pals si grands ; je ne chausse
que du quarante cinq ! La preuve, c'est que ceux-ci me vont. – Prends-les, alors. – Bien sûr que je les prends. – Voilà, ma belle, quarante francs de
moi, et vingt de mon ami. Est-ce juste?.. Au plaisir ; comptez sur notre amour ! – Au revoir, Messieurs, merci. Tandis que la demoiselle rit aux éclats
sur le seuil de son magasin, nous reprenons le chemin du café. Dans la rue,
nous croisons des officiers que nous oublions de saluer. Maïs comme il fait assez
noir. Nous arrivons sans accroc. Les filles sont là ; le piano joue déjà
une valse. – Allons, Dubuisson, c'est le moment de
nous dégourdir les jambes ! – Je ne sais pas danser, moi ! – Tant pis pour toi ! Les zouaves nous accueillent par des
bravos. Les filles nous regardent des pieds à la tête. Une grande rousse fait
la moue. Je m'en aperçois et m’adressant à elle : – Une valse à nous deux, Mademoiselle ? – Je veux bien, Monsieur, dit-elle, d'un
ton que je crois dédaigneux. – Allons Dubuisson, prends les paquets !
Tiens voilà mon manteau ; remonta le truc ; mets, deux sous. Vous dansez à
l'envers, Mademoiselle ? – Comme on veut. – A gauche alors. Valsons... Elle danse bien la grande rousse ; les
zouaves nous regardent et, fièrement je fais tourbillonner une compagne dans un
cercle qui n'a pas trois mètres de diamètre. – Mince alors ! s'écrie un zouave ; il
faut être Belge ou bien du Nord pour savoir valser. – Tu perds tes papiers ; ta culotte est
trouée, crie Dubuisson. – Cela ne fait rien. Allé-là ! – Le morceau est fini : la grande rousse
ne me lâche cependant pas la main. – Servez du vin et de la goutte à tous,
patron ! C'est moi qui paie. Crie Dubuisson, Et cela continue : nous buvons. Entre
les rasades, je fais danser la grande rousse qui ne me lâche pas. Je la serre toujours
un peu plus fort, et, ma foi, je crois qu'elle en fait : autant. Dubuisson a pris une brune sur ses
genoux. Trois autres sont aux prises avec les zouaves. Vive la joie ! L'ancien
esquisse de bizarres pas de danse. – C’est ainsi qu'on dansait de mon
temps, prétend-il ! Pour nous, à notre avis la guerre a du
bon ! nous n’avons personne de la famille pour nous surveiller et nous en
abusons à corps perdu. La fête a continué très tard dans la
nuit. Nous avons, peut-être, chiffonné un peu trop les filles ; en compensation,
nous leur avons promis de revenir et même de les épouser. Nous sommes dans de beaux draps !
En voulant aller se coucher, Dubuisson a dégringolé d’une échelle et est tombé
sur le ventre du chef de service. Moi, j'ai éveillé tous les hommes qui
couchaient dans la même écurie que moi, je me suis disputé avec eux et en ai
même appelé dans la cour de la ferme, pour nous battre. Un chef a saisi le
litre et la bouteille de vin. Maintenant, nous sommes, Dubuisson et
moi, callés, en position devant le lieutenant Lebrun. Sur la table qui nous
sépare de lui, les deux bouteilles sont installées comme pièces à conviction. Dubuisson
s’est composé une figure de séminariste dévot ; celui qui ne le connaîtrait pas lui donnerait
le bon Dieu sans confession. Les talons joints, la tête haute, les petits doigts
aux coutures de la culotte nous attendons que le lieutenant nous interroge. – Vous êtes sortis, hier, du cantonnement
malgré la défense formelle du chef de service, gronde Lebrun. Conseil de Guerre
! Vous, Dubuisson, vous êtes tombé sur le ventre d'un supérieur ; c’est
très grave ! En plus, vous vous êtes disputé avec lui et l’avez traité de ramolli !
Conseil de guerre ! Vous, dit-il, s'adressant à moi, vous êtes rentré abominablement
ivre, porteur d'un litre d’eau de vie et d'une bouteille de vin ! Conseil de guerre ! Vous avez défié, de plus, vos
collègues. Conseil de guerre ! Qu’avez-vous à dire pour vous justifier ? – Il y a erreur, mon lieutenant, répond Dubuisson, ce n’était
pas nous ! – Nom de Dieu ! Ce n’était pas vous. Ce
n’était pas vous non plus que j’ai vu abominablement
sales sur la porte d’un restaurant d'Hondschoote ? Ce n’était pas vous !
ce n'était pas vous ! Vous avez de la chance qu'il' n'y ait pas de cachot ici ;
vous y seriez fourrés pour longtemps. Ce n' était pas vous ! Rompez, nom
de Dieu, ou je vous brise vos deux mauvaises têtes l’une contre l’autre. Nous filons comme des zèbres, pour ne
nous arrêter que dans une écurie. Ouf ! nous l'avons échappé belle ! Dubuisson
fredonne : Le
régiment de Sambre et Meuse Marche toujours au cri de liberté. « Lumières ! Lumières ! Personne ne répond. « Allons, bon sang, éteignez les
lumières, ou j'en fait rapport..; » Dzing. Quelque
chose, un morceau de pain sec probablement, lancé du haut de l'échelle au pied de
laquelle je crie, vient de me passer à cinq centimètres de l'oreille. Cela
n'est rien si des souliers ne jaillissent pas de la même source. « Tas de propres à rien ! Si vous
continuez, je vous fais fourrer tous dedans et adieu les permissions ! » « Permission ! » je viens de prononcer
le mot magique. Là haut, dans l'espèce de grenier, où sont couchés les soldats,
j'entends des chuchotements. Une voix crie : – Qui est là ? – Gendarmerie, Eteignez vos bougies ou
voilez les ouvertures du toit ; on voit les lumières. Vous avez envie de vous
faire casser la figure par une bombe d'avion sans doute ? – On n'entend pas d'avion. – Je m'en fous ; éteignez ; c'est
le règlement. – On éteint ; on éteint... Enfin, cela y est. Je sors de la place
obscure et me retrouve sur l'Avenue de la Mer, à La Panne ; Dubuisson, avec qui je suis en patrouille, sort d'une maison et vient me
rejoindre. – Et bien, cela a marché à côté, demande
t-il ? – Comme-ci, comme ça. Un crouton de pain
m'est passé à cinq centimètres de la frimousse. Et toi ? – Ce sont des civils : avec eux, cela va
tout seul. – Il est embêtant, le service lumières. – Tu parles ! – Viens, nous irons vers la mer. Nous marchons lentement ; nos éperons
sonnent légèrement au contact de nos talons sur les pavés. – Bon Dieu ! Voilà encore l'hôtel Terlinck illuminé ! – Que veux-tu y faire ? – Rien, bien, sur ! Pour ma part,
j'ai déjà rédigé trois procès-verbaux à charge du tenancier. Ah ! ouiche !
C'est comme si on crachait en l'air : cela n'a jamais aucune suite et, le
lendemain, il y a une lumière en plus. – Naturellement ; :nous n'avons
absolument rien à dire dans cette boîte. C'est rempli d'officiers supérieurs ; – Non. En sommes, nous n'avons
d'autorité que sur les soldats et encore ; Sincèrement, il est des moments où
je voudrais reprendre ma place au 12ème de ligne, où j'ai servi
avant la guerre. De quel régiment sors-tu toi Dubuisson ? – De l'artillerie de forteresse. – Ce n’est pas étonnant que tu connaisses si
bien la définition de trajectoire ! – Ne blague pas, mon vieux ; écoute...
on entend un bruit de dispute : c'est sérieux, dirait-on. – Démolissons le truc, crie une voix. Des menaces, des jurons, un bruit de verres
cassés, troublent le silence de la nuit. – Qu’en, dis-tu Dubuisson ? – Il faudra bien qu’on aille voir. Mais,
en douceur hein ! Pas de menace de punition aux soldats ; ce n'est pas le
moment. – Non. Oh là ! On crie au secours. Allons vivement. D'un même élan, par la porte de
derrière, nous entrons dans la cuisine d'un café. Nous arrivons juste à' point,
pour arracher un civil des mains d'un soldat occupé à lui administrer une raclée
épouvantable. D'autres soldats sont là : Deux ou trois s’éclipsent furtivement :
les autres grondent. – Tas d’imbéciles ! leur dit Dubuisson.
Non content de vous faire servir de l’alcool, ce qui est défendu, vous troublez
l’ordre à deux heures et demie du matin, alors que les cafés doivent être
fermés à sept heures du soir ! Vous avez votre carte d identité vous ? ajoute~t-il, en s
adressant au civil. – C'est le patron, dit une serveuse. – Il voulait nous faire payer des verres
en trop affirme un soldat. – Pourquoi est-il civil et nous soldats ?
demande un autre. – Silence ! commande Dubuisson. Vous,
les soldats, vous allez gentiment retourner dans vos cantonnements, et vous,
patron, on vous le passera pour cette fois. Mais si vous récidivez, on vous
apprendra ce qu'il en coûte de servir de l'alcool à des militaires, à deux
heures du matin. Allons, ouste, vous autres, videz les lieux ! Les soldats sortent en grognant, tandis
que le patron essuie le sang qui lui coule des narines. – Allons, bonsoir, et qu'on ne vous y
reprenne plus. Dehors il fait un beau clair de lune. Le
sommet des dunes émerge dans la pâle clarté de l'astre de la nuit. Les vagues
de la mer chantent doucement leur éternelle chanson. Au front, les canons
tonnent et les mitrailleuses crépitent. – Il a été sonné le patron ! – Oui : mais qu'il ne se plaigne pas :
ce sont les risques d'un métier où il gagne une fortune. Cela vaut bien une
série de coups de poing sur la figure ! – Oui C'est le filon d'être commerçant à
l’arrière ! La guerre a du bon pour les gens du pays. – Bien sûr. C'est bizarre quand même
qu'il y ait des gens à qui la guerre profite ! Quelle heure est-il ? – Presque trois heures. – Nous sommes de service jusque quatre ;
mais comme les lieux paraissent vidés : si on allait se coucher ? – Et si le lieutenant Lebrun vient au
contrôle ? – Il a contrôlé les patrouilles d'avant
minuit ; il dort donc ; pas de risque : rentrons. – Oui, rentrons. Nous sommes donc à La Panne, où nous
sommes arrivés en février 1915. Nous voilà en juin 1916. Depuis seize mois nous
formons le détachement à cheval dit du « Front de Mer ». Notre service consiste à maintenir l'ordre
à La Panne, à faire des patrouilles
de jour et de nuit jusque Oostdunkerke et à fournir
des cavaliers pour monter de garde autour du secteur réservé à la Famille
Royale. Ville d'eau en temps de paix, La Panne
est devenue ville de garnison en temps de guerre. C'est ici que toutes les
divisions d'armée viennent, à tour ,de rôle, prendre leur grand repos, qui dure
généralement un mois. C'est ici aussi, que j'ai revu presque tous les soldats
de mon village et la plupart de mes amis de régiment. Ensemble nous passons
parfois des soirées animées. – Mon vieux, les gendarmes sont de sales
types, me sert un jour Lefrançois, alors que nous sommes rassemblés dans le
grenier, au-dessus de l'écurie où je suis cantonné. – Ce sont de sales types ? Pourquoi ? – Ils ont ramassé des camarades qui
trayaient les vaches d'un fermier d'Ave Capelle. Moi aussi, je trais les
vaches, et il n'y a pas un gendarme au monde capable de m'en empêcher. Avant de
commencer, je mets des copains en sentinelle avec le fusil chargé, et le
premier Piottes-pakers[2]
qui montre sa tête, on le fout en l'air. Aussi vrai que je te le dis. – Et si c'était moi ? – Toi comme un autre. Mais tu es verni,
on te manquerait. St-Pierre ne veut pas de pareils à toi au paradis ! – Non, il n'y a que les fantassins qui y
vont. – Tu dis vrai en blaguant. Il n'y a, en
effet, que les fantassins qui se font tuer ! – A eux la gloire ! – Je m'en fous de ta gloire. Vous
autres, tas d'embusqués, vous vous rincez le gosier pendant que les piottes
encaissent les crachats des crapouillots ! –
On nous réserve pour repeupler, après la guerre ! – C'est ça ! On va repeupler la Belgique
de jeunes Piottes-pakers. Ça sera beau ; ça
sera beau ! Bande d'embusqués, va ! – Tiens, avale ce verre de vin, tu auras
plus facile pour gueuler... – Merci ; à ta santé et à celle des
autres. – A la santé de la gendarmerie. – Ah ! non alors ! Je ne bois pas, – Bois quand même, dit Scion.
Dépêche-toi, j'ai soif moi. Lefrançois est un ancien, il est au 12ème
de ligne depuis le premier jour de la guerre. C'est un soldat d'élite, un peu
maraudeur, mais tenace au feu. Les autres sont des volontaires de Guerre, venus
en 1915, par la Hollande. Comme anciens il y a aussi François Croisier et
Joseph Sparmont, mes meilleurs amis du régiment. Croisier
est un soldat très calme ; ordinairement, il écoute les autres et se contente
de tirer de longues bouffées de la pipe qu'il a toujours aux dents. Sparmont, lui, est marié et père d'un petit garçon. Cela change
la mentalité d'un soldat d'être père de famille. Pour lui, le fait de remonter
en ligne est un évènement plus grave que pour les autres. – Si je me fais zigouiller, je laisse
une veuve et un orphelin, dit-il souvent. – Il n'est pas fameux, le vin, remarque
Lefrançois, en tendant le verre vide à Scion. – Tu préfères l'eau salée du boyau de la
mort, peut-être ? – Ne me parle pas du boyau de la mort,
tu ne sais seulement pas où il est ! – Explique-le moi. – Je n'en ai garde. Après la guerre, tu
serais capable d'aller en parler au village, comme si tu l'avais connu ! – Ne nous disputons pas, intervient
Scion ; chacun fait ce qu'on lui commande. On ne choisit pas son rôle à la
guerre. – Oui, grogne Lefrançois : tout le monde
est utile à l'armée, sauf les gendarmes. Quand je pense qu'ils ont fait pincer
de pauvres types pour avoir trait des vaches ! Qu'on dise : ce qu'on veut, il faut
être chameau. – Avec tout ça, la guerre ne finit pas
trouve Bochmer. – Tu ne voudrais pas rigole, Xhaard : on commence seulement à s'y faire ! Il n'y a pas
encore deux ans qu'on se bat. – Ne viens pas encore avec tes bêtises,
hein toi, dit Sparmont. – Deux ans sans voir sa femme et son
gosse, c'est bien assez. – Ce sera bientôt fini. Le bruit court
que les Français ont avancé de cinquante centimètres ! – Vous blaguez, dit Croisier ; mais, ce
qu'il y a de sûr c'est que tant qu'on ne s'y prendra pas autrement, on
n'enfoncera pas les lignes al1emandes et nous piétinerons ici des années. Nous dressons l'oreille. Croisier a,
parmi nous, la réputation de voir clair dans les opérations militaires. Quand
il explique le pourquoi d'une victoire ou d'une défaite, c'est avec un bon sens
et une clarté de vue extraordinaires. – Que veux-tu dire François ? demandons-nous. – Voici : Vous avez lu les journaux
comme moi et avez compris que toutes les offensives, n'ont abouti qu'à un échec
complet. Elles y aboutiront toutes ; on ne peut pas enfoncer les lignes en les attaquant
carrément. Elles sont élastiques ; elles avancent et reculent selon la force
qui les pousse, mais ,elles ne rompent pas. – Mais on ne peut quand même pas sauter
par dessus, dit Lefrançois ! Comment ferais-tu, toi, Croisier, si tu étais général
en chef ? – J'attendrais d'être assez fort ! Puis,
je me laisserais enfoncer sur une certaine longueur du front. – Cette fois, tu déraisonnes, François.
Les Français, les Anglais et les Allemands font tuer des milliers d'hommes tous
les dix mois en essayant de faire le contraire ! – Je sais, répond Croisier : mais ça,
c'est de la bêtises. Moi, je prétends que l'armée qui enfoncera l'autre, sera
battue, elle se coincera et se fera attaquer sur ses flancs. Alors ce sera la débâcle.
Ce n'est pas encore aujourd'hui que nous verrons cela. Je vous rassure ; les
alliés ne sont pas encore assez forts pour se laisser enfoncer ; mais, cela
viendra. Du moins, c'est mon idée. Nous ne comprenons pas très bien la
stratégie de Croisier et je parle d'autre chose : – Personne n'a reçu des nouvelles du
pays ? – Si, répond Scion, j'ai reçu une lettre
de mon père, venue par la Hollande. – Que raconte-t-elle ta lettre? – Tout va bien chez nous. – Ton père ne dit pas s'il a de quoi
manger ? – Non ; ils n'en ont guère probablement.
Quand nous avons quitté, en 1915, plusieurs familles étaient déjà au régime des
fourragères. – Des fourragères ? – Des betteraves, quoi. – Nous ne les retrouverons certainement
pas grossis ! – Bon Dieu non ! A propos, Henri Gillard a voulu venir à La Panne pour te voir. – Il ne m'a pas trouvé ? – Il n'a pu venir jusqu'ici, les
gendarmes lui ont fait faire demi-tour, au Moeder Lambic. – Quand je vous dis que les gendarmes
sont des chameaux, hurle Lefrançois. Ils ne sont bons que pour embêter les
soldats. Qu'on leur fasse arrêter les espions ; le ,front en est plein ! Nous
en avons encore arrêté deux à Wulpen et il paraît qu'on
fait des signaux, au moment des relèves à Oostkerke.
L'artillerie allemande en profite pour taper dur et juste. Mais voilà, Oostkerke c'est près des lignes et les gendarmes n'y vont
pas. – Mais si, mon vieux, il y a un poste à Oostkerke. –
C'est un poste dans un abri alors on ne les voit pas. – Allons, Lefrançois, parle d'autre
chose, tu en veux absolument aux gendarmes, aujourd'hui ! – Je répète que ce sont des chameaux. – Va pour chameaux, mais parle d'autre
chose. – Oui, Maurice, par égard pour toi. – Merci. – Nous montons demain en lignes, dit
Scion. – Dans quel secteur ? – Pervyse, château de Vicagne. – Ça tape là-bas ? – Pas trop ; mais nous y avons de sales
petits postes près du château, on y est entre ciel et eau, en pleine
inondation, avec quelques sacs de terre autour de soi. Quand les Allemand nous repèrent,
ils ont vite fait d'envoyer les sacs de terre et les bonhommes en l'air. – Ce n'est pas le rêve, quoi ? – Bon Dieu, non ! – Paraît que les Allemands ont des
costumes pour voyager sous l'eau, raconte Bochmer. – Comme des sous-marins ? – On le dit. – Zut alors ! on ne les verra plus venir
! – Les deux bouteilles de vin sont vides.
Si on mettait pour un litre de cognac. – Combien coûte un litre de cognac ? – Cinq francs. – A combien sommes-nous ? – Un, deux, trois ; nous sommes sept.
Mettez chacun cinquante centimes, je ferai le reste. – C'est que, dit Scion, j'ai acheté pour
remonter aux tranchées six paquets de cigarettes à vingt cinq centimes et ai mangé
des pâtés pour soixante. Ma solde de la semaine est au diable ! – Je mettrai pour toi. Allons, Bochmer, va chercher cela : tu es le plus jeune : sers les
anciens. Tiens, voilà cent sous : dépêche-toi. Bochmer
descend l'échelle en criant sur les chevaux qui sont en-dessous de nous : « oe ... oe ... » – Pourquoi sommes-nous à la guerre ?
demande Lefrançois, qui décidément à l'humeur tracassière aujourd'hui. Pourquoi
se fait-on zigouiller ? – C’est pour la Patrie, répond Scion,
dans un éclat de rire. – Fous-nous la paix avec ta Patrie :
c'est les journalistes qui racontent ça ! Des chameaux, les journalistes ! Ils
nous bourrent le crâne. A les entendre c'est toujours nous les plus forts, ils ont
menti ! Si on était les plus forts on avancerait ! A mon avis, on devrait
fusiller tous les journalistes ; ce sont des imbéciles. – Que tu es féroce, aujourd'hui. – Oui, nom de Dieu ! le sergent m'a fait
aller à l'exercice malgré moi ce matin. Je démolirais le bazar quand c'est
comme ça ! A quoi cela sert-il de faire faire l'exercice à un ancien comme moi
? En décomposant : une, deusse, troisse.
Mais, bon Dieu je l'ai fait des mille et mille fois, une, deusse,
troisse. Et puis, pourquoi se ferait-on zigouiller ? – Est-ce que tu te marieras un jour ? – Pourquoi, demandes-tu cela? – Réponds toujours. – Oui, si on ne m'enterre pas dans les
boues de l'Yser. – Tu auras des gosses ? – Oui, des fils. – Et bien, si tu risques de te faire zigouiller
maintenant, c'est pour que, plus tard, les Allemands ne mettent pas un casque à
pointe sur la tête à tes fils et ne les fassent pas marcher au pas de l'oie, eine, sweie, dreie
: eeie, sweie, dreie. – Je ne discute plus avec toi, tu me
ferais redevenir patriote. Je l’ai peut-être été, mais je ne le serai plus. – Sauf, quand les Allemands attaqueront. – Quand les Allemands attaqueront, je
défendrai ma peau. Bougre d'idiot ; le patriotisme n'a rien à voir la dedans. – C'est comme tu veux l'entendre. Voilà Bochmer. Allons, dépêche-toi, bleu pilou. – Les chevaux me regardent, crie Bochmer. – Cela ne fait rien, crie dessus. – Oe ... oe... oe .... En place repos, les
chevaux ; en place repos ! Les chevaux de gendarmes ne m'inspirent aucune confiance,
dit Bochmer en émergeant du trou de l'échelle. Voilà
le Hue. « Piottes~pakers
! Piottes pakers ! » L'insulte, criée, à tue-tête,
par une voix cachée, nous fait tourner la tête. Dans le sable des dunes, nos chevaux
piétinent, car pour eux notre énervement se traduit par de légers coups
d'éperons dans leurs flancs. «
Piottes-pakers ! Piottes-pakers
! » Je me sens pâlir de colère. Sans doute, ce n'est pas la première fois que
j'entends ce cri qui a le don de m'énerver aujourd'hui. A plus de cent reprises
différentes les soldats me l' ont jeté à
la face sans que cela m'ait fait la moindre impression. Mais cette fois,
c'est une voix cachée qui nous la hurle : une voix menaçante. – J'enrage, dit Collard,
avec qui je suis en patrouille. – Moi, aussi. – Si on essayait de trouver celui qui
crie ? –
Non ; il est, sans
doute, caché dans une villa. Il est plus sage à nous, de ne faire semblant de rien.
Continuons vers Coxyde. Nous continuons et le cri nous suit : « Piottes-pakers ! Piottes-pakers !
Petit à petit, la voix se fait plus lointaine
; puis, elle se tait. – Ne trouves-tu pas que les soldats nous
en veulent ces moments-ci, demande Collard. – Bien sûr que si. Avant-hier, nous
avons failli avoir du vilain. Des chasseurs à pieds ont voulu arracher un déserteur
des mains de Cowez et de Fonck, et il a fallu la
moitié du peloton pour dégager nos deux collègues. – Je me demande à quoi tient cet état
d'esprit des soldats. – Pas facile à comprendre, mais enfin,
nous sommes leur bête noire. Notre service ne consiste-t-il pas surtout à les
embêter ? Nous exécutons les ordres qu'on nous
donne : qu'en pouvons-nous ! Ce n'est pas nous, qui exigeons que les cafés
soient fermés à sept heures : ce n'est pas nous qui trouvons qu'une permission écrite
est nécessaire pour aller d'un cantonnement à un autre. Nous ne sommes que les
exécuteurs des ordres des états-majors qui, eux, s'en fichent. – Oui, et les choses se gâtent. Notre
collègue Champuvier a été tué à coups de couteau par
des soldats près de Leysel ; la situation
devient grave et nous, au lieu de rester calmes, nous nous énervons. – Calme ! calme ! grogne
Collard. Ce n'est pas facile de rester calme quand on
tue des camarades. Peut-être, va-t-on nous demander de maîtriser nos nerfs et
de nous laisser assassiner ! Mais, minute, hein ! * *
* Pendant les quatre heures, qu'a duré
notre patrouille, nous avons impitoyablement fait faire demi-tour aux soldats
non munis de permission, et c'est de mauvaise humeur que, le soir, nous mettons
pied à terre devant notre cantonnement, à La Panne. – Un chef s'approche de nous et, d'une
voie sourde, dit : – Bodson est
tué ! – Bodson est tué
? – Oui, et Suze, son collègue de service,
a la cuisse droite traversée par une balle de browning. – Où cela s'est-il passé ? – Dans les dunes, non loin de la villa
royale. – Qui a fait le coup ? – Un soldat qui, lui aussi, est tué. – Par qui ? – On ne sait. Bodson
a été frappé, d'une balle dans la tête, alors qu'il était à cheval au poste II.
Suze était au poste III ; il a entendu la détonation et s'est porté, au galop,
au secours de Bodson. Le soldat qui avait fait le
coup, s'est caché derrière un buisson, a laissé passer Suze, puis a tiré dessus.
Suze a eu la cuisse traversée, mais il a encore pu se retourner et riposter par
un coup de carabine. Seulement, on dit que ce n'est pas ce coup de carabine qui
a tué l'agresseur ; il s'est suicidé, parait-il. Suze, qui avait perdu beaucoup
de sang, n'a pu être longuement interrogé ; on l'a transporté à l'hôpital. – Et Bodson ? – Il est toujours là, où il a été tué, à
côté du soldat. On les a laissés, en attendant que toutes les constatations
soient faites. En silence, nous rentrons et
déharnachons nos chevaux. J'ai le cœur gros, à éclater. Malgré mes efforts, des
larmes me montent aux yeux. Bodson était un bon
garçon ; jamais il n'a fait, inutilement, de peine à un soldat. Et puis, voilà
presque deux ans qu'on vivait ensemble ; à force de se coudoyer, on devient
frères à la guerre. Bodson m'a 'souvent parlé de ses
parents. « Ce sont deux bons vieux disait-il ». – Allons nous voir Bodson
? demande Collard, d'un ton bourru. – Je ne sais pas. Je crois qu'il vaut
mieux ne pas y aller. Nous avons encore bien du service à faire parmi les soldats,
d'ici la fin de la guerre, et ne crois-tu pas... – Tu as raison, coupe Collard, nous ne devons pas voir le cadavre de Bodson. * *
* Voilà huit jours que Bodson
est enterré. Les soldats sont plus calmes, le souffle d'émeute qui, un moment, a
passé sur La Panne, paraît éteint ; et notre énervement de ces jours de fièvre
a disparu. – Trois soldats sont venus te demander,
me dit le garde d'écurie, en me voyant rentrer de patrouille. – Où sont-ils ? – Je ne sais. Il n'y a pas dix minutes
qu'ils sont partis. Tiens, les voici. – En effet, les voici. C'est Lefrançois,
Scion et Collin qui, lui aussi, est un soldat de mon
village. – Tu vis encore, crie Lefrançois en
m'apercevant. – Sans doute ; je n'ai aucune envie de
mourir. – Figure-toi, qu'au front le bruit a
couru que les soldats avaient supprimé tous les gendarmes de La Panne. Alors on
a demandé une permission pour venir s'assurer. On avait peur pour toi. – On a beaucoup exagéré les choses. – Oui, nous l’avons vu ; il ya encore
tellement de gendarmes qu'on trébuche dessus. Il n'y a rien de changé ! – Sauf que Bodson
est tué et enterré. – On nous l'a dit. C'est bête comme
chou. Nous connaissions Bodson : si tous les
gendarmes avaient été comme lui, on aurait pu s'entendre. Et puis, tuer,
vois-tu Maurice, c'est le dernier de tout. On peut s'engueuler, se battre même,
cela n'est rien. Mais tuer ! Faut-il être bête ! faut-il être bête ! Qui a fait
le coup ? – Un soldat déserteur, un tatoué. – Ce n'est pas étonnant ; ces cocos là
ont peur de leur peau ; mais ils n'hésitent pas à trouer celle des autres. Mais oui, il faut bien le dire, nous
sommes criblés de poux. Ah ! les sales bêtes ! – Regarde, quel gros, me dit un jour
Dubuisson qui en tient un entre le pouce et l'index – Analysons-le. – Oui, c'est une idée ; tu as une loupe
je crois ? – Oui ; mets-le, là, sur la planche. Dubuisson se gratte. – Les autres recommencent dit-il. – Tu as éveillé les miens ; Oh la la ! – Allons, voyons celui-ci. – Qu'il est gros l'imbécile ! – Naturellement ; la loupe le grossit. Regarde,
c'est un mâle. – Oui, il est gris et de forme ovale. – Waïe ! j’en
ai un entre les doigts de pied. – Il te chatouille ? – Je te crois. – D'où viennent-ils donc ces salauds ? – On dit qu'ils sont venus avec la paille
d’Amérique. – Au diable soit la paille. – J'ai une idée. – Laquelle ! – Attends ; je vais m'en prendre un.
Nous allons leur faire faire la course. – Comment cela ? – Nous allons, tracer un cercle à la
craie, sur la planche ; nous mettrons chacun notre pou au milieu et le premier
qui sortira du cercle sera le gagnant. Voilà ; j'en ai un, dis-je en mettant le
doigt sur quelque chose qui se promène, dans ma nuque. – Oui ; un instant, demande Dubuisson,
le mien est malade ; je lui ai serré la tête ; il faut que j'en attrape un
entre. Tiens, j'en ai déjà un. – Allons, voici le point qui marque le
centre du cercle. Lâchons-les. Attends ; je vais mettre une tâche d'encre sur
le mien pour le reconnaître. Allons-y. Je parie dix francs que le mien dépasse la
ligne le premier. – Ça va, argent sur table. – Voilà, Délicatement, nous posons
chacun notre pou au centre du cercle. Ils y restent quelques secondes puis se
mettent en marche. Celui de Dubuisson tourne sans s'écarter du centre, tandis
que le mien marche à peu près en ligne droite. Je vais gagner. – Imbécile ! crie Dubuisson à son Pou. Qu'as-tu
à tourner ainsi sur place ? Le mien arrive à la ligne, mais ne la
dépasse pas. Il s'arrête, puis fait demi-tour. La course va être passionnante. – Voilà le mien qui démarre, exulte
Dubuisson. – Oui, et le mien perd le Nord ! Ah !
l'animal ! Celui de Dubuisson marche en zigzag vers
la ligne et la dépasse. Le mien est revenu au centre. Dubuisson à gagné. C'est une bonne race que
j'ai, dit Dubuisson en me rabotant mes dix francs. Je ne veux pas la perdre, et
relevant sa chemise, il remet son pou sur le ventre. Flâner dans La Panne est un plaisir.
Tout le long de l'Avenue de la Mer jusque sur la route de Furnes, c'est un va
et vient continuel de militaires : soldats au repos qui reboutonnent vivement
leur veste en voyant arriver un officier supérieur ; officiers subalternes qui
font de l’œil aux misses de la Croix-Rouge : gendarmes à pied en patrouille qui
traînent nonchalamment leur flemme le long des trottoirs. Parfois, un embusqué,
qui se distingue des autres par sa tenue clinquante et son visage poudré. C'est en regardant s'agiter tout ce
monde que je viens visiter, par une après-midi, un soldat de mon village
cantonné dans un magasin à fourrages. Du premier coup d'œil, je l'aperçois. Il
est occupé à manipuler des bottes de paille, pressées à la machine et entourées
de fils de fer. –
Tiens, qui voilà ! Voilà Mathieu ! – Tu es là, toi, répond-il. – Oui, comment vas-tu ? – Pas mal. Puisque tu es venu que les
bottes de paille aillent au diable ; le chef n'est quand même pas ici. Alors,
rien de nouveau ? – Non. Et toi ? – Une lettre de ma marraine de guerre ;
nous allons lui répondre. – Je n'ai pas mes bouquins d'anglais. – On fera comme on pourra. Viens dans
mes appartements. Les appartements de Mathieu consistent
en une petite cagna de trois mètres sur deux qu'il s'est construite à raide de
quelques perches et de bottes de paille. A l'intérieur, il y a un lit, fait de
gites en sapin et de fils de fer ; une caisse en guise de table et les quelques
menus objets indispensables à un soldat. – Assieds-toi sur le plumard dit
Mathieu. Veux-tu une cigarette anglaise ? – Bien sûr, que j'en veux une. – Tiens ; c'est une Gold-Flac : elle
vient de ma marraine. – Elle est gentille ta marraine ? – Un ange mon vieux. – Tu la marieras ; je vois cela. – Je ne dis pas non. Tiens, lis sa
lettre. – Oui mais, tu sais qu'il y a des mots
qui m'échappent ; je ne comprends pas tout. – Si va, tu comprends bien. Lis. Cahin-cahin, je traduis la lettre à Mathieu dont les yeux
brillent de plaisir. – Nous allons répondre, dit-il. – Ah ! mais mon vieux, ceci est une autre
histoire. Je n'ai pas mes bouquins d'anglais, et, si, je le traduis à peu près,
je ne sais pas l'écrire. C'est beaucoup plus difficile. – C'est des contes tout ça, répond
Mathieu. Tiens, voilà une page et un crayon. Fais le brouillon. Commence : Ma
chère Marraine. My dear Marraine. – Ah ! Ah ! Tu vois que tu sais. – Je sais cela quand même. Mais toi,
Mathieu, qui es resté plusieurs mois en Angleterre pour ta blessure, tu connais
l'Anglais beaucoup mieux que moi. – Des bêtises que tu racontes. Je sais
baragouiner quelques mots, c'est tout. Continue : My dear Marraine. « J’ai reçu votre gentille lettre ». – Oui mais, mon vieux, tu compliques les
choses. – Mais non, mais non. Ecris : I have. – Comment est-ce qu'on dit « reçu » en
anglais ? – Je n'en sais rien, mets : « reçu »
c'est la même chose ; elle comprendra quand même. I have reçu your. – Et « gentill
» comment est-ce ? – Je ne sais pas encore. – Bon Dieu ! tu ne connais rien... – Ni toi non plus, bon sang ! – Allons ne nous fâchons pas. Comment
vas-tu mettre, Maurice ? – N'est-ce pas la même chose de mettre «
votre belle lettre » ? – Si ; c'est ça ; mets : « votre belle lettre » y have reçu
your beautiful letter, – Ça va ! ça va ! exulte Mathieu.
Continuons : « Je vais très bien » – Ceci
c'est facile : I am
very well. – Ah non ! tu te trompes Maurice. Tu dis
« je suis très bien ». Ce n'est pas la même chose. Je veux dire que je ne
suis pas malade. – Et bien, voilà : « I am not ill. » – C'est ça, c'est ça. Maintenant écris «
je t'aime » – C'est comme la chanson : 1 love you. – Oui, mais, tu écris « je vous aime »
et depuis le temps qu'on se connaît, on peut bien se tutoyer. Avec ma marraine, écris
: « Je t'aime ». – En anglais, mon vieux, on n'emploie «
Tu » que dans les prières ou dans les Invocations à Dieu. Mathieu me regarde avec des yeux
immenses. Il n'en revient pas de m'avoir entendu énoncer cette règle que, par
hasard, je sais par cœur. – Que tu es instruit, dit-il ! – Oui, mais, je te prie de ne plus
m'interrompre, parce que je pourrais bien ne plus rien faire de bon. Où en sommes-nous ? I am not ill, I love you, répond Mathieu en imitant, l'accent anglais. Bon ; après, que veux-tu mettre ? Que ma marraine est plus belle que les
filles de ce pays-ci. – Ah ! voyons : You are very more beautiful that
the girls of this country. – Très bien Maurice, ça va comme sur des
roulettes. Voyons : Dis-.lui : « merci » pour ses bonnes cigarettes » Tank-you for your good cigarettes. – Mais, ça va tout seul, mon vieux. – Oui, mais essaie d'en finir ; je transpire
: je suis à bout de mon savoir. – Tu as raison, il vaut mieux être bref
que de dire des bêtises. Seulement, dis-lui encore : « j'aurai un congé pour
l'Angleterre le mois prochain ». I shell have a permission
for the England the first
mount. Good bye, my dear Marraine. Your filleul Mathieu Phillipin – Tu es un as Maurice. Tiens, voilà un
paquet de Gold-Flac. – Merci, Mathieu. – « Nous partons », crie un jour Collard en montant l'échelle. – Nous partons ? – Oui, toi et moi. Nous passons à
l'escadron divisionnaire de la quatrième division d'armée. – Tiens ! Paraît qu'on y est pas trop
mal, – Non ; on le dit. Nous allons aller
refaire connaissance avec les obus. – J'aime autant cela que les bombes
d'avions. – Vaut mieux les obus. Seulement, ici,
on a cinq ou six bombes tous les deux mois, tandis que là-bas nous aurons des
obus deux ou trois fois par semaine. Enfin, on a vu pire que cela à la bataille
de l'Yser en 1914. – Quand partons-nous ? – Aujourd'hui ; nous devons nous
préparer tout de suite. – Ah ! Bon Dieu ! j’en ai un de fourbi ! – Le contraire serait étonnant de ta
part. Faut être propre, Maurice, pour te présenter au départ et à l'arrivée. – Propre ! propre ! C'est facile à dire
; mais tout mon fourbi est rouillé. – Naturellement. Il n'est jamais
autrement ton fourbi ! Il n'y a pas encore deux mois que nous avons trinqué, à
six, de huit jours d'arrêt par ta faute. – Par ma faute ? Mais oui, par ta faute ! Le commandant Guèvers, qui passait inspection du cantonnement, est venu
tomber en arrêt devant ta bride, qui était rouge comme une ferraille. Alors, le
commandant a retroussé son nez et a inspecté minutieusement toutes les brides.
Résultat : huit jours d'arrêt à six gendarmes, toi y compris, naturellement.
Mais, le plus bisquant de l'affaire, c'est que, moi j’ai trinqué pour une
petite tâche de rien du tout. – Tu ne les as pas digérés tes huit
jours, hein, beau Collard ? – Penses-tu ! Mais, dépêche-toi ; attends,
je vais astiquer ton harnachement ; nettoie tes armes. – C'est cela. Ton fourbi est propre, toi
? – Je suis toujours propre moi, mon
vieux. – C'est vrai. Allons, à
l'ouvrage ! * * * Le nettoyage a duré toute la matinée.
Enfin, nous sommes présentables ; c'est, du moins, ce qu'a trouvé le lieutenant
Lebrun qui vient de nous inspecter. – Vous viendrez à mon bureau à deux
heures a-t-il ajouté. A deux heures précises, nous frappons à
la porte du bureau. – Entrez, crie le lieutenant. Côte à côte, nous allons nous caller en
position, au milieu de la pièce. Lebrun nous regarde de la tête aux
pieds, remue quelques paperasses, puis, de sa grosse voix et en martelant ses
mots, dit : –
Vous passez à l'escadron divisionnaire de la quatrième division d’armée. Je
plains les chefs qui vont vous avoir sous leurs ordres. Après une pause, il ajoute : – Vous êtes deux têtes brûlées ; vous
n'avez rien fait de bon à La Panne. –
Nous avons maintenu l'ordre, mon lieutenant, risque Collard. – Vous avez de l'aplomb Collard, répond le lieutenant, c'est votre seule qualité.
En fait de maintien d'ordre, vous vous
êtes enivrés, tous les deux, jusqu'à deux fois par jour ; vous vous êtes battus
en ville, je ne sais combien de fois ; vous avez carotté des patrouilles : vous
êtes partis du cantonnement sans permission et vous avez tué les faisans de sa
Majesté le Roi en montant de faction dans le secteur réservé à la famille Royale.
En résumé, vous avez mérité de passer, cent fois, devant le conseil de guerre. – Mon lieutenant, nous… – Taisez-vous : vous voulez encore dire
une sottise. Aujourd'hui, vous partez : ce n'est pas dommage. Malgré cela, je
tiens à vous dire que je perds, en vous, deux gendarmes qui n'ont jamais reculé
devant les services dangereux ou difficiles. Je vous souhaite bonne chance à
l'escadron divisionnaire de la 4ème D.A., que vous aller rejoindre, aujourd'hui
à Wulpen. Rompez. Septembre 1916. On ne quitte pas un
peloton, dont on a fait partie pendant deux ans, sans un serrement de cœur. Collard et moi, nous avions la gorge un peu sèche et la
parole difficile quand nous avons fait nos adieux à nos camarades. Mais, nous
sommes ainsi faits. Ce que nous croyions ne jamais oublier, se dissipe bientôt comme
la fumée d'un obus sous l'action de la brise. – En route, nous faisons, ce que Collard appelle. notre examen de conscience. – Qu'en dis-tu des adieux du lieutenant
Lebrun, demande-t-il. – Ma foi, il nous a dit nos vérités – Oui, nous avons eu de la chance. Si on
nous avait pincés chaque fois que nous l’avions mérité ! – Oh la, la ! – Faudra être plus sérieux à la 4ème
D. A. – Oui ; bien sûr. – Nous allons avoir une conduite
exemplaire. – Sans doute. – Nous ne boirons plus. – Pour cela, non. – Nous éviterons les querelles. – Cela surtout. – Nous ferons notre service à la lettre. – Oui ; et tu verras que ce n'est pas
difficile. Enfin, c'est l’esprit animé des
meilleures intentions que nous arrivons au troisième peloton de l’escadron
divisionnaire. Après avoir casé nos chevaux, nous allons nous présenter au chef
de service. Il n'a pas l'air méchant, le chef de
service. – Vous venez de La Panne, dit-il. – Oui, chef. – Le service était dur là-bas ? – Pas trop, chef. – Beaucoup de service de nuit ? – Assez bien. – Ici, si vous êtes raisonnables, vous
aurez facile. A part les heures de faction aux postes de l’avant, il n'y a rien
de dangereux. Ce que je vous recommande le plus, c'est d'être très calmes dans vos
rapports avec les soldats. Il est inutile de faire des histoires pour des bêtises
; ces pauvres diables sont déjà assez malheureux. Vous pouvez disposer. Vous
trouverez à vous caser dans le baraquement. – Ça à l'air chic ici, remarque Collard. – Oui, le chef de service à l'air d'être
un brave homme. – Viens, nous irons dans le baraquement. – Oui ; attends, je vais chercher mon
manteau qui est roulé sur ma selle. – Je vais chercher deux places. – Oui, oui. En allant chercher mon manteau, je parle
avec le garde d'écurie. – Nous avons six postes à fournir, me
dit-il. Comme il faut trois hommes par poste, il y a donc dix-huit hommes de
service. Dans les six il y a trois postes insignifiants, mais en revanche il y
en a trois autres où on est, parfois, salué par l'artillerie allemande. Ce sont
ceux du pont du Pélican, près de
Nieuport, de la Grande Briqueterie et du Kolof-Brug, sur la route de Ramscapelle. En somme, on est assez tranquille.
Les soldats connaissent les gendarmes de
leur division et, jamais, nous n'avons de difficultés avec eux. Il n'y a que
les sans-floches[3]
qui nous donnent parfois du fil à
retordre et ceux de la prison prévôtale, où nous montons de faction quand la
division est en repos. Il y a un bon quart d'heure que j'ai
quitté Co1lard, quand j'entre dans le baraquement, il a déjà eu le temps d'aller
faire des siennes, sans doute, car le premier gendarme que je rencontre m'aborde d'une drôle de façon
: – Va nettoyer ça, dit-il, en me tendant
sa bride. Je le regarde, étonné. C'est un grand
bougre de six pieds de haut qui me toise d'un air dédaigneux. – Qu' as-tu à me regarder ainsi, comme
un idiot, dit-il. Allons, va nettoyer ça et, en même temps, il me prend par le
bras pour me faire marcher. – Non, mais ! Que te prend-il toi ? Ton domestique
est-il habillé comme moi ? – Voyez-vous ça ! Monsieur qui rouspète
! – Je fais ce qu'il me plait. Fous-moi la
paix. – Oh ! oh ! Regardez comme vous parlez, garçon ! – Je parle comme bon me semble. Ce n'est
pas toi, ni personne d'autre, qui êtes capables de me faire parler autrement
qu'à mon idée. – Tout doux, mon vieux, tout doux, ou
sinon ! – Ou sinon. Quoi ? – On va t'apprendre à te tenir. – Je suis ton homme, bon Dieu ! où et
quand tu voudras. – Vous aurez bientôt fini, vous deux,
crie un chef ! Vous, me dit-il, allez au bout du baraquement, votre place y
est. Et vous, dit-il à l'autre, allez nettoyer votre bride et taisez-vous. – Je rejoins Collard
et je jette violemment mon manteau à terre. – Ta réputation est faite, dit-il en
éclatant de rire. Pendant que tu es allé chercher ton manteau, j’ai raconté à
l'imbécile avec qui tu viens de te disputer, que tu étais un peu simple et
qu'on te faisait faire ce qu'on voulait. – Oui, en effet, ma
réputation est faite. * * * Brrr... Qu'il fait froid ! Le vent du
Nord chasse de légers nuages gris qui courent, haut, dans le ciel. La neige,
durcie par la gelée, couvre la plaine. Les toits des maisons, les prairies, le
canal en dessous de moi, le pont Kolof-Brug où je suis de garde, les dunes de Nieuport à gauche,
les ruines de Ramscapelle à droite, tout est blanc. Les canons se taisent. Pas même le bruit
d'un coup de fusil ne
fait vibrer l'air. Je
suis seul. Aucun être vivant n'anime le tableau désolant. C'est qu'il fait bien
froid. Oh ! oui, il fait froid. Malgré la pèlerine de mon manteau, retournée
sur ma tête, malgré la couverture enroulée autour de mon cou, je grelotte. La
bise, qui souffle de fa mer, gerce mes lèvres et transforme en cristaux de glace
l'humidité de mes moustaches. Pour m'abriter, j'ai une petite guérite
en planches. Il ne faut pas que j'y reste. Cinq minutes d'immobilité et ce
serait fini. Mes jambes se raidissent ; mes articulations me font mal. Je
marche : dans un mouvement de va et vient, j'arpente le pont de mes jambes engourdies. Dans l'angle formé par la route et le
canal surgissant d'un réseau de fils-de-fer barbelés, une croix noire se
dresse. Elle est noire, la croix, mais, dans le sens de ses deux bras, il y a
une inscription en lettres blanches : « Ici est enterré le soldat Chantraine ». De temps à autre, un tourbillon de
neige, fine comme du sable, se soulève de terre et s'engouffre dans mes yeux.
Ils doivent être bien rouges mes yeux ; ils me font mal ; mes paupières
s'engourdissent ; mon cerveau aussi. Je ne distingue plus les ruines de
Ramscapelle ni de Nieuport. Tout ce qui m'entoure se confond dans un même plan
: tout uni, tout blanc. Seule, la croix noire y met encore sa note d'une
tristesse infinie. Mais, qu’ai-je donc ? La pleine s'étend...
s'étend. L'horizon recule. Le ciel n'est plus gris : il est blanc, tout blanc,
comme la neige. Ce1a me fait mal tout ce blanc. Je regarde la croix, elle est toujours
là, noire avec ses lettres blanches : « Ici est enterré le soldat Chantraine ». Je la fixe, 1a croix, pour me reposer
les yeux. Mais, est-ce une hallucination ? Des planches noires. En un beau relief,
je vois se détacher un Christ. Il est blanc, comme la neige infinie qui m'entoure.
Il est blanc : mais de son front, des gouttes de sang vermeil jaillissent et
ruissellent sur sa figure. Il en jaillit aussi de ses mains, de ses pieds et de
la blessure qu'il a au cœur. Je le vois le Christ, et je lui parle : « Ecoute Christ : j'ai lu quelque part,
oui, Christ, j'ai lu que la guerre est un fléau que Dieu envoie sur la terre pour
punir les hommes de leurs crimes. Je ne veux pas croire à cela Christ ; je ne
veux pas. Ce n'est pas Toi, dont la bonté fut infinie, qui a voulu que le soldat
Chantraine meure à vingt ans ! Il n'avait pas commis
de crime, le soldat Chantraine. Dis-moi que je fais
bien, Christ, de ne pas croire à cela. Dis-moi que c'est l’orgueil ou la
rapacité de certains hommes qui lance les soldats les uns contre les autres.
Dis-moi cela, Christ, dis-le moi » Le Christ ne répond pas. Il disparaît.
Je revois la croix noire avec ses lettres blanches : Ici est enterré le soldat Chantraine. La quatrième division est au repos. Nous
sommes cantonnés à Ondschoote et dans les environs, Collard et moi, montons de garde à la prison prévôtale. Pour le moment, la prison prévôtale de
la 4ème D. A. c'est le grenier de l'hôtel de ville de Ondschoote. Il a belle allure l'hôtel de ville. C'est un
ancien bâtiment dont les escaliers monumentaux de l'intérieur sont garnis d'une
rampe de toute beauté. La charpente du toit est également remarquable. Elle est
tout en chêne, d'un chêne patiné qui rend la moindre planche agréable à l'œil.
C'est sous cette magnifique charpente que nous gardons les détenus. Ils forment deux groupes, les détenus ;
celui de gauche comprend les professionnels de la désertion.
Beaucoup de ceux-ci sont tatoués. L'un d'entre eux m'a montré son ventre ; de
grosses lettres d'un bleu verdâtre s'y étalent « Robinet d'amour, plaisir des
dames » dit l'inscription. Un autre m'a montré sa poitrine. Il y est écrit :
Enfant du mal, né pour le malheur ». Un troisième a un serpent dessinée en
spirale autour du corps ; la queue de l'animal part d'une des cuisses de
l'homme et la langue fourchue arrive à la naissance de la gorge. Pour tuer le
temps, je les écoute parler : – Je préfère aller à la prison d'Orléans
qu'à l'ile de Zézambe, émet l’un entre eux. Dans
l'île, le caoutchouc parle trop souvent ! – Tu as passé deux fois le conseil ?
demande un autre. – Oui, j'y vais pour la troisième fois ! – De quoi veut-on t'accuser ? – Désertion devant l'ennemi, comme les autres fois ; seulement, ce coup-ci, ils
prétendent que
j'ai participé à un vol à main armée ; mais je suis innocent. – Combien d'années as-tu fait ? – Vingt ans de travaux-forcés et vingt
ans de réclusion. Cette fois, je vais, trinquer pour vingt-cinq. Cela fera
soixante-cinq, au total. – Tu me dois le respect. j'en ai déjà
quatre-vingts. Je passe la sixième fois. J’ai encore déserté et j’ai fait l'amour avec une fille qu'ils
trouvent un peu jeune ! – Quel âge qu'elle a ? – Dix à douze ans, je crois. – Cela te vaudra encore vingt ans ! Tu
auras la centaine. Alleps en a cent vingt-cinq, lui. – Oui ; si c'était à l'armée française.
il y a longtemps qu'on nous aurait fait passer au tourniquet. A l'armée belge,
rien à craindre on ne fusille p1us et on est tout de même mieux en prison qu'aux
tranchées ! – Je te crois ! Le flic nous écoute
! Le flic, c'est moi. Les deux gaillards
se lèvent et, en arpentant la moitié du grenier de leur allure souple. Ils
fredonnent : A la prison prévôtale Où l'on est pas trop mal Exempt des balles. Collard est
près du groupe de droite où je vais le rejoindre. – Regarde, me dit-il, cette tête de
femme ! C'est Brisson qui l'a dessinée. – Elle est magnifique. Pourquoi es-tu
ici Brisson ? – Rentré trois jours en retard de
permission, maréchal-des-logis ! Qu'est-ce que je vais avoir pour ça ? Vingt-huit jours, c'est le tarif. – J'en ai déjà fait vingt en attendant
de passer conseil de guerre. – Alors, tu vas bientôt retourner à ta
compagnie. – Je l'espère. – Tu ne te plais pas ici ? – Non, maréchal-des-logis ; j'en ai
assez de coucher sous le même toit que des criminels. – Dans ce groupe, m'explique Collard, ce sont tous de bons soldats. Ils sont ici pour
des bêtises. L'un est rentré en retard : un autre a donné une gifle à un
corporal : des peccadilles, quoi. Ils ne veulent pas faire bande avec les
tatoués disent-ils. Mais, que font ces cocos-là ? – Attention ! nous chuchote un
soldat, plusieurs veulent s'évader. Ils complotent depuis plusieurs jours et
ils voient que vous n'êtes que deux pour le moment. Les
tatoués sont une bonne vingtaine. Rassemblés
dans leur coin, ils parlent à voix basse, et, sous leurs paupières à demi
baissées, passent des regards obliques. –
Attention, Collard, c'est aussi un tatoué qui a tué Bodson à La Panne. Faut voir à ne pas laisser notre peau
ici. Regarde, Alleps, va de l'un à l'autre en chuchotant
je ne sais quoi. – C'est celui qui a fait son service
avec toi au douzième ? – Oui, c'était un fameux voyou ! Et il n'a
pas changé ! Il profite de ce que j'ai servi avec lui pour m'appeler : « Mon
ami ». Attends, je vais lui en donner moi, des « mon ami. » ! z Face au mur, Alleps
! dis-je, en tirant mon pistolet de sa gaine. Les autres dispersez-vous ou je
tire dans le tas ! – Mon ami, répond Alleps,
en louvoyant le long du mur. – Face au mur ou je vous brûle la
cervelle. Alleps se
colle le nez au mur, pendant que les autres se dispersent avec des mouvements
de félins. – Ils sont matés, me dit Colllard : mais c'est égal : ce n'est pas prudent de ne
rester que deux pour garder ces fauves. – Gérard règlera cela, dis-je d'une voix
sonore. Le nom de Gérard fait passer un frisson
dans le groupe des tatoués. C'est qu'il le connaissent le maréchal-des-logis
Gérard ! c'est un hercule, sans pitié. Il s'est nommé lui-même : « Exécuteur
des hautes œuvres à la prison prévôtale » et ses coups de matraque font hurler
de douleur. – Il y a un transfert à faire à Roeninghe. Vous irez reconduire six soldats à la compagnie
de réhabilitation, me dit le chef de service. Mais, il nous faut encore un
autre. Voyons un peu... – Désignez Collard,
chef. – Je ne peux pas. Il rentre de
patrouille. – Attendez, chef, je vais le lui
demander, moi... Tu viens avec. Collard ? – Où ça ? – Reconduire six « sans-f1oche » à Roeninghe. – Je viens de rentrer de patrouille, moi,
mon vieux ! – Qu' est-ce que ça peut faire !
Nous irons à cheval. – Oui, c'est une promenade. – Où sont les soldats, chef ? – A la prison prévôtale. Voici les
papiers n'oubliez pas de les faire signer. – Non, chef... Collard !...
Je vais seller les chevaux pendant que tu achèves de manger. – Oui ; dans dix minutes, je suis à toi. – Pardon, chef, le directeur de la
prison est-il ici. – Mais oui, le chef Lavigne est dans la
cuisine. – Que me veut-on ? crie Lavigne. – Chef, voulez-vous ! bien faire
préparer les soldats qui doivent être transférés aujourd'hui ? Dans
un quart d'heure. nous serons là. – Mais oui, répond Lavigne. je vais
donner des ordres en conséquence. – Merci, chef. Un quart d'heure après, nous arrivons, Collard et moi, à cheval, sur la grand' place, en face de l'hôtel
de ville, où les soldats sont déjà réunis. – Rien de particulier ? demandons-nous aux
gendarmes qui les ont amenés. – Il y a deux mauvais bougres dans les
six, nous répond-on. – Lesquels ? – Ceux avec, le col bleu. Ils se sont
déjà évadés plusieurs fois et ne demandent qu'à recommencer il est
prudent de leur mettre les chaînes de sûreté. – Les chaînes ? Mais nous n' en avons
plus ! – Ah ça ! Tirez votre plan ! – Dites donc les gaillards, dit Collard en s'adressant aux soldats, on ne vous mettra pas les Chaînes
; inutile de vous humilier devant les soldats du front. Seulement, pas de
bêtises, hein ! Le premier qui fait mine de vouloir se sauver, on lui casse une
patte d'une balle de pistolet. Allons, en route. vous avez dix-huit kilomètres
à faire. Nous partons. Les deux soldats, qu'on
nous a désignés comme dangereux sont en tête. Leur allure est plus souple que
celle des autres : Ils marchent sans bruit, sur la pointe des pieds. – On les reconnaîtrait dans un régiment
ces cocos-là, remarque Collard. Le
long de la route des soldats qui flânent, nous regardent passer en échangeant
des réflexions : – Tiens ! des « sans-floches » ! – Oui ; ce sont des volontaires entre
deux gendarmes ! – On les conduit à la compagnie de
réhabilitation. – Ils ont l'air sévères les « piottes-pakers ». – Tais-toi : On ne peut plus le dire. – Quoi ? – « Piottes-pakers
». Nous avançons et les réflexions ne changent
guère. T'ous les soldats, que nous croisons et que nous
dépassons, s'arrêtent et discutent entre eux. Ils ne nous aiment pas ; nous le
savons. Ils aiment encore moins les « sans-floche » qu'ils se gardent bien
d'interpeller. C'est que les « sans-Floches » n'ont pas bonne renommée. Dans
les régiments, on les accuse d'une foule de méfaits : vols dans les boutiques
de l'arrière, assassinats de soldats partant en permission, compagnies entières
passant à l'ennemi. Autour d'eux, s'est créée une légende de vols et de sang
qui les fait presque craindre. De village en village, notre voyage
s'est déroulé monotone. Nous arrivons enfin au camp des « sans-floche », devant
lequel, baïonnette au canon, un soldat est de faction. Je lui demande : – Il y a un officier ici ? – Oui, voilà le lieutenant. –
Que voulez-vous ? demande le lieutenant. – Mon lieutenant, nous amenons, de la
prison prévôtale de la 4ème D. A., six soldats arrivés hier, par le
transfert de France. Nous avons des papiers à faire signer : à qui dois-je
m'adresser ? – A l’adjudant, au bureau, là, dans ce
baraquement. Pendant que je fais signer mes ,paperasses,
un sergent et deux soldats viennent chercher les « sans-floche » : puis : Collard parle avec le lieutenant.
– Nous en avons cent septante, dit l'officier, au moment où je reviens
près d'eux. Dans ce nombre il n'yen â pas beaucoup qui cherchent à se faire
réhabiliter. Demain, vous arrêterez peut-être, ceux que vous avez ramené
aujourd’hui. Quand ils auront mangé, dormi et changé de linge, s'ils le peuvent,
ils déserteront de nouveau. AUTOMNE 1917 Après avoir remonté deux mois en lignes,
dans les secteurs de Boesinghe, où notre peloton a eu des pertes en tués et blessés,
la 4ème D. A. a eu un long
repos qu'elle a passé en France, aux environs de Calais. Il a été tellement
long, le repos, que Gustave Herve : dans « La Victoire », demandait : « Peut-on dire que l’armée
belge a perdu sa quatrième division et qu’une bonne récompense est promise à
qui la retrouvera. » . Collard et
moi, sommes revenus de France, avec six mois de privation de faveur pour nous
être querellés et battus ; encore une fois. Maintenant, la 4ème D.A. le paie
cher, son repos. Elle remplace les Français qui viennent de quitter le secteur
de Merckem. Nous, les gendarmes, nous avons, dans ce
secteur, ce que nous appelons un sale poste. C'est le Pont de Steenstraat. Nous y avons la consigne de nous assurer de
l'identité des militaires qui nous paraissent suspects ; de faire éteindre les lumières
et de donner les renseignements et l’aide qu'on nous demande. Pour nous
faciliter la besogne, les Allemands bombardent le pont cinq ou six fois par
jour. C'est sur ce pont qu'aujourd’hui je suis de faction. Sur le pont en planches, que les
Français ont rétabli, je vais et je viens, pipe aux dents, carabine au dos. Ce
n'est pas que je sors très tranquille : deux fois déjà, par leurs sacrés obus,
les Allemands m'ont fait jeter à plat ventre sur le pont. Ici, la vie ne tient
qu'à un fil ; il suffit d'un rien, dans le pointage d'un canon, pour que : je
soie envoyé en morceaux dans le canal. Le voisinage de la mort me fait faire un
tas de réflexions. Je trouve la vie belle. Ces futilités, auxquelles j'attache
de l'importance en temps ordinaire, ne comptent même plus dans mon esprit. Devant
mes yeux, défilent des images : je revois la maison de mes parents, la solide
carrure de mon père, le sourire de ma mère. Les reverrai-je ? Puis, par une
saute de pensée, je me revois au manège, pendant mon instruction de gendarme ;
les cris du chef qui, alors, me paraissaient terribles, me semblent,
maintenant, puérils. Et puis, mourir ! C'est un étrange saut à faire !
Qu'y a t-il de l'autre côté ? Le néant ? Non, sans doute ; ce serait trop bête !
Allons, Maurice, chasse ces pensées : elles t'amollissent ! Regarde ce qui ce
passe autour de toi, pour le raconter un jour, si tu en échappes : et je
regarde... Le terrain, que les Français ont
littéralement bouleversé, avant de déclencher leur offensive, il y a un mois,
montre, à côté de tas de terre, gros comme des maisons, des trous larges,
remplis d'eau verdie par les gaz asphyxiants. Des fils de fer barbelés, des
pierres, des poutrelles, des fusils, des canons même, sont enchevêtres dans la
boue grasse et jaunâtre. Les anciens abris allemands sont, les uns, démolis :
les autres, penchés ou complètement retournés : le béton, disloqué par les obus,
laisse passer les barres d'acier qui le renforçaient. Aux abords du canal, tout
est bouleversé : ses rives sont déchiquetées : ventre en l'air, un cheval
encore harnaché, git, raide et gonf1é. Partout des ossements sont à fleur de terre
: des crânes, des mâchoires des tibias blanchis par l'eau et le soleil. Vers
l'Est, des arbres déchiquetés pointent, vers le ciel, leur silhouette
squelettique. Quelques pans de mur indiquent encore l’emplacement du village de
Merckem. Un peu plus loin, le long d'une ligne parallèle au canal et qui ne
finit pas, des paquets de fumée noire ou jaune naissent, se rejoignent se
confondent et tourbillonnent. Le sol vomit du feu, des paquets de boues, des
armes et des morceaux d'hommes. Et tout cela vibre dans le vacarme infernal de
la bataille. *
* * Quatre heures du matin. Sur le pont, je
reprends ma faction que deux autres ont montée successivement depuis huit
heures du soir. Autour de moi, quelques soldats affalés
sur le pont ronflent à poings fermés. Ils sont anéantis. Pour arriver en 1igne,
ils ont du partir par petits groupes et être munis de cordes. La nuit dans la boue
jusqu'aux genoux ; ils ont avancé parmi les trous d'obus. Parfois l'un d'entre
eux a glissé et est tombé dans un trou rempli d'eau ; à l’aide des cordes dont ils se munissent les autres l'en ont retiré. Après quatre jours passés
dans des postes enchevêtres parmi ceux des Allemands, ils ont dû, pour revenir,
refaire le même voyaqe qu'à l'aller. Ils dorment ces soldats, ils dorment
dans un anéantissement de tout leur être. Il faut pourtant que je les réveille.
D'un moment à l'autre, une dans le pointage d'un canon, pour que je sois déchiqueter.
Mais en voici un autre. – Cré nom de Dieu,
de nom de Dieu, de nom de Dieu ! sacre le soldat. en mettant le pied sur le pont.
Jamais plus, jamais plus, le ne retournerai dans cet enfer ! – Repose-toi un peu, dis-je, pour le
calmer. – Non, répond-il : si je me couche, j'y
resterai. Mais, cette voix ! je la reconnais ! – N'es-tu pas Renard ? dis-je. – Si répond-il, je suis Léon Renard. Nous sommes du même village. Renard est
un volontaire de guerre. Comme tant d'autres, il est venu, en 1915, par la
Hollande, croyant venir se battre au Soleil, au son, des clairons et de la
musique. – Ecoute, me dit-Il en tendant le bras
vers le champ de bataille ; tu es gendarme, mais, moi, je te le dis : Jamais
plus je ne retournerai dans cette boucherie. Renard est exalté : que puis-je faire pour
le calmer ? Lui parler de devoir ; de patriotisme ? Allons donc ! C'est facile
d'être patriote quand on a, comme moi, les pieds secs et le ventre plein. – Aide-moi, lui dis-je, nous allons
éveiller ceux-là. Il fait dangereux sur ce pont et nous ne pouvons quand même
pas laisser esquinter tes camarades. – Pour ça non, répond-il. Allons debout,
nom de Dieu ! crie-t-il en secouant un des dormeurs. J'en
fais autant ; mais qu'ils sont durs à éveiller ces bougres là. – Allons, debout nom de Dieu ! répète
Renard, en en soulevant un, qui se laisse retomber comme un sac. Enfin, nous y parvenons. Les soldats et
Renard partent, en titubant, vers l'arrière. Boum
! boum ! boum ! Une salve d'obus explose autour
de moi et fait sauter l'eau du canal. qui me retombe
en larges flaques, sur le dos. Boum ! boum ! boum ! Oh
là là ! dis-je, en m'aplatissant sur le pont. *
* * Six heures. Une lueur pâle éclaire
l'orient. Doucement, elle monte au-dessus du brouillard de la bataille. Par moments, je vois émerger, puis
disparaître des têtes au-dessus des tas de terre. Un groupe de soldats approche. Lentement,
ils viennent, paraissant traîner quelque chose de lourd, Les voici. Mais est-ce bien cela des
hommes ? Ramassés
en boule, ils paraissent rouler de trous d'obus en trous d'obus et toujours,
ils traînent ce
quelque chose de lourd en poussant des « han ! » dans l'effort. Les voilà sur le pont. – Un gazé, me dit l'un d'entre eux, en
soufflant comme un phoque. Le gazé est étendu sur le dos, brûlées
par le toxique, sa figure et ses mains, sous la couche de boue qui les recouvre,
paraissent rouges et gonflées. Ses yeux, presque recouverts par les paupières boursouflées,
sont brouillés par une matière sanguinolente. Les lèvres, gonf1ées et teintées d'une
mousse verdâtre, laissent passer une langue grosse et noirâtre. La respiration
est difficile. Atteints
par les gaz, les poumons de l'homme se dilatent et le suffoquent. Il ne crie
pas : les organes gonflés de sa gorge ne fonctionnent plus ; ses plaintes se
traduisent par un râle sourd qui me fait mal au cœur. Dans un geste, toujours répété, le
malade veut porter les mains à ses yeux ; ses camarades l’en empêchent. De
temps à autre, une convulsion agite son corps et fait faire une effrayante
grimace à sa figure. Depuis un moment, la main droite du
malheureux, au lieu de se porter vers les yeux, se dirige vers le côté gauche
de sa capote. Un soldat croit comprendre que le malade demande de lui passer
quelque chose. Plongeant la main dans la poche intérieure du vêtement, il en
retire un porte feuille et l'ouvre. A l'intérieur, il trouve quelques lettres
souillées et une photographie. Le portrait représente un homme et une femme
d'un âge avancé. Le père et la mère du moribond sans doute. Doucement, le soldat met l'image des
vieux dans la main du malheureux. Dans un geste suprême, celui-ci la porte à
ses lèvres où elle reste collée. Son camarade la retire ; des lambeaux de chair
y adhèrent. Déjà, sous l'action du poison, le portrait est brouillé et méconnaissable. Après
d'eux ou trois soubresauts, l'intoxiqué expire dans un râle atroce. *
* * Voilà quatre jours que j'ai été relevé
de faction au pont de Steenstraat. Je suis, maintenant,
de garde au carrefour de Roeninqhe. La nuit tombe : une
compagnie, qui s'en va vers l’avant, piétine la boue de la route. – A bientôt ! si je reviens ! me crie
une voix. – Tu reviendras, va ! bonne chance. Tête
basse, le front creusé par un pli volontaire, Léon Renard remonte en lignes. PRINTEMPS 1918 Tout en mettant fin aux hostilités entre
les deux pays, le traité de paix Russo-Allemand, a permis
à Ludendorff d'envoyer ses troupes, rendues disponibles, sur le front Ouest.
Déjà, sur plusieurs points du front anglais et français, ces troupes, habituées
à vaincre, ont enfoncé les lignes. Sur notre front, et particulièrement
dans le secteur de Roeninghe, tenu par la 4ème
D. A., un choc allemand s'annonce. Depuis quelques jours, dans ce secteur, la
situation est épouvantable. Tous les jours et toutes les nuits, 1'artil1erie et
l'aviation allemandes martèlent les cantonnements à coups d'obus et de bombes.
Le sommeil est devenu presque impossible. Partout, des projectiles éclatent, des
aviens emplissent l'air de leurs vrombissements et du crépitement de leurs
mitrailleuses. Dans la mesure de ses moyens, notre
artillerie répond. Sur la droite, l'artillerie formidable des Anglais salue
l'ennemi d'innombrables projectiles. *
* * « Les Allemands attaquent ! » La
nouvelle est criée par un cycliste qui traverse Woelveringhem
à toute allure. Tous, nous arrêtons, de brosser nos chevaux. « Le pansage est fini
! Apprêtez-vous, il est probable qu'on va partir vers l'avant » crie le
chef. « A cheval ! » commande le
lieutenant, qui revient nous ne savons d'où. « Prenez votre nécessaire, mais
rien de superflu : il ne faut pas surcharger vos montures ! » Nous partons vers
Elverdinghe. Il ne faut pas longtemps à un peloton de
gendarmes pour être prêt à partir. Un quart d'heure ne s'est pas écoulé depuis
la rentrée du lieutenant, que tous, nous sommes à cheval dans la cour de la
ferme où nous sommes cantonnés. Naturellement, Collard
et moi, sommes côte à côte. Quand on sent un danger, on se serre et, chacun de
nous, compte plus sur l'autre que sur soi-même. –
Mon avis qu'on va à un coup de chien, me dit Collard. – Probable. – Tu n as pas la frousse ? – Pas encore et toi ? – Moi non plus : mais cela viendra
peut-être. – Le danger n'est pas très grand : si
c'était pour combattre, on ne prendrait pas les chevaux. – C'est peut-être pour protéger la
retraite, si les nôtres reculent. – Penses-tu ? Que veux-tu que nous
protégions ? Nous sommes trente pelés et deux tondus ! – C'est vrai ! Mais, grogne Collard, on ne va pas nous faire recommencer l'histoire de
la bataille
de l'Yser, hein, sans doute ? Vois-tu qu'on nous mette derrière pour empêcher
les soldats de battre en retraite ! – Tais-toi, tu me fous la frousse ! Je
ne tiens pas à recommencer ce métier. – Ecoute quelle canonnade. – Nous n'irons pas loin avec nos
chevaux, là dedans. – Non ; regarde le mien, il pointe déjà
les oreilles. – Il sent venir l’orage. Bon Dieu !
Comme cela roule ! Jamais je n’ai entendu un bombardement pareil. – On dirait que toute l'artillerie du
monde s'est donné rendez-vous ici. Hé la ! Dans un ronflement de locomotive, un
obus de gros calibre passe au-dessus de nous. Nos chevaux piétinent. – Hé la ! biquard
! Tu vois, Collard, nos chevaux tremblent d'avance. – Il y a de quoi, mon vieux. « A gauche par deux... Marche ! »
commande le lieutenant. Dans un ordre parfait, le peloton
s'ébranle. – En avant la musique, plaisante Collard. – La ferme ! répond un autre. – Combien as-tu de cartouches, toi,
Maurice. poursuit Collard. – Complet. Cent et vingt de carabine ;
vingt et une de pistolet. Et toi ? – Il me manque quatre chargeurs de
carabine, mais j'ai deux paquets de réserve pour le pistolet. – Donne-moi un paquet, je te donnerai
deux chargeurs : nous serons égaux. – Tiens : donne. – Attends, voilà… – Mais, n'est-ce pas à Elverdinghe que nous allons ? – Paraît. – Mon vieux, apprêtons-nous à danser. Elverdinghe c'est tout près d'Ypres, à la limite du secteur
anglais. – Oui, c'est vrai. Nous ne reviendrons
pas tous. – Probablement : à moins qu'en auto de
la Croix-Rouge. Mais, si on parlait d'autre chose ? – Oui, parlons beaucoup : quand on ne
parle pas, on pense trop. – C'est vrai. Comme il passe des
motocyclistes ! – Oui, ils portent des plis à l'arrière.
Au grand quartier général, sans doute. Nous tournons à droite, par là grand' route
d'Ypres. « Au trot, marche ! » commande le lieutenant.
Dans un cliquetis de sabres et d'étriers, nous dépassons des fantassins, des
autos de la Croix-Rouge, des batterie d'artillerie, puis encore des fantassins. « Ça chauffe ! Nous crie des
hommes. Ça
chauffe ! bien sur ! Un, roulement de coups de canon ébranle l'air. Par douzaines,
les avions poursuivis par les nuages blancs des shrapnels vrombissent dans le ciel.
Quatre de nos ballons captif sont en l'air ; un cinquième, touché par une fusée
incendiaire d’un avion allemand, descend, en se tordant, dans les flammes. Plus
loin, ceux des allemand paraissent gros comme les ballons rouges qu'on achète aux
gosses aux fêtes des villages. Ra qua tac, tac tac...
Au dessus de nous, un de nos avions, est aux prises avec un Allemand. Mon cheval
devient nerveux ; trois fois déjà, il s' est dérobé comme pour faire demi-tour.
Un coup sec d'éperon l'a remis, chaque fois dans les rangs. « Pagnouf ! » dit Collard au sien
qui vient de buter et il lui relève la tête d'une brutale saccade des mors. C’est que nous aussi, nous sommes
nerveux ; du moins. moi le suis-je. J'ai l'impression que la fournaise du
champ de bataille avance vers nous. – On dirait que le combat vient par ici,
dis-je à Collard. –
Je le pensais. Il y a du louche du côté des Anglais ; des coups de canons
allemands partent d’en face, alors que le front est sur notre gauche. – Les Anglais reculent ! nous hurlent un
motocycliste. – Ta gueule, nom de Dieu ! répond Collard. Le lieutenant accélère le train ;
plusieurs chevaux doivent prendre le galop pour pouvoir suivre. Nous passons à
un carrefour un cheval butte et s'abat. « Un homme à terre ! » crie le chef. « Au galop ! marche ! » répond
le lieutenant. D'une pression des genoux, nous enlevons
nos montures, qui deviennent blanches d'écume. Toujours, le long de la route nous dépassons des troupes. Des fantassins,
que nous dérangeons nous tendent le poing en jurant comme des païens. Nous traversons Wousten,
Une rafale d'obus fait gémir le village. Comme des épis sous le souffle du
vent, les têtes s'inclinent sur les encolures. Les chevaux bondissent. « T'as de ramollis ! Tenez vos
chevaux nom de Dieu ! » crie le lieutenant. Notre
lieutenant est un grand diable de Flamand qui a l'air de n'avoir peur de rien.
Il s’appelle Dekeulaere. On le dit flamingant, mais,
cela c'est une histoire dont je ne veux pas parler… Dans tous les cas, c'est un
brave homme et s'il le fallait. Wallons et Flamands nous 1e suivrions au galop,
jusqu'en première ligne. Sans ralentir, il tourne à droite dans un champ crevé
de trous d'obus pour s'arrêter, enfin, dans la cour d'une ferme aux trois-quarts
démolie. « Pied à terre ! Mettez vos chevaux à
l'écurie ! Rassemblement, dans dix minutes, derrière la ferme »
commande-t-il. Nous mettons pied à terre et, dans un
concert de jurons et de disputes, nous casons nos chevaux dans une écurie trop
petite. Collard est
aux prises avec son voisin : – Mets ton cheval plus loin, dit-il, il
rue à l'écurie : il va casser les pattes du mien. – Mon cheval a autant de droit que le
tien, répond l'autre ; je ne vais quand même pas le laisser à la porte. Ta
bique n'a qu'à se défendre. –
S'il fait du mal au mien, je lui troue la panse ! As-tu compris ? riposte Collard. – Silence ! commande le chef. Bouchonnez
vos chevaux sans les desseller. Dans le piaffement des sabots, nous ramassons la
paille pourrie qui traîne encore à l'écurie et nous essuyons nos chevaux
ruisselants de sueur. « Rassemblement ! Evitez de passer au milieu
de la cour ; longez les murs et courbez-vous ; les Allemands ne doivent pas vous
voir. Au diable soit celui qui nous fait
occuper ceci en plein jour ! Derrière la ferme, sur deux rangs, le
peloton s'est rassemblé. « Garde à vous ! » commande le lieutenant.
Un claquement de talon mêlé à un cliquement d'éperons,
et le peloton se raidit comme à l'exercice. « La situation est grave, nous dit le
lieutenant. Les allemands attaquent en masse sur le front de la division. Depuis ce matin, les Anglais reculent. Le Quartier général de la
division compte sur l’escadron divisionnaire pour empêcher les soldats de
battre en retraite en deçà du Kemelbeek. Les deux
autres pelotons tiendront le centre et la gauche du secteur ; nous nous
aurons la droite à garder. Le chef de service va vous dire où sont les postes
que vous irez reconnaître tout de suite, pour pouvoir les occuper, la nuit, si
on vous en donne l’ordre. Défense formelle de dire aux soldats que les Anglais
reculent »
– Doit-on aller reconnaître les postes, à cheval ? demande un
homme.
– Non, vous n’y arriveriez pas. Rompez.
– Que ceux qui savent encore leur acte de contrition, le fasse, nous
souffle Collard.
– Il y a six postes à reconnaître, nous explique le chef. Ils sont tous,
le long du Kemelbeek. Le premier est à l’extrême
droite du secteur, tout contre les Anglais. Vous irez, vous, me dit-il ;
vous connaissez un peu d’anglais.
– Seul, chef ?
– Non, qu’un autre aille avec vous.
– Moi, propose Collard.
– Comme vous voudrez. Allez et faites attention ;
dépêchez-vous ; vous pouvez encore être revenus avant le soir.
Collard et moi, nous quittons le groupe.
– Nous finirons par crever ensemble, grogne Collard.
– C’est peut-être le moment. Mais dépêchons-nous.
– Par où allons-nous ?
– Nous allons essayer de rejoindre la grand’ route, près de la maison où
Dangiès a été tué l’année dernière.
– Ah ! Oui ! L’imbécile de Titeux,
qui était avec lui, avait trouvé bon de mettre ma culotte neuve pour aller au
poste ce jour là. Non seulement il se l’a fait trouer par des éclats d’obus,
mais il est encore parti à l’hôpital avec. Si bien, que je n’ai jamais revu ma
culotte.
– C’est du passé cela Collard. Pour le moment,
il s’agit de quitter la ferme sans être vu ; inutile d’attirer l’attention
dessus, sans quoi… Voilà un boyau sur notre droite ; enfilons-le…
En rasant le sol, nous atteignons le boyau qui est assez profond pour y
marcher debout, sans être vu.
– Allons Collard, dépêchons-nous.
– Ça manque d’horizon ici, répond-il. Quel zigzag, bon Dieu ! Hé
là ! nos pauvres biques ! Une salve d’obus passe au-dessus de nous.
Nous nous hissons hors de terre pour voir.
– Cent mètres plus loin que la ferme, dit Collard ;
ça doit-être des cent cinquante. En voici d’autres ; nous allons être
fixés.
Les obus passent en hurlant et vont exploser plus loin que les premiers.
– Ce n’est pas pour nos biques, Collard, ils
visent plus loin.
– Tant mieux.
– Allons, dépêche-toi. Si tu t'amuses à regarder où tombent les obus nous
ne serons pas là au soir.
– Tu sais où c'est ?
– A peu près. C'est dans les environs de Brielen,
presque à Ypres. J'y suis allé plusieurs fois en flânant, quand nous montions
de poste ici, l'année dernière. Il y fait chaud pour le moment ; écoute.
– Oui, cela t'apprendra à étudier l'anglais. Imbécile, tu vois à quoi
cela nous sert !
– Tu n'étais pas forcé d'y venir ; c'est toi qui l'as demandé.
– Faillait te laisser zigouiller tout seul, peut-être ?
– Dépêche-toi, voici la grand' route ! Couche toi ! nom de Dieu.
Nous nous aplatissons. Une volée de shrapnels éc1ate des éclats s'enfoncent
dans le sol, autour de nous.
– Au pas de course, hein ! Je connais un abri ici, un peu plus
loin. Si l'averse est trop forte, nous l'y laisserons passer.
– Au diable soient les éperons ! s'exclame Collard,
en piquant une tête au fond du fossé.
– Tu ne tomberas pas plus bas. Au pas, maintenant : nous sommes vernis,
mon vieux ils allongent leur tir ; les communications arrière vont trinquer. Devant nous, la route s'étend toute droite.
De temps à autre, des Anglais, que nous reconnaissons à leurs casques plats, la
traversent, s'emballant vers l'arrière.
– Tu vois, Maurice, les Ang1ais battent en retraite.
– On le dirait. Dommage qu'ils soient si loin ; je leur demanderais où
ils vont.
– En voilà deux, tiens : demande-leur. – Where do you go ?
– « Germans no bonne to-day
», répond un des deux hommes.
Et, tête basse, ils traversent la route, s'en allant vers l'arrière.
– Où vont-ils ? demande Collard.
– Ils décampent, mon vieux ; ils disent que les Allemands ne sont pas
bons, aujourd'hui.
– Cré nom de Dieu !
– Cré nom de Dieu ! bien sûr ! Si nos fantassins
se fourrent dans la tête d'en faire autant, nous seront balayés, comme des
fétus de paille. On pourra porter le deuil de l'escadron divisionnaire de la 4ème
D. A. Ensuite, l'armée belge sera tournée par sa droite et ramassée en entier.
Pour le moment, mon vieux Collard, les piottes de la
4ème D.A. tiennent le sort de tout le truc dans leurs mains.
– Ils tiendront, affirme Collard.
– Je le crois aussi, mais, écoute ce qu'ils prennent pour le moment.
Depuis que nous avons quitté la ferme, le bombardement s'amplifie de
minute en minute. De brutales détonations font vibrer les couches d'air. C’est
un roulement formidable et continu. La puissance infernale de la poudre secoue
la terre de Flandre qui frémit sous les coups.
– Presque rien, grogne Collard. – Prenons à gauche par les champs ; nous
n’aborderons ni Elverdingne, ni Brielen.
Regarde ces villages sautent en l’air.
– Oui, on les réduit à leur plus simple expression.
– Allons, par ici… Oh ! la ! Mais on répond, mon vieux.
Sans arrêt, le sol crache des éclairs : Ce sont nos canons qui
répondent. Depuis les 220 à la voix de basse profonde, jusqu’aux 75, aux
claquements secs comme des coups de fouet, tous nos canons hurlent la mort.
– Il y a du bon, Collard, on ne voit pas venir
nos soldats. Ils sont terrés et ils tiennent. Mais qu’est-ce qu’ils prennent
les malheureux ? Allons l’essentiel, pour nous, est d’arriver au Kemelbeek. Vois-tu cette dépression de terrain ? c’est
là.
– Nous entrons en enfer, il n’y manque que le diable !
– Oui, fonçons ; on en revient ou on n’en revient pas. C’est
suivant la destinée. Seulement, attention au gaz. Tu ne sens rien ?
– Non et toi ?
– Moi non plus ; nous mettrons nos masques pour entrer dans le
brouillard qu’on voit là-bas : on ne sait jamais. Le terrain est encore
assez potable. Pas gymnastique… y es-tu ? – Oui, allons-y. * *
*
L'état-major avait sous-estimé la valeur de ses soldats. Les fantassins
de la 4ème D. A. tiennent. Nous n'avons donc pas reçu l'ordre d'occuper
les postes sur le Kemelbeek. On se contente de nous faire
faire des patrouilles, a cheval, dans tous les sens et de nous faire monter de
faction aux carrefours des routes, pour
y régler la circulation.
Sur la droite, les Anglais ont reculé. Leurs régiments, accablés par le
nombre, se sont disloqués. Ils ont battu en retraite. En les suivant, les Allemands
ont contourné Ypres, ils menacent Poperinge et occupent maintenant le mont
Kemmel. L'armée belge est tournée.
La nuit, le spectacle est effrayant. Le mont Kemmel est comme embrasé. Décrivant
un quart de cercle de feu, l'artillerie allemande vomit la mort sur la
division. Nous vivons dans l'appréhension d'être bientôt tués ou prisonniers.
Un jour, une espérance folle fait soudain battre les cœurs. Nous
apprenons que les Anglais se sont ressaisis, contre-attaquent et reprennent du terrain
perdu ; d'autre part, des tenues bleu-horizon commencent à mettre leur note
claire parmi nous. Les Français arrivent.
Le gros de leur troupe s'amène bientôt. C'est un de ces légendaires
corps d'attaque. Tout de suite nos soldats fraternisent avec les chasseurs Alpins
solides et râblés. Ces héros de Verdun et d'autres lieux, serrent la main aux
nôtres et mi-blagueurs, mi-sérieux, leur disent de ne pas s'en faire ; leur
équipement et leur tenue sont usés par cent combats.
Voilà deux mois que la division a changé de secteur. Le peloton est maintenant,
cantonné à Palinchoce. De là, nous allons monter de
faction sur les ponts et passerelles du Canal de Loo Par une radieuse après-midi, alors que je
suis de faction sur le pont de Forthem. François
Croisier vient me trouver. Lors de la réorganisation des régiments en 1916, il
a passé du douzième de ligne au treizième ; il fait donc, depuis lors, partie de
la 4ème D. A. Nous nous sommes vus depuis très souvent.
– Bonjour, Maurice ; tu es de garde
? me demande-t-il en m'abordant sur le pont.
– Oui, jusque quatre heures ; après,
je serai libre jusque minuit. Bonjour François.
– Je voudrais faire une noce, me dit Croisier, sans autre préambule. 
Je le regarde. Ce désir, formulé par Croisier, me paraît étrange. Ordinairement,
il est très calme et, jamais, je ne lui ai entendu proposer de faire la noce.
– Oui, répond-il ; tu peux me regarder. Je voudrais faire la noce. Cela
t'étonne, hein ?
– Un peu, oui : tu as toujours été beaucoup plus sérieux que moi. Mais,
je suis ton homme, sais-tu. François. Quand je serai relevé de faction, je paie
un litre de ce que tu voudras.
– Oui, soupire Croisier, ce sera la dernière.
– Que racontes-tu ?
– Le sais-je moi ? Des bêtises peut-être. Mais, enfin, Maurice, tu sais
où j'ai passé pendant mes quatre années de guerre ? Liège, Anvers, Dixmude, Mercksem, Blocsinghe: j'ai été de
tous les mauvais coups et, tout cela, sans une blessure. C'est trop de chance,
vois-tu ! C’est fini, je
le sens. Tiens, je voudrais être fait prisonnier, la première fois que j'irai
aux tranchées : c'est le moins qu'il puisse m'arriver.
– Allons, mon vieux François, plus d'idées comme celle-là, hein !
Si tôt que j'aurai fini ma faction, nous irons faire la ribouldaine,
nous deux : nous irons nous flanquer une cuite, je ne te dis que ça ! Cela remet
le moral : après, tu verras que cela ira mieux.
– Faut l'espérer, répond Croisier, avec un sourire forcé.
Oh ! ce sourire ! Il me rappelle celui de Desy
partant pour sa dernière reconnaissance. Une peur atroce m'étreint le cœur. Malgré
moi, je crois au pressentiment de Croisier.
– Mon remplaçant viendra bientôt, dis-je, dans un effort. Où irons-nous
?
– Où tu voudras. Tu connais mieux les cafés que moi. La noce que nous avons faite avec
Croisier a été d’importance. Sans savoir trop comment, je me suis retrouvé, à
trois heures du matin, sur le pont de Forthem où un
de mes collègues montait de faction à ma place. Je me rappelle vaguement avoir
reconduit Croisier jusqu’à son cantonnement et lui avoir entendu dire que cela
allait mieux et qu’il viendrait me voir lors de sa descente des tranchées. *
* *
– Mon vieux, nous partons, me dit Collard. Dès
ma rentrée au cantonnement.
– Nous partons ? où ?
– A Calais. Il a paru aux ordres, aujourd'hui, que tous les gendarmes.
qui font partie d'une unité du front depuis le début de la guerre,
peuvent partir à Calais. On va nous remplacer par des gaillards qui sont là-bas
depuis toujours.
– On n'est pas forcé de partir ?
– Tu comprends que non. Mais, il n'y a pas à hésiter. C'est bien le tour
des embusqués de venir ici.
– Je reste.
– Tu... tu reste ?
– Oui mon vieux.
– Mais... mais tu es fou !
– Possible. Mais, puisque c'est mon idée.
C'est une idée d'imbécile cela, Maurice. Ainsi, tu veux rester, alors
qu'il y en a qui se pavanent à Marck et dans les villes de France depuis 1914 ?
Tu veux rester, alors que tout l’avancement et les avantages de solde ont été
donné â ceux de l'arrière ? Enfin, tu veux rester pour te faire casser la gueule
quoi ? Tu ne me l'expliqueras pas autrement ?
– Tu as fini ?
– Non, tu n'es qu’un idiot, un imbécile, un…
– Je ne trouve pas assez de gros mots pour le qualifier. Mais, enfin, pourquoi reste-tu ? – Je reste pour voir.
– Pour voir quoi ?
– Pour voir la fin de la guerre.
– On voit cela dans les journaux beaucoup mieux qu'ici.
– Possible, mais ce n'est pas la même chose.
– Que le diable t'emporte, grogne Collard ; j'étais
heureux comme un roi et voilà que tu me coupes ma joie. Ah ! oui ! tu me la
coupes !
– Mon vieux Collard, tu m'excuseras ; ce n'est
pas pour te faire de la peine que je reste. Va à Calais, tu as raison. Ne
t'occupe pas de moi. Quand nous nous reverrons, après la guerre, nous boirons
une sacrée bouteille ensemble. Bon voyage et au revoir, mon vieux Collard. On ne s'oubliera, pas va.
– Cré nom de Dieu ! de nom de Dieu ! de nom de
Dieu ! sacré Collard, que je laisse seul à l'écurie. Collard et pas
mal d'anciens de la division sont partis.
Pour comble de malchance, on m'a fait changer de peloton. Celui dont je
vais faire partie a, depuis trois ou quatre mois, mauvaise réputation. Le chef
die service est un bonhomme qui a fait plus de trois ans à l'arrière avant
de venir ici, et, pour
se rattraper, il se distingue à sa manière.
Le premier gendarme, avec qui je parle, dès mon arrivée dans ce peloton
de malheur est un ancien de la division. Lui non plus, n'a pas voulu partir. Il
m'explique que le chef de service fait de l'excès de zèle ; il a le grade de premier-chef.
Il exige qu'à leur rentrée de patrouille, ses gendarmes aient des rapports à rédiger
à charge de soldats ; et, quand ils n'en ont pas, il les fait retourner jusqu'à
ce qu'ils aient trouvé un soldat à faire punir.
Après avoir entendu les explications de mon collègue, c'est à contrecœur
que je vais me présenter au chef de service. Il me reçoit
dans un bureau qu'il a installé dans une chambre d'une ferme à St-Ricquiers où le peloton est cantonné.
– Vous venez du troisième peloton ? me demande-t-il.
– Oui, premier chef.
– Et bien, mon ami, il faudra essayer de faire votre service. Vous
n'êtes plus ici au troisième peloton.
– ……….
– Vous m'avez compris ?
– ……….
– Et bien ? Répondez ! J'ai dit que vous n'étiez plus ici au troisième
peloton !
– Le troisième peloton vaut le vôtre, premier-chef.
– Oui, oui... naturellement ; ce n'est pas cela que je veux dire. Mais, enfin,
ici, on fait du service :
il y a toujours du service à faire. Les soldats vont d'un cantonnement à
l'autre sans permission. Il faut que cela finisse et cela finira, c'est moi qui
vous le dis. Avez-vous, parfois, rédigé des rapports à charge des soldats qui voyageaient
sans permission ?
– Jamais, premier-chef.
– Ici, vous en rédigerez. Ecrivez-vous facilement ?
– ……….
– Mais, il me semble que vous avez la réponse difficile !
Maréchal-des-logis, mettez-vous en position convenablement. Vous avez une mauvaise
tête, je vois cela. Méfiez-vous ! Les mauvaises têtes, je les brise comme
verre. Avez-vous déjà été puni ?
– Oui, premier-chef.
– Plusieurs fois ?
– Oui, premier-chef.
– Pour quels motifs ?
– Pour m'être battu et pour avoir négligé de nettoyer ma bride. – Je m’en doutais. Vous
êtes ce qu’on appelle un mauvais serviteur. Ici, on vous dressera. Rompez… Ouf ! je suis dehors. Quel
animal ! Bon Dieu ! Quel animal ! « Il me dressera »
a-t-il dit. Peut-être, mon bonhomme, peut-être. Bien sur, je me défendrai.
Comment ? Je n’en sais rien.
Collard m’a écrit de Calais. On y est parfois
bombardé par des avions et des zeppelins, me dit sa lettre, mais on y couche dans
un lit, on y gagne deux francs par jour de plus qu’au front et le service n’y
est pas trop dur. Il a un peu la nostalgie du front, mais il espère que cela
passera.
Sacré Collard ! son absence me pèse
lourd. J’ai bien, ici, deux ou trois amis de sa trempe, mais je ne suis pas
attaché à eux comme je l’étais à Collard. Et puis, je
suis à couteau tiré avec le chef de service. J’ai déjà fait trois patrouilles
consécutives, sans trouver de soldat à faire punir, et j’attends l’itinéraire
de la quatrième, pour partir de nouveau. Seize heures de patrouille sans
répit ! Je crois que j’aurai le record.
– Un soldat te demande, me crie-t-on.
– Où est-il ?
– Dans la cour.
– J’y vais… Tiens ! c’est Potier, un ami de François Croisier.
– Comment vas-tu, Potier ?
Le soldat fond en larmes.
Un atroce pressentiment m’étreint le cœur.
– Qu'as-tu, Potier ? Il est arrivé malheur à François ?
– Oui, répond le soldat ; il est tué.
– Pas possible ! Il doit être descendu des tranchées depuis trois jours !
– Il a été tué, au cantonnement, par accident,
– Par accident ?
– Oui, il était sorti du baraquement pour venir te voir, et à peine avait-il
fait quelques mètres, qu'il s'aperçut qu'il avait oublié son tabac ; il
retourna pour aller le chercher. Comme il rentrait, un de ses camarades qui
nettoyait le fusil, d'un sergent, a tiré sur la détente de l'arme sans savoir
que celle-ci était chargée. La balle a frappé Croisier en pleine figure, il est
mort sur le coup. On craint pour la raison de l'autre.
Cela a été dit, par Potier, entre les sanglots qui lui montaient à la
gorge. Moi je ne pleure pas et pourtant... Je revois dans sa petite maison à Surister, près de Jalhay, le vieux père de Croisier.
J'allais parfois lui dire bonjour quand, avec François, nous étions soldats à Verviers
; à nous deux, nous taquinions le vieillard en parlant de ses amours de
jeunesse.
Croisier est mort. C'était un brave et vaillant petit soldat qui jamais
n'a flanché. Dans mes souvenirs, aucune figure de héros ne me
semble plus pure que la sienne...
– Vous êtes prêt ? demande le chef de service qui s'est approché de
nous.
– Prêt ? Pourquoi ?
– Pour partir en patrouille. Vous irez, sans repos, jusqu'à ce que vous
ayez un rapport à rédiger.
– Je n'irez pas, premier chef.
– Qu'est... qu'est-ce que vous dites ?
– Je dis que je n'irai pas, nom de Dieu !
Pour le moment, la vie du chef de service ne vaut pas plus, dans mon
jugement, que celle de n'importe quel animal malfaisant. Il s'en aperçoit, sans
doute, car blêmit et rentre dans son bureau. * *
* Nous n'avons plus gardé longtemps notre chef
de service. Un de mes collègues a trouvé moyen de lui seller son cheval de
telle façon que, ce jour-là, le bonhomme n'a pas fait cinq cents mètres sans
piquer une tête. On l'a ramassé sur la route avec les deux bras fracturés et,
naturellement, on l'a transporté à l'arrière d'où il n'aurait jamais dû venir. SEPTEMBRE
1918.
Depuis quelque temps, notre infanterie multiplie ses raids dans les
lignes adverses. Les avions et les ballons captifs tiennent l'air chaque fois
que le temps le permet. Les journaux annoncent continuellement de nouvelles
victoires.
Aux cantonnements, les soldats sont énervés, inquiets. Dans les cafés,
plus de chansons, plus de rires : les rares clients discutent nerveusement.
Des Français arrivent : ils sont moins gais que d'habitude. Les
plaisanteries ne trouvent plus d'échos. Graves et rêveurs, les hommes attendent
le coup de chien.
Le peloton est cantonné à Oofstade. On nous a
pris nos chevaux pour les mettre à l'artillerie : en échange, on nous a donné
de lourdes bicyclettes d'ordonnance.
Vingt-sept du mois. – Avec un premier maréchal-des-logis et
un collègue, appelé Crucifix, nous recevons l'ordre de nous trouver à minuit à
la borne 21 de l'Yser. Crucifix est un ancien de la division.
Il a le verbe haut et ne mâche pas ses mots. Ce qu'il pense, il le dit,
immédiatement, sans réfléchir. Avec cela, il est fort comme un bœuf et n'a peur
de rien, prétend-il. – Le premier n'est pas là ; nous devons l'attendre.
– Il nous rattrapera. Allons ! en route
! – Ne va pas trop vite, je sais à peine rouler.
Là... j'y suis. En douceur, hein ! Nous partons. Crucifix pousse comme un diable,
me semble-t-il. – Va doucement, bon Dieu ! je ne sais
pas suivre. – Qu'as-tu dans les pattes ? – Pas grand chose... Ecoute, que je te
dise. Crucifix attend. – Explique-toi, dit-il, quand il me voit
à sa hauteur. – Sais-tu
où nous allons ? – A la borne 21 de l'Yser. – Oui, c'est en première ligne ! – Crois-tu ? – J'en suis sûr : je connais l'endroit. – Par où qu'on y va, là-bas ? – Par Loo, Nieucapelle,
Oudecapelle, St. Jacques-Capelle, – En voilà des Capelle. – Oui, bien sûr. – Qu'allons-nous faire à la borne 21 ? – J'en sais rien. Voici le premier ; il
va, peut-être, nous le dire. Qu'en allons nous faire, premier, à la borne 21 ?
– Nous mettre à la disposition d'un
général. – Ah ! nous prenons de l'importance. – Paraît. – Comment faut-il parler avec ce coco-là
? demande Crucifix. Latin ? – Va au diable ! Mais, n'allons-nous pas
nous faire zigouiller, sur cette borne ? – La borne n'y est plus ; il y longtemps
que les obus allemands l'ont envoyée en l'air. – Comment veux-tu qu'on la trouve alors
? C'est toujours comme cela, bon Dieu ! On reçoit toujours des ordres
impossibles à exécuter. Vous tirerez votre plan, premier. Vous êtes le chef. – Oui, Crucifix, répond le premier ; seulement,
vous essayez de tenir votre langue. – Il n'y pas de danger ; s'il faut lui
parler latin. je ne sais que Dominus vobiscum ; j'ai appris cela quand j'étais enfant de
cœur. – Tu devais être un bel enfant de cœur. – Oui, je buvais le vin du curé.
Attention ! Tu vas nous flanquer en l'air. Tu es sur ta bicyclette comme une grenouille
sur une barre d'écurie. – Je m'en aperçois. Ça va barder je
crois ! – Oui paraît qu'on prend l'offensive
cette nuit. – Si on ne prend pas un éclat d’obus
dans la peau, cela ira encore bien. – Ah ça ! mon vieux, c'est au petit
bonheur. Tu as peur ? – Je n'ai jamais tremblé que de froid, clame
Crucifix. Claquer aujourd'hui ou mourir demain, il faut quand même démarrer un
jour. D’ailleurs, j'ai fait mon testament. – Tu as quelque chose à laisser ? – Sept francs cinquante qu'i1 me reste. – Ce sera pour qui ? – Pour nos Marraines de France et
d'Angleterre : sept francs cinquante et mon cœur. – Mets le mien avec. – Finissez, hein, avec vos bêtises ! dit
le premier, ce n'est pas le moment de rigoler. – Nous ne rigolons pas quand nous
laissons notre cœur à nos marraines : c'est toute notre fortune et elles le
méritent et puis faudrait pleurer, peut-être ? – Non, mais on peut quand même être
sérieux ! – Ce n'est pas mon genre ; je n'en peux
rien, premier maréchal-des-logis. En voilà-t-il un de titre. Nous sommes à Loo : par où faut-il
aller ? – Tout droit. «
L'air est pur la route est large »
fredonne Crucifix, puis, il reprend : – Premier ! s'il manque une ordonnance
au général, vous me présenterez ? – Oui, répond le premier ; il serait
servi. – Il serait, avec moi, comme un petit
coq en pâte. Je comprends maintenant, ce que nous allons faire à la borne 21 !
Le général va marcher en tête de 1a division, et, nous, gendarmes, nous serons
là pour écarter les balles et les obus qui pourraient nuire à sa gracieuse
personne. – Pour l'amour de Dieu, taisez-vous, Crucifix,
supplie le premier. – Impossible, premier : la langue me démange.
– Attention, hein, toi, continue
Crucifix, en s'adressant à moi, tiens ton guidon, nous entrons dans les piottes !
Les deux cotés de la route Sont couvert
de fantassins. Au repos, sur les accotements, les soldats parlent à voix basse ;
les officiers paraissent faire les dernières recommandations. Soudain, une
émotion me fait battre le cœur. J'appelle : – Collin ! Collin ! Collin ! – Présent, répond un soldat, qui se
dresse parmi les autres. – Ah, c'est toi, Maurice, où vas-tu ? – A la borne 21 de l'Yser. – Fais attention, sais-tu, Maurice,
c'est en première ligne cela. – Ne t'en fais pas pour moi. J'y vais pour
y rester un moment, tandis que toi, tu vas passer outre pour attaquer. Renard
n'est pas avec toi ? – Si Maurice. j'y suis, répond Renard à côté
de moi. On va entrer dedans, mon vieux ! – Oui ; paraît. Allons, bonne chance :
faites attention, défilez-vous... – On n'a pas peur ; donc c'est qu'on n'y
restera pas, répond Collin. Au revoir, Maurice ; bonne
chance ; rendez-vous pour bientôt à Comblain, hein ! – Au revoir, bonne chance, crie Renard, alors
que je donne mon premier coup de pédale. Je pousse comme
un sourd, pour rattraper les deux autres. Je suis à peine près d'eux que
Crucifix crie : Si tu traines comme cela en route, nous serons à Bruxelles
avant toi. Que t'ont-ils dit les
piottes ? –
Leur moral est bon. Je crois qu'on va voir quelque chose. – Oui, je te crois aussi. Ce sera le
moment d'ouvrir ses quinquets. Pied à terre ! nous roulons sur des barbelés, – C'est vrai ce que Crucifix dit ; des fils
traînent à terre : C'est une chance si nous n'avons pas crevé nos pneus. – Je suis crevé devant et derrière, nom
de Dieu, clame Crucifix. – Moi pas, mes pneus sont restés durs. – Les miens aussi, dit le premier. – Portez armes ! commande Crucifix
en chargeant sa bicyclette sur son épaule. Nous en faisons autant. Elles sont
diablement lourdes nos bicyclettes. Notre fourbi est, tant bien que mal,
attaché dessus avec clef, cordes. Cela fait un poids et le chemin devient mauvais.
Des trous d'obus, mal rebouchés, créent des bosses et des fosses ; les pavés
font place à de la boue.
Nous enfonçons. – Au trot, marche ! commande Crucifix – Taisez-vous ; imbécile, répond le premier. * *
* Minuit ! Des fusées allemandes montent
et retombent, éclairant le sol. Le long des lignes, plane un calme lourd, menaçant.
– C'est le calme précurseur de l' orage
me dit Crucifix. – Oui, il y a de l'électricité dans
l'air. Mes nerfs s'agitent. – Dis que c'est la frousse, plutôt. – Je ne dis pas non. Es-tu à ton aise,
toi. – Bon Dieu non ! A la borne 21 de l'Yser, dans un solide
abri en béton armé, le général a installé son poste de combat. – Par ici, commande le premier, après s'être
présenté au commandant-adjoint du général. L'abri est divisé en deux
parties. Nous entrons dans le côté gauche. * * * Deux heures du matin. Le
fond de l'abri est recouvert d'une nappe d'eau de vingt centimètres d'épaisseur.
Pour se préserver du liquide, les cyclistes et les ordonnances du général qui sont
avec nous, ont mis, des blocs en ciment l'un sur l'autre et, dessus, ont posé
des planches. A califourchon dessus, les pieds pendants nous attendons. Sans
dire un mot, les uns après les autres, nous consultons nos montres. * * * Deux heures ! Mettez vos masques
commande un fourrier d'infanterie. qui est dans l'abri avec nous. On n'a pas
fini d'exécuter l'ordre, qu'un roulement, pareil à des milliers ; de tonnerres,
ébranle le sol, fait trembler l'abri et
tressaillir les hommes. C'est notre artillerie. Des milliers de canons belges, anglais,
français tonnent ensemble. Leurs gueules d'acier crachent le feu. le fer et la
mort. Pendant quelques minutes, nous restons blottis dans l' abri : puis la
curiosité devient plus forte que la prudence. Un à un nous sortons de l'abri, montons
sur la digue et enlevons nos masques pour mieux voir. – Mes yeux clignent : mes oreilles bourdonnent
: des tressaillements agitent mes nerfs. Dans un effort, je domine mes sens et
je regarde : Le général était avant nous sur la digue.
Jumelles aux yeux, droit comme une épée, il découpe, dans l'espace, une
élégante silhouette. Comme embrasé par des
milliers d'éclairs. Le ciel paraît être une immense voûte de feu, repoussés en
arrière par les lueurs fugitives des coups de canon. En face, la côte de Clerken crache les gerbes de feu produites par l'
éclatement des obus, à droite, tel un vaste miroir, le lac Blancquart renvoi
les éclairs qui illuminent le ciel. A gauche, dans les ruines de Dixmude. les
moignons de murs émergent en rouge de la plaine, derrière nous, à cinquante
mètres, des artilleurs en bras de chemise, chargent la culasse des cent et
vingt longs, se retirent en arrière pour le départ des coups, reviennent et
recommencent. Plus loin, c'est le jet continuel des langues de feu que vomissent
nos canons. A terre. devant nous, on ne distingue rien ; un voile obscur recouvre
les horreurs du champ de bataille. Soudain, je pense aux soldats du village surtout
aux fantassins. Pour le moment, ils entrent sans doute, dans la fournaise ;
pied à pied, ils vont reconquérir le sol et déblayer la route qui doit nous reconduire
à Comblain. Les reverrai-je ? Assez déjà, ont jalonné
de leurs * * * Neuf heures. Amené par un soldat, le
premier prisonnier arrive. – Vous Je conduirez au poste de combat
de la division d'armée, me dit le commandant. Debout, près de l'abri, le prisonnier est
pâle, Une écharpe qui soutient son bras droit, est maculée de sang. Au bras
gauche, il porte un brassard de la Croix-Rouge. Je lui retire la baïonnette
qu'il porte encore au côté. Un, murmure de colère monté du groupe de
soldats qui le regarde. Drôle de brancardier qui est porteur d'une baïonnette !
La pâleur de l'Allemand s'accentue. Les nôtres grondent. Je comprends qu'il est temps d'en finir.
Vivement, je fais marcher le prisonnier devant moi et nous disparaissons
derrière la batterie de cent et vingt longs. Le prisonnier parle français. – J'ai mal dit-il. – Qu'as-tu comme blessure ? – Un éclat d'obus dans le bras. – Je vais te conduire au poste de
secours, à 500 mètres d'ici. Tu es brancardier ? – Non, je suis fantassin. – Alors, ce brassard ? – Je l'avais en poche. Quand vous avez
commencé votre bombardement, j'ai senti que je n'en sortirais pas ; alors, j'ai
mis l’insigne. – Tu as eu tort ; cela a failli te
coûter cher, tout à l'heure. Dans la vie, vois-tu, il vaut mieux être franc. L'Allemand baisse la tête, puis, soudain,
la relève. – Tu ne m'en veux pas ? dit-il. – Pourquoi t'en voudrais-je ? Tu as fait
ton devoir de l'autre côté ; moi je l’ai fait de celui-ci... et après ? – Tu es un homme, dit-il, en
me tendant la malin valide. * * * *** Vingt
heures ! Le long de la digue, c'est un va et vient de troupes. Des fantassins
partent vers l'avant ; des blessés en arrivent. Près de moi, le premier et Crucifix sont
aux prises : – A la première bêtise que vous faites
encore, je vous fais fourrer dedans, dit le premier. –
Catastrophe alors, répond l'autre. – Qu' as-tu fait. Crucifix ? – J’ai demandé les jumelles au général
pour admirer le paysage. – Il te les a données ? – Bien sûr. Pourquoi pas : – Il n'y a rien de mal fait alors ? – Non ; seulement, en rendant les
jumelles eu général, je lui ai dit qu'il était un chic type et il m'a regardé
d'une drôle de façon. – Al1ons, est-ce à faire, d'aller dire des
choses pareilles à un général ? demande le premier. – Mais, enfin, puisque je le pensais, répond
Crucifix, je n'allais quand même pas lui dire le contraire ! – Il n’aurait plus manqué que celle-là,
grogne le premier. Je l'avais bien pensé que j'aurais des ennuis à cause de
vous. – Si vous vous ennuyez ici, nargue
Crucifix, vous pouvez retourner au peloton, je vous le permets. – Taisez-vous. – On se tait, premier maréchal-des-logis
: on se tait. Sais-tu qui c'est le général ? demande Crucifix, en s'adressant à
moi... – Non. – C'est le général Borremans
: il commande une D.I. autrement dit, une division d'infanterie. – C'est lui qui t'a donné ces détails ? – Non, c'est le fourrier. NOVEMBRE L'offensive
s'est développée. Nous approchons de Gand. Au hasard des ordres reçus, je suis passé,
de la suite du général, au peloton ; de là, à la prévôté de la division
d'armée, comme estafette, pour être, ensuite, envoyé à une division d'infanterie.
J'ai conduit des groupes de prisonniers
de l'avant à l'arrière, troupeaux éperdus qui auraient voulu courir pour sortir
de la zone de feu. Je n'ai pas tous les jours mangé à ma
faim. En portant des plis, en montant de faction aux carrefours des routes, j'ai
passé des heures d'angoisse sous des rafales d'obus. J'ai entendu des blessés pleurer
et geindre comme de petits enfants et j'ai vu les yeux ternis dans les faces
grimaçantes des morts. Et puis, j'ai bu, à pleines gorgées, des gourdes d'alcool
d'un goût affreux. Je rencontre Collin. – J'ai des nouvelles, me dit-il ; elles ne
sont pas bonnes. Les soldats de Comblain ont trinqué.
Henri Gillard est tué d'une balle en plein, front ; Jules
Winand a la poitrine traversée : Lefrançois, Renard
et Jadin sont blessés. Le lieutenant Piroton aussi, et ton camarade Dubuisson, qui était à La Panne
avec toi, est mort de la grippe espagnole. Nous y resterons tous nom de Dieu ! Collin a
raison. Du train où l'on y va, encore deux ou trois mois de combat, et la
Belgique ne reverra guère de ses soldats
du front. – Au revoir, me dit Collin,
essaie de ne pas te faire trouer la panse. – Où vas-tu ? – Je rejoins le bataillon ; j'ai été porter un pli au
colonel. Nous devons encore attaquer cette nuit. – Fais attention à ta vilaine peau. – Vaut plus la peine. Et Collin s'en
va en traînant sa silhouette terreuse le long du chemin. – On y crèvera, on y
crèvera, dit-il en s'en allant. * *
* Dix du mois ! Depuis la veille, une
rumeur court parmi les troupes. Les grands états majors sont, dit-on, sur le
point de signer l'armistice. La 4 D A descend de l'avant à l'arrière.
La troisième division d'armée monte pour la remplacer. En Face du château d'Ansbeck,
je regarde passer des éléments du douzième de ligne. Parmi eux, j'aperçois
Scion. – Où vas-tu, Scion ? – Tu vis encore, toi ! Nous allons à la
mort, mon vieux. – Où ça ? – Nous allons attaquer sur un canal qui
a, paraît-il, plus de trente mètres de largeur. Ramasser une balle dans la gueule,
passe encore. On pousse un « Ah ! » et c'est fini ! Mais barboter dans la
flotte plusieurs minutes avant de claquer, cela me dégoutte ! –
Tu n'attaqueras pas, on va signer l'armistice, – Que n'est-ce vrai ! Ecoute, dit Scion,
d'une voix soudain plus douce, depuis le début de l'offensive, nous avons
attaqué je ne sais combien de fois. J'y allais, pour de bon, avec l'idée que j'allais
revoir les vieux. Mais, aujourd'hui, cela ne va plus ; j'ai peur de rester dans
le canal. – Porte-toi malade, tu as bien fait ta
part. – Penses-tu ! Tu déménages sans doute !
Il faut avoir la tête en bas des épaules, mon vieux, pour être considéré comme
malade par les temps qui courent. Allons, au revoir Maurice, si je ne retourne pas, tu.
iras dire bonjour au père et à la mère, de ma part. – Oui ; au revoir ; et soit tranquille, tu
n'attaqueras pas sur le canal ! Scion s'en va d'un pas plus
léger : il me croît, bien sûr. En somme, je lui ai peut-être dit la vérité. * * * Onze du mois. Cela y est ! L'armistice
est signé. Avec une rapidité électrique, la nouvelle vole de l'arrière à lavant,
des routes aux cantonnements. – On se regarde. – C'est fini ! c'est fini ! crie un soldat,
qui danse à côté de moi. – Alors, tu es content ? – Si je suis content ! répond-il en
faisant une pirouette. Mais, voilà des copains. Et
le soldat file vers un groupe de fantassins qui bras dessus, bras dessous,
sans, fusil, sans baïonnette, en chantant, marche gaîment vers une ère
nouvelle. L’HEURE SONNE Dix-huit ans ont passé. L'heure sonne. Les
idées se croisent, s'affrontent, se choquent et provoquent des étincelles.
Recroquevillés dans un nationalisme forcené, des dictateurs arment à une
vitesse de jour en jour accélérée ; mais, car il y a un mais, ces engins de
guerre qu'ils fabriquent avec une telle rapidité, ne devront-ils pas les mettre
dans les mains du peuple ? Qu'en fera-t-il ? Question troublante que ne peuvent
manquer de se poser, avec angoisse, ces amateurs de guerre. D'autre part, qu'ils
l'appellent Dieu. Allah ou Civa, des millions d'êtres humains prient le Tout-Puissant
de faire paix, sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Que ce soit, par la faute des hommes,
dans la plus horrible des catastrophes, ou que ce soit dans la paix et la
liberté par la volonté de Dieu, l'ordre nouveau, rêvé par Briand, est en
marche. Aujourd'hui le peuple le veut confusément encore ; demain il le
réclamera à grands cris. VOX POPULI. VOX DEI. Comme toujours, les gendarmes SERONT DERRIERE, ils feront
respecter la loi quelle qu'elle soit. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©